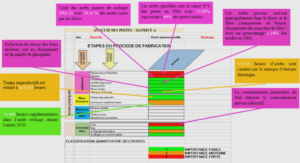Les écosystèmes marins et côtiers occupent le tiers des littoraux tropicaux du monde, avec 15% pour les récifs coralliens et 18% pour leurs écosystèmes associés, qui sont constitués d’herbier de phanérogames et de mangrove. Si les formations coralliennes couvrent 600.000 km2 (UNESCO, 2008) et 15,6 millions d’ha pour les mangroves (FAO, 2005) au niveau mondial, à Madagascar, leur superficie est de 1.000 à 1.500 km de longueur et 0,5 à 3,5 km de largeur pour les récifs (Ministère de l’Environnement, 2001) et entre 303.814 ha (FTM et ESSA-EF, 2004 cité par FAO, 2005) et 453.000 ha (Mayaux et al, 2000, cité par FAO 2005) pour les mangroves.
Ces écosystèmes assurent des rôles importants aussi bien au niveau biologique qu’au niveau socio-économique. Effectivement, les récifs avec les forêts tropicales, sont les écosystèmes les plus riches en biodiversité ainsi que les plus complexes et les plus productifs de la planète. Par ailleurs, ils protègent les côtes contre les déferlements des vagues et constituent une réserve de nourriture pour les populations côtières. La mangrove offre une zone de fraie, de nurserie et de refuge pour plus de 85% des espèces marines et joue effectivement un rôle primordial dans la pêcherie (Robertson et Duke, 1987 ; Primavera, 1998). Entre autre, elle fournit des bois de construction et d’énergie, des alimentations, des remèdes pour les communautés du littoral. Ensemble, il est démontré que ces écosystèmes possèdent une énorme capacité de séquestration de carbone atmosphérique.
Les récifs coralliens et les mangroves sont des écosystèmes marins et côtiers interdépendants entre eux. D’ailleurs, les mangroves sont considérées comme un écosystème associé aux récifs. Les récifs protègent les mangroves contre les déferlements des vagues, donc un mode calme pour les mangroves, tandis que celles-ci empêchent la sédimentation et la pollution terrigènes d’arriver sur les récifs coralliens. Malheureusement, ces écosystèmes subissent une dégradation continue et alarmante dans de nombreuses régions du monde. D’une part, plus de 10% des récifs ont été déjà détruits par les activités humaines et 25% sont menacés de disparition d’ici 30 ans, si aucune action n’est entreprise (Conand et al, 1996 ; Salm et al, 2000 ; ICRI, 2007 ; UNESCO, 2008) ; et d’autre part, la mangrove est l’écosystème le plus menacé et subit quasiment partout dans le monde des dégradations anthropiques de toutes sortes et de diverses amplitudes (Ellison et Farnsworth, 1996 ; Valiela et al, 2001 ; FAO, 2005). Les principales menaces sur ces écosystèmes sont d’origine anthropique et liées étroitement à la croissance démographique et au changement climatique (Gardes et Salvat, 2008 ; UNESCO, 2008).
MILIEU PHYSIQUE
Localisation géographique
Le Fokontany de Sarodrano se trouve sur la côte Sud-ouest de Madagascar, environ à 30 km au Sud de la ville de Toliara, dans la commune rurale de Saint Augustin, district de Toliara II et région du Sud-Ouest . Ses coordonnées géographiques se situent dans la latitude 23° 30′ S et la longitude 43° 44′ E. C’est un village de pêcheurs implanté dans une anse.
Géomorphologie et pédologie
Le village de Sarodrano est caractérisé par des dunes de sable. Ces dernières se sont formées d’une part par l’accumulation de sables apportés par le vent et d’autre part par les apports des vagues. En effet, les sols sont de type sableux pour le milieu terrestre, sabloargileux pour le littoral, et du sable fin au niveau des plages.
Végétation
Sur la partie terrestre, on y trouve une végétation caractéristique d’un climat sub-aride. Cette formation s’installe sur des zones dont les conditions écologiques sont sévères. Par conséquent diverses formes d’adaptation biologique telles la spinescence et la microphyllie sont apparues chez certaines espèces. La végétation est composée de séries de Didiéracées et de bush Euphorbiacées telles que : Euphorbia stenoclada (famata fotsy), Didierea madagascariensis (fantsiolitra), Euphorbia leucodendron (laro). On trouve aussi des arbres et arbustes comme Ziziphus vulgaris (tsinefo), Celastrus linearis (tsingilofilo), Flacourtia indica (lamonty) (Heriniaina, 2008). Sur une partie du cordon littoral, il y a une mangrove assez étendue sur des vasières qui couvre une surface de 80 hectares et présente 5 espèces de palétuviers : Avicennia marina, Sonneratia alba, Bruguiera gymnorhiza, Ceriops tagal, Rhizophora mucronata. Cette mangrove héberge une faune importante de poissons, de crustacées (en particulier crevettes et crabes), de coquillages, d’oiseaux rares ainsi que des algues.
Hydrologie et hydrodynamisme
a. Salinité
La salinité de la plage de Sarodrano varie de 26,2 à 35‰. Cette variation de salinité dans ce milieu est due au courant de marée descendante qui étale l’eau douce amenée par le fleuve Onilahy et provoque une dessalure importante bien qu’elle soit légèrement compensée par l’évaporation (Heriniaina, 2008).
b. Température
On constate une élévation de la température de l’eau de mer qui reste plus ou moins constante à chaque marée. La température moyenne des eaux se situe entre 28 et 30°C (Heriniaina, 2008).
c. Mode, marée et courants
La plage de Sarodrano reçoit la grande houle océanique venant du sud-ouest qui est freinée par le récif de Soalara et les autres formations coralliennes entourant le village et s’étale dans la baie de Saint-Augustin. Les mouvements de la mer sont généralement moindres dans cette zone. L’amplitude de vague varie de 1 à 3 mètres selon l’état de la mer. En hiver, la mer est souvent agitée à cause du vent du sud (tiokatimo), ce qui limite les sorties des pêcheurs. En été, la mer est calme la plupart du temps (Vasseur et al, 1988).
La marée est à cycle semi-diurne avec un marnage égal à 3 mètres et les courants marins dominant se portent vers le sud (Vasseur et al, 1988). La marée descendante longe la côte pour contourner la falaise de Barnhill et elle entraîne les matières latéritiques en suspension apportée par le fleuve Onilahy, particulièrement en période de crue, et se déplace vers l’extrémité Nord. En effet, le courant qui affecte la plage de Sarodrano est essentiellement de marée.
Climat
Comme toute la région du Sud-ouest de Madagascar, Sarodrano est caractérisé par un climat semi-aride où s’alternent deux saisons :
– un été chaud d’octobre à avril et humide entre décembre et février,
– un hiver frais de mai à septembre.
La variation des températures tout au long de l’année reste faible (amplitude annuelle comprise entre 7° et 10°C). Les moyennes annuelles sont toujours comprises entre 25°C et 23°C. Les températures assez basses sont enregistré es à la saison fraîche, la moyenne des minima du mois le plus froid (juillet) pouvant descendre en deçà de 10°C.
La pluviosité est faible et irrégulière qui varie de 300 à 600 mm/an, avec une forte insolation. Les précipitations insuffisantes, les moyennes thermiques assez élevées et le vent dominant, le tiokatimo qui souffle sur la frange côtière, caractérise cette région au climat semiaride (SAGE, 2006). Les cyclones tropicaux venant de l’Océan Indien passent très rarement dans cette région. Les cas de passage des cyclones tropicaux sont des exceptions comme Gafilo, Elita et Ernest. C’est la raison pour laquelle elle est victime de la sècheresse pouvant durer pendant un trimestre, voire plus de la moitié de l’année.
MILIEU SOCIAL
Population humaine
Le village de Sarodrano compte 1.624 habitants répartis dans 290 ménages dont la taille varie de 4 à 7 personnes. Environ 60% de la population est active dont la majorité exerce le métier de pêcheurs, comme tous les villages du littoral du Sud-ouest de Madagascar . Cette population est composée majoritairement par des Vezo pêcheurs. Historiquement, les Vezo sont originaires de trois berceaux : Anakao, Saint Augustin et Sarodrano. A la fin des années 1800 début 1900, les Vezo, par groupe de famille, ont migré vers le nord à la recherche des nouvelles zones de pêche plus propices et occupant le littoral. Au début, ils ont installé des campements qui, par la suite, ont évolué en villages.
Santé publique
Le village de Sarodrano n’a pas d’infrastructure sanitaire (centre de soin, dépôt de médicament) et la population doit joindre le CSB II de Saint Augustin en cas de maladies graves ou d’accouchement. Les communautés ont recours à la pratique traditionnelle comme l’utilisation des feuilles d’afiafy (Avicennia marina) pour soigner l’ulcère d’estomac et le paludisme. Les maladies majeures que subissent ces populations sont l’infection respiratoire aigue et le paludisme. Ces maladies fréquentes se déclarent par un brusque changement climatique. L’Intoxication par Consommation des Animaux Marins n’est pas enregistrée dans le village.
|
Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : MILIEU D’ETUDE
1.1. MILIEU PHYSIQUE
1.1.1. Localisation géographique
1.1.2. Géomorphologie et pédologie
1.1.3. Végétation
1.1.4. Hydrologie et hydrodynamisme
1.1.5. Climat
1.2. MILIEU SOCIAL
1.2.1. Population humaine
1.2.2. Education
1.2.3. Santé publique
1.3. SITUATION ECONOMIQUE
1.3.1. Activités économiques
1.3.2. Revenus de ménage
DEUXIEME PARTIE : METHODOLOGIE
2.1. RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE
2.2. DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE
2.2.1. Station d’étude
2.2.2. Etude du récif corallien
2.2.3. Etude de la mangrove
2.3. ENQUETE ET OBSERVATION
2.4. TRAITEMENT DE DONNEES
2.4.1. Traitement des données biologiques
2.4.2. Traitement des données cartographiques
TROISIEME PARTIE : RESULTATS ET INTERPRETATIONS
3.1. ZONES RECIFALES
3.1.1. Diversité biologique
3.1.2. Taux de recouvrement linéaire
3.1.3. Taux de recouvrement du benthos
3.1.4. Poissons
3.2. MANGROVE
3.2.1. Diversité floristique
3.2.2. Occupation du sol
3.2.3. Zonation
3.2.4. Fréquence
3.2.5. Dominance relative
3.2.6. Densité spécifique
3.2.7. Biomasse
3.3. PRESSIONS ET MENACES
3.3.1. Zones récifales
3.3.2. Mangrove
QUATRIEME PARTIE : DISCUSSIONS
4.1. DISCUSSION METHODOLOGIQUE
4.2. DISCUSSION DES RESULTATS
4.3. PROPOSITION DE STRATEGIES DE CONSERVATION
4.3.1. Création de réserves
4.3.2. Appui aux communautés de pêcheurs
4.4. PROPOSITION DE PLAN DE GESTION
CONCLUSION ET PERSPECTIVES
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ANNEXES