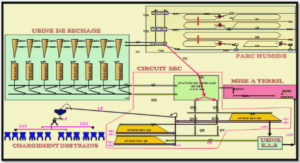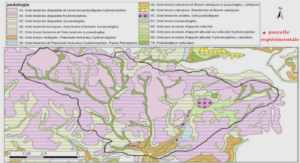LE CONCEPT DE « NICHE ECOLOGIQUE » ET LES STRATEGIES DE DISPERSION
Hutchinson a défini ce qu’était la « niche fondamentale » d’une espèce (ou « niche grinnellienne ») comme étant « un hypervolume à n-dimensions » dans lequel chaque point correspond à un état de l’environnement qui permettrait à l’espèce de vivre indéfiniment (Hutchinson, 1957 in Pulliam, 2000). En clair, la niche fondamentale représente un espace où toutes les conditions environnementales conviennent à l’espèce considérée et où donc, le taux de croissance de la population de l’espèce est supérieur ou égal à 1 (Guisan & Thuiller, 2005).
Cependant, une espèce n’occupe que rarement toute sa niche fondamentale puisqu’elle peut se faire exclure par la compétition, la prédation, ou les perturbations (anthropiques, géomorphologiques etc.). La « niche réelle » de Hutchinson correspond donc aux espaces de la niche fondamentale où l’espèce est compétitivement dominante (Pulliam, 2000 ; Guisan & Thuiller, 2005). Puisque certaines espèces sont présentes en grand nombre dans des espaces dans lesquels les conditions de vie leur sont défavorables (les « zones puits », i.e. des secteurs où la mortalité est supérieure à la reproduction) grâce à une immigration régulière d’individus (depuis les « zones sources »), on peut considérer que bien souvent, la niche réelle est plus grande que la niche fondamentale (Pulliam, 2000). Cependant, la situation inverse existe où une espèce est fréquemment absente d’un habitat favorable à cause d’extinctions récurrentes et d’une capacité de dispersion limitée qui empêche sa colonisation (Guisan & Thuiller, 2005)
SUCCESSIONS VEGETALES ET INTERACTIONS SPECIFIQUES
Lorsqu’un nouvel espace devient disponible pour la végétation (retrait glaciaire, déforestation, incendie, déprise agricole etc.), il survient une série de séquences de colonisations appelées « successions végétales » (Connell & Slatyer, 1977). Ces successions peuvent être « primaires » (lorsque le sol est vierge de toute présence végétale) ou « secondaires » (lorsqu’un terrain déjà végétalisé devient disponible pour la colonisation).
En théorie, ces successions conduisent l’écosystème à un stade d’équilibre optimal que l’on appelle « climax » (Lacoste & Salanon, 1999 ; Pinson ; 2013).
Par exemple, le retrait des glaciers en réponse à l’élévation des températures a permis de libérer de nouveaux espaces colonisables où peuvent s’établir des dynamiques de successions primaires (Carlson, 2013). Toutefois, dans les Alpes, le changement climatique et le changement d’utilisation des terres induisent plutôt des dynamiques de successions secondaires (FIGURE 5).
En théorie, il n’y a que trois réponses possibles pour les plantes de montagne face aux changements environnementaux : (i) persistance dans le nouvel environnement modifié, (ii) migration vers des habitats plus favorables, (iii) extinction. De même, trois types de persistance sont possibles : l’adaptation génétique graduelle de la population, la plasticité phénotypique (i.e. les variations individuelles des propriétés produites par un caractère génétique donné en conjonction avec l’environnement), ou l’atténuation écologique (ecological buffering – i.e. si le caractère de succession végétale le plus déterminant n’est pas le climat mais le sol par exemple, ce qui peut atténuer les effets du changement environnemental) (Theurillat & Guisan, 2001). Ces processus de succession sont souvent interrompus par des perturbations naturelles ou anthropiques, conduisant à l’hétérogénéité spatiale et structurelle des milieux (Connell & Slatyer, 1977 ; Holtmeier & Broll, 2005). Cette hétérogénéité modifie à son tour les conditions stationnelles et donc, les dynamiques de colonisation et de migration des espèces qui s’y déroulent (Pinson, 2013).
En général, en cas de migration, les espèces « opportunistes » sont les premières à s’implanter. Ce sont des espèces à croissance rapide et à fort potentiel de dispersion que l’on appelle aussi « espèces pionnières » (e.g. le mélèze, Larix decidua). Ce sont généralement des espèces héliophiles qui ne tolèrent pas l’ombre que leur apportent les individus de plus haute stature (Connell & Slatyer, 1977 ; Albert et al., 2008).
Paradoxalement, il apparaît que le mélèze entretient une relation inverse entre la lumière disponible et son taux de germination. En effet, les graines de mélèze germent bien mieux si elles sont à l’ombre que si elles sont au soleil. Cependant, les plantules ont très vite besoin de lumière pour se développer et supplanter le reste de la végétation (Albert et al., 2008).
C’est le phénomène dit de la « facilitation », où la croissance d’une espèce est favorisée par la présence d’une autre (Connell & Slatyer, 1977). Pour le cas du mélèze dans les Alpes (succession secondaire), ce sont surtout les espèces herbacées ou buissonnantes qui facilitent son développement.
Dans le même temps, on retrouve souvent des espèces qui s’accommodent des faibles ressources que leur laissent les espèces pionnières dominantes et qui donc parviennent à cohabiter avec ces dernières (Connell & Slatyer, 1977).
Dans la plupart des cas cependant, l’interaction spécifique dominante dans les écosystèmes n’est pas la « cohabitation » mais la « compétition ». Le modèle de l’ « inhibition » suggère que toutes les espèces tolèrent l’invasion de compétiteurs et que la lutte pour les ressources se base sur la dominance. Les espèces pionnières empêchent les espèces suivantes de s’installer en s’accaparant les ressources jusqu’à ce qu’elles finissent par disparaître ou qu’une perturbation laisse de la place pour les espèces suivantes, et ainsi de suite jusqu’à l’arrivée d’espèces qui cohabitent et qui éventuellement facilitent l’immigration d’autres espèces (Connell & Slatyer, 1977).
Les sites abandonnés par l’Homme voient donc souvent disparaître des espèces nonadaptées à la compétition face aux espèces héliophiles qui d’ailleurs se reproduisent généralement de manière végétative et donc, plus rapidement (Tasser & Tappeiner, 2002 ; Haugo et al., 2011). En outre, avec le changement climatique, la quantité de litière va certainement augmenter dans les étages subalpins et alpins (voir plus bas). Or, lorsque les sols s’enrichissent, les plantes appréciant les sols pauvres périclitent : soit parce qu’elles ne peuvent pas supporter le surplus de nutriments, soit parce qu’elles ne peuvent tolérer la compétition des nouvelles espèces qui se développent de pair avec l’eutrophisation du sol (Tasser & Tappeiner, 2002).
LES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX
Si la réponse des plantes et de la treeline face aux perturbations climatiques ou anthropiques est si difficile à prévoir, c’est parce que de nombreux facteurs stationnels influencent les dynamiques naturelles d’adaptation ou de migration. Ces facteurs, dont l’influence varie selon l’échelle considérée, peuvent donc fortement modifier l’effet du climat sur la végétation (FIGURE 6).
LE SOL
Le sol influe énormément sur la capacité des arbres à se développer. Certains auteurs pensent même que la position de la treeline serait en partie déterminée par l’accessibilité aux nutriments du sol, notamment de l’azote. D’ailleurs, il apparaît que les arbres se développent plus aisément sur des terrains qui ont été amandés (Case & Duncan, 2014). En outre, la décomposition et la minéralisation de la matière organique au sol étant grandement dépendante de la température, de l’humidité et de la microtopographie, une élévation des températures pourrait entraîner une augmentation de la quantité de litière disponible aux hautes altitudes/latitudes, favorisant ainsi une expansion de la forêt (Grace et al., 2002 ; Holtmeier & Broll, 2005).
En outre, les arbres eux-mêmes modifient certaines caractéristiques du sol. Ils créent de l’ombre, ils tempèrent les températures du sol, ils ont un impact sur l’accumulation de neige et les précipitations qui touchent le sol, ils effectuent une compétition pour les ressources et ils influencent l’accumulation de matière organique et le cycle des nutriments (Haugo et al., 2011). Par conséquent, cela influe sur le développement des autres végétaux mais également sur d’autres facteurs limitant, comme l’humidité.
LES FACTEURS CLIMATIQUES
En montagne, le vent peut agir indirectement sur le développement des végétaux.
Les brises de pentes par exemple permettent une singularisation du microclimat et jouent un rôle important de brassage et de dissipation des polluants atmosphériques dans les vallées urbanisées et industrialisées. Or, il se trouve qu’il est possible de trouver dans les Alpes de fortes concentrations d’ozone (O3, gaz corrosif responsable de dégâts importants sur les arbres), ou encore d’observer des « pluies acides » (issues d’une dissolution du dioxyde de souffre dans l’eau atmosphérique conduisant à la formation d’acide sulfurique : H2SO4) libérant des métaux lourds dans l’environnement comme le cuivre, l’aluminium ou le mercure (Beniston, 2006).
A contrario, les vents violents peuvent induire une dessiccation de l’appareil foliaire par transpiration (e.g. par un effet d’abrasion), notamment en hiver si l’humidité n’est pas suffisante. Les vents violents et les fortes températures peuvent également amincir le couvert neigeux et ainsi réduire les réserves d’eau du sol au printemps et diminuer la protection contre l’insolation qu’offre la neige aux plantules (Camarero & Gutiérrez , 2004 ; Holtmeier & Broll, 2005 ; Van Bogaert et al., 2011).
Par ailleurs, le développement d’îlots boisés peut augmenter la quantité de neige accumulée, notamment pour les espaces « sous le vent », conduisant ainsi à une diminution de la période végétative, à une augmentation de la pression sur les plantules (pouvant mener à des blessures, des déformations etc.), et à une augmentation du risque d’infections fongiques hivernales (Holtmeier & Broll, 2005).
Une faible humidité atmosphérique et édaphique peut donc limiter la germination et le développement des jeunes arbres (Vittoz et al., 2008). Mais les précipitations présentent d’autres intérêts indirects qu’un simple apport en eau. Körner (1995) a en effet suggéré que les phases de sécheresse diminueraient l’activité biologique des sols et donc la disponibilité en nutriments (in Vittoz et al., 2008).
L’effet de la variabilité climatique sur la treeline, bien que peu étudiée, semble également être un facteur important pouvant limiter l’expansion de la forêt. En effet, de longues périodes d’élévation de la treeline ont semble-t’il été interrompues lorsque l’instabilité du climat s’est accentuée et que des vagues de températures extrêmes sont survenues (Camarero & Gutiérrez, 2004 ; Harsch et al., 2009). On sait par exemple qu’il existe une relation entre le gel et la survie des graines et des plantules au printemps et en automne.
Un réchauffement durant ces périodes favorisent ainsi la colonisation et la densification forestière (Camarero & Gutiérrez, 2004).
La variabilité interannuelle des précipitations quant à elle, déjà extrêmement importante dans les Alpes, risque d’augmenter grandement dans le futur avec les conséquences que cela aurait pour la végétation (Beniston et al., 1997 ; Rebetez & Dobbertin, 2004). Ainsi, certains auteurs pensent qu’une élévation des températures n’est pas susceptible de provoquer une élévation de la treeline si elle s’accompagne d’une augmentation de la variabilité climatique (Camarero & Gutiérrez, 2004). Or, dans les Alpes, il devrait y avoir à l’avenir de plus en plus d’hivers très rigoureux ou anormalement doux (Beniston et al., 1997), ainsi que des vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses et plus longues (Meehl & Tebaldi, 2004)
LA TOPOGRAPHIE
De nombreux paramètres topographiques influencent la présence des végétaux. Par exemple, les trous et autres cuvettes vont avoir tendance à maintenir l’enneigement, influant ainsi sur la durée de la période végétative, l’humidité du sol, les ressources en eaux ou en nutriments (Lassueur et al., 2006). Les effets de versant importent également. En fonction de l’exposition des versants, à altitude égale, la quantité d’énergie solaire reçue au sol n’est pas identique. Cela induit des différences de températures entre les différents versants et donc des positions variables de la treeline (Case & Duncan, 2014). Un autre facteur clé à prendre en compte est la perte de surface avec l’altitude qui induit une baisse de la richesse spécifique. En effet, en montant en altitude, la quantité de terres disponibles diminue et sa fragmentation augmente (Körner, 2007a). Avec l’élévation des étages de végétation inférieurs, certaines espèces des étages supérieurs vont donc être condamnées à disparaître à mesure que leur propre habitat se réduira (Carlson et al., 2013).
L’effet de masse joue lui aussi un rôle dans le positionnement de la treeline. Les grosses montagnes ont tendances à modifier l’environnement thermique en agissant comme des remparts contre les vents dominants. Par ailleurs, les massifs important présentent une amplitude thermique annuelle plus élevée, de même que les milieux à forte continentalité.
On trouve donc généralement des treelines plus élevées dans les massifs à fort effet de masse ou à forte continentalité (Leonelli et al., 2011 ; Case & Duncan, 2014). S’il peut arriver que la microtopographie favorise l’apparition de « refuges » pour certaines espèces face au changement climatique (Carlson et al., 2013), de manière générale, la topographie risque plutôt d’agir comme un obstacle à l’immigration des espèces que comme une protection (Randin et al., 2013).
Les facteurs géomorphologiques jouent également un rôle important dans la dynamique des communautés végétales de montagne. Les phénomènes glaciaires et périglaciaires par exemple (pergélisols, gélifluxion, cryoturbation etc.) ont une influence sur la distribution des espèces végétales, sur l’humidité du sol, de l’air ou encore sur la température (Holtmeier & Broll, 2005 ; Virtanen et al., 2010). De plus, les perturbations géomorphologiques favorisent généralement l’hétérogénéité du paysage ainsi que l’immigration en maintenant les milieux ouverts ou en générant de nouvelles surfaces à conquérir (Virtanen et al., 2010).
Cependant, en milieu de haute-montagne, il est très important de prendre en compte l’effet de l’élévation des températures sur les processus géomorphologiques. Les effets d’un tel réchauffement sur les milieux glaciaires et périglaciaires peuvent être nombreux : retrait et désagrégation des glaciers, augmentation des écroulements rocheux à cause du réchauffement du pergélisol, modification de la durée d’enneigement etc. (Leonelli et al., 2011). En outre, le changement climatique risque d’impacter la magnitude et la fréquence des glissements de terrain, des laves torrentielles, ou encore des taux d’érosion et de sédimentation via une augmentation de la fréquence et de l’intensité des inondations (Beniston, 2006).
Au final, dans les zones où la forêt est limitée par des facteurs géomorphologiques ou orographiques, le changement climatique ne devrait pas visiblement modifier la localisation de la forêt. Toutefois, si les dynamiques de migration de la treeline s’intensifient, la forêt devrait se rapprocher de plus en plus des pics et aiguilles alpines et donc, des contraintes géomorphologiques. Cela pourrait, à terme, entrainer la disparition (au moins locale) de nombreuses espèces à cause de la diminution et de la fragmentation des habitats ouverts (Leonelli et al., 2011).
Il est donc clair que de nombreux facteurs peuvent moduler voire annuler l’influence du climat sur la position et la structure de l’écotone de la treeline. Ainsi, il est attendu que, malgré des élévations importantes des températures moyennes, dans la plupart des sites, la position de la treeline ne montre pas de tendance significative à l’élévation à cause de l’influence d’autres facteurs (Kullman & Öberg, 2009).
ANALYSE DE L’EVOLUTION DE LA TREELINE
S’il est possible d’observer l’évolution de la treeline réelle du massif uniquement grâce à la couche d’évolution forestière, ce n’est pas le cas pour la treeline théorique/potentielle. Une manière d’étudier son évolution serait de calculer l’altitude exacte où l’on trouve une période végétative d’au moins 94 jours ayant pour moyenne thermique 6,7°C ±0,8°C (Körner, 2007b) pour 1952 et pour 2006. Seulement, puisque le modèle SAFRAN offre une faible précision spatiale et ne remonte pas jusqu’en 1952, cette méthode n’est peut-être pas la plus indiquée pour cette étude.
Une autre technique, privilégiée ici, est celle utilisée par Gehrig-Fasel et al. (2007) pour étudier l’influence du climat et de l’abandon des terres agricoles sur la treeline des Alpes suisses. Elle s’intitule « méthode d’analyse focale » (focalmax analysis).
Cette méthode fonctionne un peu comme une moyenne mobile. On fait passer une fenêtre mobile (moving window) sur la zone d’étude afin de lisser l’altitude du pixel central (focal) grâce aux valeurs de ses voisins contenus dans le cadre de la fenêtre. En clair, on considère que l’altitude des pixels de forêt les plus élevés dans la fenêtre focale représente l’altitude de la treeline potentielle régionale. Bien sûr, cette technique n’est efficace que si par endroit, la forêt monte effectivement jusqu’à sa treeline climatique (Gehrig-Fasel et al., 2007). Cependant, pour des zones d’études très étendues, comme c’est le cas ici, la probabilité que plusieurs avancées de forêt non-perturbées atteignent leur treeline climatique est assez élevé, notamment sur les crêtes (Holtmeier & Broll, 2005).
Pour appliquer cette méthode, il a d’abord fallu multiplier chaque couche de forêt (1952 et 2006) avec le MNE afin d’attribuer une valeur d’altitude à chaque pixel tout en restant au format raster (donc sans transformer les couches en vecteurs de points).
Ensuite, il a été nécessaire de choisir la taille appropriée de fenêtre. Il apparaîtrait qu’une « fenêtre de 10km de côté est assez restreinte pour capturer les différences régionales dans l’élévation de la treeline climatique et suffisamment grande pour éviter les biais dus à des micro-conditions climatiques locales (Paulsen & Körner, 2001 in Gehrig-Fasel et al., 2007) ». Comme cette recommandation s’applique pour des études à petite échelle, deux tailles de fenêtres ont été retenues : 5000 et 10 000m.
Ainsi, grâce à l’option « MAXIMUM » de l’outil de Statistiques Focales d’ArcGIS, deux fenêtres mobiles circulaires de 5 et 10km de rayon ont été appliquées sur les deux couches de forêt. Cela a permis d’obtenir pour chaque date, deux couches présentant l’altitude maximum de la forêt dans un rayon équivalent au rayon de la fenêtre. En utilisant une nouvelle fenêtre focale avec cette fois-ci l’option « MEAN » (moyenne) qu’on a appliqué sur les couches d’altitude maximum de la treeline, il a été possible de lisser les valeurs maximums et ainsi de représenter graphiquement la treeline potentielle régionale moyenne pour chaque taille de fenêtre et pour chaque date (FIGURE 10).
Maintenant, on peut supposer qu’en théorie, le changement climatique en tant que facteur de la régénération des forêts serait principalement responsable des modifications de la treeline au-dessus de la treeline climatique « historique » (ici celle de 1952), alors que l’abandon des terres serait plutôt responsable de ce qui se passe en-dessous de la treeline historique (Gehrig-Fasel et al., 2007 ; Améztegui et al., 2010). En effet, s’il n’y a pas d’influence du changement climatique, alors l’utilisation du sol ne devrait pas modifier la structure ou la position de la treeline au-dessus de la limite supérieure « historique» de la forêt (Gehrig-Fasel et al., 2007).
Par conséquent, tous les pixels de forêt en 2006 situés au-dessus de la treeline climatique de 1952 peuvent être considérés comme ayant profité d’une élévation des températures (ou éventuellement de l’atténuation d’un autre facteur limitant : géomorphologie, humidité du sol etc.).
Pour repérer ces éventuels pixels de forêt dont l’élévation serait due au climat, il a suffi de soustraire aux deux couches représentant la treeline climatique potentielle de 1952 la couche de forêt de 2006 à l’aide de la Calculatrice Raster d’ArcGIS.
DESCRIPTION GENERALE DE L’EVOLUTION FORESTIERE
Le périmètre total de la zone d’étude mesure 139,4km pour une superficie « plane » de 635km2soit 63 560 hectares environ. Rappelons que puisque chaque pixel des couches de forêt mesure 15m de côté, un pixel couvre une surface de 225m2.
En 1952, la forêt recouvrait une surface plane de 8942,5 hectares soit environ 14% de la surface totale du massif (FIGURE 11). En 2006 en revanche, la forêt recouvrait une surface plane de 14 316,1 hectares, soit 22,5% de la surface totale du massif du Mont-Blanc. On peut donc observer une augmentation relative de la surface forestière de 60,1% avec 5373,6 hectares de couvert boisé supplémentaire en 2006 par rapport à 1952.
Comme attendu, les estimations de surface réelle donnent des superficies beaucoup plus importantes que les superficies virtuelles planes et horizontales. En effet, la surface totale de la zone d’étude en tenant compte du relief passe de 635 à 744 km2 environ, et les surfaces forestières de 1952 et de 2006 passent respectivement de 89,42 à 100,93km2et de 143,16 à 161,28 km2.
Cependant, bien que ces écarts soient assez importants, ils ne changent pas réellement les tendances observées.
En superficie réelle estimée, la forêt recouvrait 13,55% de la surface du massif en 1952 et environ 21,65% en 2006, ce qui est très proche des surfaces planes calculées.
Pour ce qui est de l’évolution détaillée de l’occupation forestière du sol, les différences entre surface théorique plane et surface réelle sont également importantes bien qu’encore une fois, les tendances ne s’en trouvent pas profondément modifiées. Les zones où la forêt s’est maintenue entre 1952 et 2006 occupent 12,44% de la superficie totale du massif (soit 7901,8 ha), et le gain net de forêt est de l’ordre de 6400,7 ha, soit 10,07% de la surface totale. En revanche, le massif a tout de même perdu 1035,6 ha de forêt depuis 1952, soit 1,63% de sa surface totale.
Au vu de la FIGURE 12, on peut observer que dans l’ensemble, la distribution de la forêt en fonction de l’altitude en 1952 et en 2006 est plutôt régulière. On note cependant une très légère dissymétrie vers le haut, plus marquée pour 1952, indiquant une forte concentration de forêt au-dessus de 1500m environ, les distributions de la forêt en dessous des altitudes médianes étant plus étalées. La dispersion des deux distributions est cependant comparable, avec un coefficient interquartile de 0,301 pour 1952 et de 0,299 pour 2006.
Quoiqu’il en soit, il est clair au vu de ce graphique que la forêt s’est nettement élevée entre 1952 et 2006. En effet, l’altitude médiane de la forêt est passée de 1454m en 1952 à 1542m en 2006, et le 9ème décile de forêt s’est élevé de près de 120 mètres durant la même période, passant de 1803 à 1920m d’altitude (alors que le 1er décile ne s’est élevé que de 48m). Cela confirme que la surface forestière a grandement augmentée depuis le siècle dernier et ce, principalement dans les altitudes hautes (>1500m), ce qui suggère une remontée de la treeline. De fait, l’altitude des arbres les plus élevés a augmenté de près de 50m en seulement 54 ans.
DESCRIPTION DE L’EVOLUTION PAR « REGION »
Tout d’abord, il est intéressant d’observer la répartition des terres du massif en fonction de la « région ». On peut donc voir que, sans surprise, la Haute-Savoie représente la plus grande part du massif puisque 52,97% de la superficie de ce dernier est en territoire haut-savoyard (soit 33 647 ha environ). Soulignons cependant que près de 64% de la surface d’évolution (surface de gains, pertes et maintien de la forêt) du massif se trouve en Haute-Savoie, ce qui veut dire que cette région représente près des 2/3 des contributions de l’évolution des surfaces forestières du massif du Mont-Blanc. Le Valais vient en seconde position puisque son territoire représente 22,33% du massif et que sa contribution pour l’évolution de l’occupation du sol est d’environ 29%. Ensuite, malgré une surface à peu près équivalente à celle du Valais (avec 20,06% du massif), le Val d’Aoste ne représente que 6,5% de la surface d’évolution. Enfin la Savoie, qui ne représente que 4,64% de la superficie du massif, offre une modeste contribution de 0,6% des surfaces d’évolution (TABLEAU 2).
ETUDES DES HABITATS VEGETALISES EN FONCTION DES PARAMETRES TOPOGRAPHIQUES
La FIGURE 22 permet d’apprécier d’un seul coup d’œil la part importante que représente la forêt dans le massif du Mont-Blanc par rapport aux autres types d’habitats accueillant des communautés végétales. De fait, en-dessous de 1800m, les espaces végétalisés sont pratiquement entièrement dominés par la forêt (qui couvre près de 11 500 hectares), ne laissant que quelques 1600 hectares de pelouses montagnardes (ou éventuellement subalpines) et environ 750 hectares de landes. Entre 1800 et 2400 mètres en revanche, on peut constater que les espaces ouverts dominent encore le paysage. La forêt y représente près de 3000 hectares, mais c’est bien la lande et la pelouse subalpine qui occupent la plus grande surface. La pelouse alpine et les sols nus végétalisés commencent également à couvrir une grande surface à cette altitude. Au-dessus de 2400m, la forêt ne représente plus que 0,8 ha et c’est cette fois la pelouse alpine et les sols nus qui composent la plus grande part du paysage. Leur part est d’autant plus importante que la surface terrestre diminue avec l’altitude. Ainsi, au-delà de 3000m, seuls restent quelques sols nus végétalisés qui ne représentent toutefois que 6 ha, les terres restantes appartenant au monde minéral ou glaciaire.
DISCUSSION
De manière générale, il est clair que la forêt du massif du Mont-Blanc a connu de nombreux changements au cours de ces dernières décennies. Le couvert forestier a par exemple gagné plus de 6400 hectares en l’espace de 54 ans. Et même si de nombreuses « pertes » de forêt sont à dénombrer, celles-ci restent largement minoritaires.
Si la tranche altitudinale située entre 300 et 600m d’altitude est la seule à présenter plus de pertes de forêt que de gains sur l’ensemble de la zone d’étude, c’est car ce secteur, très réduit, est localisé sur la zone artisanale de la commune de Passy, qui a donc certainement connu de nombreux déboisements à des fins de construction (ateliers, entrepôts, autoroute, incinérateur etc.) entre 1952 et 2006 (Martin, 2013).
Maintenant, plus des trois-quarts des pertes ont été observés entre 900 et 1800m d’altitude. Or, c’est justement dans cette tranche altitudinale que se trouve la quasi-totalité des villages du massif : Chamonix, St Gervais, les Contamines, Entrèves, Orsières, Champex, Vallorcine etc. La plus grande partie des pertes observées à cette altitude est donc certainement due à l’urbanisation très importante qu’on connu les vallées du massif, principalement sur leurs parties basses et relativement plates, d’où la faible superficie des habitats naturels dans ces configurations (FIGURE 22). En outre, une bonne part des pistes de ski des stations de la région se trouve aux alentours de 1800m, c’est notamment le cas de la station des Houches à l’emplacement de laquelle des traces de déboisement sont visibles sur la FIGURE 10.
La limite de 1800m coïncide également à peu près avec la limite supérieure de l’exploitation forestière dans le massif du Mont-Blanc. En effet, les pentes du massif étant particulièrement abruptes, surtout sur les versants haut-savoyards et valdotains, les dessertes forestières sont par conséquent peu nombreuses. Par ailleurs, les câbles-mâts utilisés pour le débardage des grumes de bois ne peuvent atteindre que des longueurs relativement restreintes : environ 800 mètres pour les câbles courts, et environ 1400m pour les câbles longs9. Ainsi, l’exploitation forestière dans le massif du Mont-Blanc ne dépasse que rarement les 1800 – 2000m d’altitude.
Une autre partie des pertes peut certainement aussi être imputée aux processus géomorphologiques, évidemment nombreux dans le massif. En effet, sur la FIGURE 10, on peut observer que de nombreuses pertes sont situées le long de talwegs ou sur des cônes de déjections, notamment dans le Val d’Aoste ou dans la partie sud du secteur valaisan. Le versant valdotain étant particulièrement escarpé (FIGURE 26), il est possible que des processus de versant comme des coulées de boue, des avalanches ou des écroulements rocheux soient à l’origine de ces pertes.
Enfin, il ne faut pas oublier que même si la classification par photo-interprétation est une méthode assez fiable, il existe toujours un risque d’erreur. Ainsi, on distingue généralement les erreurs de « commission », quand on prédit la présence d’un individu (ici un arbre ou un groupe d’arbre) alors qu’il n’est pas là, et les erreurs d’ « omission », quand on passe à côté d’un individu pourtant bien présent (Guisan & Thuiller, 2005). Par conséquent, il est évidemment possible qu’une petite partie des pertes, des gains ou du maintien observés, résulte en réalité d’une erreur de classification.
C’est probablement le cas en Savoie, où les pertes se sont avérés proportionnellement élevées (induisant également un maintien plus faible et donc des gains plus forts). Une analyse a posteriori a permis de constater qu’une bonne partie des pertes observées résultaient en fait d’une erreur de commission : de fait, sur le bords de la mosaïque d’orthophotographies, le grain de l’image peut être particulièrement mauvais (Aplin, 2001).
|
Table des matières
RESUME
ABSTRACT
REMERCIEMENTS
LISTE DES ACRONYMES ET DES ABREVIATIONS
SOMMAIRE
AVANT-PROPOS
INTRODUCTION
1. METHODOLOGIE
2. RESULTATS
3. DISCUSSION
4. PERSPECTIVES
CONCLUSION
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
WEBOGRAPHIE
TABLE DES FIGURES
TABLE DES TABLEAUX
TABLE DES ANNEXES
TABLE DES MATIERES
ANNEXES
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet