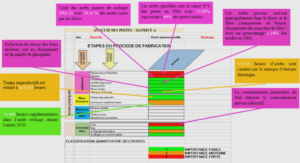L’eau est une ressource vitale, indispensable à l’homme pour se maintenir en vie. C’est également un bien éminemment économique, et à ce titre elle nécessite la mobilisation de mesures techniques, économiques et financières ; sa répartition équitable en quantité satisfaisante à la population. Actuellement, les ressources en eau constituent un problème fondamental dans la région sud de Madagascar, alors que l’eau est considérée comme un facteur primordial pour le développement dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, et de l’assainissement. La gestion et la préservation de l’eau, denrée rare dans cette région est donc essentielle, et mérite la mise en place d’un programme de mise en valeur, avec l’appui des autorités et des différents acteurs de développement.
PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE
Localisation
Le bassin du Mandrare est situé dans la région extrême sud de Madagascar, province autonome de Tuléar, région d’Anosy qui s’étendant sur les sous préfectures d’Amboasary sud et d’Ambovombe Androy. La carte FTM d’Ampanihy à l’échelle de 1/500.000 permet de la localiser entre les longitudes 45° 87′ Est et 48° 39′ Est, et les latitudes 24° 07′ sud et 25° 21′ sud. La région du Haut Bassin de Mandrare est constituée de la partie en amont du grand bassin du Mandrare.
Situation Morphologique
Le bassin du Mandrare, d’une superficie voisine de 13.000 Km², est situé sur une région montagneuse dominée par les chaînes anosyennes culminant à 2000 m d’altitude. Cette région forme la limite orientale du bassin. Au nord, un grand escarpement appelé le rebord manambien d’altitude 1500m forme la bordure septentrionale du bassin. La moitié occidentale du bassin est dominée par le massif volcanique de l’Androy culminant à environ 900 m d’altitude. Une haute plaine dénommée plaine de Tranoroa, large d’une trentaine de kilomètres dont l’altitude varie de 400 à 50m du nord au sud. La partie sud du bassin est une zone basse, assez plane, dominée par quelques dunes et dont l’altitude diminue de 50 m à 0 m (niveau de la mer).
Contexte géologique
Madagascar comporte 2 grands types de terrains géologiques : le socle cristallin et les terrains sédimentaires. Pour la zone d’étude, la majorité du bassin est constituée de socle cristallin. Plus particulièrement, le bassin du Mandrare est caractérisé géologiquement par :
– Les roches cristallines dans la partie supérieure du bassin (gneiss, granite), constituant un ensemble imperméable.
– Les formations éruptives (basaltes et rhyolites) au centre du bassin.
– Les sables roux, perméables dans la partie sud du bassin.
Contexte climatique
La région d’étude jouit d’un climat intermédiaire entre la région Est, humide, et la région ouest semi–aride, où les pluies annuelles moyennes diminuent de l’est vers l’ouest et du nord au sud, variant de 1200mm à 500mm. La majeure partie du bassin reçoit entre 700 et 1200mm de pluie par an.. Le régime pluviométrique de la région est très irrégulier, et cette irrégularité s’accentue au fur et à mesure que l’on se déplace vers l’Ouest et vers le Sud. Néanmoins on remarque deux saisons : une pluvieuse de novembre à mars, où il tombe plus de 90% des pluies annuelles, et une saison sèche de sept mois ( Avril à Octobre ) recevant moins de 10% de la pluie annuelle. La présence de massif de l’IVAKOANY et des petits monts adjacents fait que l’influence orographique est déterminante. Si au voisinage immédiat du massif de l’IVAKOANY, la précipitation annuelle varie de 1.200 à 1.400mm, la pluviométrie moyenne annuelle relevée sur quelques postes d’observation dans le bassin du Mandrare varie des 700 à 150mm Quant au régime thermique, la température moyenne sur le bassin est de 23 à 25 °C, avec des maxima de 30 à 33°C en saison chaude, et des minima de 10 à 20°C en juin – juillet.
Réseau hydrographique et régime du cours d’eau
♦ Structure hydrographique
Le fleuve Mandrare coule suivant trois directions :
– du sud vers le nord en amont, longeant la chaîne du Beampingatra ; il n’y reçoit que des torrents des montagnes
– De l’est vers l’ouest dans son cours moyen, où il creuse sa vallée dans les roches cristallines et reçoit sur la rive droite Sahanony et Voronkatsa , sur la rive gauche Manambolo.
– Du nord vers le sud dans son cours d’eau inférieur, sur des formations volcaniques avant Ifotaka . Les principaux affluents sont, sur la rive droite Tsivory, Andratina, Sakamahasoa, Ikonda, et sur la rive gauche Ranobe et Ifamata.
Après Ifotaka , le fleuve Mandrare coule sur des formations cristallines et sédimentaires.
♦ Régime des cours d’eau
Le régime du cours d’eau est fonction de la fréquence des pluies : les crues, très fortes après les orages se tarissent rapidement ; les ruisseaux sont donc à sec la plupart du temps avec un bref écoulement dans la couche d’alluvions. Les premiers régimes ont un régime torrentiel dans la haute chaîne Anosyenne. Les rivières venues des chaînes beaucoup plus arrosées à couverture latéritique ont presque toujours de l’eau courante. Les pluies y sont plus fréquentes, avec des orages et des crachins qui tombent presque toute l’année. Les rivières torrentielles ont des débits très variables.
Par ailleurs, les cours d’eau dans le bassin s’écoulent sur des formations géologiques issues des plateaux cristallins, dont le régime, quoique très variable suivant la saison, permet néanmoins un cours permanent.
les sols
Dans le Grand sud, on distingue trois catégories principales de sols :
❖ les sols ferrugineux tropicaux
❖ les sols minéraux bruts et peu évolués qui comprennent aussi les sols dunaires
❖ Les sols calcimorphes.
La zone d’étude est faite de types de sols complexes dans la zone semi – aride.
• Sur les marges Nord, Nord–est et Est du bassin, on rencontre par endroits des sols latéritiques imperméables.
• Sur le massif volcanique il y a les sols sub–squelettiques et argileux
• Ailleurs on rencontre surtout des sols ferrugineux tropicaux, des sols rouges sableux sur calcaire, sols alluvionnaires le long du fleuve et ses affluents, et sols hydromorphes dans les dépressions à drainage difficile.
Végétation
Dans le bassin versant du Mandrare, la végétation est composée essentiellement de plantes adaptées à la sécheresse (graminées, bush à xérophiles, baobabs etc. … ) La majeure partie du bassin est occupée par la savane, avec de nombreuses zones couvertes de plantes épineuses. la forêt galerie longe des principaux cours d’eaux. On y trouve de grands arbres tels que les Dalbergia et les Tamar Indus.
Dans le cadre socio – économique, l’évolution de la population est estimée à peu près à 205.249 en 2020, ce qui représente un besoin de 1 025 000 litres d’eau par jour. D’où le besoin crucial de l’évaluation des ressources en eau. Les valeurs du potentiel économique dans la zone d’étude tels que l’élevage et l’agriculture jouent un rôle très important dans la vie de la population. A l’heure actuelle, la ressource en eau est un problème crucial au développement de sa condition de vie. Face à cette situation, nous allons évaluer, par l’analyse estimative et fréquentielle, les ressources en eau, et notamment la gestion des ressources. On espère ainsi aboutir à une solution pour maîtriser la capacité disponible, et satisfaire les besoins de la population.
|
Table des matières
INTRODUCTION
Chapitre 1 : GENERALITES
1.1 Objectif de l’étude
Notre travail consiste en la création de plusieurs mares dans les hauts bassins du Mandrare, afin de satisfaire les besoins en eau destinée à la population des hauts Bassins du Mandrare, identifiés sur la base des enquêtes réalisées par l’ANDEA en année 2003
1.2 Méthodologies
1.3 Problèmes d’eau dans le grand sud
Chapitre 2 : PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE
2.1 Localisation
2.2 Situation Morphologique
2.3 Contexte géologique
2.4 Contexte climatique
2.5 Réseau hydrographique et régime du cours d’eau
2.6 Contexte socio-économique
2.6.1 Population
2.6.2 Activités économiques
Source : Schéma directeur de mise en valeur des ressources en eau du grand sud Edition 2003
2.7 les sols
2.8 Végétation
Chapitre 3 : EVALUATION DES RESSOURCES EN EAU DU HAUT BASSIN
3.1 Estimations Pluviométriques
3.1.1 Précipitation
3.2 Estimation des débits
3.3 Estimation des basses eaux
3.4 Estimation des crues
Où
Q(P) : Débit maximum, en m3/s, d’une crue de fréquence P
S : surface, en km², du bassin versant
I : pente moyenne, en m/km, du bassin
H(24,P) : Hauteur moyenne maximum, en mm, de l’averse précipitée
3.5 Types de gestion des ressources en eaux
3.5.1 Estimations des variations du stock
3.5.2 Application des types des gestions des ressources en eau
Chapitre 4 : CONTRIBUTION A L’AMELIORATION DES GESTIONS DES RESSOURCES EN EAU PAR LES METHODES GEOPHYSIQUES
4.1 Identifications des caractéristiques géologiques du terrain
4.1.1 Télédétection
4.1.1.1 Définition
4.1.1.2 Outil de télédétection
4.1.1.3 Applications liées à la géologie
4.1.2 Photographie aérienne
4.1.2.1 Généralités
4.1.2.2 Photo Interprétation
4.2 Identification des mares par la méthode géophysique
4.2.1 La méthode de prospection électrique
4.2.1.1 Technique utilisant le courant continu
4.2.1.2 Panneau électrique à 2D
4.2.1.3 Interprétation géologique des coupes géoélectriques
CONCLUSION
REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE
REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE