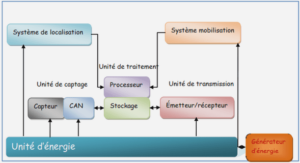Les débuts de l’élevage moderne à La Réunion
Depuis l’introduction des premiers animaux au 17ème siècle, l’élevage s’est développé graduellement sur l’île. Si l’on remonte aux origines, on constate que l’élevage à La Réunion est antérieur au peuplement permanent et définitif de l’île que l’on arrête classiquement à 1663. Cette date correspond à l’arrivée de Louis Payen, Français vivant à Fort-Dauphin depuis 1856 et qui débarque en baie de Saint-Paul en compagnie d’un compatriote et de dix Malgaches dont trois femmes. En effet, comme le rappelle J-M. Jauze dans son mémoire sur « l’élevage à La Réunion » (Jauze, 1986), un document extrait de l’ouvrage d’Albert Lougnon1 précise : « En cette année mil six cent quarante-neuf, j’y ai placé (dans l’île) quatre génisses et un taureau* afin d’y multiplier, et en l’année mil six cent cinquante-quatre, j’y ai envoyé autant, lesquelles on trouva qu’elles s’étaient multipliées jusqu’à plus de trente. J’ordonnais au Capitaine Roger Le Bourg d’en prendre une seconde fois possession de ma part au nom de sa Majesté, d’y poser les armes du Roi et de la nommer Île Bourbon ». Ce témoignage rare extrait d’un rapport rédigé par Flacourt -Gouverneur de Fort-Dauphinconfirme qu’il était courant d’utiliser les petites îles comme des garde-manger depuis l’époque des Grandes Découvertes en déposant du bétail qu’on laissait se reproduire librement afin de disposer de viande fraîche lors des escales qui ponctuaient les longues traversées océaniques. Bien que s’agissant de reproduction d’un bétail apporté par l’homme, on peut considérer que cette configuration ne renvoie évidemment pas aux formes « modernes » de l’élevage qui se structurent bien plus tard à La Réunion. En effet, c’est seulement vers le milieu du XIXème siècle après l’abolition de l’esclavage à La Réunion (20 décembre 1848) qu’on assiste pour la première fois à un effort de planification économique à l’échelle de l’île à des fins de sécurité alimentaire. Cet effort de planification incité par les décisions du Gouverneur Doret en 1851 aura des conséquences directes sur la structuration des systèmes d’élevage à La Réunion. Le Gouverneur arrête alors des mesures incitatives pour accélérer la colonisation des « Plaines » -Plaine des Cafres et Plaine des Palmistes- afin de tenter de fixer une population de « petits blancs » pauvres et de nouveaux affranchis qui tentent difficilement de survivre. Incitant à la diversification agricole et au développement des cultures vivrières et fourragères face au modèle de la monoculture de la canne à sucre, le gouverneur Doret prévoit l’installation d’un centre d’élevage à la Plaine des Cafres grâce à des concessions de terres gratuites à la condition qu’elles donnent lieu à une installation pérenne de plus de quatre années. Au total, 990 hectares furent distribués à La Plaine des Cafres avec des surfaces importantes réservées par ailleurs au pâturage commun. Comme le rappelle J-M. Jauze (Jauze, 1986), « les concessionnaires devaient dès la première année, entretenir du bétail, construire des étables et clôturer leurs concessions », ce qui correspond finalement à l’avènement d’une véritable filière d’élevage de ruminants à La Réunion. Notons cependant une grande différence avec « l’élevage moderne » et qui concerne la destination de la production animale de ruminants. En effet, si les ruminants et leur production de lait étaient utilisés pour la consommation humaine, leur destination première renvoyait au travail de la terre et au déplacement des hommes. Cet élevage visait donc prioritairement la traction animale, la fameuse « charrette bœufs » étant jusqu’au XXème siècle l’unique moyen de transport présent sur l’île pour les personnes et les marchandises, à commencer par la canne à sucre à transporter du champ à l’usine. S’agissant du dénombrement des ruminants sur l’île tout au long de cette histoire, force est de constater que les données sont lacunaires. Jean Defos Du Rau, auteur de la première grande thèse de géographie humaine consacrée à La Réunion (Defos Du Rau, 1960) souligne que « sur les effectifs du troupeau réunionnais, on n’a jamais possédé que des chiffres assez fantaisistes. Maillard parle en 1660 de 5600 bovins et 60 000 porcs. En 1887, il y aurait eu 8400 bovins et 15 000 ovins. En fait, le seul document officiel récent était celui du recensement de 1943 qui faisait état de 49 313 bovins dont 27 964 vaches laitières, 6080 ovins, 24 686 caprins, 102 000 porcins et 841 chevaux, 771 ânes et de la volaille dans toutes les cases ». S’agissant des perspectives de la filière élevage à La Réunion, le même auteur cité par Jauze (Jauze, 1986) portait un regard particulièrement noir en concluant ainsi son chapitre sur l’élevage à La Réunion : « Espérer aménager dans l’île d’immenses et riches pâturages dans les Hauts, transformer en vertes prairies les steppes du littoral sous le vent, peuvent dès lors sembler des vues de l’esprit. L’élevage restera un élevage de petits exploitants (…). Un réseau de distribution fournissant du lait frais à toute la population semble pour le moment exclu, à moins que l’élevage extensif de vaches laitières finisse par devenir plus rentable même que la culture de la canne ». L’histoire récente de l’élevage à La Réunion sera le théâtre d’une transformation de la perception du potentiel des Hauts. Suite à la mécanisation importante dans les années 60, les animaux de trait sont remplacés et le cheptel diminue fortement passant de 49 313 bovins en 1943 à 17 730 en 1973. Le secteur de l’élevage se professionnalise. En 1960, la Coopérative des éleveurs de la Plaine des Palmistes est créée. L’accent est mis sur la production de lait. Dans cette lancée, la SICALAIT voit le jour en 1962 ainsi que l’implantation à La Réunion de l’IRAT (Institut de Recherches Agronomiques Tropicales et cultures vivrières) qui sera plus tard intégré au CIRAD (Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement) avec d’autres instituts de recherche tropicaux français. Au début des années 1970, le prix de la viande augmente en Europe, et Madagascar préfère exporter sur le continent, destination plus rentable que La Réunion. Un déficit important se fait alors sentir sur l’île et l’accent est porté sur la production de viande. En 1974, 90% de la consommation est assurée par les importations. Un plan sur dix ans est alors encadré par la future SICAREVIA (Coopérative SICA REunion VIAnde) ainsi que par la SEDAEL (Société d’Etudes de Développement et d’Amélioration de l’Elevage) pour la production de géniteurs. Une forte volonté largement soutenue par les pouvoirs publics permet le développement des filières de production. Mais ce développement soutenu est rattrapé par la croissance démographique du littoral qui va accentuer les déséquilibres entre le pourtour et le centre du territoire. Le littoral voit se développer une classe moyenne travaillant dans les administrations et le tertiaire qui tranche radicalement avec la petite agriculture de l’intérieur de l’île
Le sol très peu fertile du Kalahari
L’histoire de la géologie du Kalahari est bien plus ancienne que celle de La Réunion. Le bassin du Kalahari s’est formé à la fin du Crétacé. Un affaissement de la zone ainsi que l’élévation de certains axes épirogéniques permettent l’apparition de rivières qui commencent leur travail de dépôt de graviers et de sédiments (Haddon et McCarthy, 2005). La partie sud du Kalahari est une plaine relativement plane dont l’altitude varie entre 1 000 m et 1 500 m. Elle est traversée par des rivières éphémères enfermées dans des vallées jusqu’à 50m de profondeur par rapport à la plaine (Lancaster, 1988). Après des modifications de la composition du sol à l’échelle géologique, la couche supérieure du sol est aujourd’hui largement composée de sables classés comme arénosols. A plusieurs reprises (Buckley, Gubb, et al., 1987; Buckley, Wasson, et al., 1987), le sol du Kalahari est comparé à celui du centre de l’Australie, lui-même jugé comme très peu fertile. Les résultats montrent un sol avec des taux de phosphore, potassium, et calcium bien inférieurs. Le taux d’azote est quant à lui comparable. Cette faible fertilité du sol et l’absence d’eau en surface ont longtemps été des arguments mobilsés pour attester de la non viabilité d’une filière élevage dans la région (Debenham, 1952). Mais l’évolution des technologies permettant des forages profonds ainsi que la taille des surfaces disponibles pour puiser l’eau ont permis le développement agricole de cette région
Un climat géographiquement varié, induit par le relief
Le relief fortement accidenté de l’île a des conséquences sur le climat. Les hautes formations montagneuses constituées par le massif du Piton des Neiges et le Piton de la Fournaise bloquent les alizés venant de l’est et qui apportent des quantités de précipitations importantes toute l’année. La pluviométrie annuelle moyenne enregistrée entre 1981 et 2010 se situe entre 2 500 mm et 12000 mm (Figure 12). Les sommets de l’île détiennent même plusieurs records mondiaux de pluviométrie durant des épisodes extrêmes. Le récent cyclone Gamède en 2007 apporta 3 930 mm en 72 heures sur le secteur du Piton de la Fournaise. L’ouest, plus à l’abri, est en revanche touché par une saison sèche très marquée durant l’hiver austral (Figure 10). Cette sécheresse engendre régulièrement un déficit fourrager qu’il faut combler, soit par des reports fourragers, soit par des achats de fourrages. Cette dysmétrie est nuancée par un gradient altitudinal impactant lui aussi les précipitations et températures. Nous observons un climat plus humide et frais en altitude se rapprochant d’un climat tempéré, avec de très courtes périodes de gel vers le volcan. À faible altitude se trouve un climat tropical propice à la canne à sucre et aux cultures fourragères tropicales (Chloris, Pennisetum sp., etc.), avec des chaleurs plus importantes et des précipitations plus faibles.
La télédétection
La télédétection désigne un ensemble de techniques permettant d’étudier à distance des phénomènes ou objets. La télédétection spatiale, qui nous intéresse plus particulièrement, permet l’acquisition d’un signal (rayonnement électromagnétique réfléchi ou émis), transformé en images afin de l’étudier. C’est seulement un siècle après la première photographie aérienne (Gaspard Félix Tournachon, 1856) que les premières applications spatiales voient le jour avec l’observation météorologique. Dans les années 1970, le satellite Landsat1 permet d’observer la surface terrestre et ouvre la voie vers une évolution continue de la télédétection. Depuis, les résolutions se sont affinées, les plages de fréquences ont augmentées et les capteurs se sont diversifiés (optique, radar, laser). Les deux principaux outils de télédétection spatiale pour observer la végétation sont le radar et le capteur optique. Les capteurs radar sont des capteurs actifs. Ils envoient un rayonnement électromagnétique et en réceptionnent une partie, une fois réfléchie sur la surface terrestre. Ils ont l’avantage de pouvoir fonctionner de nuit car la source d’énergie reçue n’est pas lumineuse. Cela augmente les possibilités de prise de vue. Ces techniques sont jusqu’à maintenant utilisées majoritairement sur la détection de biomasse forestière (Hussin et al., 1991; Luckman et al.,1998; Rignot et al., 1995). Elles viennent aussi en appui à l’imagerie optique dans le cas de suivi de cultures (Dusseux et al., 2014; Joshi et al., 2016). Si cette technique est fiable pour les végétations arborées, elle l’est encore trop peu pour le suivi de biomasse herbacée dont les variations durant la croissance sont trop faibles pour être détectées.
L’imagerie multi-spectrale pour l’estimation de biomasse à l’échelle d’un territoire
L’imagerie multi-spectrale est sans doute l’offre la plus développée en ce qui concerne l’emprise des images, la capacité de revisite ou encore le rapport coût-efficacité (Kumar et al.,2015). Les nombreux capteurs offrent pléthore de possibilités, tant en termes de résolution spatiale que temporelle mais aussi en termes de longueurs d’ondes couvertes. Depuis les années 2000, l’ESA (Agence Spatiale Européenne) et le CNES (Centre National d’Études Spatiales) ont à eux seul lancé dix satellites avec capteur optique pour le suivi de la surface terrestre. Nous trouvons les SPOT5, 6 et 7, Pléiades 1 et 2 et Venµs gérés par le CNES ; Sentinel2A, B et 3 et Proba-V gérés par l’ESA. Les images issues de ces satellites peuvent être gratuites ou payantes suivant les capteurs. La résolution offerte peut aller de 100 à 0,5 m et la capacité de revisite peut être journalière à tri-mensuelle. En combinant les différentes bandes spectrales qui réagissent différemment suivant l’état de la plante, il est possible de calculer des indices de végétation (IV) permettant d’analyser l’état d’un couvert. Ce sont en général le rouge et l’infrarouge qui sont utilisés dans ces indices. Une plante réfléchie très peu du rayonnement solaire dans les longueurs d’ondes correspondant au rouge. Cette bande sert en quelque sorte d’étalon dans le calcul d’indices. A l’inverse l’activité chlorophyllienne d’une plante aura pour conséquence une forte réflectance dans le procheinfrarouge. Sa présence dans un indice de végétation renseignera donc sur l’état de production chlorophyllienne de la plante. Nous pourrons ainsi avoir des renseignements sur l’état de santé de la plante mais nous pourrons également disposer d’une information quantitative très utile relative à la biomasse. Les premiers indices utilisés, étaient simples, sous forme de différences ou de ratios entre les bandes spectrales (RVI, DVI). Le NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) (Rousse et al., 1974; Tucker, 1979) est à ce titre l’indice le plus largement utilisé pour l’étude de cultures (Collet, 2001; Pettorelli et al., 2005). Il représente un bon indicateur de la productivité primaire de la végétation terrestre
|
Table des matières
Introduction
Partie I : La production fourragère et son contexte à La Réunion et au Kalahari
I. Élevage et production fourragère à La Réunion
1. Les débuts de l’élevage moderne à La Réunion
2. Le plan d’aménagement des Hauts : décision charnière dans le développement de l’élevage réunionnais
3. L’élevage aujourd’hui à La Réunion
II. Élevage et production fourragère en Afrique du Sud
1. Localisation du Kalahari
2. L’élevage en Afrique du Sud et dans le Kalahari
III. Des environnements de production très contrastés
1. Géologie
2. Climat
3. Espèces de graminées
4. Production fourragère : conclusion
Partie II : Estimation de la biomasse fourragère et télédétection
I. Utilisation de la télédétection dans l’estimation de la biomasse fourragère
1. La télédétection
2. L’imagerie multi-spectrale pour l’estimation de biomasse à l’échelle d’un territoire
II. Imagerie multi-spectrale pour le suivi de biomasse
1. Modèles empiriques
2. Approche couplage
Partie III : Matériel et méthodes
I. Les sites d’étude
1. La Réunion
2. Kalahari
II. Les données terrestres
1. Données météorologiques
2. Mesures sur les parcelles
III. Les données satellitaires
1. Données Spot5
2. Données Sentinel-2
3. Les indices utilisés
IV. Les modèles de croissance
1. Module prairial du modèle GAMEDE
2. Modèle de croissance tropical
V. Le couplage
1. Les méthodes de couplage utilisées
2. Calcul de l’erreur
3. Modélisation sous Ocelet
Partie IV : Résultats et Discussion
I. Phase exploratoire
1. Modèle empirique d’estimation de biomasse avec SPOT5
2. Estimation du LAI à partir des images SPOT5take5
3. Cas particulier de l’Afrique du Sud
II. Estimation de la biomasse et du LAI à partir des images Sentinel-2
1. Ajustement des modèles empiriques de biomasse et LAI en fonction du NDVI
2. Estimation par l’algorithme « biophysical processor »
III. Couplage des modèles de croissance
1.1. Adaptation du modèle tropical
1.2. Couplage des modèles avec le LAI issu de la relation empirique avec le NDVI
1.3. Couplage des modèles avec le LAI issu du « biophysical processor »
1.4. Analyse des résultats
IV. Forçage et visualisation spatiale du modèle
Partie V : Conclusion
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ANNEXES
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet