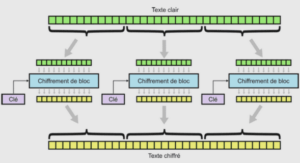Problématique
Contexte et justification du sujet
Avec la rude concurrence qui règne au niveau des pays développés, les émissions de gaz à effet de serre principalement le carbone deviennent de plus en plus importantes. Ces gaz à effet de serre, par leurs influences sur le climat, ont des conséquences néfastes sur les activités humaines et particulièrement sur la santé des populations. Depuis plus d’un siècle, des activités humaines telles que l’exploitation des combustibles fossiles, la déforestation, la conversion des terres de parcours naturelles et d’autres formes d’utilisation des terres ont contribué à une forte augmentation dans l’air de divers gaz à effet de serre. La communauté scientifique estime que cette accumulation rapide du CO2 atmosphérique contribue au réchauffement global de la terre et entraîne des changements climatiques (CSE, 2005). Si les pays industrialisés sont les principaux responsables de cette situation, la contribution des pays en développement comme le Sénégal à l’effet de serre n’est pas négligeable. D’ailleurs, le développement économique auquel ces pays aspirent s’accompagne d’une hausse de la pollution atmosphérique. Il y a un consensus scientifique selon lequel le climat est en train de changer et que les phénomènes météorologiques deviennent de plus en plus extrêmes. Les scientifiques, les gouvernements et les organismes internationaux de la santé et de l’environnement reconnaissent que le changement climatique affectera l’environnement ainsi que la santé des hommes.
Bien qu’il ne soit pas actuellement possible de prédire de façon précise l’ampleur de ces phénomènes climatiques, les impacts potentiels sont considérables. Les facteurs environnementaux affectent encore dramatiquement la santé de nombreuses populations. Selon l’OMS (1998), trois millions d’enfants meurent chaque année de causes liées à la dégradation de l’environnement. Entre 80 et 90 % des cas de diarrhée sont attribuables à des causes environnementales. Dans les pays en développement, entre 2 et 3,5 milliards de personnes utilisent des combustibles émettant des fumées et des substances nocives. Dans les zones rurales, des pratiques inadéquates d’élevage entraînent la prolifération de maladies transmissibles par les animaux et une résistance aux antibiotiques. Chaque année, quelque 300 à 500 millions de personnes contractent le paludisme et de 1,5 à 2,7 millions en meurent. 90 % de ces décès surviennent en Afrique au sud du Sahara (OMS, 1998). L’Afrique pourrait être le continent le plus vulnérable à ces impacts. Très probablement, il faudra s’attendre à une variabilité des précipitations annuelles plus marquée, des événements climatiques plus sévères y compris des inondations et des sécheresses plus accentuées, particulièrement dans les pays soufrant déjà d’un niveau avancé de la dégradation des terres (CSE, 2005).
LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Les caractéristiques physiques de la zone d’étude sont les principaux déterminants des conditions environnementales. Ainsi, dans ce chapitre nous allons nous focaliser sur le relief, le climat, la végétation, le réseau hydrographique et les sols.
Localisation
Belfort est un quartier spontané de la ville de Ziguinchor (carte 1). Situé au nord de la commune, le quartier de Belfort s’étend sur une superficie de 4,649 Km². Son milieu physique est diversifié. Se trouvant dans la région de Ziguinchor, son climat est de type sud-soudanien côtier et a le point le plus bas de la commune. La végétation y est diversifiée et variée. Il est limité au nord par les quartiers de Santhiaba et de Boucotte Nord, au sud par les quartiers de Néma et de Tilène, à l’est par le quartier de Santhiaba et à l’ouest par le quartier de Boucotte Est.
Le relief
La ville de Ziguinchor appartient au bassin de la Casamance situé dans la partie méridionale du grand bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien. Elle est constituée par des plateaux, des terrasses et des bas-fonds. Notre zone d’étude étant un relief bas, nous nous intéresserons aux bas-fonds. Un bas-fond est une zone basse dont une partie est constituée par les slikkes et schorres envahis par les marrées (lits des marigots et vasières) et une autre composée par des sables limoneux recouverts de limons sableux (rizières) (Diallo, 2005). Cette dernière est en général exploitée pour la riziculture. Les bas-fonds sont composés par :
• les alluvions fluvio-marines récentes (sables limoneux et limons sableux) généralement exploitées dans la riziculture ;
• une vasière fonctionnelle à mangrove qui n’est pas présente dans notre zone d’étude.
Le climat
Le climat à Ziguinchor se caractérise du point de vue global par ses aspects hérités du domaine tropical. Il se détermine ainsi par la conjonction de facteurs géographiques et aérologiques qui en font une région à nuance climatique particulière à l’intérieur de l’ensemble sénégalais. La région de Ziguinchor appartient au domaine climatique sudsoudanien côtier, ce qui lui confère le climat chaud et pluvieux. Des quantités de pluie supérieures à 1000 mm sont enregistrées chaque année entre mai et novembre. Cette abondante pluviométrie à favorisé une végétation abondante et un réseau hydrographique alimenté durant une bonne partie de l’année.
La végétation
La végétation de Belfort, à l’instar de celle de la région de Ziguinchor est diversifiée et variée. Le paysage arbustif est composé de palmerais (Elaeis guineensis), de cocotiers (Cocos nucifera), de manguiers, de palmiers, de fromagers, d’acacia, etc. Pendant l’hivernage, avec l’apparition du tapis herbacé et des casiers rizicoles, le paysage de Belfort devient très luxuriant.
Le réseau hydrographique
L’étude du réseau hydrographique se fera de manière globale. Du point de vue hydrologique, la ville de Ziguinchor est sous l’influence du fleuve Casamance et de ses affluents notamment le marigot de Djibélor et celui de Boutoute. Le fleuve Casamance est un petit fleuve dit « côtier » dont la superficie du bassin est d’environ 20 150 Km². Il est situé à la limite nord de la ville au contact du quartier BoudodyEscale. Sa source est en Haute-Casamance près de Saré Boido Mali, entre Fafacourou et Vélingara (Bassel, 1993) cité par (Diallo, 2005) à environ 350 Km de la mer. Le lit du fleuve s’élargit d’amont en aval de 50 m (amont Kolda) à 6 Km (Ziguinchor). Sa partie avale est en contact avec les eaux de l’océan, qui remontent jusqu’à après Ziguinchor à 152 Km (Diana Malari) de l’embouchure déterminant ainsi deux zones distinctes dans le cours d’eau : un bief maritime en aval de Diana Malari ou les eaux sont salées et une zone d’eau douce en amont de cette localité.
Son réseau secondaire correspond à de multiples affluents et de chenaux de marée. Les plus importants sont le Soungrougrou, la Khorine, le Tiangole Dianguina et les marigots de Dioulacolon, de Guidel et Baïla (Bassel, 1993) cité par (Diallo, 2005). L’eau du fleuve Casamance à Ziguinchor résulte d’un mélange d’eaux douces provenant de débits propres du fleuve et d’eau marine de volume plus important. En conséquence, la qualité de son eau y reste très salée durant toute l’année et impropre aux activités humaines. Le marigot de Boutoute à l’est et celui de Djibélor à l’ouest de la ville sont salés. Ils sont soumis au phénomène de marée et constituent leur principale source d’alimentation.
|
Table des matières
Introduction générale
Première partie : Présentation générale du quartier de Belfort
Chapitre I : Les caractéristiques physiques
Chapitre II : Les caractéristiques humaines
Conclusion partielle
Deuxième partie : Facteurs de risque et maladies associées
Chapitre I : Environnement physique et risques sanitaires
Chapitre II : Environnement humain et risques sanitaires
Chapitre III : Tableau pathologique du quartier de Belfort
Conclusion partielle
Troisième partie : Stratégies de gestion des risques sanitaires
Chapitre I : Aperçu sur l’assainissement de la ville de Ziguinchor
Chapitre II : Gestion des risques sanitaires à Belfort
Conclusion partielle
Conclusion générale
Bibliographie
Annexes
Liste des figures
Liste des tableaux
Liste des photos