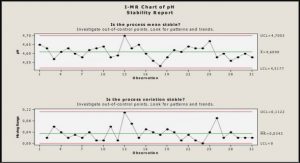Les fermetures récentes, ou en cours, de grands sites de production industrielle cristallisent les préoccupations économiques, politiques et sociales de la société française. La mise à l’arrêt des fours sidérurgiques de l’usine ArcelorMittal à Florange, la fermeture du site de production automobile d’Aulnay-sous-Bois de Peugeot-Citroën ou la restructuration des activités de recherche pharmaceutique du groupe Sanofi, remettent en cause l’emploi de milliers de personnes ainsi que l’avenir de nombreux sous-traitants. La poursuite du phénomène de globalisation et de fragmentation de l’industrie manufacturière combinée à une longue crise économique, affecte ainsi très fortement l’industrie manufacturière française et européenne. Les inquiétudes sur la délocalisation des entreprises se transforment en crainte d’ « une perte de substance de l’industrie » (Fontagné & Lorenzi, 2005, p.9).
Or, si l’industrie manufacturière représente une part de plus en plus faible de l’emploi et de la valeur ajoutée dans l’économie, ce secteur demeure un moteur de l’économie par ces exportations et son rôle dans l’innovation (Le Blanc, 2009). A ce contexte économique morose s’ajoute une transformation importante des marchés de l’énergie dans le monde. Les appréhensions d’hier sur la disponibilité des ressources en énergie cèdent le pas à celles sur le réchauffement climatique (Percebois & Mandil, 2012). Les nouvelles ressources en gaz et en pétrole non conventionnels semblent pouvoir satisfaire la très forte croissance de la demande d’énergie, surtout dans les pays émergents. Cependant, à mesure que les marchés de l’énergie se réorientent vers les pays émergents, des tensions de plus en plus fortes apparaissent sur les prix de l’énergie. Quelles sont les conséquences d’une asymétrie croissante des prix de l’énergie sur l’industrie ?
INCERTITUDES SUR LA COMPETITIVITE INDUSTRIELLE ET SUR L’AVENIR DU SYSTEME ENERGETIQUE
Le sujet de la thèse, l’effet des prix de l’énergie sur la compétitivité de l’industrie, s’inscrit dans un contexte économique, politique et social polémique et incertain. D’une part, la crise financière et économique affecte fortement l’industrie française et européenne. Malgré une reprise hésitante entre 2010 et 2011, la « crise après la crise » sur les dettes souveraines place l’industrie dans une situation critique, dont les nombreux cas de fermetures et de dépôts de bilan sont le reflet. Le resserrement budgétaire des finances publiques réduit, de plus, la probabilité d’une intervention gouvernementale. L’incertitude sur l’avenir de l’industrie est très forte, tant d’un point de vue économique que social et les moyens d’action sont restreints (CEPII, 2011).
D’autre part, la problématique de l’énergie, même si elle peut paraître secondaire dans la situation économique actuelle, demeure au cœur des grands enjeux français et mondiaux des années à venir. Face à une demande mondiale en énergie en forte croissance, les marchés de l’énergie vont considérablement évoluer dans un avenir proche, s’orientant de plus en plus vers les pays émergents. Malgré les nouvelles sources d’énergie découvertes, pétrole offshore au Brésil et gaz non conventionnels aux Etats-Unis et en Australie, la question de la dépendance énergétique demeure essentielle du fait des incertitudes importantes sur l’accessibilité et sur les prix des combustibles fossiles dans le futur. A cela s’ajoutent les enjeux du réchauffement climatique qui vont vraisemblablement devenir plus contraignants que les problèmes liées aux limites géologiques des réserves d’énergie (Percebois & Mandil, 2012). Néanmoins, un accord international sur une réduction concertée des émissions de gaz à effet de serre semble encore lointain, d’où une possible asymétrie importante et persistante des contraintes environnementales sur les économies. Notamment, des objectifs précis ont été mis en place en Europe, avec le plan d’action « énergie climat » qui a pour but de mettre en place une politique commune de l’énergie plus durable et de lutter contre les changements climatiques . L’atteinte de ces objectifs, ainsi que la remise en question de la production nucléaire après l’accident de Fukushima, impliquent une redéfinition de la stratégie énergétique des pays européens. Cela constitue alors d’intenses débats parmi lesquels les prix de l’énergie représentent un enjeu majeur de toute politique énergétique ou environnementale.
LA COMPETITIVITE INDUSTRIELLE D’UN POINT DE VUE ECONOMIQUE, POLITIQUE ET SOCIAL
LA PLACE DE L’INDUSTRIE DANS L’ECONOMIE
Les fermetures emblématiques de sites de production dans les secteurs traditionnels de l’industrie française, telles que la sidérurgie, l’automobile, mais aussi dans la recherche pharmaceutique, soulèvent des inquiétudes grandissantes sur l’avenir de l’industrie en France. Malgré les réponses théoriques avancées par les économistes, sur « une évolution naturelle des économies avancées », il semble qu’il ne soit plus uniquement question d’une réorganisation mondiale des spécialisations industrielles mais bien d’une possible « perte de substance de l’industrie française » (Fontagné & Lorenzi, 2005, p.9). La compétitivité industrielle apparaît cruciale dans ce contexte. Afin d’aborder cette problématique de l’avenir industriel en France et en Europe, nous présentons d’abord les dernières évolutions de l’industrie, sa situation dans l’économie et les conséquences sociales de son affaiblissement. Enfin, une discussion est ouverte sur les possibles politiques de stratégie industrielle.
Le poids de l’industrie dans l’économie française
Avant toute considération sur l’avenir de l’industrie, il convient de définir le poids de l’industrie dans l’économie. Différents périmètres sont possibles pour définir l’industrie. Tout au long de cette thèse, ce périmètre sera limité à l’industrie manufacturière . Les industries énergétiques et extractives sont exclues. Cette définition de l’industrie comprend alors les secteurs suivants :
– Industries agricoles et alimentaires
– Industries des biens de consommation
– Industrie automobile
– Industries des biens d’équipement
– Industries des biens intermédiaires .
L’industrie regroupe les secteurs économiques possédant les trois caractéristiques économiques suivantes : standardisation des produits et des procédés, rythme important d’innovation et niveau très élevé d’immobilisation et d’investissement en capital (matériel ou immatériel), (Le Blanc, 2005). L’industrie demeure une composante très importante de l’économie française, avec des effets d’entrainement considérables sur l’économie toute entière (CPCI, 2009). Ces effets d’entrainement se présentent sous trois formes différentes: les consommations intermédiaires, les gains de productivité et l’innovation (Le Blanc, 2005).
Dans son ensemble, l’industrie manufacturière représente un chiffre d’affaire global d’environ 7230 milliards d’euros, en 2008, pour toute l’Union européenne des 27 (UE), réparti sur 2.1 millions d’entreprises industriels employant 34 millions de personnes (Eurostat, 2012a). l’industrie manufacturière européenne est surtout concentrée dans cinq pays : l’Allemagne, l’Italie, la France, le Royaume-Uni et l’Espagne. Ces cinq pays regroupent environ 70 % du chiffre d’affaire industriel dans l’UE, en 2008. L’Allemagne est de loin le premier producteur industriel européen. Pour la France, le chiffre d’affaire, en 2008, s’élève à 989 milliards d’euros répartis dans 235 000 entreprises employant environ 3.6 millions de personnes.
La structure des industries manufacturières européennes indique la spécialisation sectorielle des pays européens . L’Allemagne, principal producteur et exportateur de biens manufacturés en UE, produit principalement des équipements mécaniques et électroniques, des automobiles, des produits chimiques et des métaux. La France et l’Espagne possèdent des spécialisations industrielles assez proches, avec une part importante des industries agro-alimentaires (IAA), des transports (automobile, aéronautique) et des minéraux non-métalliques. Ensuite, l’Italie se distingue par une forte production dans le textile, l’habillement et le cuir. L’industrie polonaise se caractérise par une activité importante dans les IAA ainsi que dans la production de minéraux non-métalliques. La Suède est surtout spécialisée dans les industries du bois et du papier. Le Royaume-Uni possède une spécialisation industrielle assez proche de la structure moyenne de l’UE, avec un avantage dans les transports (non automobiles). La Suisse, en-dehors de l’UE, est beaucoup plus spécialisée, avec une très forte part de la chimie et des équipements mécaniques, électroniques et électriques. Ces données décrivent des contrastes significatifs dans les spécialisations industrielles nationales en Europe. Toute intervention industrielle de type sectoriel de la part de l’Union européenne, induit donc des effets inégaux entre les pays, notamment dans le cas d’une taxe carbone ou d’une régulation sur l’énergie (Le Blanc, 2005).
|
Table des matières
SOMMAIRE
INTRODUCTION GÉNÉRALE
CHAPITRE I ENERGIE ET COMPETITIVITE : QUELS SONT LES ENJEUX POUR L’INDUSTRIE ?
SOMMAIRE DU CHAPITRE 1
INTRODUCTION
1.1) INCERTITUDES SUR LA COMPETITIVITE INDUSTRIELLE ET SUR L’AVENIR DU SYSTEME ENERGETIQUE
1.1.1) La compétitivité industrielle d’un point de vue économique, politique et social
1.1.2) Un débat sur la question énergétique
1.1.3) Conclusion sur le contexte économique et énergétique
1.2) L’ENERGIE DANS L’INDUSTRIE MANUFACTURIERE : LES INDUSTRIES GRANDES CONSOMMATRICES D’ENERGIE
1.2.1) La consommation d’énergie dans l’industrie manufacturière
1.2.2) Structure économique des IGCE : Des secteurs homogènes ?
1.2.3) Adaptation des IGCE face aux enjeux énergétiques et climatiques
1.2.4) Conclusion sur la place de l’énergie dans l’industrie
1.3) LA NOTION DE COMPETITIVITE DANS L’INDUSTRIE
1.3.1) Une nécessaire qualification du concept de compétitivité
1.3.2) Proposition de classification des facteurs de compétitivité industrielle
1.3.3) Le lien entre énergie et compétitivité dans l’industrie
1.3.4) Conclusion sur la notion de compétitivité industrielle et son lien avec l’énergie
CONCLUSION DU CHAPITRE I
CHAPITRE II QUANTIFICATION EMPIRIQUE DE L’IMPACT DES PRIX DE L’ENERGIE
SOMMAIRE DU CHAPITRE II
INTRODUCTION
2.1) UN CADRE METHODOLOGIQUE POUR ETUDIER LES DETERMINANTS DE LA COMPETITIVITE
2.1.1) Une approche économétrique déterminée par l’échelle d’étude
2.1.2) Définition du cadre sectoriel, géographique et temporel des travaux
2.1.3) Acier et Papier : Deux secteurs en transition
2.1.4) L’énergie dans les coûts de production des industries de l’acier et du papier
2.2) EFFETS DES COUTS DE L’ENERGIE SUR LES ECHANGES INTERNATIONAUX DE PRODUITS MANUFACTURES
2.2.1) Dans la littérature, des modèles de gravité qui s’orientent vers des études sectorielles
2.2.2) Construction des modèles de gravité des échanges internationaux pour les industries du papier et de l’acier
2.2.3) Comparaison du rôle des coûts de l’énergie dans les échanges de produits manufacturés Ressemblances et divergences entre les industries du papier et de l’acier
2.2.4) Conclusion sur l’effet des coûts de l’énergie sur les échanges internationaux
2.3) POIDS RELATIF DES COUTS DE L’ENERGIE DANS LA COMPETITIVITE DE LA PRODUCTION NATIONALE DES INDUSTRIES DU PAPIER ET DE L’ACIER
2.3.1) L’abondance des ressources et la proximité des marchés au cœur des précédentes recherches
2.3.2) Construction d’un modèle d’analyse en données de panel sur les industries du papier et de l’acier
2.3.3) Résultats : L’énergie n’est pas le principal déterminant de la localisation de la production des industries du papier et de l’acier
2.3.4) Conclusion sur la comparaison des déterminants de la compétitivité dans les industries du papier et de l’acier
2.4) LE ROLE DE L’ENERGIE DANS L’EVOLUTION DES CAPACITES DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE
2.4.1) Bibliographie : Des modèles utilisés pour étudier la survie des entreprises et des usines
2.4.2) Construction des modèles de changements de capacité pour une application sur la sidérurgie au niveau mondial
2.4.3) Résultats Des prix élevés de l’énergie augmentent les risques de fermeture des capacités sidérurgiques
2.4.4) Conclusion de l’étude sur l’évolution des capacités de production dans la sidérurgie
CONCLUSION DU CHAPITRE II
CHAPITRE III PRISE EN COMPTE DE L’ENERGIE GRISE DANS LE BILAN ENERGETIQUE DE L’INDUSTRIE : CONSEQUENCES SUR LA COMPETITIVITE
SOMMAIRE DU CHAPITRE III
INTRODUCTION
3.1) LA NECESSAIRE PRISE EN COMPTE DES FLUX D’ENERGIE DANS LES PRODUITS INDUSTRIELS
3.1.1) La nouvelle géographie de l’industrie requiert une mesure plus fine de l’énergie contenue dans les produits manufacturés
3.1.2) Méthodes existantes d’analyse du contenu des produits manufacturés : des travaux surtout orientés vers le CO2
3.1.3) Construction d’un modèle mondial intégrant les flux d’énergie dans l’industrie
3.1.4) Conclusion sur l’apport de ce nouveau modèle
3.2) BILAN GLOBAL PAR SECTEUR ET PAR PAYS DE L’ENERGIE GRISE
3.2.1) Une nouvelle carte des flux énergétiques dans le monde et en France
3.2.2) L’origine géographique et sectorielle des consommations d’énergie implique une dépendance forte de l’industrie aux prix non-domestiques de l’énergie
3.2.3) Conclusion sur le bilan global de l’énergie et du CO2 contenus dans les produits manufacturés
3.3) APPLICATIONS : DEMANDE ENERGETIQUE ET TAXE CARBONE
3.3.1) Impact d’un changement structurel de l’industrie sur la demande en énergie
3.3.2) Effets distributifs d’une taxe carbone européenne sur les pays et sur les secteurs industriels
CONCLUSION DU CHAPITRE III
CONCLUSION GENERALE
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet