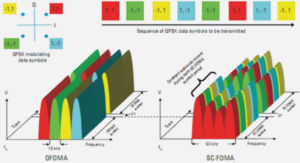Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Objectifs du projet
Les objectifs sont l’affirmation des effets escomptés et à atteindre dans un délai déterminé auquel le résultat du projet vacontribuer en fin d’exécution ou de concrétisation. Ainsi, selon les délais à respecter, les objectifs peuvent être répartis en objectif à court terme, c’est-à-dire dans un délai d’un an ou moins ; et les objectifs à long terme, c’est-à-dire dans un délai qui dépasse cinq ans.
Objectifs à court terme :
Introduire l’utilisation des énergies renouvelables à Madagascar. Bien que les énergies renouvelables existent depuis belle lurette, ça reste une source d’énergie méconnue chez nous alors qu’elles pourraient être une technologie bénéfique pour notre pays.
Minimiser les méfaits de l’instabilité du prix des carburants. En utilisant les énergies renouvelables, nous diminuons notre dépendance envers les ressources rares telles que le pétrole, le charbon, et le fioul.
Mettre une pression sur le marché monopolisé par une seule compagnie d’électrification. En augmentant cette concurrence, nous pourrons faire baisser le prix de l’électricité au KWh et ainsi rendre plus accessible à la majorité de la population l’électricité.
Objectifs à long terme :
Protéger l’environnement. Cela peut se faire par la diminution de nos gaz carbonique à effet de serre si l’on utilise des énergies propres, donc renouvelables. Ce qui éviterait ensuite la dégradation de la couche d’ozone, donc le ralentissement du réchauffement climatique. Electrifier les zones rurales, les sites isolés, et les villes n’ayant pas accès à l’électricité. L’électrification de toutes les zones rurales à forte potentialité économique ou artisanale peut se faire par l’instalation des sites d’énergie renouvelable. Pour cela, on peut avoir recours à un accord partenarial avec l’Etat.
Fournir l’électricité à des entreprises industrielles. La JIRAMA à elle seule ne pourra plus satisfaire les besoins grandissants en matière d’énergie des entreprises industrielles à Madagascar.
Nous avons vu dans cette section tous les caractéristiques de l’énergie renouvelable et cela nous a permis de formuler des objectifs pour éliminer les problèmes ou du moins minimiser leurs impacts. Arrivé à ce stade de l’étude, nous avons une bonne connaissance de l’énergie renouvelable et nous connaissons les mobiles qui nous ont poussé à la formulation de ce projet.
Environnement du projet
Le but de cette étude est de définir objectivement l’environnement dans lequel vivra le projet pour en connaître les forceséventuelles ainsi que les faiblesses.
On parle d’environnement général lorsque le projet ne peut influer sur l’ensemble des variables qui agissent sur lui. Autrement dit, l’environnement général.
est constitué d’un ensemble de facteurs économiques, culturels, techniques et juridiques qui s’imposent au projet et définissent ainsi son cadre d’action.
L’environnement spécifique regroupe tous les éléments qui influencent directement le projet mais sur lesquels il peut agir en retour en fonction de son importance du point de vue pertinence, efficacité, efficience et impact.
Environnement politique
L’environnement politique du projet se caractérise par l’appui que le pouvoir central peut apporter au projet à des fins bénéfiques pour le pays. Dès le début du XXIè siècle et en phase de développement apider et durable, le gouvernement malgache a mis dans son programme l’électrification du monde rural. D’ailleurs le projet coïncide exactement avec les spirations du pouvoir central qui est de promouvoir le secteur énergie.
Environnement économique
L’environnement économique se matérialise par les retombés économiques que pourrait engendrer le projet. Comme nous savons tous, le taux d’électrification de notre pays est actuellement faible. Le système d’électrification est basé sur l’utilisation des centrales thermiques et peu de sources hydroélectriques alors que le pays dispose d’énormes potentiels électriques au nord et au sud malheureusement inexploités. Ces sources pourront ê tre exploitées pour se libérer de la dépendance des produits pétroliers qui gonflent lourdement la valeur de nos importations. Toutefois, dans le cas de notre pays, l’énergie peut être un facteur d’accélération du développement rapide.
Environnement social
L’environnement social est constitué par la responsabilité du projet envers la société qui l’entoure car il peut permetre la pérennisation du projet.
Environnement technologique
L’environnement technologique consiste à adopter des nouvelles techniques à des fins positives. Pour le cas de notre pays, le projet pourrait être une nouvelle technologie à maîtriser.
Environnement écologique
L’environnement écologique concerne la responsabilité du projet envers la faune et la flore. Après de longues années, l’environnement écologique est maintenant devenu un facteur très important à considérer dans l’élaboration d’un projet et dans la prise de décision à cause des problèmes du réchauffement climatique..
Environnement légal
L’environnement légal regroupe toutes les règlementations et les interdictions imposées au projet que ce dernier se doit de respecter.
Ayant pu définir l’environnement général et spécifique du projet, cette section peut se conclure par la constatation des forces du projet au sein de chaque environnement bien défini. Nous pouvons donc affirmer que le projet est bénéfique à l’égard de son environnement.
Identification de la société
Pour cette dernière section, le but de notre étude est d’avoir une vision globale de la future entreprise. Cette partie définit et donne les caractéristiques des produits de la future entreprise tout en énonçant esl modalités pour la formalité administrative.
Présentation de l’entreprise
Cadre juridique de l’entreprise :
Le statut juridique de la société se présente commesuit :
· Siège social : Antananarivo (Région Analamanga)
· Forme juridique : Société anonyme (S.A)
· Dénomination : Energie renouvelable de Madagascar (E.R.M)
· Activités : Achat et revente d’éoliennes et des équipements solaires, études et prestations, électrification d’une localité.
· Capital : Ar 15 000 000
Modalités de constitution2 :
En tant que société anonyme, la constitution du capital se fera par l’appel public à l’épargne. La constitution se déroule en quatre étapes qui se terminent par l’accomplissement d’une formalité externe.
Etape 1 : la fondation
Le ou les fondateurs rédigent les statuts, déposent le projet sur papier libre au greffe du tribunal de commerce et signent une notice qu’ils doivent publier au bulletin des annonces légales obligatoires avant toute inscription et préalablement à toute mesure de publicité.
Etape 2 : la souscription et le versement du capital
Le capital doit être intégralement souscrit. Un bul letin de souscription constate les souscriptions d’actions en numéraire ; celles-ci doivent être libérées d’un quart au moins de leur valeur nominale. Les fonds recueillis sont déposés pour le compte de la société en formation soit à la caisse de dépôt et de consignation, soit chez un notaire, soit dans une banque. Les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation des bulletins de souscription.
Etape 3 : l’assemblée constitutive
L’assemblée constitutive réunit tous les souscripteurs et constate que le capital est entièrement souscrit et que les actions sont libérées du montant exigible. L’assemblée se prononce sur l’adoption des statuts, nomme les premiers administrateurs et désigne les commissaires aux comptes.
Etape 4 : la constitution définitive
La société est définitivement constituée à l’issue de l’assemblée constitutive. Toutefois, la société n’acquiert la ouissancej de la personnalité morale qu’après l’immatriculation au registre des commerces et des sociétés. Cependant, au préalable, les fondateurs ainsi que les premiers dirigeants sociaux doivent établir et signer la déclaration de conformité et faire insére un avis signé par le notaire qui a reçu l’acte de société dans un journal d’annonceségales.
Remarque : Lorsque les apports ont été effectués en nature,leur évaluation doit être approuvée par les associés réunis en assemblée constitutive sur rapport des commissaires aux apports.
ETUDE DE MARCHE ET STRATEGIES GENERIQUES
Nous tenterons dans ce chapitre de montrer les données fiables et pertinentes recueillies à travers les investigations afin de faire une analyse concrète du marché. L’étude de marché doit répondre aux questions : Qui ? Quoi ? Où ?
Quand ? A quel prix ? et Pourquoi ?. L’étude de marché a donc pour objet d’évaluer le projet par rapport à son environnement (offre, demande), de donner les moyens d’identifier et de localiser les concurrents, leur nombre, ainsi que l’intensité concurrentielle du secteur. Nous ferrons aussi une analyse minutieuse du marché pour avoir une bonne idée sur la situation qui présage dans le secteur où l’entreprise va se positionner. Pour l’étude de marché, nous allons établir successivement l’analyse de l’offre, de la demande, de la concurrence pour en faire ressortir la part de marché du projet.
Marché
Le marché est le lieu de rencontre des acheteurs qui ont des besoins à satisfaire avec les vendeurs qui proposent un produit clairement identifié dans un secteur donné.
Présentation du marché
Cette section délimite le secteur où l’entreprise va se positionner tout en énonçant les caractéristiques du secteur.
Analyse du secteur d’activité
Le précurseur de l’analyse sectorielle est Michael Porter qui repose sur la notion de secteur constitué par l’ensemble des firmes produisant des produits fortement substituables. Pour chaque firme, l’objectif est d’obtenir au sein du secteur un avantage concurrentiel défendable sur la longue période en agissant sur les forces caractéristiques du secteur.
Selon Porter, la dynamique d’un secteur d’activité est conditionnée par cinq forces qui sont :
· La pression concurrentielle,
· les nouveaux arrivants,
· les produits de substitution,
· les fournisseurs,
· et les clients.
Pour notre cas, le secteur tertiaire se compose aussi d’agents et de facteurs :
· Les agents sont les producteurs en présence et en concurrence ; les intermédiaires (distributeurs et prescripteurs) ; et les consommateurs.
· Les facteurs sont ceux de l’environnement (législatif et réglementaire, économique, technologique, sociologique, culturel, …)
Situation actuelle du marché
Outre la grande couverture du JIRAMA sur l’île (cf .tableau N°01), il existe d’autres opérateurs sur l’énergie renouvelable et les barrages hydro-électriques.
Les autres opérateurs alimentent 1465 personnes à Ambondromamy dans la région de Boeny et 605 personnes à Ambatosoratra dans la région d’Alaotra Mangoro. Ces autres opérateurs se composent de la société EDM et RAVEL.
Pour l’énergie renouvelable, MAD’EOLE alimente 156 personnes à Sahasifotra dans la région de Diana et deux autres sociétés alimentent 788 personnes à Ranomafana et 588 personnes à Mangamila. Pour les projets en cours de réalisation, 576 personnes bénéficieront de l’électricité à Amboasary dans la région d’Alaotra et 2288 personnes à Ankazomiriotra dans la région de Menabe.
Ainsi, d’après ces dires, nous pouvons donc conclure que 4396 personnes sont alimentées par des opérateurs dans ’énergiel renouvelable. Quoi qu’il en soit, ces chiffres seront nettement analysés dans l’analyse de l’offre et de la demande.
Analyse de l’offre
L’offre regroupe tous les producteurs et distributeurs présentant leurs produits sur le marché tout en essayant d’accaparer leurs parts de marché respectives. L’étude de l’offre permet de voir clair sur le marché local et d’estimer l’offre.
Marché local
Une grande partie de l’offre sur le marché est dominée par l’énergie conventionnelle représentée par la société JIRAMAqui détient 15,93% du marché. L’énergie renouvelable couvre 0,035% de l’offre sur le marché.
Estimation de l’offre
Etant donné que nous avons choisi la partie nord et sud de l’île, notre offre se focalisera sur ces deux parties. On peut estimer l’offre par la capacité totale des produits écoulés sur le marché sur les cinq années d’exploitation et de ce fait, le nombre des habitants bénéficiant de l’électricité.
Analyse de la concurrence
La concurrence est le combat que mène chaque société qui se trouve sur le marché pour obtenir le monopole ou avoir une part de marché par des stratégies marketing élaborées au préalable, aprèsavoir étudié des données fiables.
La concurrence directe et indirecte5
Les concurrents directs sont ceux qui commercialisent des produits similaires à notre société en utilisant les mêmes principes de distribution. Les principaux concurrents directs sont :
· la société TENEMA,
· la société IET,
· la société MAD’EOLE,
· la société TED,
· la société MAJINCO,
· la société SOLAR’MAD.
Les concurrents indirects sont ceux qui sont présents sur le marché en adoptant d’autres techniques et technologies tout en ayant une incidence sur la part de marché de chacun. Les principaux concurrents indirects sont :
· la société JIRAMA,
· la société BIONERR,
· la société EDM,
· la société RAVEL,
· la société POWER & WATER,
· la société HYDELEC,
· la société GREAT,
· la société VITASOA.
Forces et faiblesses des concurrents
Une des grandes forces des concurrents est le fait qu’ils ont déjà un réseau de distribution établi sur le marché tout enayant une relation de confiance avec leurs collaborateurs sur le marché. Mais leur faiblesse demeure dans le fait qu’ils n’arrivent pas à dominer les coûts et ne peuvent offrir un prix intéressant aux acheteurs.
Positionnement de la société
Face à tous ces opérateurs et concurrents, notre société est un nouveau entrant sur le marché et va essayer de s’imposer en cherchant sa part de marché tout en accaparant celle des autres.
Part de marché
La part de marché potentielle s’obtient par le nombre des consommateurs relatifs déduit du taux de desserte national. Pour pouvoir identifier les consommateurs relatifs, on doit mettre en évidence le taux d’activité à Madagascar pour bien isoler les personnes qui ont le pouvoir d’achat pour notre produit. Le taux d’activité à MADAGASCAR est de 64,6% dont 88,1% pour les âgés de 15 à 64ans ; 65,3% pour les âgés de plus de 65 a ns et 19,6% pour les âgés de 6 à 14 ans. La part de marché potentielle s’obtient par le nombre de consommateurs relatifs déduit du nombre de la population ayant accès à l’électricité. Les consommateurs relatifs sont ceux qui ont le pouvoir d’acheter les produits, c’est-à-dire les cadres, les salariés et les indépendants sur tout le territoire national (cf. tableau N°04).
Part de marché potentielle = Consommateurs relatifs – Taux de desserte national Part de marché potentielle = 47,7% – 15,97% = 31,73%.
Donc, notre part de marché potentielle s’élève à 31,73%. Ce qui signifie que 31,73% de la population démunie d’électricité ont le pouvoir d’acheter les produits de la société. Pour pouvoir identifier la part de marché réelle, l’élaboration d’un questionnaire s’impose. Le résultat du questionnaire après dépouillement peut chiffrer la part de marché réelle. La part de marché s’obtient par le nombre de la population ayant le pouvoir d’achat des produits et qui veulent acheter le produit. Après dépouillement du questionnaire sur un échantillon représentatif, on a déduit que notre part de marché s’élèverait à 2,64%. Il est à noter que la base de données regroupant le dépouillement du questionnaire se trouve en annexe.
Stratégies génériques
Nous tenterons dans cette section d’exposer des théories sur la stratégie et d’expliquer la mise en application de cette dernière afin de suivre la concurrence qui s’établit sur le marché. Pour cette étude, nous allons établir successivement les théories sur les stratégies et les stratégies à adopter.
Théories sur les stratégies
La stratégie « PUSH » et « PULL »
La stratégie « Pull » consiste à communiquer l’exis tence du produit à l’attention du consommateur final en utilisant notamment la publicité, pour l’attirer vers le produit.
La stratégie « Push » vise à pousser le produit ver s le consommateur, à l’aide notamment de la force de vente, de la promotion et/ou en stimulant les intermédiaires de la distribution.
La stratégie de Michael Porter6
Dans son livre intitulé « Stratégie et concurrence », porter définit la stratégie comme une combinaison des fins que s’efforce d’atteindre la firme et des moyens par lesquels elle cherche à les atteindre.
Selon Porter, pour affronter les cinq forces concurrentielles, l’entreprise dispose de trois grands types de stratégies :
· la domination par les coûts notamment par l’obtent ion d’une dimension suffisante génère des économies d’échelle c’est-à-dire des baisses des coûts liées à de longues séries (production de masse) et des effets d’expérience c’est-à-dire des baisses des coûts provenant de la maîtrise progressive des techniques qui engendrent des gains de productivité. La domination par les coûts correspond souvent à une production et à une distribution de grande masse ou en grande série ;
· la différenciation qui confère aux produits de l’entreprise des caractères distinctifs par rapport aux concurrents grâce à des innovations techniques, logistiques ou commerciales ;
· la spécialisation des activités qui permet la concentration des ressources sur un segment particulier où l’entreprise peut acquérir un avantage concurrentiel.
La politique Marketing Mix7
D’après Kotler & Dubois, Marketing Mix, c’est l’ensemble des outils dont l’entreprise dispose pour atteindre ses objectifs auprès du marché cible.
Le plan de marchéage se fondait essentiellement selon Jérôme McCarthy (1960) mais largement vulgarisé par Philip Kotler sur la règle dite des 4 P, ces quatre politiques définissent le produit au sens large et ses implications commerciales au plan :
product (produit) : la politique de produit (choix de la gamme de produits, profondeur de gamme, largeur de gamme,…). Le mot pr oduit est employé au sens générique et comprend donc aussi les services qui, dans la société postindustrielle, représentent une part de plus en plus grande des offres marketing. Pour le cas de notre projet, la future entreprise se munira des produits de haut de gamme et fiables. Nous pourrons offrir aux futurs clients des garantis sur l’achat de marchandises.
price (prix) : la politique de prix (écrémage, pénétration, prix d’acceptabilité, rentabilité,…). Les prix de nos produits sont les plus bas sur le marché en raison du choix des fournisseurs.
place (distribution) : la politique de distribution (choix du réseau et des canaux de distribution, force de vente,…). La distr ibution de la future entreprise inclut également le commerce électronique. promotion (communication) : la politique de communication (choix du type de publicité, promotion, marketing direct, relations publiques,…). Nous avons opté une politique de communication par la voie des publicités qui seront inclus dans un budget bien défini.
Les démarches préalables à la définition du marketing mix sont le diagnostic interne et externe de l’entreprise qui aboutissent à la définition d’objectifs en termes de segmentation du marché.
Stratégies à appliquer
La stratégie permet à l’entreprise d’atteindre ses objectifs en terme de rentabilité et de rendement tout en ayant un avantage compétitif sur le marché vis-à-vis de ses concurrents. Dans notre projet, les stratégies retenues sont la stratégie Pull et Push à domination Pull, la stratégie de Michael Porter et le Marketing Mix.
La stratégie Pull et Push à domination Pull pour inciter les consommateurs relatifs à l’achat du produit. La stratégie de Porter pour dominer les coûts afin d’offrir aux consommateurs un prix raiso nnable et compétitif face à ceux des concurrents. La stratégie de Marketing Mix pour une bonne politique de prix,de distribution,de produit et de communication.
A travers cette section, on a pu définir les stratégies à appliquer pour pouvoir accaparer notre part de marché et celle des autres.
Ce chapitre nous a permis de mettre à nu toutes les facettes du marché avec les acteurs qui agissent dans ce marché en analysant les opportunités à saisir et les menaces à éviter. Nous avons pu au cours de ce chapitre définir les stratégies à appliquer pour conquérir le marché.
|
Table des matières
Introduction
PARTIE I : IDENTIFICATION DU PROJET
CHAPETER1. PRESENTATION DU PROJET
Section 1 : Caractéristiques du projet
1.1- Définition et domaines des énergies renouvelables
Définition
Evolution
Energies non renouvelables
Conditions géographiques
Stockage et distribution
Avantages escomptés
Avantages sur le plan environnemental
Avantages sur le plan social
Avantages sur le plan économique
Avantages en terme géopolitique et de sécurité
Contraintes et limites
Intégration paysagère
Situation actuelle
1.2- Objectifs du projet
1.2.1- Objectifs à court terme :
1.2.2- Objectifs à long terme :
Section 2 : Environnement du projet
2.1- Environnement politique
2.2- Environnement économique
2.3- Environnement social
2.4- Environnement technologique
2.5- Environnement écologique
2.6- Environnement légal
Section 3 : Identification de la société
3.1- Présentation de l’entreprise
3.1.1- Cadre juridique de l’entreprise :
3.1.2- Modalités de constitution :
3.2- Présentation des produits
3.2.1- L’éolienne
Étymologie
Historique
Définition
Fonctionnement
Avantages
L’avenir de l’énergie éolienne
3.2.2- L’énergie solaire
Historique
Nature et définition de l’énergie solaire
Energie solaire dans le présent et le futur
Le boom des objets solaires
Le soleil est-il l’énergie de demain ?
CHAPITRE2: ETUDE DE MARCHE ET STRATEGIES GENERIQUES
Section 1 : Marché –
1.1- Présentation du marché
1.1.1- Analyse du secteur d’activité
1.1.2- Situation actuelle du marché
1.2- Analyse de la demande
1.2.1- Identification de la clientèle
1.2.2- Demande potentielle
1.2.3- Evaluation de la demande
1.2.4- Freins et motivations d’achat
1.3- Analyse de l’offre
1.3.1- Marché local
1.3.2- Estimation de l’offre
1.4- Analyse de la concurrence
1.4.1- La concurrence directe et indirecte
1.4.2- Forces et faiblesses des concurrents
1.4.3- Positionnement de la société
1.5- Part de marché
Section 2 : Stratégies génériques
2.1- Théories sur les stratégies
2.1.1- La stratégie « PUSH » et « PULL »
2.1.2- La stratégie de Michael Porter
2.1.3- La politique Marketing Mix
2.2- Stratégies à appliquer
PARTIE II : ETUDE DE FAISABILITE TECHNIQUE ET ORGANISATIONNELLE
CHAPITRE 1: ETUDE TECHNIQUE
Section 1 : Climat de Madagascar
1.1- Le vent
1.2- Ensoleillement et température
Section 2 : Etude des produits
2.1- L’éolienne
Types d’éoliennes
Caractéristiques techniques
Le stockage
Critères de choix de l’implantation éolienne :
Le vent
Autres critères
Sur la terre ferme
Pour les zones isolées et exposées aux cyclones
Pleine mer
Altitude
Villes
Production d’énergie électrique d’une éolienne
Modalités de freinage et d’arrêt
Régulation et freinage par basculement de l’éolienne
Régulation aérodynamique sur les pales
Arrêt par frein à disque automatique
Démantèlement
2.2- L’énergie solaire
Géographie terrestre
Techniques pour capter l’énergie solaire
Energie solaire photovoltaïque
Energie solaire thermique
Energie solaire thermodynamique
Energie solaire passive
Systèmes de production d’énergie solaire
CHAPITRE 2: MOYENS
Section 1 : Moyens matériels
Section 2 : Moyens humains
Section 3 : Aménagement et installation
CHAPITRE3: ETUDE ORGANISATIONNELLE
Section 1 : Organisation
1.1- Organigramme
1.2- Effectif
1.3- Description des tâches
Section 2 : Structure
2.1- Attributions
2.2- Rémunération
2.3- Motivation
Section 3 : Chronogramme des activités
3.1- Démarches administratives
3.2- Délai des opérations
3.3- Démarrage du projet
PARTIE III : ETUDE FINANCIERE ET EVALUATION DU PROJET
CHAPITRE1: ETUDE FINANCIERE
Section 1 : Comptes de gestion
1.1- Les charges
1.1.1- Les achats consommés : compte 60
1.1.2- Les services extérieurs : compte61/62
1.1.3- Les charges de personnel : compte 64
1.1.4- Les charges financières : compte 66
1.1.5- Les dotations aux amortissements et provisions : compte 68
1.1.6- Impôts sur les bénéfices et assimilés : compte 69
1.2- Les produits
1.2.1- Le chiffre d’affaires prévisionnel
1.2.2- Les produits financiers
Section 2 : Evaluation des investissements du projet
2.1- Les immobilisations
2.1.1- Les actifs non courants
2.1.2- Système d’amortissement
2.2- Besoin en fonds de roulement initial
2.2.1- Budget de trésorerie pour la première année
2.2.2- Détermination du FRI
2.3- Plan de financement
2.3.1- Apport propre
2.3.2- Dette à long terme
2.3.3- Tableau de plan de financement
2.4- Remboursement des dettes
2.4.1- Principe adopté
2.4.2- Tableau de remboursement des dettes
Section 3 : Les états financiers prévisionnels
3.1- Bilans prévisionnels des cinq années
3.2- Compte de résultat
Le compte de résultat par nature
Le compte de résultat par fonctions
Tableau N° 38 : Compte de résultat par nature
Tableau N° 39 : Compte de résultat par fonction
Tableau N° 39 : Compte de résultat par fonction
Section 4 : Seuil de rentabilité
CHAPITRE2: EVALUATION DU PROJET
Section 1 : Evaluation financière du projet
1.1- Evaluation suivant les outils d’évaluation :
1.1.1- Calcul de la valeur actuelle nette (VAN)
Avec MBA : Marge Brute d’Autofinancement
1.1.2- Calcul du taux de rentabilité interne
Années
Résultat net
Amts
MBA
MBA actualisée à 28,95%
1.1.3- Mesure du délai de récupération du capital investi (DRCI)
Année
MBA
MBA Cumulée
*Source : Calcul du promoteur
DRCI = 3,19 années soit 3 ans 2mois et 10jours
1.1.4- Calcul du degré de profitabilité
1.2- Evaluation suivant les critères de succès d’un projet :
1.2.1- Evaluation de la pertinence
1.2.2- Evaluation de l’efficience
1.2.3- Evaluation de l’efficacité
1.2.4- Evaluation de l’impact du projet
1.2.5- La viabilité du projet
Section 2 : Evaluation économique et sociale
2.1- Evaluation économique
2.1.1- Impact sur la valeur ajoutée
2.1.2- Impact sur le produit intérieur brut
2.1.3- Electrification des entreprises industrielles
2.1.4- Electrification des zones rurales à forte potentialité économique
2.2- Evaluation sociale
2.2.1- Création d’emploi
2.2.2- Augmentation du taux de desserte national
Section 3 : Hypothèses pessimistes
3.1- Les barrières à l’entrée
3.2- Disponibilité des marchandises
Section 4 : Cadre logique
Conclusion
Annexes
Bibliographie
Télécharger le rapport complet