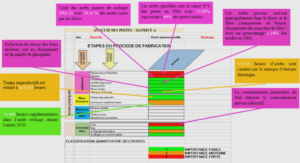ECOLOGIE TROPHIQUE
Origine et évolution de la famille des Canidés
Selon certains auteurs (Van Valkenburgh, 1989 ; Macdonald et al., 2004), La famille des Canidés est originaire d’Amérique du Nord, elle est reconnue dès l’Éocène inférieur il y a environ 40 à 50 Millions d’années (Ma). La sous famille des Caninés est le résultat d’un rayonnement final qui a commencé il y a environ 10 à 12 Ma en Amérique du Nord à partir d’un genre ancien « Leptocyon », déjà connu dès le début de l’Oligocène (Macdonald et al., 2004). Les canidés tels que le loup et le renard ont commencé à diverger juste après, et ces deux lignées ont colonisés indépendamment l’ancien monde. Au cours du Miocène inférieur, ils ont pu quitter l’Amérique du Nord à travers le détroit de Béring pour atteindre l’Eurasie puis l’Afrique. Les canidés arrivent enfin en Amérique du Sud après la formation de l’isthme de Panama il y a environ trois Ma (Macdonald et al., 2004). Tout cela signifie que la famille des Canidés a atteint cette grande diversité connue aujourd’hui en quelques millions d’années seulement (Sillero-Zubiri et al., 2004). Le genre « Canis » est d’abord enregistré autour de la frontière entre le Miocène et le Pliocène (cinq à six Ma) sur le continent Nord Américain, tout en élargissant leur aire de répartition en Eurasie et en Afrique (Sillero-Zubiri et al., 2004).
Phylogénie des Canidés
Il y a eu toujours un grand intérêt à connaitre les relations phylogénétiques au sein des Canidés chez lesquels des progrès importants ont été réalisés dans ce sens au cours des trois dernières décennies. L’analyse du génome complet du chien réalisée par Lindblad-Toh et al. en 2005 afin d’obtenir un ensemble de gènes nucléaires à évolution rapide a permis de répondre, avec un soutien statistique solide, à de nombreuses questions qui restaient jusque là peu claires. En termes d’ordre de ramification et d’affinités les plus proches, des études ont été effectuées sur : Le Chien sauvage Africain, Licaon pictus (Creel & Creel, 2015), le dhole, Cuon alpinus (Venkataraman, 1998), le Loup Ethiopien, Canis simensis (Marino et al., 2012), le Loup gris, Canis lupus (Stenglein et al., 2011 ; Ruprecht et al., 2012 ; Caniglia et al., 2014), le coyote, Canis latrans (Bekoff & Wells, 1982 ; Way, 2003), le Chacal à dos noir, Canis mesomelas (Moehlman, 1979), et le Chacal doré, Canis aureus (Moehlman, 1983).
Organisation sociale et reproduction
L’organisation sociale chez les carnivores est basée sur trois composantes : 1) la taille et la composition des groupes et leur répartition spatio-temporelle ; 2) les modes de reproduction et 3) la structure sociale, définissant les interactions et les relations de parenté entre les individus d’un groupe (Kappeler & Van Schaik, 2002 ; Kappeler et al., 2013). L’unité sociale de base la plus commune chez les Canidés est une paire monogame, qui marque et défend son territoire contre les intrus (Moehlman, 1987) et où les deux parents élèvent mutuellement leur progéniture (Moehlman, 1989). Des différences par rapport à cette unité de base peuvent exister où plusieurs individus matures ont la possibilité de former un même groupe comme chez le Chien sauvage d’Afrique Lycaon pictus (Girman et al., 1997). D’autres canidés peuvent avoir un comportement de polygamie tel que le Renard arctique Vulpes lagopus (Carmichael et al., 2007 ; Cameron et al., 2011).
D’après Khidas (1990), des groupes de Loup doré d’Afrique formés par des femelles et leurs petits sont observés en dehors de la période de reproduction à la recherche de la nourriture. Dans certaines conditions, le groupe peut être plus complexe où le couple reproducteur partage son territoire avec des adultes subordonnés non reproducteurs qui sont habituellement des descendants philopatriques des années antérieures (Moehlman, 1979 ; Girman et al., 1997 ; Sparkman et al., 2011), mais peuvent également être des individus sans rapport avec le couple (Meier et al., 1995 ; Grewal et al., 2004). L’attribution des tâches pour chaque individu au sein du groupe peut être influencée par le sexe ou la position dominante (Mech, 1999) ; le couple dominant guide généralement les activités du groupe (Peterson et al., 2002). Au moment où les petits atteignent la maturité sexuelle, deux chemins différents peuvent être suivis: 1) des individus se dispersent et tentent d’établir un nouveau territoire vu l’intolérance mutuelle qui s’accroit avec l’âge (Le Berre, 1990) ou 2) des individus restent une ou plusieurs années supplémentaires sans quitter leur territoire original en assistant leurs parents à nourrir les descendants des années successives (Moehlman, 1979). La maturité sexuelle du Loup doré d’Afrique est atteinte à l’âge de 10 mois et la reproduction se fait une fois par an à partir du mois de Novembre (Khidas, 1990). Parfois la femelle peut avoir deux portées par an comme il a été signalé par Haltenorth & Diller (1980). Après une gestation de 57 à 63 jours, la femelle mi-bas six à huit chiots (Le Berre, 1990).
Régime alimentaire
Le Loup doré d’Afrique est un prédateur qui occupe le sommet de la chaine trophique au sein de son habitat. Cette espèce est connue comme opportuniste dans son comportement alimentaire, elle s’adapte à une large gamme de climat et utilise les ressources trophiques selon leur disponibilité (Amroun et al., 2014). Une diversité importante dans son spectre alimentaire a été soulignée par diverses études dans différentes régions où il a été montré qu’il se nourrit de fruits, d’invertébrés, de reptiles, d’oiseaux, de rongeurs, de mammifères de tailles différentes et même de déchets organiques (Amroun et al., 2006 ; Oubellil, 2011 ; Amroun et al., 2014 ; Maynard, 2015). Selon la disponibilité et l’accessibilité, la contribution de chaque aliment peut varier d’une région à une autre. Certains auteurs signalent que les mammifères de petites tailles constituent la part la plus importante de son spectre alimentaire (Amroun et al., 2006 ; Maynard, 2015), alors que d’autres parlent d’une tendance vers les proies de grandes tailles, principalement le sanglier et les ovins (Amroun et al., 2014 ; Eddine et al., 2017).
Situation géographique
La réserve de chasse de Tlemcen est située dans la partie Nord-ouest d’Algérie à 26 km au Sud-ouest du chef lieu de la Wilaya de Tlemcen et à environ 10 Km de la Daïra de Sabra (Fig. 4). Elle fait partie de la forêt domaniale de Hafir et occupe la zone la plus culminante et la plus boisée des monts de Tlemcen. En consultant la carte de situation géographique de la réserve établie par les anciennes études, des anomalies ont été relevées telles que les coordonnées géographiques non exactes, le périmètre en deçà du réel et une échelle peu précise. Suite à cela, nous avons établi une nouvelle carte à partir d’un masque des limites réelles de la réserve. Les coordonnées exactes de latitude et de longitude ont été également corrigées. Ainsi, la RCT est comprise exactement entre une latitude de 34°43’45,27¨N à 34°47’28,22¨N au lieu de 34° 41’ à 49’ et une longitude de -1°26’32,55¨E à -1°30’21,62¨E au lieu de 1° 25’ à 35’. La superficie de la réserve est de 2156 km2 avec un périmètre de 25,04 km au lieu de 15 km. En se basant sur un extrait d’une image satellitaire LANDSAT 8 (2014) et sur nos relevés de terrain, nous avons corrigé la situation des agglomérations limitrophes de la réserve qui devient : la commune de Sabra au Nord-ouest, le village de Hafir à Est, le village de Tamaksalet à l’Ouest, le village d’Ain Fetouh au Sud-est et le barrage de Beni Bahdel au Sud.
Les 21.56 km2 de la RCT s’étale sur le territoire de quatre communes dont celle de Bouhlou qui à elle seule occupe la plus grande partie avec 17.76 km2 soit 84% de la superficie de la réserve, suivie respectivement par les communes de Beni Bahdel, Sabra et Ain Ghoraba avec de petites surfaces (Tab. 1). Ces superficies ont été déterminées à partir de la superposition du masque de la réserve que nous avons traité en utilisant l’image Google Earth tout en effectuant des confirmations sur terrain avec un GPS (Garmin GPS 72), et le fichier ComGéo (fichier contenant la délimitation de toutes les communes algériennes).
|
Table des matières
Avant-propos
Résumé
ملخص
Abstract
Liste des figures
Liste des tableaux
Liste des photos
Liste des annexes
Liste d’abréviations
INTRODUCTION GENERALE
CHAPITRE I : DESCRIPTION DU MODELE BIOLOGIQUE
I.1. Origine et évolution de la famille des Canidés
I.2. Phylogénie des Canidés
I.3. Systématique et description du Loup doré d’Afrique
I.3.1. Taille
I.3.2. Morphologie et dimorphisme sexuel
I.3.3. Pelage
I.3.4. Dentition
I.4. Ecologie de l’espèce
I.4.1. Habitat et distribution
I.4.2. Organisation sociale et reproduction
I.4.3. Régime alimentaire
I.5. Conflits homme-carnivores
I.6. Statut du Loup doré d’Afrique en Algérie
CHAPITRE II : PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE
II.1. Milieu physique
II.1.1. Situation géographique
II.1.2. Aperçu géologique
II.1.3. Aperçu pédologique
II.1.4. Aperçu topo-morphologique
II.1.4.1. Hypsométrie
II.1.4.2. Pente
II.1.4.3. Exposition
II.1.5. Aperçu hydrographique et hydrologique
II.2. Climat
II.2.1. Station météorologique retenue
II.2.2. Paramètres climatiques analysés
II.2.2.1. Précipitations
II.2.2.2. Températures
II.2.2.3. Neige
II.2.2.4. Vent
II.2.3. Synthèse climatique
II.2.3.1. Diagramme ombrothermique
II.2.3.2. Quotient pluviothermique d’Emberger
II.3. Milieu biotique
II.3.1. Diversité floristique
II.3.2. Diversité faunistique
II.4. Actions anthropiques et aperçu socio-économique
II.4.1. Occupation du sol
II.4.2. Travaux de génie forestier
II.4.3. Agriculture
II.4.4. Elevage et pâturage
II.4.5. Incendies de forêts
CHAPITRE III : ECOLOGIE TROPHIQUE
III.1. Introduction
III.2. Méthodologie
III.2.1. Reconnaissance et collecte des fèces
III.2.2. Période d’enquête et taille d’échantillonnage
III.2.3. Traitement des échantillons au laboratoire
III.2.4. Détermination des composants alimentaires
III.2.5. Détermination de l’âge des proies
III.3. Evaluation des données collectées
III.3.1. Détermination de la fréquence
III.3.2. Calcul de la biomasse
III.3.3. Indice de diversité de Shannon
III.3.4. Indice d’équitabilité
III.3.5. Test d’indépendance du Khi-deux
III.4. Résultats
III.4.1. Identification moléculaire des crottes
III.4.1. Pesée et mensuration des crottes
III.4.3. Identification spécifique des proies ingérées
III.4.3. Caractéristique du régime alimentaire
III.4.5. Proportion des juvéniles dans le régime alimentaire
III.4.6. Contribution des animaux domestiques
III.4.7. Variation saisonnière du régime alimentaire
III.4.7.1. Période estivale
III.4.7.2. Période automnale
III.4.7.3. Période hivernale
III.4.7.4. Période printanière
III.4.8. Diversité et équitabilité
III.5. Discussion
CHAPITRE IV : ETHOLOGIE
IV.1. Introduction
IV.2. Méthodologie
IV.2.1. Activités
IV.2.2. Organisation sociale
IV.2.2.1. Observations directes
IV.2.2.2. Piégeages photographiques
IV.2.2.3. Surveillance acoustique
IV.2.3. Abondance, répartition et coexistence avec les carnivores sympatriques
IV.3. Analyse des données
IV.3.1. Détermination des groupes et de leur densité
IV.3.2. Taille des groupes détectés
IV.3.4. Analyse factorielle des correspondances (AFC)
IV.3.5. Indice de similarité de Sørenson
IV.4. Résultats
IV.4.1. Activités
IV.4.2. Effort d’échantillonnage
IV.4.2.1. Surveillance acoustique
IV.4.2.2. Caméras pièges et observations directes
IV.4.3. Densité des groupes
IV.4.4. Taille des groupes
IV.4.5. Abondance et coexistence des trois carnivores
IV.4.6. Facteurs déterminants la répartition des carnivores
IV.5. Discussion
CHAPITRE V : DIVERSITE GENETIQUE
V.1. Introduction
V.2. Méthodologie
V.2.1. Collecte des échantillons
V.2.2. Extraction d’ADN
V.2.2.1. Premier lot d’échantillons
V.2.2.2. Deuxième lot d’échantillons
V.2.2.3. Evaluation d’ADN extraite
V.2.3. Amplification et séquençage d’ADN mitochondriale
V.2.3.1. Amplification
V.2.3.2. Evaluation du produit de PCR
V.2.3.3. Séquençage
V.2.4. Amplification et génotypage des microsatellites
V.3. Analyse des données
V.3.1. Identification spécifique
V.3.2. Analyse phylogénétique
V.3.3. Paramètres des microsatellites et diversité génétique
V.3.4. Analyse des coordonnées principales
V.4. Résultats
V.4.1. ADN mitochondriale
V.4.2. Arbre phylogénétique
V.4.3. Diversité des nucléotides et des haplotypes
V.4.4. Succès d’amplifica0tion des marqueurs
V.4.5. Diversité génétique
V.4.6. Structure génétique des populations
V.5. Discussion
CONCLUSION
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ANNEXES
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet