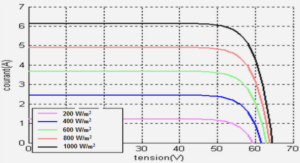Eau de consommation humaine
L’eau desservie à la population peut provenir de deux sources aux caractéristiques différentes :
– Eaux de surface : elles proviennent des lacs, rivières, barrages, etc. Les eaux de surface sont ouvertes à l’environnement et sont exposées à des impuretés telles que les matières en suspension (matières organiques dont les algues et colloïdes), des matières organiques dissoutes (naturelles ou artificielles), des organismes pathogènes (virus, bactéries, protozoaires parasites etc) et des minéraux particuliers comme les métaux lourds (Rovel et al., 2011).
– Eaux souterraines : elles proviennent de l’infiltration des eaux superficielles à travers les couches terrestres pour s’accumuler à la nappe aquifère (Rovel et al., 2011). Elles sont desservies aux populations à travers des puits, des forages etc.
Qualités d’une eau potable
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’eau potable est une eau qui ne contient pas d’agents pathogènes ou d’agents chimiques à des concentrations pouvant nuire à la santé (OMS, 2004). Cela inclut les eaux de surface traitées et les eaux de surface non traitées, mais non contaminées, comme les sources d’eau, les forages et les puits (DCSMM, 2012). Les paramètres pouvant être réglementés sont : la qualité organoleptique (couleur, turbidité, odeur, saveur), les paramètres physico chimiques (selon l’OMS : température, pH, chlorures : 200 mg/l, sulfates : 250 mg/l, fluorures : 1,5mg/l, etc.) ; les substances indésirables (selon l’OMS nitrates : 50 mg/l, nitrites : 0,3mg/l, pesticides, etc.) ; les substances toxiques (arsenic, cadmium, plomb, hydrocarbures, etc.) ; les paramètres microbiologiques (l’eau ne doit pas contenir d’organismes pathogènes et une quantité limitée d’organismes non pathogènes). Selon ces normes, une eau potable doit être exempte de germes pathogènes (bactéries, virus), d’organismes parasites et une quantité limité de germes non pathogènes car les risques sanitaires liés à ces microorganismes sont énormes (OMS, 2004). À l’inverse, la présence de certaines substances comme les oligo-éléments, peut être jugée nécessaire à l’organisme. Une eau potable doit aussi être une eau agréable à boire : elle doit être claire, ne doit pas avoir une odeur particulière et avoir un bon goût. Pour le goût, l’eau doit contenir un minimum de sels minéraux dissous (de 0,1 à 0,5 gramme par litre), lesquels sont par ailleurs indispensables à l’organisme. Enfin, elle ne doit pas corroder les canalisations afin d’arriver « propre » à la sortie des robinets (DCSMM, 2012).
Pollution de l’eau de consommation
La dégradation de l’eau peut être d’origine :
– Domestique : par les égouts et les latrines qui contiennent des matières putrescibles (eaux – vannes) ou par les eaux de linge, de cuisine, de la vaisselle, eaux grises etc. ;
– Industrielle : par les effluents rejetés par les usines contenant des matières fermentescibles, des sels dissouts dont certains sont toxiques (cyanures, phénols…);
– Agricoles : par les eaux de ruissellement qui entraînent les sels minéraux des engrais (DCSMM, 2012). Selon l’OMS, une eau potable ne doit pas contenir d’agents pathogènes ou d’agents chimiques à des concentrations pouvant nuire à la santé (OMS, 2017). Cependant, si ces références ne sont pas respectées, l’eau consommée peut induire des maladies.
Maladies liées à l’eau
Les maladies liées à l’eau sont celles contractées par ingestion, par contact direct ou encore les maladies pour lesquelles l’eau est le milieu de vie d’hôtes de larves ou de parasites (Somé, 2014). Il s’agit essentiellement :
❖ Des maladies du péril fécal, très fréquentes sous les tropiques :
– le choléra et tous les syndromes cholériformes qui sont des infections intestinales aiguës caractérisées par une diarrhée liquide due à des germes non invasifs Vibrio cholerae, en particulier chez l’enfant à des virus gastroentériques dont les rotavirus, agents les plus fréquents des diarrhées du nourrisson et de l’enfant de moins de 3 ans (Aubry et al, 2012).
– la fièvre typhoïde, une infection potentiellement mortelle causée par la bactérie Salmonella typhi caractérisée par une fièvre prolongée, une fatigue, des nausées, des douleurs abdominales et des troubles du transit (constipation ou diarrhée). La contamination se fait par les eaux ou les aliments souillés par des selles infectées (Aubry et al, 2012).
– la poliomyélite : sa transmission se fait dans les pays en voie de développement (PED) par voie féco-orale. C’est une maladie infectieuse essentiellement neurotrope due aux poliovirus sauvages 1 et 3. L’apparition de poliovirus dérivés du VPO (VDPV), devenus pathogènes, est à l’origine de flambées de poliomyélite dans les PED (Aubry et al, 2012) .
❖ Les diarrhées aiguës et les dysenteries : elles représentent la deuxième cause de mortalité infantile dans les PED. La mortalité survient dans les deux (2) premières années de la vie dans 80 % des cas (Aubry et al, 2018).
Ce sont des maladies transmissibles dues à un ou plusieurs agents pathogènes : bactéries, virus ou parasites. Le principal facteur de gravité de la diarrhée aiguë hydrique est la déshydratation, surtout chez les jeunes enfants et les personnes âgées. Elle est habituellement due à des germes non invasifs : Entérotoxinogénes (ETEC) Escherichia coli, Vibrio cholerae O1, Rotavirus, Cryptosporidium parvum etc. Les ETEC sont la cause principale de maladie diarrhéique dans les PED tant chez l’enfant que chez l’adulte. On distingue deux types de diarrhées :
– La diarrhée dite invasive est causée par des bactéries (Shigella, Salmonella, Campylibacter, Yersinia, Escherichia coli entero-invasif (EIEC), Clostridium difficile ; et rarement parasitaire : E. hystolitica. La diarrhée invasive se caractérise par une diarrhée glaireuse ou purulente et/ou sanglante, accompagnée de douleurs abdominales à type d’épreintes, de faux besoins.
– La diarrhée dite hydrique est caractérisée par une perte abondante d’eau, d’installation rapide, sans douleurs abdominales avec des vomissements. Elles est causée par des virus (rotavirus, norovirus), par des bactéries (Vibrio choléra, Enterotoxinogéne E. coli (ETEC), Staphylococcus aureus ou Bacillus cereus), par des parasites : Cryptosporidium.
Le syndrome dysentérique représente environ 10 % des maladies diarrhéiques aiguës d’origine infectieuse. Les agents en cause sont des bactéries entéro-invasives : Shigella spp., Salmonella spp.,Campylobacter jejuni, Yersina entérocolitica, …ou des parasites : Entameba histolytica, Balantidium coli,…(Aubry et al, 2018). La dysenterie peut entraîner une large gamme de symptômes, mais la létalité est faible. Campylobacter est un agent commun de diarrhée dans le monde entier. Comparer à d’autres bactéries pathogènes, la dose infectieuse de Campylobacter est relativement faible et peut être inférieure à 1000 organismes. Cette bactérie est relativement commune dans l’environnement et des flambées liées à l’eau ont été enregistrées (OMS, 2017). L’infection à E. coli O157 et à d’autres souches de E. coli entérohémorragiques transmise par l’eau est nettement moins fréquente que l’infection à Campylobacter, mais les symptômes de l’infection sont plus graves, notamment le syndrome hémolytique et urémique ainsi que des décès. La dose infectieuse peut être très faible ; moins de 100 organismes (OMS, 2017) Shigella provoque plus de 2 millions d’infections chaque année, entraînant près de 60 000 décès, principalement dans les PED (OMS, 2017).
La dose infectieuse est faible et peut ne pas excéder 10 à 100 organismes (OMS, 2017). Des flambées liées à l’eau ont été enregistrées (OMS, 2017). Les Salmonella non typhoïdiennes provoquent rarement des flambées liées à l’eau mais S. typhi est à l’origine de flambées importantes et dévastatrices de fièvre typhoïde liée à l’eau (OMS, 2017).
|
Table des matières
INTRODUCTION GENERALE
CHAPITRE I : SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE
I. Généralités sur l’eau
1. Eau de consommation humaine
2. Qualités d’une eau potable
3. Pollution de l’eau de consommation
4. Maladies liées à l’eau
II. Qualité microbiologique des eaux de boissons
1. Bactéries pathogènes
1.1 Bactéries indicatrices d’une contamination fécale
1.1.1 Coliformes totaux
1.1.2 Coliformes fécaux
1.1.3 Streptocoques fécaux
1.2 Bactéries indicatrices de pollution
1.3 Traitement des eaux de consommation humaine
1.3.1 Traitement des eaux brutes dans les sociétés
1.3.2 Désinfection de l’eau
1.3.2.1 Chloration
1.3.2.2 Demande en chlore
1.3.2.3 Paramètres influents sur la désinfection de l’eau avec le chlore
a. potentiel d’Hydrogène (pH)
b. Température
c. Turbidité
d. Ammonium
e. Matière organique
CHAPITRE II : MATERIEL ET METHODES
I. Zones d’étude
1. Présentation de la société de traitement des eaux brutes
1.1 Historique
1.2 Organisation administrative de la structure d’accueil
1.3 Sous-direction de Traitement des Eaux
1.3.1 Section microbiologie
1.3.2 Section chimie
1.3.3 Section Assistance à l’exploitation
2. Système Qualité Sécurité Environnement (QSE)
3. Site de prélèvement des eaux brutes
II. Matériel et méthodes
1. Préparation des échantillons
2. Analyse physico-chimique
2.1 Eaux brutes non chlorées
2.1.1 Mesure de la Turbidité
2.1.2 Mesure du pH
2.2 Chloration des eaux brutes
2.2.1 Préparation de la solution initiale
2.2.2 Chloration de l’échantillon
2.3 Eaux brutes chlorées
2.3.1 Détermination du taux de matière organique
2.3.2 Détermination du taux d’ammonium
2.3.3 Mesure du chlore résiduel
3. Analyse bactériologique
3.1 Technique de filtration sur membrane
3.2 Technique de l’incorporation en gélose
3.3 Culture bactérienne
4. Dénombrement des bactéries
4.1 Dénombrement des coliformes
4.2 Dénombrement des entérocoques
4.3 Expression des résultats
5. Traitement des données
CHAPITRE III : RESULTATS ET DISCUSSION
I. Résultats
1. Analyse physico-chimique
1.1 Eaux brutes non chlorées
1.2 Eaux brutes chlorées
1.2.1 Relation entre le chlore et la matière organique en fonction de la turbidité
1.2.2 Relation entre le chlore et l’ammonium en fonction de la turbidité
2. Analyse bactériologique
2.1 Eaux brutes non chlorées
2.2 Effet sur les germes totaux
II. Discussion
1. Désinfection par le chlore
2. Influence de la turbidité de l’eau sur la désinfection par le chlore
3. Influence de la matière organique et de l’ammonium sur la désinfection par le chlore
4. Temps de contact
CONCLUSION GENERALE