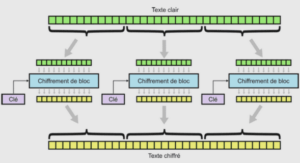E-Banking et réseaux mobiles
L’Internet
Internet, réseau des réseaux, trouve son origine en 1969 avec la création du réseau militaire américain ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network). Le modèle ARPANET était donc sensiblement différent : au lieu de baser toute l’information sur un unique ordinateur, celle-ci est distribuée sur divers pôles géographiques, chaque pôle étant autonome. Ainsi, même si une partie de l’information se trouvait détruit, le reste pouvait toujours être exploité. Dans les années 70, l’infrastructure d’Arpanet est mise à disposition des universités américaines. Ainsi le nombre d’utilisateurs s’élève petit à petit. Bien naturellement, Arpanet se détache petit à petit de sa vocation initiale. Le protocole de transport TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) s’impose comme protocole de communication standard sur Internet. Dès le début des années 80, ARPANET explose en deux réseaux distincts : NSFNet (National Science Foundation Network) et MILNET (le réseau militaire).
En 1980, quelques centaines de serveurs (délivrant de l’information) sont interconnectés. En 1986, il y en a plus de 2000. Le nombre d’usagers ne cesse d’augmenter. Dans les autres pays (par exemple le Canada) des réseaux de nature équivalente (basés sur TCP/IP) émergent, pour finalement se regrouper au début des années 90. Et là, tout s’accélère ! En 1992 : le CERN (Centre Européen de Recherche Nucléaire) propose le projet World Wide Web, fournissant ainsi l’aspect convivial que tout le monde connaît (utilisation de navigateurs, …). Dès lors, il n’est plus nécessaire d’être un initié à l’informatique. Petit à petit, les particuliers réclame le droit de s’y connecter (et de proposer de l’information). La machine est lancée. En 2000 : on peut considérer qu’Internet n’est encore qu’un embryon. Toujours plus de personnes et de foyers rejoignent le réseau, et l’on commence à parler de visioconférence sur Internet, de commerce électronique, … Et certain voient en Internet le successeur à la télévision, à la téléphonie. Aujourd’hui le plus important est l’Internet mobile avec l’avènement de l’UMTS et les réseaux sans fils. [12]
TLS (Transport Layer Security)
Transport Layer Security (TLS), et son prédécesseur Secure Sockets Layer (SSL), sont des protocoles de sécurisation des échanges sur Internet, développés à l’origine par Netscape (SSL version 2 et SSL version 3). Il a été renommé en Transport Layer Security (TLS) par l’IETF (Internet Engineering Task Force « Détachement d’ingénierie d’Internet ») à la suite du rachat du brevet de Netscape par l’IETF en 2001. [15] TLS a tout de même mis en place un mécanisme de compatibilité ascendante avec SSL. En outre, TLS diffère de SSL pour la génération des clés symétriques. Cette génération est plus sécurisée dans TLS que dans SSL version 3 dans la mesure où aucune étape de l’algorithme ne repose uniquement sur MD5 pour lequel sont apparues des faiblesses en cryptanalyse. Le protocole TLS permet de créer un tunnel entre un ordinateur et un serveur. Ce tunnel sécurisé permet un échange d’informations en contournant les dispositifs de sécurité installés pour un serveur ou un ordinateur. Passant outre les systèmes de protection il est alors possible que des actions malveillantes soient menées au travers du point d’entrée du tunnel. Afin de limiter les risques, il est techniquement possible de filtrer les contenus d’un tunnel TLS par la mise en place d’un dispositif qui authentifie le client et le serveur. Deux tunnels sont alors mis en place, un depuis le client vers le dispositif d’authentification et le second du dispositif vers le serveur. Ce système permet alors une analyse et une sécurisation transparente des contenus transférés par le tunnel TLS comme il est montré dans la figure suivante :
L’IP Mobile
Défini par l’IETF, Mobile IP propose une solution pour résoudre le problème de changement de point d’attachement à l’Internet. Mobile IP maintient la même adresse IP quelle que soit la localisation du terminal, de telle façon qu’il ait en permanence un identifiant unique. Le nouveau protocole a la responsabilité de transmettre les paquets au terminal quelle que soit la manière dont il se déplace dans le réseau et d’indiquer de façon signifiante le point de localisation. Mobile IP permet uniquement d’introduire de la mobilité dans les réseaux IP. Les réseaux cellulaires, avec leurs propres mécanismes internes de gestion de la mobilité, permettent au noeud mobile de garder la connectivité avec un point d’attachement Internet unique (NAS pour un accès circuit, GGSN pour un accès paquet). Le protocole Mobile IP ne s’impose donc pas nécessairement dans les réseaux cellulaires. Par contre, il peut être utilisé de manière efficace en « overlay » afin de permettre la mobilité entre réseaux de natures différentes. Mobile IP permet à un mobile disposant de plusieurs interfaces radios de passer indifféremment d’un réseau cellulaire public (GSM/GPRS/UMTS) à un réseau privé d’entreprise sans fil (WLAN). Par contre il ne supporte pas pour l’instant une mobilité rapide entre cellules radio de type WLAN : le temps de latence lors du handover n’est pas optimisé (manque d’échange d’informations de contrôles entre la couche liaison et la couche IP, délai de mise à jour de la nouvelle localisation vers le réseau mère qui peut être très éloigné du point d’attachement courant). Les groupes de travail de l’IETF prévoient les améliorations nécessaires mais, tant qu’elles ne sont pas spécifiées, il n’est pas envisageable de supporter « sans coupure » des services à fortes contraintes temps réel tels que la téléphonie ou la vidéo sur IP.
L’Internet mobile
Les utilisateurs de mobiles demandent à accéder aux ressources d’informations via leurs mobiles. Il est impossible pour les opérateurs d’ignorer ce besoin d’intégration de systèmes mobiles avec l’environnement Internet. Le réseau numérique de Packet-Switched résout une partie du problème d’accès à l’Internet sans fil. Les opérateurs des réseaux mobiles ont besoin de trouver une façon pour fournir au client le service d’accès au réseau extérieur rapidement et moins cher. il y a un obstacle sur l’intégration de réseau mobile avec le réseau Internet : les protocoles adoptés par le réseau numérique et mobile n’existent pas en dehors de ce système. Les protocoles Internet sont des standards de facto de communication sur le réseau filaire. Ils constituent des points communs pour cette intégration. Les opérateurs du réseau mobile peuvent fournir un service d’accès à l’Internet soit par intégration des protocoles Internet en haut de ceux existant sur le réseau mobile, soit en établissant un Gateway propriétaire entre l’Internet et les machines mobiles qui supportent GUI (Graphical User Interfaces) en base de la technologie Internet. Cela peut permettre aux utilisateurs la connexion avec des opérateurs du réseau mobile ou avec tous les sites d’information sur Internet. En effet, beaucoup de porteurs du réseau mobile ont déjà commencé à mettre en état des protocoles Internet comme base des échanges des informations entre des appareils mobiles et le réseau externe. Par exemple, M_Banking. Pour le moment, les applications pour les réseaux mobiles sont assez différentes de celles que l’on trouve dans les réseaux fixes du fait des très faibles débits disponibles sur les interfaces hertziennes en comparaison des vitesses d’accès aux réseaux filaires. De plus, il faut séparer les applications pour les réseaux sans fil et les réseaux de mobiles.
WAP (Wireless Application Protocol) La technologie WAP a pour but de permettre à des terminaux mobiles (les téléphones portables par exemple) d’accéder à des documents circulant par des réseaux sans fil. Il s’agit donc de permettre à n’importe quel terminal mobile de pouvoir formater des documents. C’est pour cela qu’un protocole universel a été mis en place. Le WAP (Wireless Application Protocol ou en français Protocole d’Application Mobile). Il se propose de définir la façon de laquelle les terminaux mobiles accèdent à des services Internet, et cela à un niveau au-dessus de la transmission des données, celle-ci étant spécifique à chaque opérateur de téléphonie. [17] Le WAP est né de l’alliance en 1997 de plusieurs grands groupes regroupant des constructeurs de mobiles (Nokia, Ericsson…), des opérateurs en téléphonie mobile et des multinationales (Phone.com, Microsoft…) au sein du WAP Forum. Celui-ci est chargé de valider les spécifications techniques proposées par les sociétés participantes. La version 1.0 du protocole WAP a été publiée en Mai 1998. Les spécifications du WAP sont libres, c’est à dire que quiconque peut les lire et en apprendre le fonctionnement.
|
Table des matières
Introduction générale
Chapitre I E-Banking et réseaux mobiles
I.1. Introduction
I.2. Présentation d’E-Banking
I.3. Les services d’E-Banking
I.3.1. L’internet Banking
I.3.2. Guichet Automatique Bancaire(GAB)
I.3.3. Le M-Banking
I.3.4. WAP Banking
I.3.5. SMS Banking
I.4. Le réseau GSM
I.4.1. Présentation
I.4.2. Architecture
I.4.3. Acheminement de message
I.4.4. Mécanismes de sécurité dans le GSM
I.5. E-Banking en Algérie
I.5.1. Carte CIB (carte interbancaire)
I.5.1.1. Carte classique
I.5.1.2. Carte Gold
I.5.2. Internet-Banking en Algérie
I.5.3. SMS Banking en Algérie
I.6. Conclusion
Chapitre II L’accès Internet
II.1. Introduction
II.2. L’Internet
II.3. Les Protocoles de communication réseau
II.3.1. Le protocole HTTP
II.3.2. Le protocole HTTPS
II.3.3. TLS (Transport Layer Security)
II.3.4. Authentification du client SSL par certificat numérique
II.3.5. FTP
II.3.6. URL
II.3.7. Site Web
II.4. Cryptographie
II.4.1. Chiffrement symétrique ou à clef secrète
II.4.2. Chiffrement asymétrique ou à clef publique
II.4.3. Fonctions de hachage à sens unique
II.4.3.1. MD5 (Message Digest 5)
II.4.3.2. SHA (Secure Hash Algorithm)
II.4.4. Signature numérique
II.5. Le TCP/IP
II.6. L’IP Mobile
II.7. L’Internet mobile
II.7.1. Le contrôle de l’Internet mobile
II.7.2. La sécurité dans l’Internet mobile
II.7.3. La gestion de la mobilité
II.8. WAP (Wireless Application Protocol)
II.8.1. Structure de la pile protocolaire
II.8.1.1. WAE (Wireless Application Environnent)
II.8.1.2. WSP (Wireless Session Protocol)
II.8.1.3. WTP (Wireless Transaction Protocol)
II.8.1.4. WTLS (Wireless Transport Layer Secure)
II.8.1.5. WDP (Wireless Datagram Protocol)
II.8.1.6. Un exemple de réseau WAP
II.8.2. Les passerelles
II.8.2.1. Passerelle chez un fournisseur
II.8.2.2. Passerelle WAP en interne
II.9. WIFI (Wireless Fidelity)
II.10. Conclusion
Chapitre III Langages et logiciels utilisés
III.1. Introduction
III.2. Mise en place d’un serveur de développement
III.2.1. Le serveur Web APACHE
III.2.2. Le langage interprété PHP
III.2.2.1. Fonctionnement
III.2.2.2. Utilisation du formulaire
III.2.2.3. Méthode d’envoi GET et POST
III.2.2.4. Récupération des données dans PHP
III.2.3. Dynamisation des pages Web coté client : Javascript
III.2.4. Langage XHTML et CSS
III.2.5. Le Système de Gestion de Bases de Données MySQL
III.3. J2ME
III.3.1. Présentation de J2ME
III.3.2. Architecture J2ME
III.3.3. Les machines virtuelles
III.3.3.1. KVM
III.3.3.2. CVM
III.3.4. Les profile
III.3.4.1. Le profile Foundation
III.3.4.2. Le profile MIDP
III.3.5. Les Midlets
III.3.6. L’interface utilisateur
III.3.6.1. L’interface utilisateur de bas niveau
III.3.6.2. L‘interface utilisateur de haut niveau :
III.3.7. La connexion réseau
III.4. Autres outils et langages utilisées
III.4.1. Python
III.4.1.1. IDLE
III.4.2. WAMPSERVER
III.4.3. NetBeans
III.5. Conclusion
Chapitre IV Présentation de l’application
IV.1. Introduction
IV.2. Architecture globale de solution
IV.3. Base de données
IV.4. Présentation du site web
IV.4.1. Organigramme du site web
IV.4.2. Spécification et réalisation des pages
IV.5. Application Mobile (J2ME)
IV.5.1. Description des différentes pages de l’application
IV.6. Serveur SMS
IV.6.1. Communication avec le port Série
IV.6.2. Configuration du module GSM
IV.7. Conclusion
Conclusion générale
Annexe
Bibliographie
Acronymes
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet