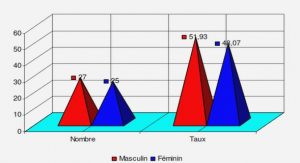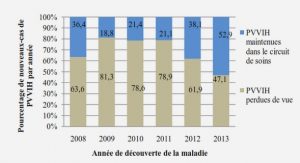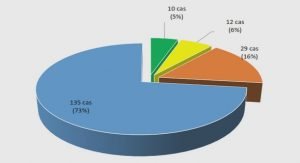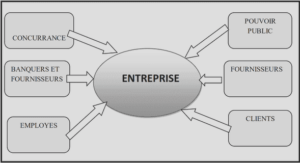Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Évaluation des premiers mots
Généralement, les premiers mots de l’enfant se réfèrent aux personnes et aux objets avec lesquels ils sont le plus souvent en contact, les objets et les per- sonnes qui font partie de son univers, les membres de sa famille, les ani- maux, la nourriture, les boissons et les jouets (Nelson, 1973). L’adaptation française de l’inventaire du développement communicatif de Bates- Mac-Arthur (Communicative Development Inventories, CDI) pour évaluer les premiers mots de l’enfant à 12 mois (Kern, 2003 ; Bovet et coll., 2005a et b) est présentée dans le tableau 1.I. On demande aux parents de cocher la première colonne (C) pour les mots que l’enfant comprend mais ne dit pas encore (on considère que l’enfant comprend un mot même s’il ne le com- prend que dans une seule situation) ou bien de cocher la deuxième colonne (CD) pour les mots que l’enfant comprend et qu’il utilise de manière sponta- née. Si sa prononciation est différente de celle des adultes, on coche tout de même le mot.
Représentation mentale des séquences d’événements
La dimension conceptuelle concerne la représentation mentale des états et événements du monde réel ou fictif ainsi que les relations temporelles ou causales qu’ils entretiennent et qui font intervenir des objets, lieux et per-sonnages. Elle correspond approximativement à ce qui est dénommé dans la Acquisition du langage oral : repères chronologiques (van Dijk et Kintsch, 1983). Elle vaut aussi bien pour les récits oraux ou écrits que pour les films ou les bandes dessinées. Elle relève de la représenta-tion du monde indépendamment de la manière dont celle-ci est (re)codée (Gernsbacher, 1990). Elle a donné lieu à plusieurs approches théoriques, dont la plus importante pour ce qui a trait au récit a été élaborée par Schank et Abelson (1977). Cette conception postule que la compréhension ou la production de récit est sous-tendue par une trame mentale où les actions s’organisent en fonction de buts poursuivis par des agents, lesquels dévelop-pent ces actions pour déjouer les obstacles qui s’opposent à l’atteinte de ces buts. Ces séquences événementielles ne sont ni verbalisées, ni dessinées. Cette trame est formalisable sous forme de réseaux causaux : chaînes d’évé-nements liés entre eux par des relations d’ordre temporel, causales ou autres. L’étude du développement de la compréhension et de la production des chaînes chronologico-causales met en évidence deux faits paradoxaux. D’une part, l’acquisition et la mise en œuvre de ces chaînes se révèlent très précoces puisqu’elles sont disponibles dès l’âge de 5 ans et même avant (Sperry et Sperry, 1996). D’autre part, l’étude de la compréhension en lec-ture et de la composition écrite révèle que la construction de modèles men-taux correspondant à ces chaînes évolue à nouveau entre 6 et 10 ans. Tout se passe comme si le passage à l’écrit, en raison des situations énonciatives qui le caractérisent par rapport à l’oral et des contraintes nouvelles qu’il fait peser sur les traitements, induisait une diminution ou une stagnation des capacités de mobilisation des connaissances relatives aux chaînes causales et aux inférences qu’elles supportent.
Structure textuelle des récits
La dimension rhétorique tient au fait que la mise en forme langagière du récit ne se limite pas à énoncer les personnages, lieux, objets et événements.
Pour une culture donnée, il existe une ou plusieurs formes canoniquesd’organisation des énoncés (et non seulement des contenus qu’ils évoquent) (Gutteriez-Clellen et coll., 1995). Les travaux des années soixante-dix ont mis en évidence l’effet de ces organisations généralement dénommées superstructures narratives. Pour Mandler et Jonhson (1977) comme pour Stein et Glenn (1979), tout récit comporte un « cadre » (frame) dans lequel se trouvent précisés les lieux, moments et personnages. Ce « cadre » se place en début des récits, ce qui correspond à des contraintes pragmatiques liées à l’efficacité de la communication, mais non aux nécessités du déroulement des faits (de la trame). Vient ensuite un « déclencheur », lequel introduit un obstacle qui s’oppose en général à l’atteinte du but poursuivi par le person- nage principal. Cet obstacle induit une réaction émotionnelle ainsi que l’élaboration d’un « sous-but » visant à lever ou contourner l’obstacle. Il s’ensuit une ou plusieurs « tentatives », actions plus ou moins couronnées de succès, jusqu’au résultat final. 19
Les recherches portant sur les adultes attestent que les récits comportant tous les constituants dans l’ordre conventionnel sont mieux rappelés que ceux qui ne respectent pas ces contraintes (Yussen et coll., 1991). Cet effet a été observé chez les enfants dès l’âge de 4-5 ans et dans différentes cultures. Toutefois, les plus jeunes tendent à rappeler moins bien certaines catégories narratives que les adultes : les réactions et les buts notamment (Mandler et coll., 1980). Cette caractéristique des patrons de rappel des plus jeunes est probablement imputable au développement des chaînes causales : les enfants de 4-5 ans rencontrent des difficultés dans la prise en compte de ce qui motive les séquences d’actions. En revanche, Poulsen et coll. (1979) mon-trent que la « fin des histoires » se trouve privilégiée lorsqu’elle s’insère dans un récit (en images) par rapport à la condition où elle se situe dans une suite aléatoire d’images.
Les premiers récits respectent rarement l’organisation cadre-déclencheur/ complication-tentative/action(s)-résolution. Il faut attendre environ 7-8 ans pour que cette superstructure devienne dominante. Notamment, le place-ment en début de récit des éléments du cadre se révèle relativement tardif (Fayol, 1991). Cette apparition d’un cadre formellement identifiable est contemporaine de l’utilisation normée de l’imparfait et du plus-que-parfait ainsi que d’expressions telles que « la veille », « le lendemain ». Ces formes relèvent en français des conventions narratives. Auparavant, les enfants tendent plutôt à produire un résumé de l’événement caractéristique du dis-cours en situation qui sera ultérieurement développé, au moins lorsqu’ils éla-borent un récit présentant une unité thématique. Ce passage d’un mode d’organisation précoce à dominante discursive à un autre correspondant mieux aux conventions du récit écrit pose le problème des raisons qui sous-tendent cette évolution.
Il paraît plausible que l’acquisition du schéma narratif soit liée à l’exposition un corpus de récits écrits. Seuls, ces récits présentent les régularités d’orga-nisation correspondantes. Varnhagen et coll. (1994) ont montré chez des enfants de première et deuxième années primaires (CP à CE1) que la lecture et l’audition répétées et prolongées de textes narratifs induisent chez ces enfants l’acquisition des régularités caractéristiques de la superstructure nar-rative. Cette hypothèse souligne que ceux qui ne bénéficient pas d’une telle exposition ne développeront pas ce schéma. Les données de Cain (1996) confirment que les enfants qui ont une compréhension faible sont aussi ceux dont les productions narratives s’écartent le plus de la superstructure du récit et qu’ils ont été moins que les autres en contact avec des récits écrits, que ceux-ci leur aient été lus ou qu’ils les aient lus eux-mêmes. La simple exposi-tion passive aux textes narratifs ne suffit d’ailleurs pas à entraîner l’extrac-tion des régularités. Fitzgerald et Spiegel (1983) ont conçu un programme d’entraînement à la découverte et à l’utilisation de la superstructure narrative en production. Les enfants ainsi instruits ont manifesté une amélioration significative de performances en production, mais aussi en compréhension, confirmant ainsi l’existence des corrélations observées par Cain (1996).
En résumé, le schéma narratif facilite l’intégration des informations en com-préhension et la complétude et le respect du caractère conventionnel des récits en production. Son intervention ne se confond pas avec celle des rela-tions chronologico-causales. Il constitue une organisation rhétorique con-ventionnelle qui ne peut s’acquérir que par exposition à un corpus de textes présentant les régularités correspondantes. Son acquisition est très précoce et dépend fortement du contact avec les récits écrits. Toutefois, un appren-tissage explicite par instruction s’avère efficace, même à un âge relativement élevé.
Dimension linguistique dans la construction du récit : mise en texte
La dimension linguistique concerne tous les phénomènes liés à la mise en texte. Elle a surtout été analysée relativement au développement du récit.
Tout récit met en scène un ou plusieurs personnage(s) qui doive(nt) être introduit(s) dans la narration puis ré-évoqué(s) au fur et à mesure des besoins.
Les langues disposent de marques spécifiques pour assurer ces différentes fonctions. Par exemple, les personnages ou objets nouveaux apparaissent d’abord précédés d’un article indéfini (« un homme entra »). Les mentions ultérieures utilisent des déterminants définis : articles (« l’homme »), pronoms (« il »), adjectifs démonstratifs (« cet homme »). Globalement, l’emploi, très stéréo- typé, de ces marques ne soulève plus de problème chez l’adulte. Il fait toute- fois appel à des régularités subtiles qui donnent parfois lieu à des erreurs (Reichler-Béguelin, 1994), notamment lorsque plusieurs personnages sont concernés et que leurs « poids » respectifs dans les actions successives varient (Fayol, 1997a).
Une autre dimension linguistique a trait au marquage de la continuité et de la discontinuité événementielles. Les récits décrivent des événements suc- cessifs dont les liaisons peuvent être de force et de nature diverses, par exem- ple, du simple déroulement parallèle de deux activités (« l’homme marchait/ une automobile passait ») à une relation causale étroite (« le coup partit/ l’homme tomba »). Des marques indiquent les degrés et natures des liaisons : connecteurs (et, mais, alors…) (Bestgen et Costermans, 1997 ; Fayol et Mouchon, 1997), signes de ponctuation (Fayol, 1997b ; Heurley, 1997), formes verbales permettant de distinguer entre des actions de premier plan et des faits ou états relevant du second plan (« l’homme marchait/un bruit attira son attention ») (Hickmann, 1997).
La chronologie de l’acquisition sur les aspects morphologiques et syntaxiques du récit chez l’enfant suggère que le statut morphologique des catégories syn- taxiques et leur construction se maîtrisent progressivement.
Automatismes dans l’identification des mots écrits
Une des propriétés essentielles de l’identification des mots écrits chez le lec-teur expert est son caractère involontaire. Elle ne mobilise pas en effet ses ressources attentionnelles, c’est chez lui un automatisme, quasiment un réflexe (Perfetti et Zhang, 1995). L’effet dit « Stroop », qui résulte d’une interférence entre le sens d’un mot et sa forme, est considéré comme étant un indicateur de cette automatisation. Ainsi, quand on demande à un lec-teur expert de nommer la couleur de l’encre d’un mot écrit, la réponse est plus longue quand le mot écrit est un nom de couleur qui ne correspond pas la couleur de l’encre, par exemple, « vert » écrit en rouge, ce qui signale que le lecteur ne peut pas s’empêcher de lire, même quand on le lui demande. Les résultats à ce type de test permettent de cerner le niveau d’automaticité des procédures d’identification des mots écrits : plus ces procédures sont automatisées, plus il y aura compétition, et donc inter-férence, entre les deux noms de couleurs activés, celui du mot écrit et celui de la couleur de l’encre.
L’idée d’une reconnaissance des mots écrits quasi-réflexe peut être illustrée par l’étude de Guttentag et Haith (1978). Ces chercheurs ont présenté à des adultes et à des enfants scolarisés en début et en fin de 1re année de primaire des images représentant des animaux, des meubles et des moyens de trans-port. Les images ont été montrées seules (condition contrôle) et dans quatre conditions expérimentales : soit avec des mots écrits appartenant à une catégorie sémantique différente de celle de l’image (« chat-cahier ») ou à la même catégorie sémantique (« chat-chien »), soit avec des symboles non alphabétiques ou des suites de lettres non prononçables. Les sujets devaient dénommer le plus rapidement possible l’image en ignorant le mot écrit. Les effets d’interférence d’une reconnaissance irrépressible des mots écrits sont évalués en comparant le temps de dénomination dans chacune des conditions par rapport à ceux obtenus dans la condition contrôle. Les résul-tats sont présentés dans la figure 2.2. Les adultes dénomment moins rapide-ment les dessins avec des lettres que ceux incluant des symboles non alphabétiques, ce qui suggère que les lettres sont traitées automatiquement. 35
De même, ils dénomment moins rapidement les dessins avec des mots écrits de la même catégorie sémantique ou d’une catégorie différente, ce qui indique que les procédures d’identification des mots écrits sont quasiment des réflexes. Enfin, l’effet d’interférence est significativement plus fort quand le mot écrit appartient à la même catégorie que le mot imagé que lorsque les deux mots ne sont pas proches sémantiquement, ce qui est révélateur d’un accès très rapide au sens des mots. Des effets d’interférence similaires quali-tativement, mais plus forts, sont observés chez les enfants après 9 mois d’apprentissage de la lecture, mais pas après 2 mois, ce qui indique que, très rapidement, le lecteur débutant a mis en place des procédures d’identifica-tion des mots écrits proches de celles de l’expert.
Synthèse des travaux sur l’apprenti-lecteur
Le lecteur expert a recours à des procédures d’identification des mots écrits très rapides, fortement indépendantes du contexte et lors de cette étape pré-coce de traitement de l’information, il a accès aux codes orthographique et phonologique des mots écrits, avant d’avoir accès à leur code sémantique. L’objectif majeur de l’apprentissage de la lecture doit donc être d’acquérir un haut niveau d’automaticité dans l’identification des mots écrits. C’est le développement de telles procédures qui permettra à l’enfant d’atteindre un niveau de compréhension écrite égal à celui de sa compréhension orale, en le dégageant du poids d’un décodage lent et laborieux, ou du recours à des anticipations contextuelles hasardeuses.
Dans cette section, après avoir développé un cadre de référence permettant de situer les problèmes auxquels le lecteur débutant est confronté, sont ensuite présentées les compétences susceptibles d’influer sur l’apprentissage de la lecture (capacités phonologiques et visuelles, QI, milieu socio-culturel…) et, enfin, la façon dont se mettent en place les mécanismes spécifiques à la lecture, à savoir les procédures d’identification des mots écrits. Une atten-tion particulière est portée à la question de l’incidence des méthodes sur l’apprentissage de la lecture.
Cadre de référence
Pour comprendre les problèmes auxquels sont confrontés les enfants quand ils apprennent à lire en français, il est nécessaire d’avoir une idée précise de ce qu’implique cet apprentissage dans une écriture alphabétique, par rapport aux autres types d’écriture. Toutes les écritures, y compris les écritures logo-graphiques comme celle du chinois (souvent incorrectement dénommées écritures idéographiques) transcrivent des unités de la langue orale, et non des idées. Ce qui change c’est la taille des unités et leur nature : unités qui ont un sens, comme les mots, ou qui n’ont pas de signification, comme les syllabes ou les phonèmes. La transcription de l’oral s’effectue en effet à trois niveaux : le mot ou le morphème, la syllabe et le phonème. Ainsi celui qui s’occupe d’enfants présentant des troubles du langage est désigné par un seul mot en français (orthophonie) et par deux en anglais (speech therapy). Ces mots con-tiennent des sous-unités qui ont également un sens, les morphèmes, comme ortho- (orthodontiste, orthographe) et phon- (phoniatre, phonétique). Ces éléments sont les unités de base, non décomposables, de certaines écritures (celle du chinois). Dans d’autres écritures, les mots et les morphèmes peuvent être décomposés en sous-unités qui n’ont pas de sens : les syllabes et les graphèmes. Par exemple, le mot oral « cheval » comporte 2 syllabes (che-val) et 5 graphèmes (« ch », plus les 4 autres lettres). Les syllabes sont les unités de base, non décomposables, des écritures syllabiques (les kanas du japonais), l’unité de base d’une écriture alphabétique étant le graphème, qui correspond au phonème. D’autres écritures transcrivent les unités phonologiques et mor-phologiques par les consonnes et les voyelles respectivement, comme en arabe ou en hébreu. La figure 2.4 présente une schématisation des principaux problèmes auxquels le lecteur débutant est confronté : la disponibilité, la con-sistance et la taille des unités qui relient l’écrit à l’oral (Ziegler et Goswami, 2005 ; voir également Sprenger-Charolles, 2003).
Capacités d’analyse phonologique et apprentissage de la lecture
Avant l’apprentissage de la lecture, les capacités d’analyse phonémique des enfants, comparativement à leurs capacités d’analyse syllabique, sont fai-bles. Cela peut s’expliquer par le fait que le phonème ne se prononce en général pas seul, sauf s’il s’agit d’une voyelle. Ce serait la confrontation avec une écriture alphabétique qui permettrait le développement des capacités d’analyse phonémique. Liberman et coll. (1974) ont été les pre-miers à avoir mis en relief ce résultat, qui a été reproduit depuis dans de nombreuses études impliquant des pré-lecteurs de différentes langues. Ainsi, comme le montre le tableau 2.I, alors que les enfants réussissent mieux des tâches impliquant la manipulation de syllabes que des tâches similaires5 impliquant la manipulation de phonèmes avant l’apprentissage de la lecture, ce n’est plus le cas après cet apprentissage, tout au moins dans des écritures alphabétiques.
Ce tableau appelle plusieurs commentaires. Tout d’abord, à la fois avant et après l’apprentissage de la lecture, les enfants ont des scores élevés dans les épreuves de manipulation de syllabe, sauf les petits anglais, probablement parce que les frontières syllabiques ne sont pas claires dans leur langue. D’autre part, les petits turcs ont des scores surprenants en analyse phonémique avant l’apprentissage de la lecture, ce qui peut s’expliquer par le fait que les voyelles en turc servent à indiquer des changements mor-phologiques (par exemple, le pluriel), ce qui peut obliger les enfants turcs à traiter des modifications phonémiques subtiles avant même d’avoir appris à lire. En comparaison, les enfants italiens, allemands, français et anglais n’arrivent à atteindre un bon niveau d’analyse phonémique qu’après l’apprentissage de la lecture, ce qui suggère que cette capacité est le résultat de l’apprentissage de la lecture dans une écriture alphabétique. Les faibles scores d’analyse phonémique relevés chez les petits japonais, qui ont appris à lire dans une écriture syllabique, confortent cette interprétation (Mann, 1986). Les résultats observés chez des adultes illettrés et ex-illettrés vont dans le même sens. Ainsi, les capacités d’analyse phonémique des illettrés sont plus faibles que celles de sujets de même milieu ayant appris à lire tardi-vement (17 % contre 72 % pour les ex-illettrés : Morais et coll., 1979), mais pas leurs capacités d’analyse syllabique (Morais et coll., 1986). La simple maturation ne semble donc pas suffisante au développement des capacités d’analyse phonémique.
Capacités d’analyse morphologique et apprentissage de la lecture
Les modèles d’apprentissage de la lecture soit ne prennent pas en compte le niveau morphologique (Ziegler et Goswami, 2005), soit considèrent que ce type de traitement ne joue un rôle qu’à partir du moment où l’enfant maî-trise le décodage (Frith, 1985 ; Seymour, 1994). L’utilisation de la mor-phologie pour identifier les mots écrits serait donc un signe d’expertise. Cette question est examinée dans la partie suivante, la synthèse présentée ci-dessous portant sur les relations entre analyse morphologique et appren-tissage de la lecture. Les travaux sur les relations entre capacités d’analyse morphologique et lecture ont porté sur la morphologie dérivationnelle (qui
46 permet de dériver des familles de mots : « lait-laitier, laiterie… ») et flexionnelle (qui sert à marquer le genre et le nombre, mais également la personne et le temps des verbes : « je chante ; tu chantes ; tu chanteras… »). Comme les épreuves évaluant les capacités d’analyse pho- nologique, celles évaluant les capacités d’analyse morphologique sont passées à l’oral, ces deux types de capacités étant souvent évaluées en même temps.
Le pouvoir explicatif des capacités d’analyse morphologique est plus faible que celui des capacités d’analyse phonologique : 4 % de variance en lecture expliquée contre 37 % en 1re année du primaire (Carlisle et Nomanbhoy, 1993). Une autre étude a montré que, aussi bien en 1re qu’en 2e année, les capacités d’analyse phonémique sont reliées aux compétences d’identification des mots écrits, pas les capacités d’analyse morphologique (Muter et coll., 2004). Toutefois, cette dernière habileté mesurée en 1re année renseigne sur le niveau de compréhension en lecture un an plus tard.
Les résultats d’une étude française vont dans le même sens (Casalis et Louis Alexandre, 2000). Les connaissances morphologiques en grande section de maternelle expliquent 6 % de la variance dans un test de lecture en 1re année du primaire (la Bat-Elem, Savigny, 1974) et 22 % de la varianc en compréhension écrite en 2e année (Écosse, Lecocq, 1996). L’implication des connaissances morphologiques serait donc plus forte chez les enfants plusâgés. Cela est également suggéré par une étude dans laquelle les enfants ont été suivis de la 2e à la 5e primaire (Deacon et Kirby, 2004). Après avoir contrôlé le niveau de lecture, le QI verbal et non verbal et les compétences d’analyse phonologique en 2e primaire, les compétences en analyse mor- phologique évaluées à la même époque renseignent sur le niveau de lecture ultérieur (de la 3e à la 5e primaire), qu’il s’agisse des capacités de décodage ou de compréhension. D’autres études indiquent que le poids des com- pétences d’analyse morphologique sur la lecture s’accroît avec le niveau sco- laire alors que celui des compétences d’analyse phonologique décroît, tout en restant significatif (Shankweiler et coll., 1995 ; Carlisle, 2000 ; Mahony et coll., 2000).
|
Table des matières
I Acquisitions et apprentissages
De l’acquisition du langage aux apprentissages scolaires
1. Acquisition du langage oral : repères chronologiques
2. Apprentissage de la lecture
3. Apprentissage de la production écrite et de l’orthographe
4. Apprentissage de l’arithmétique
5. Apprentissage du langage écrit chez les sourds
II Troubles spécifiques des apprentissages
Des difficultés d’apprentissage aux troubles spécifiques
6. Définitions et classifications
7. Données de prévalence
8. Dyslexie : études de cas
9. Dyslexie : études de groupes et de cas multiples
10. Dysorthographie
11. Dyscalculie et troubles de l’apprentissage de l’arithmétique
12. Troubles des acquisitions associés à la dyslexie
13. Troubles comportementaux ou émotionnels associés à la dyslexie
III Théories explicatives de la dyslexie
Des premières approches de la dyslexie aux hypothèses actuelles
14. Théorie phonologique
15. Théorie visuelle
16. Théorie du déficit de la fonction cérébelleuse
17. Théorie du trouble du traitement temporel
18. Apport de l’imagerie cérébrale
19. Facteurs génétiques
20. Analyse critique des théories explicatives de la dyslexie
IV Prévention et prise en charge
Du repérage à la prise en charge à l’école et à la pratique clinique
21. Repérage, dépistage et diagnostic
22. Bilan des études de prévention en milieu scolaire
23. Traitements et méthodes de rééducation de la dyslexie
24. Stratégies de soins des troubles spécifiques et associés
Synthèse, principaux constats, recommandations
Communications / Débat
Résultats préliminaires d’une étude épidémiologique au CE1
Trois méthodes comparées de rééducation
Exemple de remédiation neurodéveloppementale
Rééducation orthophonique dans la dyslexie
Rencontre-débat du 16 janvier 2007
Note de lecture de Michel Deleau
Note de lecture de Nicolas Georgieff
Note de lecture de Philippe Meirieu
Réponse du groupe d’experts au propos de Philippe Meirieu
Annexes
Expertise collective Inserm
Centres référents pour les troubles du langage
Télécharger le rapport complet