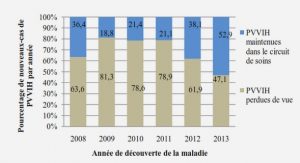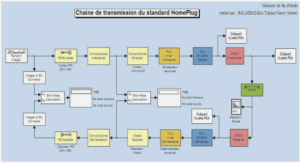Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
La reconnaissance des systèmes de gouvernance des ressources communes
Avant les années 1970, la conservation de la nature et les droits des populations autochtones sont deux choses totalement séparées. D’ailleurs, les premiers acteurs de la conservation de l’environnement rêvent de réserves naturelles vides (Dumoulin Kervran, 2005). Le concept de nature « vierge », mais également la théorie de la « tragédie des communs », thèse énoncée en 1968 par Garett Hardin, dominent alors la conception des politiques de conservation. Cette théorie avance que, livrés à eux-mêmes, les utilisateurs des ressources communes vont inévitablement les épuiser ; la seule solution possible consistant à soumettre les « communs » à un contrôle privé ou gouvernemental. Mais dans les années 1980 et 1990, plusieurs études de cas réfutent cette théorie et démontrent l’existence de systèmes durables de gestion communautaire des ressources.
Les travaux et théories développés par Elinor Ostrom et ses collègues, antithèse de la tragédie des communs et de l’hypothèse de l’individu égoïste et rationnel (i.e. en information parfaite), identifient un certain nombre de facteurs propices au succès des systèmes de gouvernance7 des ressources communes et à leur robustesse8, c’est-à-dire à leur capacité d’adaptation à des chocs exogènes ou endogènes (encadré 1). Avec son livre « Governing the Commons » (1990) et l’obtention en 2009 du prix Nobel d’économie, elle représente une référence dans l’analyse des systèmes de gouvernance des ressources communes. Ses travaux soulignent notamment la diversité des régimes de gouvernance des ressources communes par rapport à la dichotomie privée versus public. Entre le libre accès et la propriété privée, il existe un faisceau de modes d’appropriation des ressources, qui se décrit en croisant les types de droits détenus et le niveau d’organisation sociale auquel ils sont exercés (Lavigne-Delville, 2003 cité par Eloy, 2005). La gestion commune des ressources peut s’avérer plus appropriée en termes de gain collectif que ce qui est prévu si l’on s’en tient au choix rationnel et à l’appropriation des biens par un petit nombre.
E. Ostrom et ses collègues insistent sur l’importance de la communication au sein du groupe, qui génère un climat de confiance, ainsi que sur celle des mécanismes institutionnels9 qui se développent au sein des communautés (ex. ensemble des règles et normes formelles et informelles, mécanismes de surveillance et de sanctions, etc.).
Dans des publications plus récentes, les auteurs de l’école de la gouvernance des ressources communes invitent à examiner plus en profondeur la question des interactions entre les dynamiques institutionnelles (i.e. les règles d’action collective) et les dynamiques écologiques qui s’expriment à plusieurs échelles (Anderies et al., 2004 ; Gibson et al., 2005 ; Ostrom, 2007 ; Brondizio et al., 2009). Ces interactions s’insèrent également dans une perspective temporelle car la robustesse des systèmes dépend des adaptations passées, qui peuvent soit aider, soit empêcher les systèmes de résister à de nouvelles perturbations et incertitudes (Anderies et al., op. cit. ; Young et al., 2006). La prise en compte de toutes ces interactions apparaît comme fondamentale pour comprendre la robustesse des systèmes permettant une gestion durable des ressources dans le contexte actuel de globalisation économique, de changements environnementaux globaux et de l’augmentation des interdépendances.
Alliance avec les mouvements de conservation de la forêt tropicale et changement de paradigme des politiques de conservation
Les travaux sur la gestion des ressources communes et les apports de l’anthropologie environnementale et de l’écologie historique qui réfutent l’idée de nature vierge influencent fortement les politiques de conservation à partir des années 1980-1990. Les politiques de conservation reposent dorénavant sur une opposition entre les idéologies « préservationnistes » et « conservationnistes » (Castro et al., 2006). Les premiers militent pour une conservation de la nature au travers de la mise en place d’aires protégées strictes, libres de toutes interactions humaines, et gérées par un gouvernement central. Quant aux conservationnistes, ils arguent que les hommes ont toujours influencé la nature. Ils soutiennent que les écosystèmes naturels doivent donc être gérés en tenant compte des savoirs et pratiques des populations locales et doivent respecter les droits locaux sur les terres et les ressources (Diegues, 1996).
C’est dans ce contexte, qu’à partir des années 1980, les intérêts des populations autochtones et des conservationnistes se retrouvent pour lutter contre des ennemis communs : les mégaprojets de développement des États et des banques multilatérales. De nombreuses alliances11 stratégiques écologico-indigènes se forment, et ce, jusqu’à nos jours. Ceux qui luttent contre « l’ethnocide » et « l’écocide » se découvrent les mêmes intérêts et s’organisent en réseaux transnationaux militants (Dumoulin Kervran, 2005 : 83). Précisons qu’il ne s’agit pas que des populations amérindiennes, les populations forestières dites « populations traditionnelles12 » prennent également part au mouvement, pour tenter d’obtenir des droits spécifiques sur les territoires qu’elles occupent.
Les réseaux de défense des peuples indigènes et des populations traditionnelles commencent donc à utiliser de plus en plus le discours écologiste. Bénéficiant du contexte favorable de médiatisation internationale de la préservation des forêts tropicales, ils saisissent l’opportunité pour inscrire leurs revendications territoriales dans un cadre environnemental. Ils se réapproprient le discours des anthropologues et arguent que leurs modes de vie traditionnels sont basés sur une relation harmonieuse avec la nature et son utilisation raisonnée, de par leurs connaissances empiriques de la forêt. Les représentants des populations amérindiennes et des populations traditionnelles revendiquent donc que les objectifs environnementaux de conservation de l’Amazonie et les objectifs sociaux des populations forestières de maintenir leurs modes de vie par une garantie de l’accès à leurs ressources, sont compatibles (Aubertin, 1995). On a une « double conservation », qui allie diversité culturelle et diversité naturelle dans une relation d’interdépendance (Dumoulin Kervran, op. cit. : 92).
Il y a donc un changement de paradigme entre les politiques de conservation des années 1960-70 et celles d’après les années 1980-90. Les politiques de conservation prennent de plus en plus en compte les populations locales, la question de leur participation et de leurs savoirs et pratiques environnementales. La conférence du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 marque une étape importante dans l’adoption de ce nouveau référentiel de « gouvernance participative » qui prône la participation de l’ensemble des acteurs parties prenantes dans le domaine de la gestion des ressources naturelles (Angeon et Caron, 2009).
La sphère locale devient alors l’opérateur principal des actions de conservation de l’environnement et des mesures qui l’entourent (Ballet, 2007 ; Rodary, 2008). Les acteurs sont invités à co-construire avec les représentants locaux de l’État et les collectivités territoriales des pratiques de gestion durable des ressources. La légitimité du modèle classique, dit top-down, suivant lequel l’État central impulse l’action publique est remise en question au profit d’une démarche ascendante (bottom-up), où l’État trouve sa raison d’être dans l’instauration de capacités de négociation entre une grande variété d’acteurs (Muller, 1990 ; Duran et Thoenig, 1996 cités par Angeon et Caron, op. cit.).
De nombreux types d’aires protégées intégrant les populations locales ont été créées, couramment nommées aires protégées de « développement durable » : elles ont pour but de concilier conservation et utilisation durable des ressources naturelles, en associant les populations locales. C’est par exemple le cas du Parc amazonien de Guyane, et de manière plus générale de la réforme de 2006 sur les parcs nationaux de France, ainsi que de nombreuses catégories d’unité de conservation « d’utilisation durable » au Brésil. Une des plus emblématiques est la catégorie de réserve extractiviste (Resex), créée en 1990 suite à la lutte des populations seringueiros (extracteur du latex de l’hévéa) et de Chico Mendes pour la reconnaissance de leurs droits territoriaux (Acre – Brésil) (Schwartzman, 1989 ; Allegretti, 1990). De manière générale, ces aires protégées reconnaissent des droits d’usage spécifiques sur les ressources naturelles aux communautés locales. Ces droits reposent sur un plan de gestion ou une charte, sorte de contrat d’utilisation du territoire et de ses ressources. En Guyane et en Amazonie brésilienne, ces aires protégées occupent une superficie supérieure à celles des aires protégées de protection intégrale (Veríssimo et al., 2011).
Une vision romantique et statique des populations amérindiennes
Le discours associant préservation de la nature et populations amérindiennes participe à créer une vision idyllique quant au comportement de ces populations par rapport aux ressources naturelles. Il cristallise la vision romantique de l’Amérindien bon sauvage. Cette projection soutient une vision duale de ces populations qui vivent soit de manière « traditionnelle » et donc en harmonie avec leur milieu, soit font évoluer leurs modes de vie et leurs systèmes de gestion des ressources et sont donc cataloguées d’« acculturées », renvoyant alors aux scénarios de la tragédie des communs. Dans ce cas, leurs pratiques coutumières et leurs capacités à gérer durablement leur territoire sont critiquées14 (Castro et al., 2006). C’est la porte ouverte aux détracteurs des territoires amérindiens, qui remettent en question leurs droits spécifiques à la terre dans la configuration « non traditionnelle » (Stoll, 2009).
Les auteurs critiquant la connotation des termes « population traditionnelle » et « communauté » sont de plus en plus nombreux (ex : Filho, 2009). En effet, le terme tradition tend à divulguer une vision figée des modes de vie et des cultures. Ceux-ci sont perçus comme des systèmes isolés alors que la notion de culture est dynamique et s’adapte au contexte dans lequel les populations évoluent (cf. partie 1.2 de ce chapitre). La catégorisation des populations traditionnelles tend également à rendre ces populations « invisibles », comme le montrent les travaux de Nugent (1993) et Brondizio (2009) sur les populations rurales amazoniennes caboclos. De plus, le terme « tradition » est souvent utilisé pour contraster avec le terme « moderne », ce qui augmente les sources de confusion (Castro et al., 2006).
Le terme communauté quant à lui, tend à homogénéiser les groupes de population. La communauté est vue comme une unité distinctive, qui partage des caractéristiques culturelles communes, et vit en harmonie et en consensus. Elle renvoie à une organisation et une prise de décision collectives, alors que bien souvent l’échelle de décision est celle de la famille ou du groupe de parenté. Elle gomme les divisions politiques internes, le rôle des leaders, dans une vision idéale du collectif. De plus, les personnes composant la communauté évoluent, et les communautés n’ont pas nécessairement une claire définition des membres leur appartenant ou non (Newing, 2009 ; Nasuti et al., sous presse).
De manière générale, les communautés ne sont pas fixes, et leurs frontières ne sont pas clairement définies, ce qui peut porter à confusion lorsqu’elles se voient octroyer des droits territoriaux, des projets, ou des fonds communautaires (Newing, op. cit.). La minimisation des difficultés liées à l’organisation communautaire et la mauvaise prise en compte de la diversité des communautés sont une des causes principales d’échec des projets de développement durable basés sur le collectif et la gestion de ressources communes (Le Tourneau et Droulers, 2011). A cela s’ajoute que la vision romantique des populations amérindiennes néglige les réalités économiques et sociales qu’elles vivent. Elles sont considérées comme des agents économiques non représentatifs, ce qui ne favorise pas une réflexion sur l’évolution des modes de vie amérindiens et leur avenir. Or toutes les études récentes montrent que les modes de vie et les systèmes amérindiens d’exploitation des ressources naturelles ne sont pas statiques, mais évoluent et s’adaptent aux situations socio-économiques locales (Harris, 2009).
Superposition avec les aires protégées et gouvernance environnementale
Importance environnementale des territoires amérindiens
Les populations amérindiennes ont acquis une forte responsabilité environnementale, car elles sont officiellement devenues usufruitières de grands territoires forestiers continus, le plus souvent bien préservés, et d’importance considérable pour la conservation des écosystèmes amazoniens. En effet, les terres indigènes occupent au Brésil une surface quasiment équivalente à celle des unités de conservation, soit 21,7 %15 de l’Amazonie brésilienne (Veríssimo et al., 2011), environ 47 % de l’Amazonie colombienne (Peres et Terborgh, 1995) et 75 % de l’Amazonie équatorienne (Irvine, 2000 cité par McSweeney, 2005).
Des études récentes démontrent l’importance actuelle des territoires amérindiens pour la conservation des écosystèmes amazoniens. En utilisant l’imagerie satellitaire, elles montrent qu’en Amazonie brésilienne les terres indigènes sont autant, et, dans certains cas, plus efficaces que les aires protégées pour maintenir l’intégrité du couvert forestier, ceci même dans les régions où les pressions de déforestation sont élevées (Nepstad et al., 2006 ; Nolte et al., 2013). De plus, elles demandent un investissement moindre de la part du gouvernement en comparaison de la mise en place et du maintien d’aires protégées de préservation intégrale.
La superposition avec des aires protégées et les enjeux de cogestion
Il existe de nombreuses superpositions entre territoires amérindiens et unités de conservation. C’est le cas en Guyane, avec la superposition du PAG et des Zones de droits d’usage collectifs (ZDUC) des populations autochtones, mais également dans les autres pays amazoniens comme le Brésil (Le Tourneau, Mello et Pasquis, 2006). De manière générale, ces superpositions impliquent des flous sur les statuts exacts des zones et connectent plusieurs acteurs aux objectifs différents. Elles confrontent les connaissances écologiques Terres indigènes brésiliennes couvrent 21,7 % de l’Amazonie brésilienne, soit plus d’un million de kilomètres carrés, et toutes les unités de conservation brésiliennes confondues 22,2 %. Ainsi, au total 2 197 485 km² (43,9 %) de l’Amazonie brésilienne bénéficient d’un statut particulier de terre indigène ou d’unité de conservation (Veríssimo et al., op. cit.). A titre comparatif la France a une superficie de 551 500 km² non compté l’Outre-mer. traditionnelles (TEK) avec les connaissances écologiques scientifiques ainsi qu’avec les normes environnementales nationales et internationales en vigueur. De plus, les aires protégées de développement durable, comme par exemple le Parc amazonien de Guyane, ouvrent le défi de la cogestion du territoire, c’est-à-dire concrètement de l’incorporation des connaissances écologiques traditionnelles aux normes de gestion des parcs, mais également de l’intégration de plusieurs systèmes de gouvernance.
Cette approche de cogestion doit accorder une place significative aux populations locales et aux acteurs de la société civile dans les processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques de conservation et de développement durable (Enjolras, 2010). La cogestion est alors entendue comme une méthode de gouvernance qui comporte un processus de prise de décision coopératif entre les différents usagers des ressources naturelles et les pouvoirs publics. Dans la mesure du possible, cette gouvernance doit prendre en compte tous les niveaux d’interaction hommes-milieux, du local au global, concept que Brondizio, Ostrom et Young (2009 : 269) nomment de « gouvernance multi-niveau » (multilevel gouvernance). En effet, ces auteurs soulignent que les différents systèmes d’utilisation des ressources naturelles sont de plus en plus connectés16 à d’autres niveaux d’interactions, rendant toujours plus complexes les questions de gouvernance environnementale (ibid. ; Lemos et Agrawal, 2006). La (co)gestion des aires protégées et des territoires amérindiens ne peut ignorer ces connexions multiples, et penser les territoires comme des « îles de ressources ». Au contraire, elle doit prendre en compte les multiples niveaux d’interdépendances des socio-écosystèmes et favoriser les institutions permettant d’articuler ces différents niveaux (Brondizio et al., op. cit.). Ainsi dans une perspective de cogestion, les arrangements institutionnels doivent faciliter la co-production, la médiation, la traduction et la négociation de l’information et des connaissances au sein et entre les différents niveaux d’interactions (Cash et al., 2006). La cogestion implique donc la production et l’appropriation sociale de nouvelles institutions. Cela passe par la formation d’un capital social17 capable d’intégrer différents acteurs et échelles.
Influence des politiques environnementale sur les territorialités et la gouvernance
Il faut également considérer que la mise en place d’aires protégées en territoire amérindien et les superpositions de différents régimes fonciers, de formes d’usage et de régulation des ressources, et d’acteurs et instances gouvernementales qu’elles sous-tendent, entraînent fréquemment des tensions et conflits. Comme nous l’avons mentionné partie 1.3, ils peuvent être moteurs de nouvelles formes d’organisation sociale, et induire des processus de reterritorialisation et de réaffirmation identitaire. En ce sens, Kent (2008) montre comment les conflits entre un Parc et des groupes autochtones du Pérou ont abouti à la « production » de territoires coutumiers. C’est-à-dire que des territoires flexibles et vaguement définis, sont devenus des territoires « coutumiers » clairement définis, fixés et exclusifs.
Mais les études analysant les impacts de la mise en œuvre des politiques de conservation sur les systèmes de gouvernance environnementale et les territorialités des populations amérindiennes restent peu nombreuses. En fait, la plupart des études portant sur les aires protégées et les populations autochtones examinent les processus de valorisation des savoirs locaux, de cogestion, et les retombées en termes de développement durable des aires protégées (par exemple Peres, 1994 ; Colchester, 2004 ; Schwartzman et Zimmerman, 2005).
L’importance de la prise en compte des politiques environnementales sur les territorialités amérindiennes
Cela fait maintenant plusieurs décennies que les populations amérindiennes sont en interaction plus ou moins directe avec des acteurs et des politiques environnementales. Une des conséquences est la projection d’une identité environnementaliste de ces populations, représentées comme culturellement figées et déconnectées des forces du marché. Cela même alors que de nombreuses études, que nous détaillerons dans la partie suivante, montrent que les modes de vie et les systèmes amérindiens de gestion des ressources naturelles ne sont pas statiques, mais présentent plutôt de bonnes capacités d’adaptation aux changements socio-économiques et environnementaux locaux. De plus, les politiques environnementales influencent la représentation identitaire des populations amérindiennes, leurs territorialités et leurs systèmes de gouvernance. Ces processus sont complexes et encore mal compris. Des questions demeurent ouvertes sur la façon dont les populations amérindiennes adaptent l’organisation sociale, spatiale et temporelle de leurs systèmes de gestion des ressources communes face à la mise en œuvre des politiques environnementales.
Ceci d’autant plus que les politiques environnementales promeuvent de plus en plus une co-construction « bottom-up » des pratiques et règles de gestion des ressources, tentant d’associer les différents niveaux d’acteurs et d’institutions interagissant plus ou moins directement sur un territoire. En ce sens, les politiques environnementales peuvent constituer un outil innovant de gouvernance du territoire, proposant un cadre se rapprochant d’un modèle de « gouvernance multi-niveaux » tel que proposé par Brondizio et al. (2009). Pour les populations amérindiennes, l’enjeu est de percevoir les multiples interactions s’exerçant sur leur territoire, et d’adapter leurs institutions à ce nouveau contexte, mais également de s’approprier les arrangements institutionnels mis en place par d’autres acteurs. Tous ces processus sont complexes et encore peu compris, et reposent sur la mobilisation d’un fort capital social.
Réorganisations contemporaines des territoires amérindiens
La majorité des populations amérindiennes d’Amazonie vivent au moins deux changements majeurs. D’une part, après avoir survécu au brutal effondrement démographique qui a suivi le contact avec les occidentaux, elles vivent aujourd’hui une forte augmentation démographique (McSweeney et Arps, 2005 ; Grenand et Reinette, 2010). D’autre part, bien qu’elles aient obtenu des droits fonciers collectifs sur de grands espaces, certaines politiques étatiques et la création d’infrastructures tendent à favoriser un regroupement des populations et par conséquent à modifier leurs patrons d’occupation du territoire (Grenand et Joiris, 2000). Cette promotion de la sédentarisation peut être délibérée, les États cherchant à mieux maîtriser leur population, ou involontaire du fait de l’installation d’infrastructures offrant un certain désenclavement (ex. piste d’aviation et routière) et de services comme la santé et l’éducation.
De plus, beaucoup de populations amérindiennes sont insérées de façon croissante dans un contexte de modernisation des conditions de vie, de monétarisation et d’intégration au marché. Des politiques contradictoires sont menées en Amazonie, et des espaces d’intégration nationale, marqués par des fronts pionniers, sont juxtaposés avec des espaces voués à la protection de l’environnement et aux populations amérindiennes (Mello et Théry, 2003). L’urbanisation progresse vers les parties les plus reculées de l’Amazonie avec la croissance des villes régionales, et s’accompagnent de modifications des territorialités, des systèmes de gestion des ressources, des formes d’habitat et des modes de vie (Eloy, Le Tourneau et Théry, 2005). De manière générale, les forces s’exerçant sur leurs territoires et leurs modes de vie sont chaque fois plus diversifiées, et mettent en relations une grande diversité d’acteurs, interagissant à des niveaux multiples (Brondizio et al., op. cit.). Même les territoires forestiers les plus isolés, ne peuvent être considérés comme des îles isolées de toute interaction.
Cette insertion croissante des populations amérindiennes dans des contextes en évolution pose la question de leur capacité d’adaptation, et de l’évolution de leurs choix en termes de gestion de leur territoire. Cette partie vise à éclairer quelques aspects des réorganisations contemporaines de leurs systèmes de gestion des ressources naturelles. Je commence par exposer quelques caractéristiques importantes des systèmes d’agriculture itinérante sur brûlis.
La flexibilité et l’adaptation de l’agriculture itinérante sur brûlis
Un système de culture intégré à l’écosystème forestier
L’agriculture sur brûlis est le mode d’exploitation des terres le plus répandu dans la zone intertropicale, et concerne environ 300 à 500 millions d’individus et 2500 millions d’hectares. Les systèmes d’agriculture itinérante sur brûlis (AIB) s’inscrivent dans une stratégie globale de subsistance. Ce sont des systèmes complexes qui permettent de répondre avec souplesse aux différentes contraintes s’exerçant sous l’effet de l’évolution du milieu social, économique et naturel (Dounias, 2000). L’encadré 3 présente une définition de l’agriculture itinérante sur brûlis.
Une définition communément acceptée est celle de Conklin, 1957 : tout système agricole dans lequel les champs sont défrichés par le feu et cultivés pendant une période brève pour être ensuite mis en jachère, le plus souvent forestière, à longue révolution. Elle comprend plusieurs phases : (i) défrichement d’une zone de forêt ; (ii) brûlis des débris végétaux ; (iii) culture du terrain pendant une période généralement brève ; (iv) mise en jachère pendant une période généralement longue. L’agriculture itinérante sur brûlis alterne période de culture et période de régénération forestière. Ce n’est donc pas une agriculture permanente (Dounias, op. cit.), mais bien un système agro-forestier séquentiel. En anglais, on se réfère à cette agriculture par slash-and-burn agriculture et swidden agriculture.
Le fait que cette agriculture commence par l’abattage de la forêt fait qu’elle est souvent interprétée comme le préambule à une déforestation irréversible. Ce serait oublier que la régénération forestière fait partie intégrante du système d’agriculture itinérante sur brûlis.
Cette agriculture n’est pas dissociable de l’écosystème forestier (figure 1), et elle peut même être comparée au processus de chablis. Le chablis, trouée forestière provoquée par la chute d’un arbre sénescent, constitue le principal moteur du renouvellement constant des écosystèmes forestiers tropicaux. Il est à l’origine de leur structure en mosaïque, faite d’une juxtaposition de micro-espaces qui composent la richesse biologique de l’ensemble. Sous cette conception, l’agriculture sur brûlis, quand elle est pratiquée de manière itinérante, avec des parcelles de petites tailles et un temps suffisant de régénération de la forêt, s’insère dans le potentiel naturel de cicatrisation de la forêt. C’est donc un système sophistiqué, car auto- régénérant, pouvant perdurer sans apport du moindre intrant extérieur (ibid.).
Les études sur les systèmes d’agriculture sur brûlis s’accordent sur le fait que les limites de la stabilité et la durabilité du système sont un allongement excessif de la durée de culture ou une diminution de la durée de la jachère, tous deux jouant sur la capacité du système à auto-renouveler sa fertilité (ibid.).
Un système de culture flexible et diversifié
Les études systémiques de l’agriculture sur brûlis montrent que celle-ci est très flexible et diversifiée. Cette diversité s’exprime autant dans la richesse des plantes cultivées (agro-biodiversité) que par la diversité des systèmes rencontrés à travers le monde.
L’agriculture sur brûlis interagit avec les autres activités d’exploitation du milieu, comme la chasse, la pêche et la collecte de produits forestiers ligneux et non ligneux (plantes alimentaires et médicinales, artisanat, bois de feu, bois de construction, etc.). Les agriculteurs pratiquant l’agriculture sur brûlis ne sont jamais des agriculteurs stricts. Ils optent pour des stratégies avec des niches multiples, où l’agriculture n’est qu’une composante d’un système de production plus généralisé, qui se révèle plus stable et plus résiliant. L’agriculture sur brûlis se combine avec diverses activités génératrices de revenus agricoles et non-agricoles, et permet ainsi d’entretenir des relations avec l’économie marchande tout en conservant une certaine autonomie. Il y a donc une forte tendance à la pluriactivité des agriculteurs afin de diversifier les sources de revenus. Bahuchet (2000) montre par exemple que les populations forestières ajoutent, sans pour autant substituer, certaines activités génératrices de revenus à leur système de production à composantes multiples. La capacité des systèmes d’agriculture sur brûlis à s’adapter aux changements est en général élevée, du fait de la souplesse du système et de l’étendue des choix qu’ils offrent aux agriculteurs forestiers : la stratégie qu’ils choisissent de mettre en œuvre, n’est qu’une option sélectionnée parmi un éventail étendu de possibilités. Or, une société qui a le choix est une société dotée d’un fort potentiel adaptatif (Carrière et Dounias, 2011). L’agriculteur apparaît donc comme le concepteur d’un système pérenne de production vivrière, intégrant de manière dynamique un environnement, des savoirs, et une culture (ibid.).
Alors que dans les conceptions linéaires de l’évolution des pratiques agricoles, l’agriculture sur brûlis est jugée irrationnelle, archaïque et figée, ainsi que vouée à se simplifier et à disparaitre, ces approches de l’agriculture itinérante sur brûlis montrent que ces systèmes tendent plutôt vers une complexification des activités et une diversification des produits et des circuits de production. D’ailleurs, une étude récente de Van Vliet et al. (2012) dresse un bilan actuel de l’agriculture sur brûlis dans le monde et montre que celle-ci tend à se maintenir, du fait qu’elle représente pour les familles un composant diversifié et sûr de leur systèmes de production, par rapport aux risques associés aux systèmes plus intensifs.
Cependant ce système est dans de nombreuses régions de monde déstabilisé par l’augmentation démographique et la baisse de la disponibilité en terre forestière. Cette baisse de la disponibilité en terre, est engendrée par de nombreux facteurs comme la privatisation des ressources naturelles, la conversion des forêts, la spéculation foncière, l’agro-industrie, etc., responsables de la réduction des surfaces arables. Quant à l’augmentation démographique, elle est un facteur d’influence important sur tout système agraire. Cependant, les théories classiques sur la pression démographique et les transformations agraires, opposant les thèses de Malthus18 et Boserup, tendent maintenant à être dépassées au profit d’approches plus systémiques. En effet de nombreuses études interdisciplinaires récentes menées en contexte de densification démographique, ont montré la complexité des systèmes agraires et la diversité des réajustements possibles autant à l’échelle micro que macro. Ces études soulignent notamment l’importance des emplois non agricoles, de l’accès à un approvisionnement agricole extérieur, des migrations permanentes ou saisonnières, et des mobilités rurales-urbaines. Elles montrent l’existence de logiques familiales visant la diversification des sources de revenus et la sécurité alimentaire (ex. Bilsborrow, 1987 ; Dufumier, 1996 ; Mazoyer et Roudart, 1998). A l’échelle micro, ces études montrent l’importance de considérer le statut foncier de la terre, la robustesse des arrangements institutionnels, les forces du marché, l’accès à des projets de développement, à du micro-crédit, et finalement les logiques et objectifs socio-économiques et culturels des familles.
Les économies familiales basées sur l’agriculture sur brûlis sont donc complexes et diversifiées. Il existe une multitude de facteurs et d’interactions à prendre en compte pour comprendre les choix des agriculteurs pratiquant le brûlis et leur capacité d’adaptation dans un contexte démographique, socio-économique et environnemental en évolution.
Les recompositions territoriales des systèmes amérindiens de gestion des ressources
Les systèmes d’agriculture itinérante sur brûlis des Amérindiens d’Amazonie ont traditionnellement été étudiés par les anthropologues. Les études qui adoptent une approche pluridisciplinaire se sont développées plus récemment lors de la prise de conscience de l’évolution des systèmes amérindiens en réponse aux changements du milieu social, économique et environnemental. Ces études couvrent un vaste champ thématique. On peut
18 L’influence de l’augmentation démographique sur les systèmes agraires est un thème débattu depuis très longtemps. Les théories classiques sur la pression démographique et les transformations agraires opposent capacité de charge de l’écosystème (Malthus, 1798) et intensification des systèmes de production (Boserup, 1965). La théorie malthusienne considère que la quantité de ressources disponibles et le niveau de technique de production définit la population maximale dans un espace donné. Cette population maximale qu’un écosystème donné peut supporter indéfiniment sans dégrader les ressources renouvelables est alors nommée capacité de charge. A l’opposé, pour Boserup, la densité de population entraine, lorsque la terre n’est pas abondante, une intensification de l’agriculture. discerner quatre problématiques majeures et non exclusives, toutes s’inscrivant plus ou moins directement dans une perspective d’analyse de la durabilité en contexte amérindien :
– l’évolution de la représentation identitaire et territoriale (ex. Gallois, 2004 ; Robert, 2004) ;
– l’évolution des arrangements institutionnels et des formes de gouvernance des ressources communes (ex. Bremner et Lu, 2006 ; Brondizio et al., 2009 ; Hayes, 2010) ;
– l’évolution des systèmes de production et de l’organisation sociale, économique, et territoriale – ce qui inclut également l’évolution de la transmission des savoirs, des techniques et de l’agro-biodiversité – (ex. Humphries, 1993 ; Godoy et al., 1998 ; Eloy, 2005 ; Le Tourneau, 2008 ; Collectif USART, 2009 ; Nasuti et al., sous presse) ;
– les changements de l’occupation de sol et des patrons de déforestation (ex. Lu et al., 2010).
Bien sûr, ces problématiques de recherche sont perméables, et ces travaux communiquent entre eux et se complètent. Nous avons, au cours de ce chapitre, déjà souligné certaines conclusions majeures des travaux portant sur les deux premières thématiques : la représentation identitaire et territoriale et les systèmes de gouvernance des ressources communes. Dans les parties suivantes nous abordons les études s’intéressant à l’adaptation des systèmes de gestion du territoire des populations amérindiennes puis à l’apport de l’imagerie satellitaire.
Des systèmes soumis à des contraintes et opportunités diversifiées
Plusieurs études analysent les transformations des systèmes locaux de gestion des ressources naturelles lorsqu’ils sont soumis à diverses contraintes et opportunités, telles que la croissance démographique (McSweeney et Arps, 2005 ; Sirén, 2007), l’intégration au marché (Godoy et al., 2005 ; Lu, 2007), l’expansion des frontières agricoles (Hayes, 2008), l’urbanisation (McSweeney et Jokisch, 2007; Eloy et Le Tourneau, 2009), la création d’infrastructures, dont les routes (Hamlin et Salick, 2003), et les changements dans le régime foncier (Freire, 2003 ; Robert, 2004 ; Albert et al., 2008). Tous ces travaux expliquent comment les populations amérindiennes s’adaptent à ces contraintes. Ils montrent que les populations ajustent continuellement, et de diverses manières, leur organisation sociale, leurs systèmes d’exploitation des ressources, leurs dynamiques identitaires et leur appropriation du territoire. L’article de B. Albert, P. Robert, A-E. Laques et F-M. Le Tourneau (2008) illustre cette diversité de réajustements chez les Yanomami et les Kayapó au Brésil par une approche centrée sur les territorialités. Les auteurs soulignent la créativité remarquable des systèmes amérindiens de gestion du territoire. Ainsi, les territorialités amérindiennes apparaissent spécialement dynamiques, complexes et versatiles (Alexiades, 2009).
Ces études apportent plusieurs éléments importants pour comprendre l’adaptation des populations amérindiennes face à diverses contraintes, spécialement au sujet de leurs recompositions territoriales.
Entre processus de sédentarisation de l’habitat et multi-localité
Dans beaucoup de situations, les populations amérindiennes sont spatialement concentrées et plus ou moins sédentarisées autour des infrastructures publiques, ce qui implique la formation de gros villages et des polarités territoriales (Nasuti et al., sous presse). Cette concentration de la population, associée à une forte augmentation démographique, exerce des contraintes spatiales sur les systèmes d’exploitation des ressources naturelles. Dans ce contexte, plusieurs études mentionnent la survenue de déséquilibres dans les systèmes amérindiens d’agriculture itinérante sur brûlis et principalement la diminution des temps de jachère. Les principales conséquences sont l’augmentation du travail de sarclage, la baisse des rendements des espèces cultivées les plus exigeantes, et l’augmentation des temps de transport pour se rendre sur les abattis et dans les zones forestières (Sirén, 2007 ; López et Sierra, 2010). Dans certains cas, ces déséquilibres peuvent conduire à un appauvrissement des systèmes de production et à une perte d’autosuffisante alimentaire (Melnyk, 1993 cité par Eloy, 2005). De plus, ces contraintes spatiales sur l’exploitation des ressources naturelles peuvent causer des conflits internes d’usage des ressources naturelles et contribuer à l’émergence de marques d’appropriation individuelle de la terre collective.
Si ces études en contexte d’habitat concentré montrent les contraintes auxquelles sont confrontés les systèmes d’exploitation des ressources naturelles amérindiens, elles soulignent également les diverses recompositions de ces systèmes. Par exemple, dans ces différents travaux, Flora Lu (Lu, 2001 ; Lu Holt, 2005 ; Bremner et Lu, 2006) montre que les difficultés d’accès à certaines ressources participent à un processus de prise de conscience collective du caractère « limité » des ressources, alors que traditionnellement les systèmes amérindiens de relation aux ressources considèrent celles-ci comme « abondantes » (Grenand et Grenand, 1996 ; Lu Holt, op. cit.). Cette prise de conscience peut donner lieu à un processus interne de normalisation de l’accès aux ressources et à l’émergence de nouvelles institutions cherchant à réguler l’usage des ressources et donc leur conservation.
Les recompositions territoriales représentent un aspect majeur des dynamiques d’adaptation des populations amérindiennes. En effet, plusieurs études montrent des processus importants de réorganisation spatiale et temporelle des systèmes de production, avec notamment la généralisation d’habitations de culture secondaires, situées géographiquement à proximité de la ressource forestière (Moran, 1974 ; Eloy, 2005 ; Sirén, 2007). Ces habitations de culture permettent un meilleur accès aux ressources forestières éloignées des lieux de concentration de l’habitat, qui bénéficient quant à eux de l’accès aux infrastructures. D’une certaine façon, le traditionnel déplacement cyclique de l’habitat est remplacé par la multi-localité19 des lieux d’habitat et des systèmes de production.
Ainsi, dans son travail de doctorat dans le haut Rio Negro sur les systèmes de production amérindiens, Eloy (op. cit.) montre qu’au lieu d’intensifier les systèmes d’agriculture sur brûlis en main d’œuvre et en capital – tel que le présage la vision classique de l’innovation agricole – les innovations sont d’ordre territorial : les adaptations se situent plutôt au niveau de l’organisation spatiale et temporelle des systèmes de production.
La diversification des mobilités
Ces recompositions territoriales passent par une réorganisation des mobilités20 amérindiennes qui s’expriment tant à l’échelle rurale-rurale (c’est-à-dire entre plusieurs lieux ruraux d’habitat et d’exploitation des ressources), qu’à l’échelle rurale-urbaine.
Plusieurs études récentes analysent l’augmentation des mobilités vers les villes des populations forestières (i.e. amérindiennes mais aussi traditionnelles) et montrent qu’un grand nombre de familles adoptent des stratégies multi-locales, basées sur l’articulation des espaces ruraux et urbains (Piantoni, 2002 ; Peluso et Alexiades, 2005 ; Padoch et al., 2008 ; Eloy et Lasmar, 2012 ; Nasuti et al. sous presse,). Les espaces urbains offrent un accès à des infrastructures de meilleure qualité (ex. hôpitaux, écoles supérieures) et des emplois, tandis que les espaces ruraux garantissent un accès aux ressources naturelles, une sécurité foncière, et donc une certaine autonomie alimentaire. Le développement de nouveaux marchés régionaux pour les produits forestiers comme l’açai, mais aussi les plantes médicinales, le bois, le gibier, etc., lié à l’installation récente de citadins originaires des zones rurales et à une « ruralisation des goûts » participent à augmenter les mobilités rurales-urbaines (Brondizio, 2004 ; Padoch et al., op. cit.). De plus, l’accès de plus en plus fréquent à des revenus monétaires issus du développement d’emplois locaux et d’aides sociales (ex. allocation familiales et retraite rurale, que ce soit en Guyane ou au Brésil), a pour conséquence que de plus en plus de personnes adoptent un patron de mobilités circulaires mensuelles vers les villes afin de toucher son salaire et de faire des achats.
Les mobilités s’expriment à l’échelle de l’individu, du ménage ou encore de la famille élargie, avec par exemple des familles étendues multi-locales dont certains membres résident en villes et participent à la diversification des sources de revenus des membres de la famille restés en zone rurale. Nasuti et al. (op. cit.) montrent combien cette notion de réseaux de parenté est essentielle pour maintenir des droits d’usage des ressources « actifs » dans les territoires forestiers pour les personnes ayant de forte mobilité rurale-urbaine : les membres de la famille élargie ayant les patrons de mobilité les plus faibles compensent les mobilités élevées des membres passant une grande partie de leur temps en ville, leur assurant ainsi un ancrage dans le territoire forestier. En d’autres termes, la possibilité d’articuler les ressources des milieux ruraux et urbains est basée sur la capacité des familles à maintenir leurs droits d’usage et leurs alliances locales.
|
Table des matières
TRODUCTION GENERALE
PREMIERE PARTIE – Les enjeux multiples des territoires amérindiens
Chapitre 1. Les territoires amérindiens contemporains, des dynamiques variées
1. Territorialité et identité amérindienne, des notions dynamiques
2. Gestion des ressources communes et conservation des forêts tropicales
3. Réorganisations contemporaines des territoires amérindiens
4. Conclusion du chapitre. Synthèse du contexte général de la recherche
Chapitre 2. Comprendre les dynamiques du territoire des Amérindiens wayãpi et teko de la commune de Camopi
1. Un site d’étude représentatif : le territoire des Wayãpi et Teko de la commune de Camopi, dans le Parc amazonien de Guyane
2. Problématique et objectifs de recherche
3. Méthodologie générale
4. Conclusion du chapitre
Chapitre 3. Du territoire historique à la structuration du territoire actuel
1. La construction identitaire et territoriale des Wayãpi et des Teko : un processus dynamique
2. Le système « traditionnel » de gestion du territoire des Wayãpi et des Teko
3. Organisation des populations amérindiennes de Guyane, un tournant dans leur histoire
4. Les contraintes contemporaines exercées sur le territoire, entre orpaillage et conservation de l’environnement
5. Conclusion du chapitre
DEUXIEME PARTIE – Recompositions territoriales et identitaires dans la commune de Camopi
Chapitre 4. Dynamiques contemporaines de gestion du territoire des Wayãpi et Teko : des mobilités revisitées
1. Caractéristiques démographiques et socio-économiques de la société
2. Organisation contemporaine de l’habitat : la multiplication des hameaux
3. Organisation spatiale des abattis : l’articulation de plusieurs sites d’exploitation des ressources complémentaires
4. Conclusion du chapitre. La multi-localité au cœur de la gestion contemporaine du territoire
Chapitre 5. Multi-localité et réaffirmation identitaire et territoriale : une forme de gouvernance environnementale amérindienne ?
1. Des logiques familiales au cœur de la gestion du territoire
2. Les différentes logiques économiques, productives et territoriales des ménages
3. Les dynamiques de réaffirmation identitaire et territoriale, un moteur de la réorganisation des territorialités
4. Conclusion du chapitre. Adaptation du système de gouvernance environnementale des Wayãpi et des Teko
TROISIEME PARTIE – Populations amérindiennes et stratégies nationales d’aménagement du territoire
Chapitre 6. Multi-localité et affirmation de la souveraineté territoriale, l’exemple de la Terre indigène wayãpi au Brésil
1. Un contexte socio-économique, institutionnel et environnemental bien différent, mais des contraintes et enjeux communs
2. Des dynamiques d’occupation du territoire comparables : mouvements de regroupement et d’éclatement de l’habitat
3. De l’empreinte agricole aux mobilités territoriales
4. Conclusion du chapitre. Mise en perspectives sur la gouvernance environnementale des territoires amérindiens
Chapitre 7. Développement endogène et enjeux de gouvernance du territoire des Wayãpi et Teko
1. Un territoire frontalier aux enjeux multiples
2. Enjeux de gouvernance du territoire des Wayãpi et des Teko pour la définition d’un projet collectif de développement endogène
3. Conclusion du chapitre. L’appropriation sociale des parcs nationaux, un enjeu important pour appuyer un developpement endogène du territoire
CONCLUSION GENERALE
Bibliographie
Télécharger le rapport complet