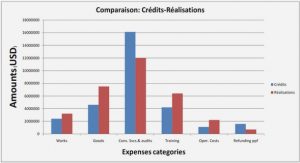Du handicap mental aux troubles des fonctions cognitives
La lecture de l’évolution terminologique qui précède mérite à présent que l’on se penche sur la signification à donner à ce glissement terminologique et sémantique à la fois. Pour cela, je formulerai deux hypothèses. La première consiste à penser que cette mutation terminologique participe d’un processus d’euphémisation destiné à dépasser certaines terminologies à forte connotation médicale devenues avec le temps trop stigmatisantes et ayant comme incidence de faire obstacle à l’intégration puis à l’inclusion scolaire. La seconde hypothèse se situe du côté de la place que prend l’avancée de la recherche et des connaissances dans le champ des neurosciences et de la neuropsychologie de l’enfant au sein de l’Éducation Nationale, et plus particulièrement pour ce qui concerne les facteurs explicatifs des difficultés et de l’échec scolaires.
Examinons la première hypothèse. On vient de voir que la notion de handicap mental est un objet ambigu tant sur le plan théorique que dans l’usage qui en est fait, au moins du point de vue de l’Éducation Nationale. À cette ambiguïté vient s’ajouter un autre inconvénient, et non des moindres, celui des effets stigmatisants sur les personnes ainsi catégorisées. Christine Magnin de Cagny souligne à cet égard que dès la parution de la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975, la notion de handicap mental n’avait été « admise qu’avec réserve en raison de sa lourdeur [souligné par l’auteur], de sa connotation négative la rendant difficile à porter » (2003, p. 61). Le terme de handicap mental sans doute ne s’était-il pas défait des connotations devenues péjoratives des termes qui l’ont précédé : idiots, anormaux, arriérés, débiles, déficients, inadaptés… L’étude de l’évolution du vocabulaire utilisé, précise François Chapireau (1999) :
« (…) illustre le malaise suscité par ce qu’on a appelé pendant longtemps l’idiotie. Pendant des siècles en effet, l’idiot n’a cessé d’interroger la société sur ce qui caractérise la nature humaine, et c’est parce que cette humanité lui a longtemps été déniée qu’il a été parfois supprimé – ce qui se faisait fréquemment dans la Grèce ou la Rome antiques, mais on a vu la résurgence de cette conduite avec le régime nazi- caché aux yeux des autres ou relégué dans des établissements qui ne furent pas toujours charitables. Les attitudes à l’égard de l’idiot furent souvent extrêmes et contradictoires en fonction de la représentation qu’on avait de celui-ci. Les arriérés mentaux ont toujours été l’objet d’une ambivalence, caractérisée par l’effroi et le rejet qu’ils inspirent du fait des liens qu’on leur prête avec le démon, ou au contraire d’une valorisation en rapport avec des pouvoirs surnaturels qu’ils possèderaient et qui conduit à ce qu’ils soient protégés parfois même par des personnages importants. » (1999, p. 18) .
Reconnaissant avec Christine Magnin de Cagny le caractère globalisant (en 1975 le handicap mental est parfois confondu avec la maladie mentale) et stigmatisant, il concède plus loin que :
« (…) l’usage faisant loi (…) Le « handicap mental » est trop ancré dans le langage courant français pour disparaître autrement que les locutions antérieures (enfant déficient, enfant inadapté, etc.), c’est-à-dire par l’usure des mots. Dans l’immédiat, il faut prendre position, en sachant que jamais aucune démonstration logique ni argumentation convenable n’ont modifié les modes linguistiques. La tyrannie de l’usage courant reste la règle primordiale. En France, on parle d’enfant handicapé mental. C’est ainsi. Le manuel de l’OMS énonce explicitement que « il est inapproprié de qualifier un handicap de mental ». Cependant, il s’agit du texte anglais où le handicap est uniquement le désavantage social. » (ibid., p. 102) .
François Chapireau fait ici référence à la classification de Philip Wood qui proposait une conception du handicap selon les trois plans d’expérience précédemment évoqués (déficience, incapacité, désavantage), le dernier seulement correspondant au terme français de handicap. C’est pourquoi en anglais la classification s’intitule : International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps. Néanmoins, contrairement au projet de Philip Wood, qui envisageait une distinction claire entre les trois plans, dans la traduction française de l’ICIDH et l’usage qui en a été fait, le terme de handicap et celui de déficience sont quasiment confondus. Le handicap (au sens de désavantage) résulte d’une déficience ou d’une incapacité qui limite ou fait obstacle à l’accomplissement d’un rôle considéré comme normal pour un individu en fonction de son âge, de son sexe et de l’environnement social et culturel au milieu dans lequel il évolue. Le handicap n’est alors ni strictement, ni proportionnellement défini par la nature et l’importance d’une déficience. La distinction entre déficience et handicap qui n’a jamais véritablement été opérée en France, du fait en partie de la traduction française, a donné un caractère englobant au terme de handicap là où celui-ci aurait dû s’en tenir à rester la seule dimension sociale et situationnelle des deux axes que sont la déficience et l’incapacité. Le recouvrement des notions de handicap et de déficience a contribué à diffuser un sens exclusivement médical au terme de handicap (entendu comme déficience) qui a par ailleurs persisté par :
« (…) l’emploi d’un guide-barême, dont l’entrée sur le handicap passe par la détermination d’une déficience, et sous l’effet sans doute ascendant de la culture médicale. Cette équivoque me semble s’ancrer dans l’ambigüité que perpétue la polysémie du mot handicap qui en français désigne à la fois la partie et le tout, le troisième niveau et l’ensemble, englobant non seulement le handicap stricto sensu, tel que l’entendait Wood et que nous avons traduit par désavantage – terme qui n’est que très peu employé dans son sens technique et n’est en tout cas pas passé dans l’usage courant, y compris celui des commissions – et la totalité des trois niveaux incluant donc celui de déficience et risquant si ce n’est de la renforcer du moins de ne pas contribuer à lever la confusion entre cette dernière et le handicap. » (Magnin de Cagny, 2003, p. 61).
Si dans sa version française, la CIDIH a permis d’introduire une dimension sociale dans la réflexion sur le concept de handicap, dans la pratique, le modèle médical est resté omniprésent (Barral, 1999 ; Barral et Roussel, 2002). C’est l’axe des déficiences, le plus « médical », qui a été le plus facilement adopté ; le troisième axe, celui des désavantages, qui était le plus novateur, prenant en compte l’interaction entre la personne et son environnement, a été quant à lui peu pris en considération. Catherine Barral attribue en partie cet usage restreint de la CIH au fait que « la cause initiale du désavantage reste uniquement imputée à la déficience en vertu du lien de causalité qui rend compte de l’enchaînement qui va de la déficience à l’incapacité et au désavantage. » (Barral, 2007). Pour François Chapireau, la relative prise en compte du troisième plan d’expérience tient avant tout à la traduction qui a été faite de la version de Wood :
« À partir du moment où les traducteurs français ont décidé que le handicap désignerait l’ensemble des trois plans de conséquences des maladies, la définition de l’enfant handicapé s’impose à nous, malgré cette contradiction entre l’usage commun français et le modèle conceptuel de Wood. » (1999, p. 103) .
Est-ce à dire que si le terme de handicap avait été employé conformément à la classification de Philip Wood, rendant impropre l’usage des adjectifs « mental » ou «physique » accolés au terme de handicap, l’usage des termes de déficience intellectuelle ou mentale pouvant générer (ou non) un handicap (au sens de désavantage), aurait été moins stigmatisant ? L’UNAPEI, dont un des enjeux est de lutter contre la ségrégation et les discriminations et dont on peut penser qu’elle se montre attentive et vigilante à l’égard des mots employés, reste également ambiguë au regard de la classification. Voici la définition qu’elle en donne :
« Pour l’UNAPEI, le handicap mental est d’abord la conséquence sociale d’une déficience intellectuelle. L’expression « handicap mental » qualifie à la fois une déficience intellectuelle (approche scientifique) et les conséquences qu’elle entraîne au quotidien (approche sociale et sociétale). » .
Alors qu’elle opère une distinction conforme à la classification de Philip Wood entre les termes de déficience et handicap, l’UNAPEI continue d’utiliser le terme de handicap assorti de l’épithète mental jusque dans le déroulé de son acronyme. La raison est sans doute que les termes de déficience intellectuelle, bien que plus appropriés si l’on se réfère à la CIDIH, n’en restent pas moins aussi stigmatisants que ceux de handicap mental. Si ces derniers sont jugés péjoratifs, celui de déficience (intellectuelle ou non) renvoie étymologiquement au manque, à l’insuffisance, à la faiblesse, termes tout aussi, sinon plus, chargés négativement. Par ailleurs, si l’on se rapporte à la conception sociale et interactionniste du handicap dont l’UNAPEI se réclame, parler de handicap mental condense à la fois la cause et la conséquence. Il serait plus juste mais moins « pratique » dans le langage courant d’utiliser l’expression « handicap dont l’origine est une déficience intellectuelle ».
Notons enfin que la première circulaire instituant les UPI faisait état dans son intitulé « d’adolescents présentant un handicap mental », se détachant par-delà de la terminologie employée dans les précédentes circulaires, connotée péjorativement, de déficience intellectuelle. Comme le souligne Jean Sébastien Eideliman avec le temps les mots employés se chargent « inexorablement de connotations péjoratives que le nouveau terme évacue pour un temps » (2008, p. 107). Ce processus est d’autant plus vrai que les termes se côtoient avant de se substituer, ce qui renforce les effets de contamination. Un terme, aussi péjoratif soit-il, ne disparaît pas d’un coup de baguette magique du langage courant par la seule volonté du législateur de le bannir de son vocabulaire, et ce d’autant plus s’il n’existe pas d’unité lexicale entre les différentes institutions. Le champ du médico-social, partenaire privilégié de l’Éducation Nationale pour le soutien à la scolarisation des élèves dont on parle, fait usage conjointement des termes de handicap mental et de déficience intellectuelle. Certes, les mots sont importants, mais l’apport du schéma conceptuel de Philip Wood ne réside pas tant dans les mots employés que dans le regard nouveau qu’il porte sur la notion de handicap à travers sa dimension de désavantage social, qui fait une place aux conséquences sociales des déficiences et incapacités et met en évidence l’aspect non médical de la question du handicap. François Chapireau regrette la confusion sémantique qu’il a pu y avoir à ce sujet (1992).
La terminologie de troubles importants des fonctions cognitives qui a vu le jour avec la circulaire sur les UPI de 2001 (devenue troubles des fonctions cognitives dans la circulaire de 2010), est apparue concomitamment à la publication par l’OMS en 2001 de la Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) qui a marqué l’achèvement d’un long processus de révision de la version de Philip Wood. Dès sa parution en 1980, la CIH s’est en effet vu reprocher un certain nombre de limites et a suscité de nombreuses controverses de la part de mouvement sociaux de défense des droits des personnes handicapées (plus particulièrement aux États-Unis, au Canada, au Québec et en Angleterre) parmi lesquels ont comptent quelques chercheurs activistes qui revendiquent une approche sociale du handicap (Ville, Fillon et Ravaud, 2014, p. 95). Catherine Barral et Pascale Roussel (1999, 2002, 2007) soulignent les principaux points d’achoppement à l’égard de la CIH : son aspect trop linéaire par la causalité qu’elle tendait à établir entre ses trois dimensions, l’axe des désavantages et l’influence de l’environnement trop peu pris en compte, une centration trop forte sur les seules caractéristiques déficitaires de la personne, une approche défectologique et fixiste du fait d’une focalisation trop importante sur l’axe des déficiences, une vision trop médicale du handicap seulement perçu comme la conséquence directe d’un problème de santé, etc . L’enjeu affiché de la CIF fut donc de répondre aux critiques portées à l’encontre de la CIH, et plus particulièrement de prendre en compte les données environnementales dans la description du handicap et d’utiliser des termes qui ne soient plus connotés négativement. L’objectif étant de sortir du seul modèle biomédical pour aller vers un modèle multifactoriel, interactif, évolutif et universel du handicap (et non à des personnes stigmatisées sur un critère physique ou mental). Elle définit un modèle au sein duquel l’individu et l’environnement sont en relation dans une circularité de causalités et d’effets.
|
Table des matières
INTRODUCTION GÉNÉRALE
PREMIÈRE PARTIE : DU MODE DE DÉSIGNATION AU TRAITEMENT SOCIAL
Chapitre I. Des mots pour les dires
A. De la difficulté à nommer ceux dont on parle
B. Du handicap mental aux troubles des fonctions cognitives
C. Nommer malgré tout
Chapitre II. Les conditions socio-historiques de l’émergence du paradigme d’inclusion scolaire
A. Au fondement de l’intégration : le temps des pionniers
B. Inadaptation versus adaptation
C. L’intégration scolaire : des intentions au droit
D. L’intégration scolaire : un paradigme en quête d’adhésion
E. L’ère de l’inclusion
Conclusion
DEUXIÈME PARTIE : LE TERRAIN, L’ENQUȆTE ET LE CHERCHEUR
Chapitre I. Lieux, contextes et temporalités de l’enquête
A. Le terrain d’enquête : bornes et limites
1. Le lycée d’enseignement professionnel Jean Jaurès
2. Le collège Jean Zay
3. Les lieux de stages
4. « Déambulations pédestres »
5. Le milieu d’interconnaissance de l’ASH
6. Le milieu d’interconnaissance de l’ULIS
B. Les « temps » de l’enquête
Chapitre II. Une relation de « familiarité double » au terrain
A. Enquêter sur un terrain familier
1. Nature des liens de familiarité au terrain
2. Etre indigène du milieu enquêté permet-il un accès plus aisé au terrain ?
3. Membre du milieu enquêté mais aussi chercheur
4. La familiarité à l’objet étudié constitue-t-elle un obstacle à sa connaissance ?
B. L’amitié dans la relation ethnographique
1. Un ami devenu « interlocuteur privilégié »
2. Une forme particulière d’« enclicage »
Chapitre III. Le point de vue de ceux qui sont désignés handicapés mentaux
A. Des voix et des points de vue en mal de reconnaissance
1. Quelle place dans les sciences sociales ?
2. Une démarche partisane ?
B. Le point de vue et les voix des élèves rattachés au dispositif ULIS
1. Le « brouillage » des âges
2. Situation de désubjectivation et statut de « non personne »
3. Des conditions peu favorables à l’émergence des voix
(a) L’organisation spatiale comme ordre social dominant
(b) Les conditions sociologiques des équipes de suivi de scolarisation
C. D’une relation de méfiance à une relation de confiance
1. Se faire accepter, être accepté
2. De l’importance du « faire avec »
3. Le journal de terrain et l’entretien ethnographique
Conclusion
TROISIÈME PARTIE : D’UNE POLITIQUE D’INCLUSION SCOLAIRE À DES EXPÉRIENCES VÉCUES
Chapitre I. Franchir le seuil du lycée : entre parcours individuels et logiques institutionnelles
A. La « lutte des places »
1. D’une place refusée à une place négociée
2. L’emprise de l’attribution des places
(a) Tom : « Le lycée, un point c’est tout. »
(b) ULIS lycée versus établissement spécialisé
3. L’ « autonomie » : un critère majeur de sélection pour accéder au lycée
4. Vers une inclusion différenciée
B. De quelques traits des conditions de possibilité des élèves de l’ULIS collège à définir un projet professionnel
C. Faire le « choix » d’un projet professionnel : entre rêve et réalisme
1. Un rapport « utilitariste » à l’atelier de SEGPA
2. Le temps de la « résignation lucide »
Conclusion
Chapitre II. Exister au sein de l’espace social du lycée
A. Comment le lycée « pense-t-il » les élèves rattachés à l’ULIS ?
1. « On les voulait pas, on avait peur… »
2. Le soupçon d’incompétence comme ombre portée dudit handicap mental
3. L’ULIS, un dispositif mal connu au lycée J. Jaurès
B. Être rattaché à l’ULIS : une épreuve pour l’identité
1. L’ULIS : un dispositif-stigmate
2. Le « handicap » un intrus en soi
3. Hugo : le temps du doute
C. Le point de vue des pairs
1. De quels pairs parle-t-on ?
2. Le temps des premières rencontres
3. « Même dans notre tête on savait qu’ils étaient décalés »
4. De la proximité compassionnelle à la distance sociofuge
5. De la proxémie en actes au contrôle de l’information
Conclusion
Chapitre III. Accéder aux savoirs, acquérir un diplôme
A. Les conditions de possibilité d’appropriation des savoirs
1. Entre présence et absence
2. Des modalisations problématiques au sein des classes d’inclusion
3. L’accessibilité pédagogique des classes de CAP
4. Faire face
(a) Oriane et Jade : « On se met à deux et on essaye de trouver »
(b) Oriane : « Des yeux de partout »
(c) Hugo : « Repérer l’intello… »
(d) Sarah : « Sécher les cours »
5. L’AVS : une aide au service de l’accessibilité pédagogique ?
(a) La crainte d’un regard extérieur
(b) L’adaptation des contenus de savoir : vers une délégation tacite
(c) « Je peux pas être invisible !»
B. Le CAP : du projet de l’institution au point de vue de l’élève
1. Le projet de l’institution
2. Le CAP : l’avenir d’une illusion
3. Le CAP du point de vue des élèves
(a) Un signe de normification
(b) Un passeport pour obtenir un travail
(c) Condition d’une indépendance économique et sociale
(d) La fin du statut de lycéen
Conclusion
CONCLUSION GÉNÉRALE