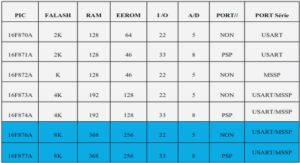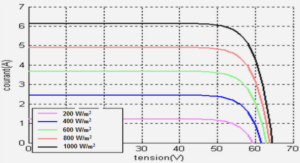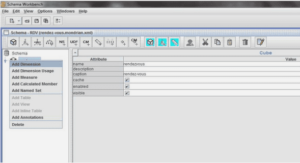Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Face aux murs des « villas » et « complejos de torres* »
Comme bon nombre des grandes métropoles lati- no-américaines, la capitale argentine témoigne de l’importante disparité économique et de l’inégale répartition des richesses au sein du pays. Coexistent, en se juxtaposant parfois brutalement, extrême richesse et extrême pauvreté.
C’est au fur et à mesure de mes expériences au sein de la ville de Buenos Aires que j’ai peu à peu pris conscience que ces deux voisines s’affrontaient quelquefois violemment dans le paysage faussement homogène de la capitale argentine. A perte de vue les tours colonisent l’horizon, nous plongeant dans un flot de fa- çades incessant, bien loin du paysage maritime du Rio de la Plata. Confrontée chaque jour au dédale des rues portègnes au travers de mes déplacements au sein de la capitale, c’est depuis les multiples moyens de transport que j’empruntais que je me suis peu à peu questionnée sur les murs érigés de Buenos Aires.
Au cours de mon année passée j’ai vécu au sein de deux quartiers et donc connu deux parcours bien distincts pour rejoindre mon école, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FADU), au Nord Est de la ville, donnant sur l’estuaire de la Plata.
A bord du bus 42 « por Frederico Lacroze1 », 1h30 durant, au mi- lieu de la congestion quotidienne du trafic, ce trajet qui me parais- sait trop souvent interminable, a maintes fois mis ma patience à rude épreuve.
De Caballito à Belgrano, en traversant les quartiers Villa Crespo, Chacarita et Colegiales, ce sont autant d’ambiances différentes parcourues, non sans mal, dans un chaos urbain flottant qui par- ticipe de l’atmosphère électrique de la ville. Pourtant, à l’approche de la Ciudad Universitaria – le campus universitaire – le climat
* Les « villas » sont les bidonvilles argentins. Les « complejos de torres » dé- signent les complexes de tours généralement ceints de murs.
s’apaise alors que le voyage prend bientôt fin. Après avoir pas- sé les rues “pittoresques” du très chic quartier Belgrano, dont les maisons authentiques de la fin du XIXe siècle rappellent l’âge d’or de l’Argentine, le bus slalome entre les nouvelles manzanas (îlots) entièrement résidentielles récemment édifiées.
Ce sont ces tours clinquantes, ceintes de hauts murs et barbelés qui m’interpellent en premier lieu. Les abords de cette manzana, cernée de murs, dénotent quant aux rez de chaussée courants de Buenos Aires, dont les entrées bordent frontalement le trottoir. Ces murs tagués d’un « Las torres arruinan a todo » – « les tours gâchent tout » – qui cernent la résidence me questionnent, et en- gagent mes premières réflexions sur ce modèle particulier.
Plus tard, au second semestre, je serai confrontée quo- tidiennement à l’autre pendant de la réalité économique du pays. Alors que mon trajet ne dure plus que dix minutes jusqu’à la Ciu- dad Universitaria, je longe, deux kilomètres durant à bord du train rouge – « el tren rojo » -, la plus connue des villas portègnes, la villa 31 construite le long du chemin de fer, en frange de la station Retiro.
Quittant le Micro-centro que j’habitais alors, près de la Plaza San Martin, proche des ambassades et du quartier des affaires de la ca- pitale, ce sont deux mondes qui se côtoient dans une ambiance très particulière où absolument tout se mêle. C’est un univers parallèle qui se dessine entre l’hôtel Sheraton et la façade de la plus célèbre gare de la capitale, entre les trente-cinq lignes de bus différentes, les embouchures de métro et l’arrivée des cars en provenance de tout le pays et de bien au delà encore… Une immersion totale dans une ambiance effervescente, survoltée entre mochileros (rou- tards), touristes, hommes d’affaires, vendeurs à la sauvette et ha- bitants de ce quartier précaire abritant plus de 30 000 personnes.
Observant la villa matin et soir, depuis le wagon, on s’habitue tris- tement à cette sombre réalité dont, souvent, les voix des enfants mendiants à bord du train nous sortent de la routine, rendant toute sa puissance à la violence de ce parcours.
Face aux murs de la ville, que ce soit ceux de Belgrano encerclant les hautes tours sécurisées ou ceux plus fragiles de la villa 31, j’étais confrontée à des impasses, des parties de la ville auxquelles je ne pouvais accéder. C’est bien deux types d’enclaves que j’étais amenée à longer. Des « ghettos », les premiers « dorés » et contemporains, les seconds très précaires et déjà anciens, dont les raisons de l’accès limitée à ses seuls résidents, différent en fonc- tion de la nature de leur enclavement.
« Le ghetto peut être compris de façon différente selon l’identité raciale ou ethnique de l’observateur, selon que celui-ci parle de l’intérieur ou de l’extérieur, et selon que la concentration est vue comme “volontaire” ou “contrainte”. Dans tous les cas ghetto parle de statut social et de rapports de pouvoir 1. »
Le mot renvoie, à l’origine, aux minorités juives contraintes de vivre à l’écart de la population, que ce soit tout d’abord au XVIe siècle à Venise en Italie ou plus tard en Allemagne et en Autriche pendant la seconde guerre mondiale. Plus tard encore, au milieu du XXème siècle, le mot intègre la langue anglo-saxonne pour dé- signer les quartiers noirs pendant la ségrégation aux Etats-Unis. En France le terme désigne dans le même temps la situation de la classe ouvrière, contrainte de vivre dans des conditions précaires. Le mot, quelque soit la langue dans laquelle il est employé, fait directement référence à l’isolat d’une minorité ethnique ou sociale identifiée et revêt automatiquement une connotation péjorative, exprimant une situation fragile, dangereuse ou risquée. La villa est un ghetto, au même titre que les complejos de torres en sont un.
« On utilise ghetto dans un sens plus général pour désigner des commu- nautés volontairement isolées ou enclaves. Détaché de son association avec la détresse sociale urbaine, peut-être par ironie, le mot peut aussi évoquer des isolats privilégiés 2. »
Ce mémoire s’attarde à interroger un modèle d’encla- vement, qui contrairement au cas des villas de la capitale, résulte, sinon d’une volonté, au moins d’un choix effectué de la part de ses habitants.
Nombreux sont les vocables utilisés pour évoquer des situations d’enclavement, d’enfermement, de retrait. Au travers de mes lec- tures j’ai pu en croiser bon nombre, empruntant à différentes lan- gues, et qui décrivent également différents modèles en fonction des pays.3 Le plus souvent perçus par la presse et les auteurs qui se sont emparés du sujet comme un modèle d’enclavement témoi- gnant d’une situation urbaine en crise et de la mise en péril du statut de l’espace public, les copropriétés fermées sécurisées sont souvent évoquées à travers le terme de « ghetto de riches » ou « ghettos dorés », ou très communément « gated communities » – du mot gate, « porte » – au États-Unis.
Les origines et l’influence anglo-saxonnes des copropriétés fermées de Buenos Aires
A l’évocation du mot Country club, qui désigne les ré- sidences fermées périphériques de la capitale portègne, le renvoi à un modèle d’origine anglo-saxonne est inévitable.
Comme le précise Sophie Loussouarn dans L’évolution de la so- ciabilité à Londres au XVIIIe siècle3, le mot « club » vient du verbe anglais « cleofan » qui correspond à l’action de diviser, et se rap- porte ainsi au partage des frais de gestion du lieu privé. J’ai retenu, afin de préciser l’origine anglo-saxonne¹ de ces cercles résidentiels fermés, trois pratiques propres à la société aristocratique britan- nique au XVIII et XIX siècles, qui témoignent d’un attrait pour le regroupement communautaire et élitiste. Bien qu’elles n’aient pas vocation à être exhaustives, elles rendent compte à la fois d’un agencement spatial, d’un mode de fermeture et de pratiques culturelles qui renvoient toutes trois au modèle sur lequel se sont construits les premiers country club ou quintas, propriétés des riches industriels britanniques immigrés en Argentine.
Si l’on s’intéresse à l’expression même et en premier lieu au vocable country, « campagne » en français, il renvoie tout d’abord à l’idéal de la nature en ville, particulièrement présent pendant la période d’industrialisation en Grande-Bretagne. On le retrouve également théorisé par E. Howard à la fin du XIXe siècle dans Tomorrow a Peaceful Path to real Reform (1898), pour la conception – utopique – de villes résolument ouvrières mais qui puissent également jouir des bienfaits de la nature.
L’archétype londonien promu par l’aristocratie n’emprunte évidemment pas aux principes d’aménagement définis par E. Howard mais à un système de rentabilisation maximale du sol qui lui appartient. L’expansion urbaine de Londres est donc laissée aux mains des propriétaires du foncier qui réalisent de nombreux lotissements dont l’accès sera réservé aux seuls riverains; il en sera de même pour l’accès aux squares présents dans le quartier dont les habitants disposent des clefs. En 1890, alors que la faculté de restreindre le passage simplement aux habitants – propre aux riches propriétaires londoniens – est abolie en Grande Bretagne², le modèle de résidences fermées commence à s’exporter outre At- lantique, en particulièrement aux États-Unis².
Désormais si l’on se penche sur le mot « club », on trouve, d’une part, la référence étymologique du mot citée précé- demment, qui appelle directement à l’évolution des conditions de rassemblement de l’aristocratie anglaise.
Le lieu de sociabilité privilégié étant en effet à l’origine le coffee house, espace public que fréquente la « polite society » afin de parta- ger à la fois idées politiques, d’échanger sur l’actualité économique et financière du pays mais aussi de se documenter sur les nouvelles à l’échelle mondiale via la presse internationale. Progressivement l’aristocratie éprouvera le besoin et l’envie de se retrouver à l’écart de la bourgeoisie et des riches négociants et commerçants et créera donc les “clubs” dont l’accès est réservé à une élite filtrée, élue par ses affiliés chaque semaine. Le club est fermé sur la rue, surveillé par un gardien qui en assure le filtrage des entrées. Il est régi par un règlement strict et son système d’adhésion permet d’exclure d’of- fice des membres indésirables. Le club donc est un espace d’exclu- sion, « juridique, sociologique, idéologique et sexuel³ », hermétique à toute intrusion non désirée.
Peu à peu la pratique du jeu sera introduite au sein des clubs privés britanniques, laissant place aux loisirs en parallèle des échanges idéologiques et politiques.
« Le jeu a toujours occupé une place considérable dans la sociabilité, comme en témoigne l’expression “jeu de société”. L’attrait du jeu réside dans le hasard, mais on y joue véritablement “à la société”.4 »
D’autre part, outre le jeu, la pratique sportive et l’entre- tien du corps tiennent une place importante dans la société britan- nique. Elle prend racine dans un premier temps chez les gentlemen farmers au XVIIIe siècle, organisant de grandes chasses sur leurs terres puis introduisant au fur à fur les formes de sport moderne à travers l’établissement des premiers règlements et tournois de cricket, de golf, de courses de chevaux, etc. Le sport s’institutionnalise alors progressivement via la création de clubs comme le Jo- ckey-Club, fondé vers 1750, du Royal and Ancient Golf Club en 1754 et du Marybelone Cricket Club en 1788. En second lieu, et un peu plus tardivement, la pratique sportive se développera au milieu du XIXe siècle au sein d’établissements scolaires privés prestigieux. Ce sont eux qui feront la promotion des jeux collectifs et contribueront à leur développement et leur exportation au sein des colonies anglaises et des dominions blancs (Canada, l’Afrique du Sud, l’Australie). Le sport est alors un vecteur de sociabilité entre les britanniques et les autochtones1.
Ces trois aspects : la fermeture en domaine clos, arboré et paysagé, le partage de valeurs communes au sein du club et la pratique sportive, se retrouvent aujourd’hui au sein des country club et torres country reprenant les codes des quintas traditionnelles établies sur le bord du rio de la Plata.
L’archétype étasunien
Lorsque l’on s’intéresse aux dispositifs de fermeture ré- sidentielle, il semble délicat de faire l’impasse sur le cas Nord amé- ricain. Un petit détour par les États-Unis paraît essentiel afin de faire connaissance avec cette figure stéréotypée, qui donne à voir à la fois les différentes échelles d’établissement du modèle, la variété des services et des modes d’administration des espaces et enfin un panel varié des raisons qui conduisent au choix – si tant est qu’il soit encore possible de choisir – de l’enfermement résidentiel.
A partir du milieu du XXe siècle, il apparaît que les États-Unis, en proie à une forte hausse démographique, aient calqué ses va- gues d’urbanisation sur le modèle des master planned communities. La production de ce type de bien immobilier prétend garantir un idéal urbain qui dessine un mode vie en frange des villes, béné- ficiant ainsi d’un cadre environnemental de qualité, sécurisé et d’une bonne desserte par voie de communication afin de répondre au mieux à « l’american way of life ». Cette urbanisation peut prendre plusieurs formes – habitat collectif ou individuel plus ou moins dense – qu’elle soit fermée ou non, mais toutes sont régies par une administration privée, propre à chaque copropriété.
En 1997, E. Blakely et M. Gail Snyder estimaient, dans leur ou- vrage Fortress America, à 20 000 le nombre de gated communities sur le sol étatunien1 et les classaient selon trois catégories:
Les résidences de luxe, répondant à une quête d’exclusivité et d’entre-soi, elles s’adressent donc aux classes les plus aisées.
Les résidences de loisirs, répandues sur la Sun Belt, propres aux re- traités cherchant à se réunir en groupe pour partager les mêmes centres d’intérêts. Et enfin les résidences que je qualifierais de spon- tanées, dont la fermeture est à l’initiative des habitants eux-mêmes, en général de classe moyenne et moins aisée que les deux citées précédemment, ils tentent la sécurisation de leurs espaces par l’ins- tallation de barrières créées par leurs soins.
Aujourd’hui environ 10% des ménages nord-américains – soit en- viron onze millions – habitent en résidence fermée, ces dernières étant inégalement réparties sur l’ensemble du territoire (en ma- jorité au Sud et à l’Ouest) et sur-représentées au sein des espaces suburbains.
« Les espaces résidentiels clos et fermés apparaissent bien souvent, en effet, comme des modalités particulières du processus général de su- burbanisation soit en localisations dispersées, soit au contraire par la constitution de véritables grappes pouvant concerner jusqu’à plusieurs milliers de personnes.2 »
Cependant, deux autres territoires privilégiés pour l’éta- blissement de ces communautés fermées peuvent être identifiés. Aux États-Unis, le dépeuplement des centres est corrélatif à la sé- grégation raciale des noirs du milieu du XXe siècle. Les popula- tions blanches sont alors tentées de déserter les centres ville en quête d’entre-soi à leur périphérie, conduisant ainsi à une ségréga- tion spatiale du territoire. Mais aujourd’hui, dans une tentative de reconquête des espaces résidentiels au coeur des agglomérations, le modèle de copropriété fermée est la condition sine qua non pour promouvoir un habitat sécure, au sein des centres villes en perdi- tion, considérés comme porteurs de risques.
Dans le cas où cette dimension sécuritaire n’est pas considérée comme indispensable, la fermeture peut simplement émaner du jeu de la concurrence entre les différents promoteurs qui sou- haitent donner une plus-value à leur produit et insister sur le ca- ractère exclusif de la résidence et des services qu’elle comprend. D’autre part les espaces naturels, qui offrent alors un cadre de vie « isolé » hors des zones métropolitaines font aussi l’objet de l’établissement de gated communities. Jacques Chevalier cite pour exemple le cas de Hot Springs Village, un des plus vastes espaces résidentiels privés qui constitue une véritable petite ville sur 10 000 hectares.
Aujourd’hui aux Etats-Unis seules sept des vingt-cinq plus grandes villes comptent plus d’habitants dans leur centre qu’à leur périphé- rie… On peut d’ailleurs s’interroger sur le sens du mot « ville » ici employé, en sont-elles véritablement encore?
« Verra-t-on simultanés la fin des citadins, la fin des paysans, les uns et les autres mêlés dans un même paysage hybride, et les grandes villes achever de se diluer parmi les espaces verts et les parcs naturels?1 »
Lesquels des grattes-ciel new-yorkais ou des immenses banlieues pavillonnaires des périphéries étasuniennes donnent le plus le ver- tige?
Le “paradis urbain* (Le Goix, 2001) rêvé des classes moyennes et moyennes supérieures nord américaines, pourrait être résumé au travers de la célèbre ville factice de Seaside dans le film de Peter Weir, The Truman Show (1998). Reprenant tous les codes d’un parfait agencement pour une vie idéalisée dans un environne- ment paysager qualitatif, cette bulle pourrait être la métaphore du monde utopique vendu au travers des copropriétés fermées. Et The Truman Show, une fable contemporaine.
Une fable interrogeant sur le modèle urbain offert aux enfants grandissant dans ces quartiers privés, sécurisés, où la société s’or- ganise autour d’un règlement interne propre à chaque résidence et non plus seulement autour des valeurs démocratiques fondatrices du pays.
« Là où grandissent les cités, l’humanité progresse. Là où elles dépé- rissent, la civilisation elle-même est en danger.2 »
Au travers des différents modèles évoqués, on comprend à quel point le marché immobilier nord américain a su compléter et diversifier son offre face aux demandes toujours plus variées du marché. Le modèle d’enclosure ou de retrait résidentiel s’adapte à tout type de clientèle, qu’elle soit temporaire, saisonnière ou permanente, jeunes ou moins jeunes, active ou retraitée, friande d’activités en pleine air ou simplement d’un mode de vie en retrait de la ville même. L’offre s’est donc subdivisée, donnant naissance à des modèles qui ont peu à peu intéressés les aménageurs bien au delà des Etats-Unis.
DU « COUNTRY CLUB » AU « COMPLEJO DE TORRES »
Barreaux aux portes et fenêtres, grillage aux balcons, gardiens aux entrées, mais qui donc détient les clefs de la ville portègne?
Sous des airs d’apparente liberté et d’une certaine dé- sinvolture, se cache un tissu urbain imperméable, impénétrable, stérilisé à l’intérieur de ses «manzanas» qui forment un front bâti difficilement franchissable et dont seulement de rares exceptions témoignent de situations urbaines intéressantes et inédites : les places Boedo ou Gonzalez Tuñón dans les quartiers Almagro et Balvanera par exemple, ou le Pasaje Barolo, emblématique. Celles- ci sont généralement liées à une interruption dans le respect de la trame urbaine quadrillée propre au continent américain. La dérogation à la règle stricte établie offre ainsi quelques précieux moment de respiration dans la ville.
Poussée à son maximum, l’exploitation des parcelles à Buenos Aires’explique par la spéculation immobilière engagée et soute- nue en premier lieu par les politiques urbaines adoptées sous la dictature¹. Celles-ci ont augmenté significativement la rentabilité des terrains achetés, qui s’est accompagnée dans le même temps de l’arrêt de tout encadrement des loyers, motivant ainsi l’édifi- cation d’immeubles en hauteur, sans contrôle spécifique de leur construction.
Parmi les quelques 12 000 manzanas de Buenos Aires, un modèle pourtant ressort. Un modèle plus aérien, net, organisé et méticu- leux. Un modèle où plus rien ne dépasse, où tout apparaît soigné et réglé à l’intérieur d’une enceinte que nul ne pourra venir dé- ranger. Les complejos de torres*, qui fleurissent dans les quartiers les plus riches de la ville – principalement Recoleta, Palermo, Bel- grano, Caballito et Nuñez – se sont imposés à moi comme étant la manière la plus extrême de privatiser un fragment de ville, le rendre inaccessible. À l’image des bulles de pauvreté dont l’am- pleur de l’emprise ne se limite plus à la périphérie de Buenos Aires, les barrios cerrados des couronnes périurbaines ont peu à peu pris place au sein de la ville, jusqu’à marquer la ligne d’horizon de la capitale argentine.
Loin donc, de l’urbanisation illégale, chaotique, furtive et spontanée des villas, dont les limites ne dépendent que de la place encore disponible dans ces franges délaissées, abandonnée; libres, s’est invitée en ville, comme l’ont bien nommé Mónica La- carrieu et Guy Thuillier, « une utopie de l’ordre et de la fermeture »². Que génèrent ces nouveaux espaces enclos sur les quartiers dans les- quels ils s’implantent? Quelles situations urbaines provoquent-ils? En sachant qu’ils visent de manière significative une clientèle res- serrée autour des élites et classes moyennes supérieures argentines, quelles réactions suscitent-ils au sein de l’opinion publique, en termes d’approbation ou de contestations?
Si les villas entraînent une forme d’investissement volontaire de la part de citoyens soucieux de voir leurs conditions s’améliorer, les « barrios cerrados » du centre ville seraient-ils perçus comme un fait établi, justifié d’un cycle « vertueux »?
|
Table des matières
#INTRODUCTION
ENTRE LES MURS ÉRIGÉS DE BUENOS AIRES
#1 GHETTO OU GHETTO?
.Face aux murs des « villas » et « complejos de torres »
.Les origines et l’influence anglo-saxonnes
des copropriétés fermées de Buenos Aires
.L’archétype étasunien
#2 DU « COUNTRY CLUB » AU « COMPLEJO DE TORRES »
.Une esquisse de l’urbanisation de la capitale Argentine et de sa périphérie
.Un produit en mutation, un regain d’intérêt pour la ville centre
.Acteurs en résistance
#3 « SU NOMBRE Y TARJETA DE IDENTIDAD POR FAVOR »
.Un climat insécuritaire?
.Tours et modèles de protection
Télécharger le rapport complet