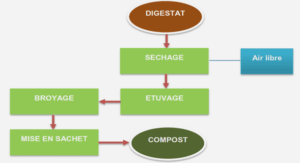Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Une tripartition de l’économie obsolète
L’une des définitions les plus anciennes du service revient à Adam Smith (1776) : « Le travail de quelques-unes des classes les plus respectables de la société, de même que celui des domestiques ne produit aucune valeur ; il ne se fixe ni ne se réalise sur aucun objet ou chose qui puisse se vendre, qui subsiste après la cessation du travail et qui puisse servir à procurer par la suite une pareille quantité de travail. Le souverain, par exemple, ainsi que tous les autres magistrats civils et militaires qui servent sous lui, toute l’armée, toute la flotte, sont autant de travailleurs non productifs. (…) Quelques-unes des professions les plus graves et les plus importantes, quelques-unes des plus frivoles, doivent être rangées dans cette même classe : les ecclésiastiques, les gens de loi, les médecins et les gens de lettres de toute espèce, ainsi que les comédiens, les farceurs, les musiciens, les chanteurs, les danseurs d’opéra, etc.. » [Smith (1843), t.1, p.414] Adam Smith montre ainsi que les services regroupent déjà une très forte disparité d’activités. Sa définition a deux aspects qui sont largement repris par la littérature : une opposition au bien matériel par sa périssabilité, et l’improductivité du service. Cela n’égaie en rien ce concept dont l’étymologie est déjà peu favorable puisqu’elle renvoie à la servitude.
Les services ont ainsi longtemps été considérés comme le parent pauvre de l’économie. C’est ce que Faïz Gallouj (1998) décrit comme le mythe d’un monde résiduel, un tiers monde, celui de l’intangible et de l’indicible. On y est improductif et aliéné : c’est le monde des prêtres et des servants. C’est enfin un monde immuable, réfractaire à l’innovation. C’est d’ailleurs à partir de cet industrialisme triomphant qui qualifie les services d’activités non nobles que Pierre Eiglier et Éric Langeard (1987) expliquent la primauté accordée à l’ingénieur dans notre système scolaire.
Mais la question qui se pose est de définir le service : « Le domaine des services est, en effet, l’un des plus délicats à explorer parce que ses frontières elles-mêmes posent problème. Que doit-on entendre exactement lorsque l’on parle de service ? » [Téboul (1999), p.7] L’une des premières définitions qui s’inscrit dans la lignée d’Adam Smith est d’opposer le service au bien, et d’adopter une répartition tripartite de l’économie avec les trois secteurs, primaire, secondaire et tertiaire. Cette définition entretient ainsi le mythe du secteur résiduel. Les services sont le monde de « ce qui n’est pas » [Gallouj (1998)]. En effet, le secteur tertiaire avait été défini très simplement comme regroupant tout ce qui n’appartenait pas aux deux précédents. Mais les frontières entre ces trois secteurs sont aujourd’hui de moins en moins étanches [Dumoulin et Flipo (1991)].
Une telle définition sectorielle du service n’est pas satisfaisante. « Le secteur des services dans le modèle trisectoriel traditionnel est trop vaste et mal défini pour qu’il se prête à l’étude. En son sein, se côtoient policiers et prostituées, banquiers et routiers, professeurs d’école et coiffeurs. » [Téboul (1999), p.13] Il paraît donc difficile d’établir un modèle unique de management ou de production quand on considère une telle diversité. Par ailleurs, cette définition sectorielle est d’autant moins pertinente que les secteurs primaires et secondaires ont également, en leur sein, développé des activités de service [Hatchuel (1994b)]. C’est pourquoi la présente étude ne s’attache pas à cette définition sectorielle. Elle retient avant tout l’activité et les classifications des services pour les identifier.
Entre post-industrialisme et néo-industrialisme : l’émergence d’une société de services
Avant de poursuivre l’exercice de définition, il n’est pas incongru de s’arrêter brièvement sur les controverses théoriques opposant les thèses post-industrielles et néo-industrielles sur l’explication et l’appréciation du taux de croissance du secteur tertiaire. La majorité de ces thèses ont une représentation du service qui se cantonne à une opposition au bien matériel. Trois économistes ont profondément marqué l’évolution de l’étude des services au cours des années 1970, à travers des courants post et néo-industriels.
Le premier est Daniel Bell (1973) qui, dans la lignée d’Allan Fisher, de Colin Clark, d’Alain Touraine ou de Jean Fourastié, estime que la demande se tertiarise et que la société a recours à de plus en plus de services ; la main d’œuvre tertiaire prend largement le pas sur une main d’œuvre industrielle qui n’ira qu’en s’amenuisant avec les développements technologiques. Après l’âge de la vapeur et l’âge de l’acier, ce serait l’âge de l’électronique. Pour Daniel Bell, la gestion des entreprises passerait d’un mode « économiste » (rationnel, quantitatif) à un mode « sociologique » (travail plus autonome, largement fondé sur le savoir). Il voit dans ces évolutions l’émergence d’un nouveau secteur économique et parle de société post-industrielle. Pour appuyer sa théorie, Daniel Bell (1973) avance deux types d’arguments : économiques et sociaux. Les uns sont principalement le résultat de la loi d’Engel (la demande de services est à élasticité revenu élevée) : l’on passe d’un secteur tertiaire avec des services de base à un secteur tertiaire supérieur à caractère collectif grâce à l’augmentation des revenus. Les autres tiennent au changement de nature et de contenu des activités professionnelles qui exigent des qualifications plus élevées et des savoir-faire plus compliqués.
Jean Gadrey (1991) critique largement la position de Daniel Bell : selon lui, il sous-estime, les potentialités d’industrialisation de certains services ; ils n’apprécie pas à sa juste mesure le concept de productivité appliqué aux services ; et il a une vision relativement bipolaire de la structure économique faisant peu de cas des complémentarités et de l’imbrication croissante des secteurs. Il est vrai que la frontière entre les services et l’industrie est aujourd’hui difficile à tracer si l’on s’en tient à une définition du concept de service à partir de l’activité.
Le deuxième économiste qui a marqué l’économie des services est Jonathan Gershuny (1978). Il s’inscrit dans le courant néo-industriel qui estime que le développement du secteur tertiaire est pour l’essentiel induit par l’évolution de l’industrie. Toutefois, il n’adhère pas aux thèses radicales de ce courant. Celles-ci considèrent le secteur tertiaire comme un secteur refuge qui, en situation de crise, évite un trop fort gonflement du chômage en préservant des emplois peu productifs, souvent peu qualifiés et peu rémunérés. Jonathan Gershuny définit la consommation comme une activité productrice de satisfaction : le consommateur n’achète pas des biens pour eux-mêmes mais pour les services qu’ils produisent lors de leur utilisation. Ainsi, de plus en plus, les ménages, disposant de biens d’équipement ménagers, produiront-ils eux-mêmes les services qui leur sont utiles à partir du temps de travail domestique.
La thèse que développe Jonathan Gershuny en fait un précurseur de la co-production dans les services. Toutefois, cette thèse soulève plusieurs objections, notamment une sur la substituabilité entre les biens et les services dans la mesure où une telle substitution ne peut pas s’appliquer à tous les services. Les relations seraient peut-être davantage complémentaires entre les deux secteurs. C’est justement à la suite de ces deux courants, post-industriel et néo-industriel, que se sont développées des thèses qui défendent la complémentarité entre les deux secteurs, notamment en matière de gestion de la complexité et de gestion de l’incertitude.
Troisième économiste marquant en la matière, Theodore Levitt (1972) voit dans l’industrialisation des services un moyen de réaliser la complémentarité entre l’industrie et les services. En effet, il prône l’industrialisme et le productivisme comme condition de développement des services, et estime que la différence entre le secteur des services et celui des biens industriels provient du retard pris par les services pour mettre en œuvre les méthodes de rationalisation utilisées dans l’industrie. Le secteur des services serait comme un secteur éponge », freinant la croissance économique et auquel il n’y aurait rien de plus urgent que d’appliquer des recettes et des techniques industrielles.
Pour améliorer l’efficience et l’efficacité des services, Theodore Levitt propose une approche systématique, normalisée, « industrielle » qui s’applique à la conception du service et à son exploitation et qu’il qualifie d’approche en ligne de produit : action discrétionnaire limitée du personnel, division du travail, substitution du personnel par la technologie, standardisation du service. La notion d’industrie utilisée par Theodore Levitt correspond d’avantage à son sens originel – haute précision et organisation des tâches – qu’au sens que lui donnera l’histoire du travail, à savoir la production en grande quantité. Pour lui, c’est en pensant les activités de service comme les activités industrielles et en y appliquant des méthodes scientifiques avec la définition de standards, la planification, le contrôle, l’automatisation, que la qualité du service pourra augmenter et que la satisfaction du client sera améliorée. L’activité franchisée de fast-food parait être le modèle idéal typique. Le service apparaît ainsi comme un produit à délivrer et à vendre en série en réalisant des économies d’échelle.
L’approche de Theodore Levitt vise à remplacer la variabilité humaine et la disponibilité envers les clients par des technologies rigides, flexibles et hybrides. Pour cet auteur, il est évident que les approches utilisées dans la gestion des services ne doivent pas se limiter à la formation de la main d’œuvre ou à l’acquisition d’équipement. Si cette approche peut paraître radicale, d’autres théoriciens s’inscriront dans son prolongement en parlant de technicisation de tous les secteurs. Certains auteurs continuent de penser, dans la lignée de Theodore Levitt, que les méthodes issues de l’industrie peuvent être appliquées dans les services. Ce sont d’ailleurs David Bowen et William Youngdahl (1998) qui, constatant le remplacement de la production en ligne dans l’industrie par la « lean production », proposent d’adopter le « lean service » qui combine des approches efficientes de production de masse avec des activités de personnalisation orientées client.
Les débats sur les activités de service sont aujourd’hui d’autant plus animés que les services représentent désormais, selon les statistiques gouvernementales (et donc selon une classification sectorielle de l’économie), entre deux tiers et trois quarts du PNB des pays développés. Avec le développement de la bulle de la nouvelle économie sur les marchés au début du troisième millénaire, l’industrie était d’ailleurs présentée comme un poids mort : « Tous les gourous de la bourse ne le disaient-ils pas depuis longtemps : l’avenir était aux services et aux nouvelles technologies de l’information, l’industrie était un poids mort, l’ancienne économie empêchait la nouvelle de se développer. »7 Cette position semble un peu exagérée tant l’industrie a façonné la conception de l’économie.
Une mesure de la productivité inadaptée au service
Si le concept d’industrialisation des services est aujourd’hui largement interrogé, c’est principalement parce que l’utilisation d’outils de mesure de la productivité dans les services est profondément critiquée.
La productivité est l’un des fondements des théories économiques. Elle est le concept de base pour une évaluation d’un type de production (quantité de produits obtenus dans une période à définir/quantité de facteurs de production utilisés). Mais elle est aussi la base du mythe de la non productivité des services [Gallouj (1998)] que la littérature a largement infirmé.
En effet, les courants d’économie et de management des services sont unanimes pour expliquer que l’indicateur de productivité, utilisé dans l’industrie, ne peut pas être appliqué au secteur des services. « Au plan conceptuel, la théorie économique s’efforce d’appliquer aux services des concepts et instruments de mesure conçus pour l’industrie (comme par exemple celui de la productivité) ; alors que de l’aveu même de ceux qui les utilisent ces concepts de mesure sont inadaptés à la compréhension du tertiaire, on continue à les employer pour expliquer le développement des services. » [Greffe (1990), p.10] Jean Gadrey (1991) confirme cette position en affirmant que la transposition aux services des méthodes d’analyses issues de l’industrie est, dans la majorité des cas, soit entourée d’un très grand flou sur la nature de ce que l’on mesure, soit même jugée impossible.
La principale raison de l’inadaptation du critère de productivité au secteur des services est la difficulté de mesurer les inputs et les outputs [Gadrey (1991)]. Ils sont difficilement mesurables dans la mesure où la personnalisation du service ne permet pas d’avoir un temps de service ou une mesure de la ressource standard. L’output est d’autant plus difficilement mesurable que le résultat n’est pas « définissable » [Lovelock et Lapert (1999)], qu’il est intangible et qu’il est hétérogène (on ne produit pas deux fois de la même manière). Dans le cas des services, la valeur ajoutée ne peut pas renvoyer à des produits séparables des unités et des agents producteurs : le volume, le prix, les biens, les heures de travail, les temps machines, les ventes ne permettent pas de mesurer à leur juste valeur les inputs et les outputs d’une prestation de service.
Deux exemples permettent de mieux identifier les défauts que l’on peut retrouver dans l’utilisation d’indicateurs de productivité.
Le premier est celui de Jean Gadrey [Gadrey et Zarifian (2002)] qui explique qu’on ne peut pas mesurer la productivité d’un hôpital à partir du nombre de jours d’hospitalisation. La difficulté de choisir la mesure adéquate de l’output est rendue d’autant plus difficile que « quand le contenu en service progresse et que l’on augmente le volume de main d’œuvre pour rendre ces services étendus (pour un même volume de biens vendus), on enregistre un apparent déclin de la productivité » [Gadrey dans Gadrey et Zarifian (2002), p.71]. C’est d’ailleurs dans ce raisonnement que réside une des explications du paradoxe de Solow : l’informatisation a permis de largement complexifier l’offre sans forcément augmenter l’indicateur de résultat.
Le second est celui de la sociologue Aurélie Jeantet (2001) qui critique l’outil de mesure de la productivité dans les bureaux de poste, la « Statistique 539 » qui définit des temps standard de délivrance de la prestation en fonction des produits : elle explique que le temps standard pour chaque opération est celui de la direction, qu’il est monochrome et qu’il suppose une grande homogénéité comme une faible variabilité du travail. Cet indicateur ne tient pas compte de l’hétérogénéité du service.
Si les critères utilisés dans l’industrie ne sont pas pertinents pour évaluer les services, Faïz Gallouj, Jean Gadrey et Edwige Ghillebaert (1999) proposent des critères de justification différents : « des critères industriels (volumes, trafics, productivité…), marchands (chiffre d’affaires, marges), civiques (équité, justice), domestiques (qualité des liens personnels), de réputation (renommée, image), de créativité ou d’inspiration » [Gallouj et al. (1999), p.418]. Toutefois, certains de ces critères, comme les produits civiques qui contribuent au lien social, à la solidarité, à l’identité collective et citoyenne, sont mal identifiés et difficiles à évaluer. La valeur ajoutée sociale que revêt une prestation de service est donc difficilement évaluable.
Faridah Djellal, Camal Gallouj et Faïz Gallouj (2001) insistent surtout sur le fait que la productivité dans le secteur des services n’est pas plus faible qu’ailleurs et que l’innovation n’y est pas moindre : « Ce sont nos conceptions théoriques et les systèmes de mesure qui en découlent qui sont inadaptés. » [Djellal et al. (2001), p.35]
Cette impossibilité d’avoir une mesure universelle de la production dans les services ne permet donc pas d’y appliquer le principe des économies d’échelle. De ces explications ressortent les premières spécificités du service : sa diversité et son intangibilité. Ces spécificités permettent-elles aussi d’infirmer le mythe que les services ne sont pas innovants ?
Des services ouverts aux logiques et processus d’innovation
La place de l’innovation n’est pas négligeable dans la croissance des entreprises. Si le paradoxe de Solow tend à affirmer l’improductivité des services, Jean-Jacques Duby (2000) répond que les services offerts par une banque moderne à ses clients sont incomparablement plus diversifiés que ceux qu’elle pouvait fournir lorsque ses seuls outils étaient l’échéancier et la plume d’oie. « N’en déplaise aux tenants du primat de l’industrie dans le progrès, il y a donc bien des innovations propres aux services. »8
Selon Christiane Hipp, Bruce Tether et Ian Miles (2000), les services ne sont généralement pas ou peu producteurs de nouveaux artefacts ou d’améliorations techniques tangibles d’artefacts existants : cela expliquerait que la majorité de la littérature sur l’innovation de service se limite à présenter l’innovation dans les services comme l’adoption et l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Ce sont d’ailleurs des économistes, à l’instar de Richard Barras (1990), qui montrent que la dynamique de l’innovation dans les services – la finance, l’assurance et l’administration – serait principalement liée à l’utilisation intensive des technologies de l’information.
Faïz Gallouj (2003) approfondit le raisonnement de Christiane Hipp, Bruce Tether et Ian Miles (2000) en expliquant que certains mythes et problèmes théoriques relatifs à la nature des services ont favorisé la méconnaissance de l’innovation dans les services. Ce sont non seulement les mythes de l’improductivité, de la faible intensité capitalistique, de la faible productivité, de la société de serviteurs, mais aussi les caractéristiques du service, son output flou, l’interactivité de la prestation, l’absence de transfert de propriété et l’hétérogénéité des services.
Ces mythes et ces caractéristiques du service ont entretenu l’image d’un secteur non innovant. L’une des idées fondamentales a donc longtemps été que les services ne faisaient en matière d’innovation qu’adopter, avec retard, les nouvelles technologies développées dans l’industrie. Faïz Gallouj (2003) résume ainsi cette philosophie autrefois dominante : « les services (subordonnés à l’industrie) se contentent d’adopter des systèmes techniques, qui peuvent modifier la nature de leur prestation, mais leur contribution à l’innovation véritable est inexistante ou relativement modeste. » [Faïz Gallouj (2003), p.114]
Mais l’économie et le management des services sont aujourd’hui unanimes pour réfuter cette idée que l’innovation n’est pas un attribut des services. Les entreprises de services ne se contentent pas d’adopter des innovations technologiques d’origine industrielle. Elles sont productrices d’un grand nombre d’innovations à travers le développement de nouveaux services aux particuliers et aux entreprises, la redéfinition, l’amélioration et la personnalisation de services génériques, ou encore par la reconfiguration des modalités de réalisation de la prestation de services [Miles (1994), Gallouj (1995), Everaere (1997a), Gallouj et Weinstein (1997)].
Comme l’expliquent Faïz Gallouj et Olivier Weinstein (1997), la théorie de l’innovation a été clairement bâtie sur l’analyse des innovations technologiques dans l’industrie et elle mérite d’être revisitée pour les services.
Une reconnaissance des spécificités du service avec le développement du marketing des services
Force est de constater que pendant que se créait un débat entre des thèses post-industrielles et des thèses néo-industrielles, un nouveau champ émergeait en sciences de gestion : celui du management des services, et plus particulièrement celui du marketing des services. L’économie industrielle a opposé le service au bien, la production de service à la production industrielle, la relation pure à la matérialité totale. S’appuyant sur cette question d’opposition entre les biens et les services, le management et le marketing des services se sont focalisés sur l’interaction entre le client et le prestataire, et sur la participation du client au processus de production d’un service. Christopher Lovelock et Denis Lapert (1999) dressent un historique de ce courant. L’émergence du marketing des services en tant que domaine d’étude académique a commencé dans les années 1970. Les premiers séminaires consacrés aux services ont eu lieu en France au début de l’année 1975 sous l’égide de l’IAE d’Aix-Marseille. L’American Marketing Association a organisé pour sa part sa première conférence sur le marketing des services en 1981.
sa constitution, le marketing des services a tout d’abord traité de sa légitimité en opposant les services aux biens et en insistant sur la différence entre le marketing des services et le marketing industriel [Berry (1980)]. Les travaux se sont multipliés, mettant l’accent sur les spécificités du marketing des services, sur la part des services dans l’économie et dressant des typologies de services.
C’est à partir des années 1980 que le domaine de recherche du management des services s’est élargi et s’est ouvert à de nouveaux travaux sur les modes de production des services : ceux-ci tentent de fournir des propositions d’amélioration à partir de classifications des services [Lovelock (1983) ; Zeithaml et al. (1985)]. L’on y voit notamment apparaître des développements sur la qualité des services [Parasuraman et al. (1985)]. Les années 1980 voient aussi le développement de revues spécialisées et l’organisation de conférences sur le sujet.
Les travaux de ce courant vont largement s’étoffer, parvenant à traiter à la fois de la production et de la conception des services. Le développement du marketing des services illustre en quoi la relation de service peut être perçue comme un mode de coordination et en quoi l’opposition entre les biens et les services a longtemps persisté, sans que l’on réfléchisse profondément aux complémentarités qui pourraient se dessiner.
La multiplicité des définitions du service
l’évidence, le service ne se définit pas simplement, puisqu’il s’avère difficile d’englober les activités disparates qui relèvent de ce terme dans une seule définition. Frédéric Jallat (1992) a déjà effectué un important travail d’énumération des définitions proposées par la littérature. La présente étude se limite à préciser les grands axes de définitions et les critiques qu’elles ont pu recevoir.
Les deux premiers types de définition sont distingués par Faridah Djellal, Camal Gallouj et Faïz Gallouj (2001). Ceux-ci différencient la représentation fonctionnelle du service du triptyque des critères techniques : la première est davantage propre aux économistes des services qui cherchent
« dénombrer » les activités de service ; le second relève plutôt du management des services qui cherche à distinguer les spécificités des services pour proposer d’autres modèles de management. Un troisième et dernier type de définition existe, celui issu du marketing des services, qui mérite d’être pris en compte : il cherche à définir la prestation de service en fonction de ses composantes marketing.
Une définition à partir de l’activité
La première définition qui relève d’une approche fonctionnelle du service et qui est largement reprise aujourd’hui dans la littérature est celle de Peter Hill (1977) : un service peut être défini comme « la transformation de la condition d’un individu, ou d’un bien appartenant à un agent économique quelconque, résultant de l’activité d’un autre agent économique, à la demande ou avec l’agrément du premier agent. » [Traduction de Gadrey (1992), p.18] Jean Gadrey (1992) reprend cette première définition de Peter Hill et l’affine en proposant son triangle des services : une activité de service est une opération, visant à une transformation d’état d’une réalité C, possédée ou utilisée par un consommateur (ou client, ou usager) B, réalisée par un prestataire A à la demande de B, et souvent en relation avec lui, mais n’aboutissant pas à la production d’un bien susceptible de circuler économiquement indépendamment du support C. Jean Gadrey accentue la part de la relation de service comme mode de coordination entre A et B, et, surtout, il insiste sur le résultat et sa relative intangibilité ou immatérialité, même si ces deux mots ne recouvrent pas totalement sa définition. Cela permet notamment de relever l’une des faiblesses de la définition de Peter Hill, à savoir l’impossibilité d’y différencier les biens des services.
Jean Gadrey [Gadrey et Zarifian (2002)], en approfondissant sa première définition, y inclut plus de services, et notamment l’hôtellerie ou la restauration. Il identifie une production économique de services, dans les systèmes capitalistes développés, dans les deux cas suivants.
Dans le premier cas, lorsqu’une organisation A, qui possède ou contrôle une capacité technique et humaine vend (ou propose à titre gratuit, s’il s’agit de services non marchands) à un agent économique B le droit d’usage de cette capacité et de ces compétences pour une certaine période, pour produire des effets utiles sur l’agent B lui-même, ou sur des biens C qu’il possède ou dont il a la responsabilité.
Dans le second cas, lorsqu’un ménage ou un consommateur final emploie lui-même un salarié pour s’occuper de ses biens ou de sa personne.
Faridah Djellal, Camal Gallouj et Faïz Gallouj (2002) précisent la définition de Jean Gadrey en transformant le triangle en pentagone des services. Ils y ajoutent des éléments environnementaux qui influent sur la prestation : l’organisation prestataire et les institutions de régulation. Ils prennent notamment l’exemple de l’hôpital dans lequel les institutions réglementaires sont fortes, et dans lequel le médecin traitant ou la famille peut se voir accorder un rôle dans la réalisation ou la prescription de la prestation.
Toutefois, les deux définitions initiales de Peter Hill (1977) et de Jean Gadrey (1992) ne résistent pas aux critiques de Philippe Zarifian (2000) qui les trouve trop économiques et pas assez sociologiques. Il formule trois remarques principales : la définition de Peter Hill prend le prestataire et le destinataire comme des agents économiques individuels, isolés, et oublie qu’ils sont eux-mêmes des produits de ce processus de socialisation, et qu’il n’est pas possible de comprendre leur comportement si on les appréhende de manière isolée et ponctuelle ; la relation de service et les interactions informationnelles entre A et B dans la définition de Jean Gadrey (1992) n’atténuent que légèrement cette critique ;
la définition de Peter Hill fait comme si le prestataire et le destinataire étaient des individus ; ces deux définitions font l’impasse sur la valeur ; le service est pour Philippe Zarifian (2000) une création de valeur.
Philippe Zarifian (2000) insiste notamment sur la valeur de service, que ce soit la valeur des effets (le résultat) ou l’efficience dans l’utilisation des ressources. Il va plus loin que des économistes comme Faridah Djellal, Camal Gallouj et Faïz Gallouj (2001) qui se limitent, comme Jean Gadrey et Peter Hill, à une définition qui n’intègre aucune notion de résultat, de qualité, d’efficience, de valeur : « Rendre un service c’est organiser la réponse à un problème (générer des caractéristiques de service nouvelles ou améliorées) en mettant à la disposition du client un ensemble de capacités et de compétences (humaines, technologiques, méthodologique, organisationnelles). » [Djellal et al. (2001), p.16]
Une définition selon ses composantes intrinsèques
La deuxième définition est principalement basée sur les caractéristiques techniques et sur les spécificités du service : immatérialité, interactivité, immédiateté, périssabilité, simultanéité et hétérogénéité. La comptabilité nationale est certainement à l’origine de ces définitions dans la mesure où elle distingue les biens des services, comme outputs de l’activité de production, essentiellement sur le critère de la matérialité. D’ailleurs, dans la définition originelle de la comptabilité nationale, les services sont les activités dont le résultat de la production n’est ni un bien physique ni un bâtiment.
La question de l’intangibilité est reprise par Lynn Shostack (1982) pour qui les services sont des actes ou des processus qui n’existent que dans le temps. Elle est la première à insister sur les éléments intangibles du service. Elle propose un modèle moléculaire pour mettre en évidence les interactions entre les éléments intangibles et tangibles d’un service.
Mais les services se caractérisent tout autant par leur immatérialité que par leur interactivité et leur immédiateté. C’est la combinaison de ces trois caractéristiques qui permet de définir le service. Christian Grönroos (1990) attache d’ailleurs une importance notable à l’intangibilité et l’interactivité du service : « A service is an activity or series of activities of more or less intangible nature that normally, but not necessarily, take place in interactions between the customer and service employees and/or physical resources or goods and/or systems of the service provider. »9 [Grönroos (1990), p.27] L’interactivité entre le « Un service est une activité ou une succession d’activités de nature plus ou moins intangible qui naît normalement, mais pas nécessairement, dans l’interaction entre le client et le personnel de l’entreprise de service ou les biens et ressources physiques ou les systèmes du prestataire de service. » client et le prestataire est incontournable, que l’interface de la prestation soit physique ou humaine.
Deux de ces trois caractéristiques sont reprises en détail dans la définition de Jean Gadrey (1992) :
On trouve, dans les travaux portant sur les services, divers critères visant à caractériser plus précisément ces activités, mais il est largement admis qu’aucun ne suffit, à lui seul, à rendre compte de la diversité des situations rencontrées. Cela peut conduire à penser que “les services” sont une addition d’activités n’ayant au fond rien en commun. (…) Les services seraient ainsi successivement caractérisés par le fait que :
leur “produit” final ne serait pas stockable, ni transportable (…) ;
leur “produit” serait “immatériel”, (…) il périrait à l’instant même de sa production (…) ;
leur processus de production, ou prestation, supposerait une proximité et une interaction étroites entre prestataire et client ou usager, pouvant aller jusqu’à la co-production du résultat. » [Gadrey (1992), p.17-18]
Cette définition met en avant l’immatérialité et l’interactivité du service : elle introduit également la périssabilité du service en raison de sa nature non stockable et non transportable. Certes, Jean Gadrey omet de mentionner dans ce texte l’immédiateté du service, mais il l’avait déjà mentionnée par ailleurs [Gadrey (1991)]. L’immédiateté ne doit pourtant pas être ignorée. Comme Faïz Gallouj, Jean Gadrey et Edwige Ghillebaert (1999) l’expliquent, il importe de faire la distinction entre le produit direct (immédiat), qui correspond à la prestation de service en actes, et le produit indirect (médiat), le résultat dans le temps. Le produit médiat prend justement en compte les effets éventuels du service dans la durée ainsi que d’autres facteurs d’environnement. D’ailleurs, Jean Gadrey (1991) estime que le résultat est encore moins susceptible d’être présenté comme produit que le service immédiat.
Du reste, une caractéristique fondamentale du service, sous-entendue dans l’immatérialité, ne saurait être laissée dans l’ombre : la simultanéité de la consommation et de la production. « Dans le cas de la production industrielle, la vente du bien est postérieure à sa production et antérieure à sa consommation. L’objet est donc vendu et promu parce qu’il existe. Dans le cas d’une prestation de service, ce rapport est inversé : le service est vendu avant d’être produit et consommé. » [Téboul (1999), p.35] C’est un des arguments qui sous tend le point de vue selon lequel, dans le cas des services, l’on ne peut pas séparer la conception, la production et la distribution du service.
Une dernière spécificité du service est également souvent mise en avant pour le définir : son hétérogénéité. Elle apparaît à plusieurs reprises dans la littérature et est notamment reprise dans le modèle « IHIP » utilisé par Giuseppe Catenazzo et Emmanuel Fragnière (2008) pour définir un service. Les deux « I » représentent l’immatérialité et l’instantanéité déjà mentionnées, le « P » la périssabilité et le « H » l’hétérogénéité. L’hétérogénéité du service signifie la difficulté de standardiser complètement la prestation en raison d’une clientèle et d’un personnel non homogènes. Si Jean Gadrey (1992) ne la mentionne pas dans sa définition, c’est certainement parce que l’hétérogénéité de la prestation peut être interprétée comme la conséquence des autres propriétés.
Est-ce l’ensemble de ces caractéristiques techniques – immatérialité, interactivité, immédiateté, périssabilité, simultanéité, hétérogénéité – qui entretiendrait un mythe de la spécificité des services ? Le service est difficilement standardisable en raison de son interactivité et de son intangibilité ; le service est à la fois médiat et immédiat ; le service ne se distingue pas de son processus de production dans la mesure où il est immatériel. Ce n’est donc pas un mythe : les services ont bien des spécificités par rapport aux biens matériels.
Le rapport de stage ou le pfe est un document d’analyse, de synthèse et d’évaluation de votre apprentissage, c’est pour cela chatpfe.com propose le téléchargement des modèles complet de projet de fin d’étude, rapport de stage, mémoire, pfe, thèse, pour connaître la méthodologie à avoir et savoir comment construire les parties d’un projet de fin d’étude.
|
Table des matières
INTRODUCTION GÉNÉRALE ET RÉSUMÉ ÉTENDU DE LA THÈSE
PARTIE I DU MANAGEMENT DES SERVICES À LA CONCEPTION D’UN SERVICE : COMMENT ORGANISER L’INNOVATION DE SERVICE ?
INTRODUCTION
CHAPITRE I.1 DISTINGUER LES SERVICES DES BIENS : L’INTERACTIVITÉ À LA SOURCE DE L’INNOVATION DE SERVICE
CHAPITRE I.2 DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX SERVICES : UNE APPLICATION LIMITÉE DES CONCEPTS DU MARKETING ET DE L’INGÉNIERIE DE LA CONCEPTION
CONCLUSION DE LA PARTIE I
PARTIE II LA POSTE, UN FORT POTENTIEL DE NOUVEAUX SERVICES AU CLIENT
INTRODUCTION
CHAPITRE II.1 QUEL PROCESSUS DE CONCEPTION DANS UNE ENTREPRISE DE SERVICES ? ÉPISTÉMOLOGIE ET MÉTHODOLOGIE
CHAPITRE II.2 LA POSTE, UN TERRAIN DE RECHERCHE PRIVILÉGIÉ : QUEL COMPROMIS ENTRE PRESCRIPTOCRATIE ET INNOVATION ?
CONCLUSION DE LA PARTIE II
PARTIE III LES INNOVATIONS À LA POSTE : ENTRE CONCEPTION CENTRALISÉE ET DÉVELOPPEMENTS LOCAUX
INTRODUCTION
CHAPITRE III.1 L’APPRENTISSAGE LOCAL : UNE RESSOURCE POUR LA POSTE
CHAPITRE III.2 LES SERVICES CONÇUS EN AMONT : APPROPRIATION ET ADAPTATION
CHAPITRE III.3 RÉSULTAT GÉNÉRAL : UNE CONCEPTION COLLECTIVE ET ÉTAGÉE DE
NOUVELLES PRESTATIONS
CONCLUSION DE LA PARTIE III
CONCLUSION GÉNÉRALE : UNIVERSALITÉ ET LIMITES DE LA RECHERCHE
BIBLIOGRAPHIE
Télécharger le rapport complet