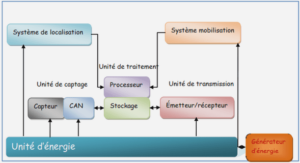Géographie culturelle et géographie des représentations
La spécialiste de la ville en guerre poursuit en expliquant que « la population est également un acteur fondamental, en fonction de ces soutiens à tel ou tel belligérant, mais également en fonction des représentations de la menace, qui provoquent, par exemple, des déplacements dans la ville (entre-soi communautaire, pour se fixer sous la protection d’une milice). En cela, la question de la ville en guerre interroge également la géographie culturelle et la géographie des représentations : comment les peurs dans la ville en guerre, mais aussi dans la ville de l’immédiat après-guerre modèlent-elles les espaces de vie, les pratiques spatiales et les déplacements de population ? ». Puisqu’il n’y a pas de géographie sans acteurs ni espace, l’étude des conflits ne peut s’appréhender sans laisser la voix à ceux qui le constituent et le vivent, ce qui suppose d’être aussi confronté à la part d’imaginaire et de fantasme qui réside en chacun, que ce soit les acteurs directs, indirects ou encore le chercheur qui interprète les données en fonction de ses propres représentations.
Géographie sociale et géographie urbaine
Enfin, « la géographie sociale est aussi un angle d’approche fondamental, comme le montre l’exemple de la ville de Beyrouth : si les médias ont souvent abordé la question de la Ligne verte (séparant les quartiers majoritairement chrétiens à l’Est et musulmans à l’Ouest de la commune) comme permanence d’une fragmentation issue de la guerre, de la peur et du rejet de ‘l’Autre’, la question de l’accentuation de plus en plus accrue de la ligne de fractures entre un Nord aisé et un Sud qui se paupérise de plus en plus est moins souvent abordée. Pourtant, cette ségrégation constitue un enjeu particulièrement prégnant dans la réconciliation de la ville à long terme, notamment autour de la question de la reconstruction qui a laissé apparaître une géographie de l’inégalité, le Nord (centre-ville) ayant bénéficié d’un programme privé de reconstruction (Solidere), tandis que les stigmates de la guerre dans la banlieue sud sont toujours visibles, et accentuent la radicalisation des populations pauvres qui y vivent (le Hezbollah joue d’ailleurs de cet argument pour affirmer son emprise territoriale dans le Sud de l’agglomération) ». Les injustices intra-urbaines constituent elles-aussi un facteur explicatif, voire un des éléments qui perpétue le conflit. A Tripoli où la pauvreté gangrène les quartiers Est, l’abandon de l’Etat ressenti par les populations entraîne une colère accrue et suscite des jalousies entre factions opposées puisque les sunnites de Bab el Tebbane se sentent lésés par rapport aux alaouites de Jabal Mohsen, qu’ils croient protégés par l’armée libanaise.
CONTEXTUALISATION
La guerre civile en Syrie : diviser pour mieux régner
Un Etat laïc ?
Le parti baathiste a depuis ses origines tenté de vaincre par avance les revendications de la communauté sunnite majoritaire en jouant le jeu de la laïcité. En se revendiquant le pays le plus tolérant de la région, « l’assise de cette ‘’remarquable coexistence communautaire’’ que le régime aimait tant inscrire à son crédit et que chaque visiteur était invité à aller célébrer dans ‘l’entrelacs des minarets et des clochers de la vieille ville’ a très régulièrement été surestimé par le regard extérieur ».
Ainsi, les chrétiens ont vu en ce pouvoir un allié plus fiable que leurs confrères sunnites, qualifiés hâtivement de Frères musulmans, quant aux Druzes – autre minorité musulmane chiite représentant environ 10% de la population – ils ont préféré adopter une « attitude de neutralité », alors que les Kurdes – majoritairement des musulmans sunnites – ont été considérés par les acteurs du régime comme une « minorité devenue précieuse pour former une alliance contre la majorité arabo-sunnite » et leur ont accordé davantage de prérogatives dans la gestion de certaines régions où cette ethnie est largement implantée.
C’est donc en clamant leur appartenance nationaliste (« Si l’on me demande à quelle communauté j’appartiens, je réponds : je suis syrien(ne) », slogans proférés par des membres supposés représenter toutes les composantes de la mosaïque ethnique et confessionnelle du pays) (Burgat, 2013) que le pouvoir alaouite allait essayer de convaincre de sa légitimité et
entériner une autorité élue démocratiquement, façade qui, aux yeux de l’Occident, compte prioritairement pour les estimer comme de potentiels alliés.
Le recours à l’autoritarisme et aux services de renseignements
Afin de garantir ses visées soi-disant altruistes et un « œcuménisme laïque » syrien, Bachar al Assad se devait de se poser au-dessus du confessionnalisme, mais dans le même temps « il obligeait ses adversaires à y prendre pied : en niant la réalité de cette problématique, ils risquaient de se faire accuser de défendre le fait majoritaire sunnite ; et, en cherchant à donner des garanties à chacune des communautés, ils nourrissaient eux-mêmes la spirale des rivalités et de la division ». Pour mieux prévenir ces éventualités, la fonction de l’armée à la suite de la guerre du Kippour en 1973 ainsi que la confrontation avec Israël au Liban en 1982, « avait été recentrée sur le rôle théoriquement dévolu à la seule Garde républicaine : la défense, non du territoire, mais du seul régime ».
De plus, elle dispose de pléthore d’informateurs à tous les niveaux de la structure, ce qui permet de garder un contrôle omniprésent et interne. Parallèlement, les services de renseignements ont vu leurs domaines d’activité s’étendre à l’ensemble de la vie quotidienne des simples citoyens, parmi lesquels la Sécurité militaire, la Sécurité aérienne, la Sécurité générale, la Sécurité politique dont tous les dirigeants avaient un lien plus ou moins proche avec le chef de l’Etat (cousins, fils ou beaux-frères).
Dans ce contexte, et lourd d’un passé en dents de scie, depuis le Printemps de Damas au massacre de Hama qui a conduit plusieurs dizaines de milliers de personnes à la mort, les animosités envers le pouvoir syrien existent mais ne se montrent pas.
Prolongement du Printemps arabe
Il faut attendre le départ de flamme du Printemps arabe d’abord en Tunisie, puis en Egypte et en Libye pour que la mèche prenne en Syrie en mars 2011. Pour faire face de façon radicale au mouvement de protestation, l’armée, forte de « 300 000 hommes, de milliers de chars, de canons, d’avions et d’autres matériels » (Glasman, 2013) s’emploie à éradiquer les opposants et éviter l’effet tâche d’huile déjà commencé à travers le monde arabe. Mais la volonté et le nombre d’activistes ne rendent pas l’exercice aussi facile qu’il n’y parait, malgré les dispersions, les perquisitions, les arrestations et autres mesures de surveillance (écoutes téléphoniques, réseaux sociaux, informateurs sur le terrain) que les forces armées mettent rapidement en place pour montrer aux yeux du monde ainsi qu’aux Syriens eux-mêmes que les manifestations sont dérisoires et que « les images de jeunes et de moins jeunes en train de défiler sont des montages des télévisions des pays ennemis ». (Glasman, 2013)
L’horreur des crimes commis par les moukhabarat (services de renseignements et de sécurité) à l’heure du Printemps arabe n’est pas sans rappeler les années sombres du régime syrien qui, depuis l’arrivée au sommet de l’Etat de la famille al Assad, a pratiqué la torture sous toutes ses formes contre les réfractaires. Dans son ouvrage, JP Perrin la décrit comme « l’instrument central de la répression du gouvernement […] qui ne sert pas seulement à arracher des informations. On torture pour terroriser, pour briser les corps et détruire les âmes, pour estropier, pour mutiler, pour rendre fou, pour tuer. Par vengeance, aussi. Et on torture par goût pour la torture, comme si c’était un jeu, une gourmandise ou une pratique sexuelle. On torture par sadisme, par pure perversité».
La systématicité de ces actes a fini par rendre docile une population maintenue volontairement dans l’isolement et contrainte de se soumettre aux désirs d’un despote rayonnant parallèlement à l’international, en menant une politique économique néolibérale favorable aux investisseurs étrangers.
La montée des radicalismes sunnites : d’Al Qaeda à Daesh
Depuis le 11 septembre 2001, le Moyen-Orient est la région du monde la plus secrète et la plus crainte par l’Occident. Oussama Ben Laden avait trouvé en Afghanistan une base confortable où implanter un fief que personne, dans les rangs de l’organisation islamiste Al Qaeda n’osait remettre en question. A sa mort dix ans plus tard, les rênes du pouvoir changent de main et font resurgir des velléités internes. C’est le cas entre le leader Abou Moussab al-Zarkaoui, chef d’Al Qaeda en Mésopotamie et Abou Bakr al-Baghdadi, ancien détenu du Camp Bucca, prison gérée par les Américains dans le Sud irakien, ouverte dans la foulée de l’intervention de 2003. C’est là que la plupart des têtes pensantes du régime de Saddam Hussein sont envoyées, ainsi que des djihadistes particulièrement dangereux. Baghdadi y a séjourné quelques mois, pendant lesquels il a pu tisser un réseau qui prendra dix années plus tard le nom de Daesh (ou Etat Islamique).
La mort de Ben Laden a jeté un pavé dans la mare, scindant en plusieurs entités le groupuscule qu’il avait lui-même créé au nom d’une application rigoriste du Coran pour semer la terreur. Al Qaeda officialise d’ailleurs leur divorce en 2014 dans un communiqué précisant qu’il n’a « rien à voir avec l’E.I ». Là où Daesh se lance dans une guerre avant tout intra-communautaire, opposant entre eux sunnites et chiites, l’autre faction cherche à se rallier aux Etats chiites (Iran, Syrie, Irak) pour mieux conquérir le reste du monde et imposer la charia.
Le contexte géopolitique du Proche-Orient est composé d’un tel arsenal de belligérants qu’il serait aventureux de ma part d’en expliquer les tenants et les aboutissants dans un mémoire qui ne concerne pas directement le conflit syrien mais une simple résurgence exportée à Tripoli.
L’essentiel étant de comprendre les oppositions idéologiques entre les musulmans sunnites et les musulmans alaouites (proches des chiites) ainsi que les enjeux politiques qui se greffent.
Pour les uns, l’idéal d’un califat islamiste fait référence à un âge d’or, « celui d’un islam conquérant et des deux califats des premiers siècles de l’islam. Un héritage reconstitué qui fait beaucoup plus appel à l’imaginaire que les musulmans ont de cette période qu’à la réalité ».
L’objectif de Daesh étant donc de reconquérir un territoire perdu, du fait en partie de l’invasion des Occidentaux dans leurs affaires personnelles (accords Sykes-Picot, guerre du Golfe, etc.) et de l’étendre le plus possible afin de régner en maître sur l’ensemble du territoire musulman, et plus si affinités.
Pour les autres, minoritaires, garder le pouvoir dans des pays stratégiques leur permet de se maintenir en vie, sans quoi ils seraient anéantis par leurs frères ennemis, laissant derrière eux une lignée descendant directement des fidèles d’Ali, gendre et cousin du Prophète Mahomet, « dont la famille a été, selon eux, écartée du pouvoir illégitimement ». Les aspirations de conquête n’en sont pas moins grandes mais leur statut d’infériorité les force actuellement à être sur la défensive, position qui leur est favorable aux yeux des spectateurs internationaux ulcérés par l’extrême bestialité des djihadistes. Mais c’est sans regarder les exactions commises par le régime syrien depuis des décennies sur les populations sunnites essentiellement.
Rappels historiques au Liban
Une guerre civile communautaire et intercommunautaire
Lors de sa première phase, la guerre du Liban n’avait pas le caractère confessionnel qui a été retenu par la suite. Entre avril 1975 et mai 1976, les revendications premières des manifestants étaient d’obtenir davantage de reconnaissance, eux qui se sentaient lésés par des « inégalités sociales excessives, un régime fiscal qui ‘dans un pays riche faisait un Etat pauvre’, des prévarications des classes dirigeantes, et d’un dosage incorrect de la représentation communautaire ».
D’après Alem et Bourrat, les principaux responsables de ce conflit étaient les Palestiniens, « imposés au Liban par les autres pays arabes, leur nombre a augmenté jusqu’à atteindre 15% de la population ». En plus d’une représentation excessivement forte, ils ont grossi les rangs de la religion présentée comme minoritaire puisque 80% d’entre eux étaient musulmans.
Quant à la Syrie, son implication dans le « drame libanais » n’est pas en reste. Bien au contraire.
Si certains, parmi les plus modérés, admettent qu’une « finlandisation de ce pays au profit de Damas » serait suffisante, d’autres le considèrent comme « une province abusivement séparée de la Syrie par la puissance mandataire ». Autrement dit, les progressifs désaccords entre les populations elles-mêmes étaient une aubaine pour leurs voisins d’appuyer leur domination, « à condition qu’ils sachent en écarter toute intervention étrangère, arabe ou non arabe ». Quoiqu’il en soit, les Syriens n’avaient plus qu’à patienter sagement, attendant que le point de rupture entre les factions déjà en présence n’intervienne tôt ou tard.
C’est au tout début de l’année 1975 qu’un premier bond en avant permet au régime baathiste d’y croire. Les querelles entre les Palestiniens, accusés de « bafouer la souveraineté de l’Etat » et les Phalanges, parti social très largement maronite (80%), qualifié de « droite chrétienne » par ses détracteurs, chauffent d’un ton. Le 18 avril, jour des actes considérés comme le déclencheur, des coups de feu retentissent sur le parvis d’une église de la banlieue Sud de Beyrouth. Peu de temps après, un car transportant des Palestiniens est mitraillé, tuant 27 passagers. Seulement deux jours plus tard, déjà 150 à 300 personnes avaient trouvé la mort et 1 000 autres blessées.
De son côté, la Syrie profitait de l’insurrection pour dérouler ses trois principes : « maintien du Liban dans la mouvance syrienne, contrôle des Palestiniens (sujets potentiels, la Palestine faisant partie de la ‘Grande Syrie’), et enfin opposition au partage du Liban : un tel partage conduirait à la création, sur une partie du territoire, d’un Etat chrétien qui deviendrait inévitablement un satellite d’Israël, et d’autre part il apporterait une confirmation à la théorie israélienne d’après laquelle la création d’un Etat pluriconfessionnel en Palestine était impossible » (Alem et Burrat). Voyant que leurs objectifs étaient en passe d’être contredits, les Syriens ont dû convaincre leurs ennemis jurés (Israël) d’adopter une position de neutralité, le temps que le parti Baas s’occupe de la question palestinienne, en échange d’un affaiblissement bienvenu pour les Israéliens, ils acceptèrent à une condition : « le non-dépassement par l’armée syrienne de la ligne rouge, expression désignant non une limite précise, mais une zone assez mal définie, aux environs du fleuve Litani ». Pendant un temps au moins, les chrétiens, jusqu’alors isolés dans leurs rangs, auraient le soutien du voisin contrôlé par Hafez al Assad, bien décidé à gagner la partie. Mais c’était sans prévoir le rôle de la communauté internationale, et notamment les liens entre l’Egypte et Israël qui envisageaient sérieusement d’instaurer la paix entre leurs deux Etats. La Syrie craignait alors qu’ « un Liban réunifié sous la conduite d’un Président maronite pourrait à son tour conclure la paix avec son voisin du Sud ». Bref, à coups de voltefaces et autres caracoles stratégiques, Syriens et chrétiens commencèrent à s’affronter à partir de février 1978. Finalement, les maronites eux-mêmes se scindèrent entre partisans du Lion (tel que le clan Frangié qui domine la commune de Zghorta, toujours leur alliée en 2015) et proches d’Israël. Dès lors, une « nouvelle guerre tribale se superposa à la guerre générale » et s’amorcèrent les prémices d’un méli-mélo confessionnel qui ne trouvait aucune cohésion ni explication pour le public occidental, pensant simplement que « tout le monde tue tout le monde au Liban ».
A partir de 1982, la ligne rouge pourtant encore jamais enfreinte par les deux camps est dépassée du côté Sud. Le gouvernement israélien, dont le premier Ministre M. Begin se sentait « investi d’une mission quasi divine : la destruction de la résistance palestinienne », lance une offensive jusqu’à Beyrouth-Ouest où 15 à 20 000 combattants avaient élu domicile, dont « 10 000 à 12 000 fedayin [groupes de commandos palestiniens ne reconnaissant pas Israël], 2 500 miliciens du Mouvement national [coalition de partis et d’organisations de plusieurs entités différentes : druzes, communistes, pro-syriens et pro-irakiens, chiites, Front Populaire de Libération de la Palestine et Front Démocratique pour la Libération de la Palestine], 1 500 chiites d’Amal, 2 000 soldats syriens » (Alem et Bourrat, 1991). Mais s’attaquer à cette région aurait demandé trop d’efforts aux sionistes et coûté cher en pertes humaines et matérielles, c’est pourquoi la méthode des bombardements par l’usure a fini par consteller terre, air et mer d’étoiles tuantes, usant des armes les plus coriaces, telles que des bombes à fragmentation ou au phosphore. Résultat : 29 506 morts et blessés ; 2 994 blessés graves étaient atteints de brûlures au phosphore (d’après les comptages de l’UNICEF). Et pourtant, avec des chiffres en leur faveur et une cruauté redoutée, l’opération n’a pas abouti. Beyrouth-Ouest est resté libanais. Finalement, la division du pays en 1983 n’accorde que 20% du territoire à l’autorité légitime, le reste étant partagé entre voisins.
METHODOLOGIE
La nécessité de l’auto-ethnographie
Avant toute tentative de rédaction, je n’envisageais pas de relater mon expérience proche orientale autrement que par l’auto-ethnographie. D’abord pratiquée par les ethnographes, cet usage s’est étendu à la géographie et se définit, selon Louis Dupont comme une « méthode favorisant l’inclusion de l’expérience personnelle du chercheur comme « étudiant » (d’une culture), c’est-à-dire comme scientifique, et comme « étudié », c’est-à-dire comme une personne ayant eu à divers degrés une expérience de l’intérieur ».
Ayant vécu des moments intenses et parfois difficiles, je me voyais mal faire fi de ma posture et de mon ressenti pour garder une objectivité qui, de toute évidence, n’aurait pu être sincère. Ce sont les épreuves endurées pendant mes quatre mois de terrain, ainsi que le quotidien dans une ville en conflit qui ont mûri ma réflexion et l’ont rendu possible.
L’auteur continue sa démonstration en précisant que « l’auto-ethnographie n’est pas une biographie personnelle, bien qu’elle puisse s’appuyer sur des notes bibliographiques et des anecdotes personnelles. L’idée n’est pas non plus, comme certains le craignent, de s’enfoncer dans la régression psychanalytique ou la narration romanesque. » C’est un écueil dans lequel je me suis moi-même engouffrée et que dans certains cas j’ai volontairement conservé dans le rendu final, notamment avec les « regards biaisés ». Je m’explique. Sur le terrain, l’écriture a été un remède, un exutoire nécessaire pour vider le trop plein de saletés que j’entassais dans mon esprit. Afin d’en réchapper, je me devais de m’échapper, et l’écriture m’a ouvert la voie vers cette issue de secours. Les quelques textes que j’ai griffonnés sur mon ordinateur ont donc eu ce rôle « psychanalytique » qui m’a été vital. Par la suite, à mon retour en France, j’ai pendant plusieurs mois repoussé le commencement de mon travail de composition. Non seulement l’année universitaire que j’entamais allait me mener dans un tout autre univers (je débutais alors un cursus en Criminologie) – il est effectivement laborieux de mener de front deux projets distincts – mais il m’a surtout été particulièrement douloureux de me replonger dans des souvenirs mal refermés. Mes premières et longues tentatives de rédaction ont ainsi fait office d’auto-psychothérapie et, avec un pincement amer, je plaisantais en présentant mon mémoire comme mes mémoires. Je suis donc à moitié d’accord avec L. Dupont car, si l’on veut pousser la méthode d’auto-ethnographie encore plus loin, tout le cheminement intérieur du chercheur devrait transparaître dans son travail et il ne devrait pas avoir honte de se mettre à nu – comme j’ai la désagréable impression de le faire – car il n’est jamais facile de s’avouer faible et brisée par quelques mois de vagabondage oriental. Il me semble que mon vécu personnel est indissociable de mon terrain, qu’il a orienté mes recherches et lectures postérieures, qu’il a inconsciemment sélectionné les informations retenues, enfin, qu’il est intrinsèque à mon travail global. Je ne saurai parler du conflit au Nord-Liban sans me référer à ce que j’y ai vécu et je refuse de me présenter comme une spécialiste de la question, puisque mon point de vue est trop partial (et partiel) pour prétendre le considérer comme une vérité scientifique, sinon universelle. Je souhaiterais donc que ce rapport soit lu comme un regard possible sur Tripoli et accepté dans toute sa subjectivité, sa spontanéité et sa relativité.
Une position préalable difficile à trouver
Jeune femme occidentale, blonde aux yeux bleus, avec appareil photo et tatouage au pied cherche terrain de recherche en zone de conflit
La première difficulté dans l’approche de ce terrain a été celle de l’apparence physique. A Tripoli, et plus particulièrement dans le quartier sunnite de Bab el Tebbane, la tradition du voile est de mise pour les femmes et rares sont celles qui se paradent dans la rue le chef découvert.
La question s’est donc posée de savoir si je devais me couvrir ou non, autrement dit si je choisissais d’être en immersion ou bien de rester à ma place en tant que spectatrice d’une situation. Toutes les personnes à qui j’ai demandé leur avis m’ont dissuadé de le faire pour une seule raison à leurs yeux : « Tu n’es pas libanaise, tu n’es pas musulmane, tu es française, alors reste qui tu es ». J’ai trouvé cette phrase suffisamment convaincante pour me résoudre à l’idée qu’en aucune manière, même si j’avais voulu le faire, je ne serai jamais comme eux. Les limites de l’immersion du chercheur s’arrêtent avec le bon sens et la seule volonté ne suffit pas à nous rendre ce que nous ne serons pas. C’est donc en tant que « moi » que j’ai décidé de faire ce travail, avec mes différences, mes préjugés et mon impossible assimilation.
A partir de là, de leur point de vue à eux, ma position a pu poser des problèmes ou des interrogations. Qu’une jeune femme voyage seule est une première source d’incompréhension de la part de ces communautés patriarcales où la femme est soumise à l’homme, qu’il soit son père ou plus tard son mari. Qui plus est si cette jeune femme porte à son pied un tatouage, considéré comme haram (péché). L’excès de zèle de cette intruse que j’étais n’a finalement pas déterminé la suite des échanges, puisqu’ils ont fini par m’accepter et comprendre ma démarche, animés par une curiosité certaine d’accueillir dans leur domaine une étrangère.
Ensuite, au-delà des apparences, c’est la langue qui a mis une barrière supplémentaire à ma recherche. Dans ces quartiers pauvres, l’apprentissage général est défaillant, alors celui d’une langue étrangère est la cadet de leurs soucis, d’autant qu’ils auront peu l’occasion de sortir de leur quartier une fois adulte. J’ai malgré tout toujours réussi à trouver, parmi les locaux, des étudiants qui apprenaient l’anglais et le parlaient même couramment, ce qui m’a permis d’obtenir les réponses aux questions que j’essayais laborieusement de formuler en dialecte libanais.
Avertissement : ambiguïté du terme ‘géographie’
Avant de partir pour quatre mois, j’ai suivi des cours d’arabe littéraire afin d’être capable de lire l’écriture et les panneaux, sans pour autant les comprendre. Un premier pas vers cette culture que j’allais tenter d’approcher au plus près. Ma professeure était elle-même tripolitaine quoique installée en France depuis près de trente ans. Connaissant bien les ficelles du conflit présent, elle a tenu à me mettre en garde sur mon statut de « géographe ». Selon elle, ce terme pouvait représenter une menace car qui dit géographie dit cartes, qui dit cartes dit frontières et qui dit frontières dit espion. Un raccourci plaisant au premier abord, mais dont il fallait tenir compte dans un contexte fragile. Son conseil a donc été de me faire passer pour une étudiante en sociologie, dénomination plus consensuelle, qui fait sens aux oreilles d’esprits suspicieux comme nombre d’habitants de Tripoli-Est.
La pratique m’aura finalement vite montré que cet avertissement n’était pas si nécessaire étant donné le public à qui j’ai eu affaire au cours de mon enquête, à savoir essentiellement des étudiants, familiers des cursus universitaires, ou des mères de famille pour qui ce rapprochement n’était pas aussi évident qu’aux hommes, eux qui sont directement concernés par les méandres du conflit. La présence d’une jeune femme sur leurs terres était à elle seule suffisamment intrigante pour ne pas s’encombrer l’esprit par de futiles défiances.
|
Table des matières
Premier regard biaisé : Posture de départ
Première partie : CADRE CONCEPTUEL
Section 1 – Le communautarisme
1. Distinction communauté et communautaire
2. Sunnisme VS chiisme
3. Le Liban, un Etat multicommunautaire
4. La notion de société civile
Section 2 – La géographie des conflits
1. Reconnaître et appréhender un conflit
2. Les géographies en support
Seconde partie : CONTEXTUALISATION
1. La guerre civile en Syrie : diviser pour mieux régner
2. Rappels historiques au Liban
3. Construction d’un territoire et scission en deux quartiers autonomes
Troisième partie : METHODOLOGIE
1. La nécessité de l’auto-ethnographie
2. Une position préalable difficile à trouver
3. Une approche informelle du terrain
4. Évolution du sujet : du rêve à la réalité
5. Tentative de comparaison avec le conflit nord-irlandais
Quatrième partie : PRESENTATION DES ASSOCIATIONS TRIPOLITAINES
1. Ruwwad al tanmeya – Lebanon
2. Utopia
3. Offre Joie
4. Fondation Safadi
5. Médecins Sans Frontières
Cinquième partie : TRIPOLI, LES TRIPOLITAINS ET LES AUTRES
1. Etrange sentiment de bien-être à Tripoli
2. Une ville rassurante, mais pour qui ? Portraits de eux, de nous
Second regard biaisé : Un mois au Liban
Sixième partie : ETUDE DE CAS : BAB EL TEBBANE ET JABAL MOHSEN, DEUX QUARTIERS DANS ET HORS DE TRIPOLI
1. Pauvreté et mise à l’écart par le reste de la ville
2. Terrain de recherche : accéder aux lieux, une aventure difficile et dangereuse
3. Adaptation forcée de l’espace : les remparts contre la guerre
4. Premières impressions d’un conflit
5. Jouer sur la ligne de front
Troisième regard biaisé : « La musique souvent me prend comme une mer »
6. Jabal Mohsen : un îlot sur la défensive
7. Bab el Tebbane et Jabal Mohsen : entre intégration et rejet de la ville
Septième partie : LA SURVIE DES QUARTIERS OPEREE PAR LA SOCIETE CIVILE
1. Quelles priorités face au tandem pauvreté/conflit ?
2. Quelles conclusions tirer de ces initiatives ?
Quatrième et dernier regard biaisé sur un des 38 conflits armés qui se déroulent actuellement dans le monde : Posture de retour
BIBLIOGRAPHIE
TABLES DES ILLUSTRATIONS
TABLE DES MATIERES
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet