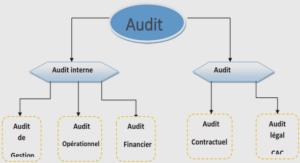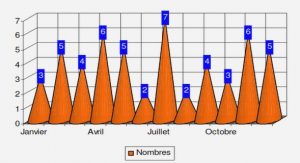Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Antigènes parasitaires
Il existe différents antigènes parasitaires, occupant différents sites à la surface du parasite dont l’apparition est liée au stade évolutif (antigène de surface des sporozoïtes, des mérozoïtes, des ookinètes etc.…
Les hématies parasitées peuvent aussi exprimer les antigènes des parasites c’est l’exemple du Mérozoite Surface Protein (MSP).
Les principaux antigènes candidats vaccins sont MSP1, MSP3, AMA (Apical Membrane Antigen), EBA-175 (Erythrocyte BindingAntigen), GLURP (Glutamate RichProtein).
Caractères culturaux [9, 68, 70]
La culture des Plasmodium doit se faire à partir de sang prélevé chez un sujet infesté, ou de souches de laboratoire. On peut utiliser un milieu de culture cellulaire tel que RPMI 1640, enrichi en nutriments (exemple de sérum AB supplémenté, Albumax, HEPES, Hypoxantine). L’incubation doit se faire sous air appauvri en oxygène (inférieur à 3%, pour au moins 93% d’azote), dans un incubateur à 37°C. On peut aussi utiliser une jarre à bougie. Normalement la multiplication des Plasmodiesse fait chaques 48 heures. La culture doit être effectuée dans un environnement strictement stérile afin d’éviter des contaminations bactériennes.
Vecteurs [54]
Le paludisme est transmis, le plus souvent, par la piqure d’un moustique infesté. Il existe 400 espèces de moustiques dont 60 assurent la transmission du paludisme. Ces derniers appartiennent au phylum des arthropodes, à la classe des insectes, l’ordre des diptères, au sous-ordre des nématocères, à la famille des culicidae ou moustiques, à la sous-famille des anophelinae, au genre anophèles. Seules les femelles sont hématophages et ont une activité nocturne.
Au Sénégal les espèces responsables du paludisme sont A.gambiae et A.funestus. Mais on y rencontre aussi A. albimanus, A.masculipennis, A.sacharovi.
Modes de contaminations [54]
La propagation du paludisme se fait essentiellement par inoculation du parasite, par l’anophèle femelle infestée, à une personne saine.
Mais on peut aussi rencontrer des cas de transmission de la mère à l’enfant par le biais de la barrière hémato- placentaire ou des cas de contamination par transfusion sanguine.
Cycle évolutif des plasmodies [50]
Pour se développer, le parasite a besoin de deux hôtes qui rendent son cycle biologique complexe, lequel comprend trois étapes dont deux se passent chez l’homme : l’hôte intermédiaire et une étape chez l’anophèle femelle : l’hôte définitif.
❖ Stade tissulaire ou schizogonie hépatique
Lors d’un repas de sang, l’anophèle femelle va injecter à l’homme des sporozoïtes contenus dans ses glandes salivaires. Ces derniers transitent dans la circulation générale. En une demi-heure environ, ils envahissent les hépatocytes. Les sporozoïtes entrent alors dans une phase de réplication dans la vacuole parasitophore. Ce qui repousse en périphérie le noyau de la cellule, laquelle finit par constituer une masse multinuclée appelée schizonte hépatique. Arrivé à maturité, le schizonte éclate et libère dans le sang des mérozoïtes. Cette étape dure 6 à 10 jours.
❖ Stade sanguin ou schizogonie érythrocytaire
Après avoir été libéré dans le sang, certains mérozoïtes sont phagocytés. La plus grande partie va parasiter les globules rouges. Le mérozoïte se différencie au sein de l’érythrocyte en prenant la forme d’un anneau correspondant au trophozoïte, à partir duquel, une intense phase réplicative commence .Une phase de développement nucléaire et de division donnant un corps en rosace ou schizonte érythrocytaire qui correspond à la cellule sanguine bourrée de Plasmodium. Le schizonte éclate. Il libère alors 8 à 32 mérozoïtes qui rapidement réinfectent des érythrocytes à nouveau. Cette phase dure 48h pour P.falciparum, P .ovale, P .vivax et 72h pour P .malariae.
En absence de traitement, les parasites évoluent de façon synchrone et détruisent les hématies de manière périodique. Cette phase est responsable des accès fébriles. Certains mérozoïtes vont à nouveau parasiter d’autres hématies, tandis que d’autres se dotent d’un potentiel sexué et se transforment en gamétocytes males et femelles. La schizogonie hépatique et la schizogonie érythrocytaire représentent la phase asexuée.
❖ La sporogonie (Phase sexuée)
L’anophèle s’infeste en avalant des gamétocytes lors d’un repas de sang chez un sujet infecté. Le gamétocyte femelle se transforme en macrogamète immobile, quand au gamétocyte mâle, il se divise en 8 microgamètes qui subissent un processus d’ex flagellation. Les microgamètes males sont donc mobiles.
La fécondation d’un microgamète mâle et d’un macrogamète femelle dans l’estomac de l’anophèle femelle donne un ookinète mobile. Il s’enfonce dans la paroi de l’estomac entre les cellules épithéliales, pour donner un oocyste au niveau de la face externe. Cette brève phase diploïde s’achève. Elle est suivie de plusieurs mitoses qui conduisent au développement des sporozoïtes. A maturité, l’oocyste éclate et libère ses éléments mobiles et haploïdes dans l’hémolymphe. Les sporozoïtes gagnent préférentiellement les glandes salivaires de l’anophèle d’où ils pourront être injectés lors d’une prochaine piqûre infectante.
Indices paludométriques [49]
Les indices paludométriques visent à déterminer la fréquence et l’intensité du paludisme dans les régions ou la transmission est assurée toute l’année .Ils peuvent être mesurés chez l’homme.
– L’indice splénique (IS) est le pourcentage de sujets présentant une splénomégalie dans une population donnée. Il est évalué chez les enfants de 2 à 7 ans dont l’hypertrophie de la rate reflète mieux que chez les adultes les réinfestations successives.
– L’indice plasmodique (IP) est le pourcentage de sujets examinés présentant des plasmodies dans le sang périphérique. Il renseigne sur le sujet, et en- même temps sur le degré d’endémicité d’une collectivité. Néanmoins, afin d’éviter toute confusion, cet indice doit être précisé pour la tranche d’âge à partir de laquelle il a été établi.
Ces deux précédents indices permettent de déterminer quatre zones d’endémicité palustre. Le tableau II montre la classification des zones d’endémicité palustres en fonction des indices spléniques et plasmodiques.
A ces deux indices, il y a lieu d’intégrer l’indice gamétocytaire (IG) qui représente le pourcentage de porteurs de gamétocytes dans le sang. Cette indication révèle le pouvoir de transmission dans une collectivité humaine vis-à-vis des anophèles.
Chez le vecteur on peut mesurer l’indice sporozoïtique. Il dévoile le pourcentage d’anophèles femelles d’une espèce donnée chez lesquelles une dissection, réalisée dans les 24h suivant la capture, montre la présence de sporozoïtes dans les glandes salivaires.
L’indice sporozoïtique, associé au nombre de piqures d’anophèles reçu par habitant, permet de déterminer le nombre de piqures infectantes ou le taux d’inoculation que reçoit chaque habitant par nuit, par mois ou par an.
Répartition dans le monde [16, 44]
Le paludisme sévit dans « la ceinture de pauvreté du monde ». Il est surtout redoutable en zone tropicale où l’on rencontre d’avantage P.falciparumagent du paludisme grave.
En Europe, le paludisme a été éradiqué mais celui d’importation y est présent depuis 1970.Cette réinfection va toucher l’Europe de l’Ouest en 2003. Le résultat fut que, l’Angleterre et la France comptèrent à eux deux 70% des cas. Cette situation découle de l’essor des déplacements vers les pays tropicaux, associé à une trop grande négligence de la chimioprophylaxie.
En Amérique, le Nord en est indemne. Par contre, il existe en Amérique Centrale.
Toutefois, il est en régression en Amérique du Sud et dans les Caraïbes(Haïti).
En Océanie, le paludisme affecte la Nouvelle Guinée et les iles Salomon. Tandis que Tahiti, la Nouvelle Calédonie et les Iles Loyauté sont épargnées.
En Afrique du Nord, le paludisme est rare on n’y rencontre les espèces P.vivax et P. malaria. Par contre, le paludisme est largement répandu dans la zone intertropicale de l’Afrique où coexiste P.falciparum, P. malaria et P. ovale.
En Asie, le paludisme sévit intensément à l’instar de l’Afrique. Ses zones de prédilection demeurent l’Asie mineure (épidémie à P.vivax en Turquie en 1976), la péninsule indienne, la Birmanie, la Chine. Au Vietnam P.falciparum et P.vivax dominent.
PHYSIOPATHOLOGIE [21]
Les modifications physiologiques causées par le paludisme sont directement ou indirectement liées à la schizogonie érythrocytaire. Leur gravité dépend de l’espèce plasmodiale, de la densité parasitaire et de la prémunition de l’hôte.
La fièvre est due à l’éclatement des rosaces, qui libèrent dans le torrent circulatoire un pigment malarique (hémozoïne). Ce dernier se comporte comme une substance pyrogène dont l’effet est comparable à celui d’une endotoxine.
Les érythrocytes sont détruits par les parasites qu’ils hébergent, favorisant l’installation de l’anémie, due à l’hémolyse permanente. Les hématies peuvent être saines par un mécanisme immunologique surtout dans les infections à P. falciparumlorsqu’elles fixent les antigènes plasmodiaux.
L’hémoglobine libérée par l’hémolyse provoquée est partiellement transformée dans le foie en bilirubine. L’excès est éliminé dans les urines (hémoglobinurie). La splénomégalie notée dans l’infection paludéenne est provoquée par l’hypertrophie de la pulpe blanche (lymphocytes petits et grands, cellules réticulaires, macrophages).
L’hyperactivité des cellules de Küpffer chargées de la phagocytose arrive à obstruer les veines lobulaires. L’hépatomégalie est légère et ne survient qu’au bout d’une longue période.
La formation de complexes antigènes-anticorps et leur dépôt dans la membrane basale cause une surcharge affectant par conséquent le rein et entraine une diminution de la capacité d’épuration de cet organe, particulièrement sollicité en cas d’hémolyse. Le blocage rénal par destruction massive de globules rouges est le danger principal de la fièvre bilieuse hémoglobinurique.
La schizogonie profonde de P. falciparum est à l’origine de complications redoutables dont le paludisme cérébral. Celui-ci consiste en des thromboses capillaires responsables de lésions vasculaires et hémorragiques. Ce qui provoque des altérations dégénératives des cellules nerveuses, entourées d’infiltrats cellulaires.
FORMES CLINIQUES [30]
Les manifestations de la maladie sont polymorphes. Il en est ainsi dans leur expression comme dans leur gravité. Les divers aspects donnent lieu à des tableaux cliniques distincts.
Le paludisme de primo-invasion [35]
Il atteint généralement l’enfant et le sujet neuf. Il comporte deux phases :
– l’incubation qui dure de 20 jours est cliniquement muette,
– l’invasion, peu spécifique, est marquée par l’apparition d’une fièvre continue. Le tableau clinique associe anorexie, douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhées, céphalées et myalgies. A l’examen clinique, le foie augmente souvent de volume. Par contre, la rate reste normale.
Accès palustre simple [35]
La gravité et l’évolution d’un accès palustre dépendent de l’espèce plasmodiale impliquée, mais également de l’âge du patient, de ses caractéristiques génétiques, de son état d’immunité et de nutrition, ainsi que de son état général de santé.
❖ La période d’incubation
L’intervalle entre l’infection et les premiers signes cliniques est d’environ 7 à 12 jours après une piqûre infestante dans le cas de paludisme à P.falciprum.
La fièvre est au premier plan, suivie des myalgies, des courbatures, des troubles digestifs à type de nausées, vomissement, douleurs abdominales.
❖ La période d’état
Dans les cas typiques, on observe la séquence suivante :
– des frissons intenses (1 à 2 heures),
– une température corporelle élevée (40-41 ºC pendant 1 à 4 heures),
– un stade de sueurs abondantes précédant la disparition de la fièvre, entre 1 à 2 heures.
Les intervalles entre les accès sont déterminés par la longueur du cycle érythrocytaire de l’espèce plasmodiale impliquée. L’ensemble de l’accès dure de 8 à 12 heures.
On parle de :
– fièvre tierce, toutes les 48 heures pour P. falciparum, P. vivaxetP. ovale.
– fièvre quarte, toutes les 72 heures pour P. malariae.
A l’examen, outre l’herpès labial, on note une hépatomégalie, parfois une splénomégalie, absente au début du cycle et n’apparaissant qu’après un certain délai d’évolution. Toutefois, elle est fréquente au cours des accès de réinfestations.
L’évolution est favorable en quelques jours sous traitement correct. En absence de traitement ou lors d’un traitement mal administré, une rechute peut subvenir quelques semaines ou quelques mois plus tard.
L’accès peut aussi évoluer vers des complications parmi lesquelles la plus redoutée est l’accès pernicieux ou le paludisme grave.
Accès pernicieux [70]
On l’appelle plus généralement paludisme grave. Il est caractérisé par l’importance de la souffrance cérébrale. Il constitue le grand drame du paludisme à P.falciparum. Cette encéphalopathie aiguë fébrile résulte d’une intense multiplication des hématozoaires dans les capillaires viscéraux et intracérébraux. L’OMS définit le paludisme sévère comme la présence d’hématozoaires dans le sang associé à l’un des signes suivants : fièvre à plus de 40°C, pouls à plus de 200 battements/min, coma d’emblée, état convulsif, hypertonie surtout paroxystique, anémie à moins de 3g/dl, œdème pulmonaire, hépatomégalie, déshydratation et hypoglycémie.
Le paludisme grave atteint les sujets dépourvus d’immunité en zone de forte endémie, il s’agit surtout d’enfant de 4 mois à 4 ans et des sujets neufs ou transplantés s’ils négligent leur chimioprophylaxie.
En zone d’hypo endémie ou le paludisme est plutôt saisonnier, les adultes autochtones mal prémunis ne se sont pas épargnés par l’accès pernicieux.
Pouvant généralement être lié à une parasitémie élevée, le paludisme grave est surtout fréquent sous les tropiques, en fin d’hivernage, période de transmission active du paludisme.
Son évolution dépend de la rapidité et de la qualité du traitement. Lorsqu’il est administré dans les normes du temps, la guérison survient sans séquelles. En absence de traitement, il est souvent fatal en 2 ou 3 jours.
Paludisme viscéral évolutif [43]
Il survient en zone d’endémie, essentiellement chez les enfants soumis à des infestations répétées à P. falciparumet/ou P. vivaxet assujettis à une chimio prophylaxie irrégulière ou peu efficace. A cette forme subaiguë ou chronique du paludisme, le praticien associe les caractéristiques suivantes : une anémie, parfois intense, voire avec complications, un subictère, une splénomégalie constante, une fébricule irrégulière à 38°C, parfois des poussées thermiques plus importantes et un retard staturo-pondérale chez l’enfant. L’altération de l’état général est évidente : asthénie, anorexie, amaigrissement. L’état du malade s’aggrave jusqu’à la cachexie. Malgré tout cela, les antipaludiques apportent une guérison spectaculaire.
|
Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : Généralités sur le paludisme
I. DEFINITION
II. HISTORIQUE
III. EPIDEMIOLOGIE
III.1. Agent pathogène
III.1.1. Classification
III.1.2. Morphologie
III.1.3. Antigènes parasitaires
III.1.4. Caractères culturaux
III.2. Vecteurs
III.3. Modes de contaminations
III.4. Cycle évolutif des plasmodies
III.5. Indices paludométriques
III.6. Répartition dans le monde
IV. PHYSIOPATHOLOGIE
V. FORMES CLINIQUES
V.1. Le paludisme de primo-invasion
V.2. Accès palustre simple
V.3. Accès pernicieux
V.4. Paludisme viscéral évolutif
V.5. Fièvre bilieuse hémoglobinurique
V.6. Autres formes
VI. DIAGNOSTIC
VI.1. Diagnostic parasitologique
VI.1.1. Prélèvement
VI.1.2. Techniques
VI.1.2.1. Goutte épaisse
VI.1.2.2. Frottis mince
VI.1.2.3. QBC (Quantitative Buffy Coat)
VI.1.3. Diagnostic immunologique
VII. TRAITEMENT
VII.1. Traitement du paludisme simple
VII.1.1. Principales molécules antipaludiques
VII.1.1.1. Schizonticides
VII.1.1.2. Gamétocytocides
VII.1.2. Autres molécules antipaludiques
VII.1.3. Associations d’antipaludiques
VII.2. Traitement du paludisme grave
VII.3. Directives thérapeutiques au Sénégal
VII.3.1. Instructions pour l’application des protocoles de traitement du paludisme
VII.3.2. Directives relatives au traitement du paludisme grave au Sénégal
VIII. CHIMIORESISTANCE
VIII.1. Définition
VIII.2. Mécanismes de la résistance
VIII.3. Facteurs favorisant la résistance
VIII.4. Evaluation de la chimiosensibilité
VIII.4.1. Tests in vivo
VIII.4.2. Test ex vivo
VIII.4.3. Etude des marqueurs moléculaires
IX. PROPHYLAXIE
IX.1. But
IX.2. Chimioprophylaxie
IX.3. Protection du sujet sain
IX.4. Vaccination
DEUXIEME PARTIE : TRAVAIL EXPERIMENTAL
I. METHODOLOGIE
I.1. Cadre d’étude : Ville de Pikine
I.1.1. Présentation générale
I.1.2. Epidémiologie du paludisme dans la ville
I.2. Type et période d’étude
I.3. Taille de l’échantillon
I.4. Population de l’étude
I.4.1. Critères d’inclusion (critères OMS)
I.4.2. Critères de non inclusion
I.4.3. Critères d’arrêt de suivi
I.5. Traitement des patients
I.5.1. Traitement antipaludique
I.5.2. Médicaments adjuvants
I.6. Suivi des patients
I.6.1. Suivi clinique
I.6.2. Suivi biologique
I.7. Saisie, Analyse et Gestion des données
I.7.1. Saisie et Analyse des données
I.7.2. Gestion des données
I.8. Considérations éthiques et déontologiques
II. RESULTATS
II.1. Efficacité thérapeutique
II.2. Sécurité et tolérance
DISCUSSION
I. INCLUSION
II. EFFICACITE
III. TOLERANCE
CONCLUSION
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Télécharger le rapport complet