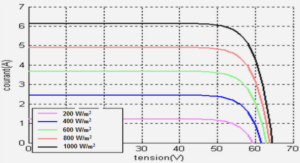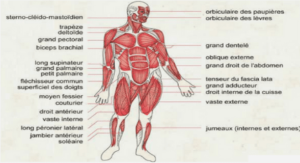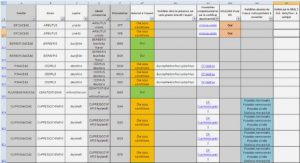Manjakandriana et la royauté malagasy
Durant la période royale, les sous préfecture fut la terre des rois célèbres de l’histoire de la ville des milles. Andrinamponimerina, le plus célèbre, est né à Ikaloy, village situé dans la partie Nord de la sous préfecture, à Sadabe plus précisément. Il était représenté par les Tompo-menakely issus des localités d’antan. Ayant eu vent d’un projet de révolte des Tompo-Menakely et informé de l’arrivée probable des émissaires, le roi était allé voir. Au moment où ils se sont rencontrés, les roitelets s’écrièrent «Manjaka ny Andriana» (que le roi règne). D’où l’origine du nom de la ville de Manjakandrina. En recevant les rapports, Andrinamponimerina fut à la fois étonnée, content et rassuré, que les rumeurs n’étaient pas fondées. Depuis, le lieu de ramification qui s’appelait autrefois Ambohitsoa, fut baptisé point de halte pour les rois et les reines, au cours de leurs voyages vers Toamasina. Ramiangaly, une des douze femmes du grand monarque était la fille du Tompo-Menakely d’Ankadimanga, commune de Sambaina : un lac a été dédié à cette femme et qui est devenu l’une des attractions touristiques de la sous- préfecture, sous le nom de DobonDramiangaly, dans le village d’Ankadimanga.La reine RANAVALONA III est née à Merinarivo, commune rurale de MIADANANDRIANA, dans la partie sud de la sous- préfecture. Sous sa règne, les forêts de Manjakandriana servaient de réservoirs pour alimenter en bois la construction des maisons d’habitation de la capitale. Le transport de ces troncs d’arbre se faisait sous forme d’imposition. Les bois de Mantasoa et de Manjakandrina ont été évacués à dos d’homme vers la capitale. Toute personne valide participait à cette corvée. De cette circonstance est née l’adage : « Antananarivo no tsara trano ka Vakiniadiana no sola vantony » Vakiniadiana est dénudé de ces forêts pour permettre à Antananarivo de construire des belles maisons ou aussi, la population de Vakiniadiana sont devenus chauves pour permettre à Antananarivo d’avoir de belles maisons : cette dernière traduction est plus plausible puisqu’elle transporte ces troncs sur la tête et à force de perpétuer cette manière de transport, les cheveux tombent et les hommes deviennent chauves. Cela démontre que Manjakandriana a beaucoup contribué à la révolution infrastructurelle de la ville des milles et demeurait le premier ravitailleur de la capitale en matière de bois.(22) Région historique, qui a vu naître ces grands rois, qui ont participée à l’épanouissement de la capitale, mais pourtant, demeure arriérée sur le plan économique et sportif.
La pluriactivité
* Les causes :A Manjakandriana, l’accès à la terre est très limité: 69% des ménages possédant une parcelle et la superficie rizicole moyenne par ménage s’élève seulement à 18 ares. Le relief accidenté de la zone limite la superficie des terres cultivables et les bas- fonds propices à la culture du riz irrigué en terrasse, sont déjà exploités. L’extension ne peut se faire que par défrichement des coteaux mais les parcelles ainsi obtenus « ou tanety » sont moins productives puisque non irriguées et caractérisées par un sol moins fertiles. Les «tanety» sont principalement affectés à la culture des tubercules, notamment des maniocs. Enfin, au fil des générations, la règle de partage de l’héritage entre les descendances implique une réduction des superficies moyennes par ménage. (4) Par ailleurs, étant donnée la dimension sacrée de l’héritage, les possibilités d’achat et de vente sont réduites. La vente d’un terrain ne se fait qu’en cas d’extrême nécessité. L’accès limité à la terre dans la zone de Manjakandriana explique la place prépondérante des activités complémentaires. Il explique également la forte émigration que connaît la zone. Cependant la pression foncière n’est pas la seule explication à la diversification des activités. Cette stratégie est dictée, d’une part, par l’accumulation de terrains par les grands propriétaires et d’autre part, par la situation de proximité à la Capitale Antananarivo, qui favorise le développement des échanges à caractères commerciaux)
* Le développement de la pluriactivité :Les activités secondaires de ménage jouent un rôle central dans le sens où, outre le fait d’apporter un complément de revenu nécessaire à la survie, elles permettent aux familles de développer ses projets. Par exemple, les ménages les plus démunis ou les migrants qui ne possèdent pas de terre cultivable vont travailler auprès des gros propriétaires terriens ou recevoir au métayage des ressources pour accumuler suffisamment, afin de pouvoir monter une petite activité, et à terme acheter un terrain.Cependant, les activités secondaires sont précaires car largement soumises aux aléas conjoncturels, elles offrent qu’une protection partielle des conditions de vie des ménages. Les activités secondaires les plus pratiquées sont le salariat agricole, les activités de commerce, les activités de transport et le plus courant, l’exploitation forestière. La population se débat pour survivre, une lutte quotidienne, sans trop d’espoir ni de désespoir. Elle cherche à vivre avec les conditions qu’offrent les perspectives locales. Face à la saturation agricole, la population se tourne vers la voie commerciale. Cette précarité des situations économiques des paysans, qui sont majoritaires, constitue un frein, car les frais de la préparation et d’entretien d’un joueur dépassent leur pouvoir d’achat.
Qu’est ce que la motivation ?
Comme la plupart des notions étudiées en psychologie, la motivation n’est pas directement observable, mais inférée (c’est-à-dire déduite) à partir de l’observation d’une conduite physique ou mentale. Ainsi, c’est en observant et en relevant les actions spécifiques d’une personne et ses habitudes, qu’on peut en déduire des caractéristiques de personnalité, comme la sociabilité ou l’agressivité. De même, on ne peut déterminer un état de la motivation qu’à partir de l’observation d’un comportement, de son orientation sélective, de son intensité ou de sa persistance Ainsi, un entraîneur ou des dirigeants, observe (nt) les comportements de jeunes pratiquants dans leur environnement pour juger de leur niveau de la motivation,et rectifie (nt) leurs évaluations au fur et à mesure que leur observation se multiple. Pour réduire le niveau de la motivation d’une personne, un observateur profane procédera certainement de façon différente d’une psychologie : le fait de voir les joueurs participer à une compétition de sport collectif avec leur club peut conduire un observateur naïf à déduire que les joueurs sont motivés pour le pratique sportive. Toutefois, l’analyse de ces observateurs naïfs est incomplète, parce qu’ils ne tiennent compte ni de la persistance des conduites des joueurs (l’absentéisme, par exemple), ni de l’intensité de leur investissement (14) Par opposition, le psychologue dispose à la fois d’outils performants pour améliorer son observation, et prend en compte l’ensemble des indicateurs de la motivation, ainsi que l’influence qu’exercent les uns sur les autres ces différentes caractéristiques observables. Il pourra tenir compte du fait qu’un sportif peut s’investir avec une telle intensité dans des exercices qu’il aura du mal à terminer la séance d’entraînement. En outre, le psychologue sera en mesure de déterminer la nature « extrinsèque » de la motivation et par voie de conséquence de prévoir à l’avance les conséquences affectives ou comportementales de l’état actuel général. A présent, nous sommes en mesure de préciser un certain nombre de concepts, qu’on utilise en psychologie de la motivation. De très nombreuses définitions de la motivation ont été proposées. Mais ces définitions, soit qu’elles stipulent que des processus internes à la personne influencent la direction, la persistante et la vigueur d’un comportement dirigé vers un but, soit qu’elles énoncent que les influences externes sont à l’origine des comportements.
Définition de la motivation
Selon les conceptions actuelles en psychologie, la conduite est à la fois le produit :
a) de variables situées dans la personne ;
b) de facteurs de l’environnement ;
c) de l’interaction entre les propriétés de la personne et les facteurs de l’environnement. C’est pourquoi, nous avons proposé la définition suivant « Le compte motivation représente le construit hypothèque utilisé afin de décrire les forces internes et/ou externes produisant du comportement » (14) Ainsi, un joueur est « stimulé » par son entraîneur qui tient à ce que les participants viennent à l’heure à toutes les séances d’entraînement programmées. Les effets de cette stimulation extrinsèque interfèrent avec la motivation intrinsèque et extrinsèque.
Motivation intrinsèque et extrinsèque
La motivation intrinsèque correspond à l’engagement dans une activité pour le plaisir et la satisfaction qu’elle procure.Selon Deci et Ryan , qui ont élaboré la théorie de l’évaluation cognitive (TEC), la motivation intrinsèque serait liée au besoin d’un individu à se percevoir comme compétent et autodéterminé. C’est parce qu’un individu s’efforce de ressentir ou de reproduire des sentiments de compétence, ou de se percevoir comme ayant choisi une activité de sa propre initiative, qu’il dénoterait une forte motivation et régulerait sa conduite avec intensité et persistance en vue de la mener à bien. Lorsqu’elles procurent de telles perceptions, des activités comme le hand bail,l’exercice musical ou la lecture, sont menés à des fins intrinsèques. Lors de telles conduites, un joueur ressent un sentiment de compétition, parce qu’il progresse dans la maîtrise du ballon et de situations collectives de jeu. (3) A l’inverse, la motivation extrinsèque correspond à un engagement dans une activité pour obtenir une récompense, susciter l’approbation de l’entraîneur, sur passe des adversaires gagner de l’argent, de l’argent pour se promouvoir socialement, etc. L’activité représente dans ce cas un moyen et n’est plus considérée comme une fin en soi..Pour les théories des buts de Nicholls, lorsqu’un individu cherche à s’opposer à autrui, veut démontrer qu’il possède une bonne compétence ou s’efforce d’éviter de paraître incompétent aux yeux d’autrui, sa conduite est extrinsèquement régulée. (https://www.chatpfe.com)
Différentes formes de la motivation intrinsèque
De nos jours, cependant, on oppose plus simplement la motivation intrinsèque à la motivation extrinsèque. Il existe différentes formes de motivation intrinsèque, comme il existe plusieurs niveaux de motivation extrinsèque. Selon la théorie de l’évaluation cognitive (3), il transforme la motivation intrinsèque à des motivations à la connaissance, aux sensations et à l’accomplissement. Vallerand et ses collègues ont construit des questionnaires destinés à évaluer ces formes de la motivation dans différents contextes « dont l’échelle de la motivation en sport ». De même Thill a distingué trois buts d’implication motivationnelle qui correspondent à des standards personnels et a proposé leur mesure en contexte académique ou sportif. A la différence des auteurs précédents et en accord avec les théories des buts et non des besoins, qui constituent les déterminants immédiats des conduites. En effet, un but et non les besoins qui constitue, correspond à un objectif (par exemple, un certain niveau de performance) ou à un état (par exemple de fierté) que les sujets s’efforcent d’atteindre ou de reproduire : les buts correspondant donc à des représentations (ils sont de nature cognitive) et constituent des standard de référence auxquels les résultats de conduite seront comparés. Il s’agit :
– des buts d’implication dans la tâche : s’engager dans une activité pour le plaisir qu’on en retire et pour découvrir les aspects d’un sport ;
– des buts d’apprentissage recherche un progrès personnel : apprendre de nouvelle habilités, améliorer sa compétence ;
– des buts d’accomplissement : faire face aux situations difficiles et chercher à se surpasser.
|
Table des matières
INTRODUCTION
PREMIÈRE PARTIE
PREMIER CHAPITRE
I – PRESENTATION DE LA RECHERCHE
I- I- OBJET DE LA RECHERCHE
1-2 -CHOIX DU SUJET
I- 3 –INTERET DU SUJET
I- 4 -LIMITATION DU SUJET
DEUXIEME CHAPITRE
II- CADRE D’ETUDE ET POSITION DU PROBLEME
II-1-l Cadre géographique
a) Délimitation territoriale
b) Particularité climatique et hydrographique
II-1-2 Cadre historique
a) Manjakandriana et la royauté malagasy
b) Manjakandriana depuis la colonisation
-II-1-3 Cadre économique
a) La polyculture familiale
b) La pluriactivité
II-1-4 Cadre démographique
II-1-5 Cadre institutionnel
a) Le Ministère de la Jeunesse et des Sports
b) La délégation Inter-Régionale de la Jeunesse et des Sports
c) La délégation du Fivondronana et L’Animation des
d) Les textes législatifs
e) Les associations reconnues d’utilité publique
f) Les Fédérations sportives
g) La ligue et la Section
h) Fonctionnement
II- 1- 6 Cadre sportif
a) La place du football dans la sous-préfecture de Manjakandriana
DEUXIEME PARTIE
TROISIEME CHAPITRE
III-CADRE THEORIQUE
III-1 -DOMAINE DE DEFINITION
III-1-1- Motivation
III-1-2-Formel
III-1-3-Informel
III-1-4- Récompense
III-1-5- Coupe ordinaire
HI-1-6-Coupe-zébu
III-2-LA MOTIVATION
III-2-1- Qu’est que la motivation
III-2-2- Définition de la motivation
III-2-3- Motivation intrinsèque et extrinsèque
III-2-4-Différentes formes de la motivation intrinsèque
III-2-5- Les niveaux de la motivation extrinsèque
III-2-6- Quels sont les mécanismes de la régulation motivationnelle ?
III-2-7- Les déterminants de la motivation
III-2-8- Les perceptions des participants et leur état de motivation
III-2-9- Les conséquences de l’Etat de motivation
III-2-10- Conséquences affectives
III-2-11- Conséquences cognitives
III-2-12- Conséquences au niveau des conduites
a) La motivation et apprentissage
b) La persistance
c) Absentéisme et décrochage sportif
d) La performance
III-3-HYPOTHESE
TROISIÈME PARTIE
QUATRIEME CHAPITRE
IV-VERIFICATION DES HYPOTHESES
IV-1- Structure informelle, en tant que support de la motivation
IV-1-1- Les caractéristiques de la structure informelle
a) Organisation parallèle
b) Financement sponsorisé
c) Récompenses en nature
d) La fin du tournoi : une véritable liesse populaire
e) Influences des hiérarchies sociales traditionnelles
IV-1-2 Signification de la coupe zébu
a) Conséquences au niveau des joueurs
IV-2- La synchronisation de la structure formelle et informelle
CINQUIEME CHAPITRE
VI- Méthodologie
VI-1 Objet
SIXIEME CHAPITRE
VI- SUGGESTIONS : SOLUTIONS AUX PROBLEMES DES CLUBS LOCAUX
VI.1. Facilitation de l’accès à la structure fédérale
VI.2. Formation des cadres sportifs
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet