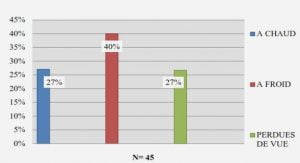Détection par séquençage de nouvelle génération des microorganismes
Taxonomie des tiques
Les tiques de par la présence d’un exosquelette et d’appendices articulés appartiennent à l’embranchement des arthropodes au sein du règne animal (McCoy and Boulanger, 2015). La classification systématique des tiques est décrite dans la Figure 1. Les tiques sont divisées en trois familles monophylétiques (regroupant l’ensemble des spécimens descendant d’un même ancêtre commun) : la famille des Nuttalliellidae, qui ne comprend qu’une seule espèce, les Ixodidae, encore appelées « tiques dures », qui incluent près de 700 espèces, et enfin les Argasidae, encore appelées « tiques molles » qui sont composées d’environ 200 espèces (Guglielmone et al., 2010). La taxonomie des tiques est encore à l’heure actuelle sujette à débat. Les divergences d’opinion concernent principalement l’affiliation des spécimens de tique au niveau du genre et de l’espèce (Estrada-Peña et al., 2010 ; 2015). Historiquement, la classification systématique des tiques se basait sur la caractérisation morphologique des spécimens ainsi que sur l’étude de leurs caractéristiques biologiques et écologiques et de leur répartition géographique. Ensuite, le développement des techniques de biologie moléculaire a permis d’affiner en partie les données de taxonomie grâce aux études de phylogénie, basées sur l’étude du génome mitochondrial et des gènes des ARNr nucléaires (McCoy and Boulanger, 2015, Burger et al., 2014). 000000000000000000000000000000 Ainsi, la taxonomie au niveau du genre et des espèces d’Ixodidae a pu être clarifiée et un certain degré de consensus trouvé. Les tiques dures sont réparties au sein de 12 genres (les deux genres fossile Compluriscutula et Cornupalpatum non compris) : Ixodes, Haemaphysalis, Amblyomma, Rhipicephalus, Dermacentor, Hyalomma, Anomalohimalaya, Bothriocroton, Cosmiomma, Margaropus, Nosomma et les Rhipicentor (Guglielmone and Nava, 2014, Estrada-Peña et al., 2015). La classification des tiques molles quant à elle reste encore controversée, le nombre et le nom des genres variant en fonction des opinions. Un des freins majeurs à la mise en place d’un consensus taxonomique est le manque de lignes directrices définissant les termes descriptifs et les traits morphologiques spécifiques des spécimens d’Argasidae, ce qui a engendré une certaine confusion et probablement une sousestimation de la diversité des tiques molles (Estrada-Peña et al., 2010). La figure 3 présente les quatre écoles de taxonomie qui défendent chacune une vision différente de la systématique des Argasidae (Burger et al., 2014). En résumé, trois genres de tiques molles sont communs aux différentes écoles de taxonomies, les genres Ornithodoros, Argas, et Otobius. Cependant les espèces inclues dans chacun de ces genres ne font pas l’unanimité et varient selon les auteurs, de même que l’existence d’autres genres de tiques molles. Plus précisément, le genre Carios décrit par Klompen and Oliver (1993) regrouperait des espèces de tiques classées dans les genres Antricola et Nothoaspis par d’autres auteurs (Estrada-Peña et al., 2010, Burger et al., 2014). Les figures 1 et 2 incluent les genres de la famille Argasidae décrit par l’école Américaine de taxonomie (Guglielmone et al., 2010 ; Burger et al., 2014). 0000000000000000000000000000000000 1.2.1.2. L’idiosome L’idiosome est composé d’un tégument dont la nature diffère entre les Ixodidae et les Argasidae. Chez les tiques molles, le tégument est chitinisé, sans sclérification, souple et rugueux, avec quelques variations d’aspect en fonction des genres décrits (Figure 5) (Pérez- Eid, 2007). Chez les tiques dures, le tégument est composé de parties rigides chitinisées et sclérifiées et de parties souples. La couverture de l’idiosome par ce tégument rigide permet de différencier les mâles des femelles Ixodidae. Chez les mâles le tégument sclérifié, appelé alors conscutum, recouvre la totalité de la surface dorsale. Chez les larves, nymphes et chez la femelle, seule la partie antérieure de l’idiosome dorsal est sclérifiée, et prend le nom de scutum, alors que la partie postérieure est appelé alloscutum (Figure 5) (Pérez-Eid, 2007). En face ventrale des Ixodidae, certaines zones peuvent être sclérifiées, notamment les coxae, mais aussi des parties de tégument appelées plaques, très utiles en classification (Pérez-Eid, 2007). L’idiosome est constitué d’une partie antérieure appelée podosome, qui porte les paires de pattes et l’orifice génital, et d’une partie postérieure nommée opisthosome qui présente de nombreuses striations et pores, des organes sensoriels, l’orifice anal, les stigmates, et divers sillons (Sonenshine and Roe, 2014a). Les paires de pattes sont au nombre de quatre chez la nymphe et l’adulte, et au nombre de trois chez les larves. Sur la première paire de pattes se trouve l’organe de Haler en face dorsale du Tarse, qui présente un rôle physiologique significatif, impliqué dans de nombreuses fonctions sensorielles, telles que la localisation d’hôte ou la reconnaissance de phéromones (Sonenshine and Roe, 2014a). La présence, le nombre et la position des organes sensoriels varient selon la famille et le genre de tique, on retrouve par exemple des yeux, des soies tactiles, des pores, des sensilles, etc. Les stigmates en position ventro-latérale sont impliqués dans la respiration des nymphes et adultes. Finalement, on peut noter que chez les tiques dures, la présence et l’orientation du sillon anal permet de distinguer les prostriata des métastriata. Le sillon anal est en forme d’arche et contourne l’anus par l’avant chez les prostriata, et est en forme de U, avec un contournement de l’anus par l’arrière chez les métastriata (sauf chez les tiques Boophilus où le sillon est absent) (Pérez-Eid, 2007). Chez les Argasidae, la distinction entre les mâles et les femelles est moins évidente et est liée à la forme du pore génital (Figure 5) (McCoy and Boulanger, 2015). Finalement, les Argasidae portent des pores coxaux situés entre la coxae I et II qui sont impliqués dans les mécanismes d’évacuation d’eau (Sonenshine and Roe, 2014a). 1.2.2. Anatomie interne générale des tiques et aspect physiologique L’anatomie interne des tiques est très similaire entre les tiques molles et les tiques dures (McCoy and Boulanger, 2015) (Figure 6). 00000000000000000000000000 1.2.2.1. Système digestif Les tiques sont des arthropodes hématophages stricts, se nourrissant uniquement du sang de leur hôte. En règle générale, chaque stase de la tique réalise un repas sanguin, en dehors de certaines espèces de tique où soit les mâles soit les larves ne se nourrissent pas (McCoy and Boulanger, 2015). L’appareil digestif débute le canal préoral situé au niveau du rostre, qui débouche sur le pharynx, suivi de l’oesophage et de l’intestin moyen. A noter que la prise du repas sanguin et l’excrétion de la salive empruntent le même trajet depuis et vers le rostre via le canal pré-oral, et fonctionnent en alternance (Sonenshine and Roe, 2014a). L’intestin moyen est l’organe le plus volumineux, il est composé d’une portion centrale, appelée estomac central, à partir duquel se déploient plusieurs diverticules (ou ceacae) (Figure 6). La digestion du sang se réalise au niveau des cellules épithéliales des diverticules de l’intestin moyen. La digestion est intracellulaire, et comprend la dégradation de l’hémoglobine et des protéines de l’hôte, la destruction des fragments cellulaires et la récupération de l’eau qui sera rejetée. L’intestin moyen est aussi un lieu de stockage, la dégradation du repas sanguin pouvant s’étaler sur plusieurs années (Sonenshine and Roe, 2014a). L’estomac central débouche ensuite sur l’intestin postérieur, encore appelé sac rectal qui permet l’évacuation des déchets vers l’anus. L’eau produite au cours de la digestion du repas sanguin va quant à elle être excrétée via les glandes salivaires chez les tiques dures, et via les glandes coxales débouchant sur les pores coxaux chez les tiques molles (Figure 5) (McCoy and Boulanger, 2015). 000000000000000000000000000 1.2.2.2. Les glandes salivaires Les tiques possèdent deux glandes salivaires. Chacune de ces glandes est constituée d’acini, reliés entre eux par des canules, et l’ensemble forme une structure en grappe. La salive excrétée par les glandes salivaires rejoint les canaux salivaires qui débouchent sur le canal pré-oral (Sonenshine and Roe, 2014a). La taille des glandes salivaires varie selon le cycle de développement de la tique et la prise de repas sanguin. Au cours du repas sanguin, leur taille augmente, alors qu’en fin de repas, les glandes salivaires dégénèrent. Il existe quatre types d’acini, définis selon la présence et la composition de leurs granules de sécrétion (Sonenshine and Roe, 2014a). Les glandes salivaires sont multifonctionnelles, et ont un rôle essentiel dans les mécanismes de parasitisme des tiques et de survie environnementale. Elles sont impliquées dans la sécrétion de multiples composés dans la salive, qui facilitent entre autre la prise du repas sanguin, qui modulent la réaction immunologique de l’hôte et qui assistent la transmission des agents pathogènes. Chez les Ixodidae, elles sont également impliquées dans la synthèse du ciment qui permet une fixation forte sur l’hôte, ou encore dans l’évacuation d’eau provenant du repas sanguin. Les glandes salivaires permettent aussi la régulation de l’hygrométrie de la tique, en lui permettant de survivre dans des environnements à faible taux d’humidité (McCoy and Boulanger, 2015). Finalement, les glandes salivaires et la salive jouent un rôle clé dans la transmission des agents pathogènes aux hôtes vertébrés En effet, la salive des tiques est non seulement un moyen de transport et d’inoculation des agents pathogènes, mais ses composants vont également faciliter leur transmission en modifiant les conditions environnementale locale au niveau du site de piqûre (Šimo et al., 2017).
|
Table des matières
INTRODUCTION
1.Les tiques
1.1. Taxonomie des tiques
1.2. Bio-écologie des tiques
1.2.1. Anatomie externe générale des tiques
1.2.1.1. Le capitulum
1.2.1.2. L’idiosome
1.2.2. Anatomie interne générale des tiques et aspect physiologique
1.2.2.1. Système digestif
1.2.2.2. Les glandes salivaires
1.2.2.3. Les tubes de malpighi
1.2.2.4. Glandes coxales des argasidae
1.2.2.5. Le système respiratoire
1.2.2.6. Le système circulatoire
1.2.2.7. Le système nerveux
1.2.2.8. Le système reproducteur
1.2.3. Cycle de vie et écologie des tiques
1.2.3.1. Le cycle de developpement
1.2.3.2. Les différents cycles de vie des tiques
1.2.3.3. Ecologie des tiques et préférences trophiques
1.3. Importance médicale et véterinaire des tiques
1.3.1. Impact direct et indirect des tiques en sante humaine et animale
1.3.1.1. Impacts sanitaires directs des tiques
1.3.1.2. Impacts sanitaires indirects des tiques
1.3.2. Epidemiologie des maladies a tiques
1.3.2.1. Acquisition et transmission des agents pathogènes
1.3.2.2. Capacité et compétence vectorielle
2.Les tiques et les agents pathogènes transmis par les tiques dans la zone des Caraïbes
3.Objectifs de la thèse
CHAPITRE 1 : Détection par séquençage de nouvelle génération des microorganismes et agents pathogènes présents dans les tiques de Guadeloupe et de Martinique
1.Introduction
2.Matériel et méthode
2.1. Collecte des tiques en Guadeloupe et Martinique
2.2. Traitement des échantillons de tiques en vue du séquençage
2.2.1. Broyat des échantillons de tiques
2.2.2. Extraction des acides nucléiques des échantillons de tiques
2.2.3. Traitement à la DNase des acides nucléiques extraits
2.3. Séquençage de nouvelle génération (NGS): RNAseq
2.3.1. Rétro-transcription des ARNs
2.3.2. Séquençage : RNAseq Illumina HIseq2000
2.3.3. Traitement des données de séquençage
2.3.3.1. Traitement et nettoyage des données brutes
2.3.3.2. Attribution taxonomique des contigs
2.4. Analyse des génomes viraux détectés en NGS
3.Résultats
3.1. Description générale des données de séquençage
3.2. Inventaire des séquences d’origine bactérienne d’importance médicale et vétérinaire
3.2.1. Séquences contigs appartenant au genre Anaplasma
3.2.2. Séquences contigs appartenant au genre Ehrlichia
3.2.3. Séquences contigs appartenant au genre Rickettsia
3.2.4. Séquences contigs appartenant au genre Borrelia
3.2.5. Séquences contigs appartenant au genre Coxiella
3.3. Inventaire des séquences d’origine parasitaire d’importance médicale et vétérinaire
3.4. Inventaire des séquences d’origine virale présentes dans les tiques
3.4.1. Séquence contig « Changping tick virus-Like »
3.4.2. Séquences contigs « Wuhan tick virus-Like »
3.4.3. Séquences contigs « Lihan tick virus-Like »
3.4.4. Séquences contigs « Jingmenvirus-Like »
3.5. Analyse et reconstruction des génomes viraux
3.5.1. Génome du virus “Changping tick virus-Like”
3.5.2. Génome du virus “Wuhan tick virus-Like”
3.5.3. Génome du virus “Lihan tick virus-Like”
3.5.4. Génome du virus “Jingmenvirus-Like”
4.Discussion
CHAPITRE 2 : Criblage des agents pathogènes et microorganismes dans les tiques des Antilles Françaises par PCR microfluidique en temps-réel a haut débit
Introduction du chapitre 2
CHAPITRE 2a : Criblage des bactéries et parasites dans les tiques des Antilles Françaises
Introduction
ARTICLE: Screening of tick-borne pathogens in the french antilles using new highthroughput microfluidic technology
CHAPITRE 2b : Criblage des virus dans les tiques des Antilles Françaises
Introduction
1.Développement de la PCR microfluidique en temps réel à haut débit permettant le criblage des arbovirus dans les tiques
2.Adaptation de la PCR microfluidique en temps réel au criblage des arbovirus d’intérêt de la zone Caraïbe
2.1. Matériel et méthode
2.1.1. Collectes et traitement des échantillons de tiques de Guadeloupe et de Martinique
2.1.2. Rétro-transcription des arn, pré-amplification, PCR microfluidique en temps réel
2.1.3. Calcul des taux d’infection
2.1.4. Sondes et amorces ajoutées
2.1.5. Recherche d’éléments viraux endogènes
2.2. Résultats
2.2.1. Criblage des arbovirus dans les tiques de Guadeloupe et de Martinique
2.2.1.1 Le Changping tick virus-Like (ctvl)
2.2.1.2 Le Wuhan tick virus-Like (wtvl)
2.2.1.3 Le Jjingmenvirus-Like (jvl)
2.2.1.4 Le Lihan tick virus-Like (ltvl)
2.2.2. Recherche d’éléments viraux endogènes
2.3. Discussion
CHAPITRE 3 : Collecte de tiques dans les caraïbes et études épidémiologiques exploratoires
1.Introduction
2.Matériel et méthode :
2.1. Organisation de la collecte de tiques en Guadeloupe
2.2. Organisation de la collecte de tiques dans les Caraïbes
2.3. Réception des échantillons de tiques et identification morphologique
2.4. Broyat et extraction des ADN/ARN des tiques
3.Résultats de la collecte des tiques en Guadeloupe et dans les Caraïbes
3.1.Les tiques collectées en Guadeloupe
3.2 Collecte de tiques dans les Caraïbes
4.Discussion et perspectives
DISCUSSION GENERALE ET PERSPECTIVES
REFERENCES
ANNEXES
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet