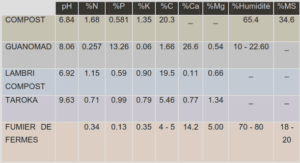Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Les mandarins et la société cambodgienne, historiographies croisées
Milton Osborne a eu accès aux archives de la Résidence supérieure conservées au Cambodge à la fin des années 1960. Il est le premier et le dernier historien avant la troisième guerre indochinoise58, à s’intéresser au rôle du mandarinat cambodgien durant la conquête et la colonisation. Son enquête met en parallèle les problématiques de la « collaboration » des élites cambodgiennes et de la « résistance » du mandarinat « cochinchinois » face aux administrations impériales françaises59. Milton Osborne avait souhaité identifier les stratégies de reproduction sociale des membres de l’administration et tenté de reconstituer leur milieu familial60. Mais lorsque d’autres chercheurs débutent leurs enquêtes sur ces élites61, le Cambodge sombre dans la guerre civile.
Du fait du blocus international, les historiens et les anthropologues des années 1980-1990 travaillent donc à partir des bibliothèques et archives étrangères, notamment sur le corpus ethnographique réuni depuis les années 1930, sur les recueils d’inscriptions ou sur la presse62. Dans un contexte politique dramatique marqué par les crises successives, les chercheurs ont inversement à cœur de reconstituer des logiques sociales de temps long, dans une optique transdisciplinaire et sur des documentations de nature multiple, pour tenter de dépasser les discontinuités documentaires et les clivages narratifs63.
Concernant l’analyse des sources coloniales, les fonds indochinois rapatriés en France sont exploités dès les années 1970 par les historiens du Cambodge64. Mais du fait de la division des fonds en deux catégories, « souveraineté » et « administration », l’orientation thématique des dossiers aujourd’hui conservés à Aix-en-Provence aux Archives Nationales de la France d’Outre-Mer induit une lecture par trop institutionnelle des réalités indochinoises. La composition du fonds, soit les archives stratégiques de la Résidence de France, donne à voir la structure de domination plutôt que la pratique quotidienne du pouvoir. Les récits produits alors portent donc sur la mise en colonisation du pays cambodgien par la Résidence et sur les tentatives de résistance politique de la société face à cet impérialisme, notamment à partir des fonds policiers répertoriant les atteintes à l’ordre colonial65.
Au Cambodge, dès 1995, une équipe dirigée par Peter Arfanis entreprend de réinventorier et de reclasser les documents des ANC66. Pour ce faire, elle réemploie l’inventaire de Paul Boudet : des tables de reclassement permettent parfois de connaître les anciennes cotes des documents, celles employées par Milton Osborne. Depuis leur réouverture à la consultation, il est possible de croiser les archives de la pratique conservées en Asie du Sud-Est avec les fonds politiques d’Aix, en étudiant à la fois le point de vue de la métropole, le point de vue du gouvernement général à Hanoï, les prises de position du gouvernement de la Cochinchine à Saïgon et les enjeux locaux à Phnom Penh67. Les chercheurs mobilisent notamment les dossiers de carrière des personnels indigènes conservés aux ANC en privilégiant la méthode biographique pour rendre compte, à travers des portraits, de logiques sociales d’ampleur68. Tous évoquent alors la sociologie bien particulière des élites cambodgiennes que nous souhaitons étudier69.
À travers ces travaux, des enjeux majeurs quant à la compréhension de la forme et de la nature de la société cambodgienne sont formulés dans les années 1990, et surtout, la nécessité de décrire
l’organisation de la société à travers ses logiques propres, que les auteurs décrivent dès lors comme des logiques réticulaires. Du fait des conflits manifestes qui opposent ces élites au Cambodge et sur la scène internationale depuis les années 1950, les logiques centrifuges nées des rapports de force entre des groupes territorialisés sont mises en évidence par les chercheurs qui analysent la société cambodgienne au XXe siècle en termes de décomposition70. Les relations de parentalité semblent le ciment de ces groupes tandis que leurs options idéologiques les opposent sans les définir71. Les auteurs de sociologie politique s’intéressent notamment au « clientélisme » – le recrutement des populations par ces élites factieuses – comme une méthode de capitalisation des forces électorales, économiques et militaires. Ils s’interrogent dès lors sur la forme et la nature que ces groupes donnent à l’État cambodgien et sur les modèles d’analyse exploitables pour faire sa description72. Face à la complexité de compréhension de la structure sociale de ces factions cambodgiennes73 , Marie-Sybille de Vienne74, Jacques Népote75, Justin Corfield76 ou Michael Vickery77 cherchent à éviter de reproduire dans leurs analyses les lignes de fractures idéologiques de la guerre froide, dont les éléments ne leur semblent pas systématiquement opérants pour comprendre les pratiques du pouvoir au Cambodge.
Ces auteurs prennent acte des logiques idéologiques divergentes, des clivages et rapports de force, mais ils vont surtout tenter de donner à voir les réseaux malgré leur opacité, en se concentrant alors sur les éléments partagés par tous les groupes qui revendiquent d’exercer le pouvoir. En remontant dans la chronologie pour prendre du recul sur les luttes partisanes78, ils décrivent comment l’élite cambodgienne se définit alors comme un ensemble de familles se reconnaissant comme membres affiliés par des degrés de parentalité. Du XIXe au début du XXe siècle, de vastes lignées de dirigeants politiques se partagent à des degrés divers le pouvoir politique. Certains acteurs de ces familles sont bien identifiés79, mais la description des réseaux de parenté au sein desquels ils s’inscrivent reste largement inédite80.
L’un des enjeux de la description de cette société élitaire formulé par ces chercheurs porte sur les sources de l’histoire sociale cambodgienne. Les historiens ont tout d’abord considéré l’histoire des lignées royales khmères à partir du récit de leurs généalogies, tel qu’il est retranscrit dans les chroniques royales, baṅsāvatār « les incarnations de la lignée » royale81. « Mythographie82 » maintes fois remaniée pour correspondre aux enjeux de la succession dynastique, ce récit rend compte de l’affirmation successive des divers prétendants au trône soutenus par leurs parentés qui se combattent pour le contrôle du pays.
Les chroniques royales telles qu’elles ont été fixées à l’écrit et transmises depuis le XIXe siècle sont de deux ordres : celles qui émanent du secrétariat royal et celles qui émanent des monastères, soient les deux relais majeurs de l’affirmation de la souveraineté royale depuis le XVIIe siècle. Cependant, on sait qu’il existait des copies à usage « privé » de ces textes, voire que ce sont des copies « privées » qui ont servi à établir les versions élaborées au XXe siècle83. Tout comme les parentés vietnamiennes conservaient des annales de l’histoire familiale, volet « privé » des annales impériales84, les familles khmères ont pu conserver des documents attestant de leur identité sociale à travers un récit généalogique85. Ce récit familial peut d’ailleurs un jour venir coïncider avec celui de la chronique royale elle-même lorsque cette famille entre dans la maison royale86.
Les élites cambodgiennes en situation coloniale, essai d’histoire sociale des réseaux de pouvoir, de la deuxième moitié du XIXe à la première moitié du XXe siècle.
Pour débuter le portrait du groupe social élitaire cambodgien en situation coloniale, nous décrivons et analysons tout d’abord les interactions entre les mantrī, les « conseillers » ou mandarins du roi cambodgien, les maisons aristocratiques et le roi. Ce groupe social élitaire se structure à travers la hiérarchie des maisons, réseaux de pouvoir et clientèles qui le composent. La première partie de cette thèse, « Des maisons royales aux réseaux mandarinaux », veut rendre compte de ces hiérarchisations, depuis le sommet de l’État jusque dans les territoires.
Le chapitre 1, « Le fonctionnement de l’État royal à la fin de l’époque moyenne : administration des maisons et pouvoirs des clientèles », présente le fonctionnement de l’État royal « à maisons » à la fin du XIXe siècle. Il démontre que la royauté cambodgienne est l’émanation des rapports de force et des
collaborations entre maisons. Son administration est elle-même organisée en maisons ou « apanages » qui sont contrôlées par de grands personnages, émanations de familles aristocratiques, qui exploitent leur réseau pour gouverner au quotidien. Ces familles cherchent à se transmettre des charges au sein des structures lignagères car la jouissance de ces charges, symboles et matérialisations de leur relation à la Couronne, détermine la puissance de leur maison. Ces maisons entretiennent entre elles des interactions : soit elles coopèrent, soit elles se combattent, et le roi peut, soit se trouver mis en difficulté par leurs menées politiques, soit exploiter ces interactions à son avantage. Il semble qu’à la fin du XIXe siècle, les rois du Cambodge ont habilement utilisé les structures lignagères et leurs patrimoines sociaux pour entamer une réforme de cet État à maisons, juste avant et aux premières heures de la présence française.
Le chapitre 2, « Démonstrations de forces à la cour du roi Norodom (1884-1904) », décrit comment
l’intrusion de la France sur la scène politique cambodgienne s’inscrit dans la continuité des enjeux de gouvernement propres à l’État royal cambodgien depuis la deuxième moitié de l’époque moyenne, sans transformer la nature des interactions sociales et la manière de faire de la politique dans cette société « à maisons ». Il donne à voir comment les élites palatiales cambodgiennes se sont affrontées pour la Couronne à la fin du XIXe siècle selon les logiques de réseau. La Résidence de France est décrite comme l’un des acteurs de ces affrontements, dans le cadre de la description de la maison aristocratique qu’elle choisit de soutenir dans cette course au trône, la maison du prince Sisowath. Le chapitre 2 présente donc comment cette maison est parvenue au pouvoir à travers sa politique lignagère et clientélaire.
Le chapitre 3, « Le mandarinat à l’ombre du protectorat (1897-1953) », décrit ensuite comment cette maison prend le contrôle de l’administration de l’État royal sous les auspices de la France. Le protectorat a en effet besoin de la maison du vice-roi puis roi Sisowath pour gouverner le pays. Les administrateurs français et cambodgiens collaborent donc même si les pratiques de gouvernement de l’élite cambodgienne sont officiellement condamnées par les élites coloniales. Il apparaît ainsi que les Français se sont servis des ressources politiques, sociales et économiques des réseaux de pouvoir et admis que ce qu’ils appellent bientôt le clientélisme ou le népotisme des mandarins – soit les logiques de reproduction sociale du groupe élitaire – faisait partie des enjeux de la reconduction de leur autorité politique sur le pays cambodgien.
Au sein de cette maison du prince puis roi Sisowath, différents acteurs de la montée en puissance du frère cadet du roi Norodom ont été identifiés au cours de la première partie. La seconde partie de cette thèse, « Les élites cambodgiennes en situation coloniale, portrait de groupe(s) », analyse la sociologie de ces élites cambodgiennes à partir de l’exemple – et parfois du contre-exemple – que représentent le secrétaire-interprète puis ministre Thiounn et sa famille, selon les données issues de la prosopographie de cent-vingt membres des administrations coloniale et indigène.
Le chapitre 4, « Description du groupe social élitaire à travers la biographie de Thiounn », propose donc une biographie critique de Thiounn : alors que la bibliographie a tendance à le présenter comme un personnage exceptionnel, nous insistons à l’inverse sur sa représentativité. À partir de la relecture de la documentation originale, nous proposons de comparer son profil social à ceux d’autres membres du cadre des résidences et de l’administration indigène. Thiounn, issu d’un mariage métis, fait partie d’une génération qui s’est spécialisée dans les « affaires étrangères » parce qu’elle représente justement un pont » entre divers espaces sociaux qu’elle peut dès lors mettre en contact164. Mais Thiounn n’est alors Glukman, Max, « Analyse d’une situation sociale dans le Zoulouland moderne (1940) », traduit par Yann Tholoniat et présenté par Benoît de l’Estoile, Genèse n°72, 2008/3, pp. 119-155 ; Hao, Yen-p’ing, The comprador in nineteenth century China, bridge between East and West, Cambridge, Harvard University Press, 1970, 314 p. pas uniquement « l’exemple type du sujet colonial165 », mais bien le représentant de la tradition diplomatique royale cambodgienne. Depuis le XVIIe siècle, la cour mobilise en effet les milieux mandarinaux allogènes – chinois, siamois, vietnamiens, malais – pour servir de passerelles avec les
Européens. Les « élites traditionnelles » et les « nouveaux venus » sont d’autre part deux catégories d’usage complexe au Cambodge du fait de la logique lignagère et clientélaire. Le mandarinat indigène s’associe ou s’allie en effet avec ces milieux allogènes et les lignes de démarcation sociales ou ethniques sont moins utiles pour comprendre la stratification de cette société que ne le sont les hiérarchisations lignagères, c’est-à-dire l’analyse de la place des individus au sein des maisons, notamment au regard du statut de la mère (khmère ou étrangère, roturière ou princesse ?) de Thiounn dans un système de parenté matrilinéaire.
Le chapitre 5, « La formation des élites cambodgiennes, XIXe-XXe siècles », décrit ainsi comment les élites « étrangères », ainsi que Thiounn, peuvent entrer dans la carrière mandarinale par le biais du parcours de formation privilégié par les familles cambodgiennes. Ces mandarins d’origine allogène peuvent ensuite devenir membres de la société élitaire par le biais de leur association ou de leur mariage dans des maisons cambodgiennes. À la période coloniale, ces maisons voient dans ces jeunes étrangers des partenaires capables de leur faire une place dans les institutions nouvelles. Dès les années 1870, les élites cambodgiennes choisissent également de réformer leurs pratiques d’apprentissage pour donner à leurs héritiers le bagage culturel nécessaire à la poursuite de leurs carrières auprès des instances françaises. Contrairement aux idées reçues, les élites cambodgiennes n’ont pas refusé de s’inscrire dans la tradition scolaire française. Cependant, les carrières auxquelles les formations coloniales conduisent, dans l’interprétariat, ne conviennent pas aux mandarins qui multiplient les stratégies pour permettre à leurs héritiers de devenir des mandarins dans l’administration indigène. Car le véritable pouvoir politique et social s’exerce dans cette ex-administration royale.
Des « officiers prédateurs210 » : us, coutumes et éthique du mandarinat.
Comment donner une texture sociale à la description générale et souvent théorique du fonctionnement
de l’administration royale esquissée dans les pages précédentes ? La fragmentation de l’autorité régalienne en maison ou « apanages » peut effectivement s’observer dans les sources de la pratique de la fin du XIXe siècle. Cet « édit de nomination211 » détaille par exemple les responsabilités d’un gouverneur de province juste nommé, rédigé lors de son installation officielle à Kaṃbat (Kampot) en
janvier 1887 d’après les notes d’Adhémard Leclère : Le gouverneur doit avoir le cœur juste, il doit suivre fidèlement la loi ancienne pour le service du roi, il doit être juste, simple dans le service et veiller à ce que les balats, les snangs, les kralapeas, les mé-sroc, les mé-prey, les oknhas, les ponhéas, les préas n’oppriment pas les habitants, afin que le service soit égal pour tous et qu’il [n’y ait ?] aucun motif de mécontentement à cause du service. Il ne doit dispenser personne des corvées par amitié, ni recevoir des cadeaux de ses administrés, ni se mettre en colère, ni se laisser égarer par le vin de riz, les femmes et le jeu. Il devra juger les différentes affaires qui viendront devant lui avec grande justice et d’après la coutume ancienne et la loi. Il ne doit menacer personne parce que ces gens sont ses amis, il ne doit pas se servir de ses fonctionnaires pour opprimer les faibles et le peuple, il ne doit pas prendre le bien pour le vol et le vol pour le bien. Il doit préférer pour le servir ceux qui sont intelligents, ceux qui sont prudents, aimants (qui aiment le service) et fidèles.212 »
À partir d’un tel inventaire des interdictions, on obtient un catalogue des attitudes qui semblent courantes dans l’exercice du gouvernement. De fait, Leclère est très concis lorsqu’il décrit les attributions du gouverneur de Kampot, l’uk ñ̎ā senā anjit en 1886-1887 : « Il avait obtenu le gouvernement de la province de Kampot, c’est-à-dire le droit de pressurer deux mille habitants213. » L’administration de la circonscription territoriale de Kampot et le rôle de son gouverneur sont décrits à travers le pouvoir exercé sur les hommes. Le gouverneur peut pressurer les populations à la fois au nom des sollicitations du chef de son saṃrāp’ – à Kampot, il s’agit du kraḷāhom – mais également en son nom propre. Car le gouverneur nomme ses subordonnés, qu’il exempte des corvées et qu’il protège afin de les attacher à son intérêt : ses adjoints directs, le pālāt’ ; le snaṅ ; le kraḷābās ; les chefs des « pays » ou des « villages » me sruk et les responsables des forêts, me brai. Représentant du roi, le gouverneur est investi d’une autorité à travers le titre qu’il porte et l’identification de ses attributions à celle du souverain, d’où l’évocation répétée de la nécessité de son impartialité puisqu’il doit agir en tant que substitut du « roi de justice » dharmarājā214. Le texte voudrait donc empêcher qu’il ne rende la justice en fonction du nombre d’épices qu’il reçoit des plaignants. Le gouverneur partage le produit de cette prédation avec les autres représentants de l’administration qui pourraient lui faire concurrence sur son territoire : les dignitaires du Palais uk ñ̎ā, bañā et braḥ, et principalement ceux venus procéder au recensement des personnes et récolter les impôts – les ājñā luoṅ – ou par exemple les représentants du ministre de la justice chargés de récolter la part du roi dans les amendes215.
La société élitaire locale est donc amenée à collaborer avec les représentants du Palais : ainsi se forment des clientèles mandarinales, c’est-à-dire un agrégat d’acteurs du pouvoir politique et administratif se reconnaissant comme des alliés sous la tutelle d’un patron – ici, à échelle de la province, la plus haute autorité locale citée – le cauhvāy – et à échelle de l’État, l’autorité palatiale de référence sous-entendue le kraḷāhom. Cette clientèle « double » les liens qui associent le chef d’apanage et ses officiers au sein du saṃrap’ : elle donne une « texture » sociale au maṇḍala idéel à travers les relations personnelles entretenues par toutes les composantes des maisons royales dans l’exercice de la souveraineté.
Le gouverneur de province ici décrit dans un document de la pratique – protégé par sa hiérarchie et chef de clientèle lui-même – semble l’archétype du mandarin prédateur tel qu’il apparaît dans les « codes de morale », les cpāp’ de l’époque moyenne. Cette littérature gnomique est fixée dans ses formes écrites aux XVIe et XVIIe siècles par des poètes de cour, moines et mantrī. Mémorisés et récités sur des rythmes codifiés, retouchés et réinventés par les copistes jusqu’au XXe siècle, ces vers sont diffusés sur ôles – manuscrits sur feuilles végétales – dans les écoles de vatt, puis sur papier – jusqu’à nos jours – dans les collèges et universités. Ces textes et la morale qu’ils dispensent décrivent ainsi justement ce qu’est l’ethos mandarinal idéel à la période moyenne et donnent un aperçu de la pratique du clientélisme dans l’administration du royaume.
Pou Saveros, qui a analysé ce corpus, décrit la pression exercée par le mandarinat sur les populations, mais également les relations de réciprocité instaurées par les liens de patronage. Décrits comme des prédateurs, notamment à travers l’image du tigre, les officiers du roi y sont caractérisés comme des individus intéressés, dont les populations – décrites comme des proies, des poissons par exemple – doivent se prémunir de la rapacité. La nature inégalitaire de leurs identités et de leurs relations est justifiée par les règles d’appartenance à la hiérarchie sociale. Mandarins, commerçants ou paysans sont ainsi tous exhortés à s’inscrire dans les chaînes hiérarchiques du groupe – gnā – et de la famille auxquels ils appartiennent et dont ils ne peuvent qu’exceptionnellement s’extraire216.
Le milieu mandarinal, ses relations à l’État central et aux maisons royales.
En 1893, Leclère devient le résident de Kaṃbaṅ’ Svāy (Kompong Svai) et décrit ainsi l’uk ñ̎ā tejo Ey apparemment, qu’avec le gouverneur de Kampot :
Le gouverneur actuel de Kompong Soai, que je vois tous les jours dans mon cabinet est le fils de cet ancien gouverneur ; il paraît avoir hérité de l’affection que les habitants avaient autrefois pour son père. C’est un homme intelligent, hardi, courageux et juste qui paraît très au courant du service et soucieux de bien remplir ses fonctions et de conserver la confiance que chacun lui marque et qu’il considère comme un héritage de famille.226 ».
Ey Thong (ID : BB) est l’un des mandarins les plus puissants du royaume puisqu’il dirige une grande et stratégique circonscription, ce qui lui vaut dix bān’ de dignité. Son père était gouverneur de cette même province avant lui : ses relations difficiles avec le Palais royal l’ont fait rappeler à la capitale après 1867 mais Norodom a conservé sa confiance à son fils. Représentant du roi, le gouverneur est investi d’une autorité à travers le titre qu’il porte – ici à forte connotation militaire dans ces territoires du Nord souvent rebelles à l’autorité du roi khmer227 – et l’identification de ses attributions judiciaires à celle du souverain228. Les deux extraits, « l’édit de nomination » étudié dans le paragraphe précédent, et le portrait d’Ey Thong, ici rapporté, insistent tous deux – chacun à leur manière – sur les relations personnelles qu’un gouverneur développe avec ses administrés. « L’héritage de famille » évoqué par Leclère rend compte de la bonne fama d’Ey Thong en ce qu’il respecte les usages et entretient les relations que son père avait noué avant lui avec ses administrés. Ey Thong incarne la fonction qu’il a héritée de son père et exploite cet héritage moral et social dans son gouvernement. De fait, ses administrés peuvent compter sur son patronage puisqu’il respecte les engagements de sa parenté. Le Palais considère également l’opportunité d’utiliser cet héritage à son propre profit : Norodom réemploie Ey Thong malgré le conflit qui l’a opposé au père. Le roi valorise la relation de réciprocité entre un officier et les populations, gage de stabilité dans les territoires, en rétablissant des relations avec cet officier après un conflit.
Cette relation entre le roi et ses « conseillers » peut s’observer dans les cpāp’ neti, les « codes de politique » ou « éthique de gouvernement », destinés aux princes et aux mandarins qui œuvrent à la « chose royale » – rājakār. Certains des cpāp’ neti sont d’ailleurs adressés aux suostī, les futurs mandarins, et décrivent la relation idéelle qui doit s’instaurer entre le roi et ses officiers229. Ces textes ne diffèrent pas de la morale commune : respect de l’aînesse et soumission au groupe en sont les grands principes. Mais à travers les cpāp’ neti, les relations de patronage sont décrites comme l’élément principal du processus d’entrée au service du roi dans le rājakār : les suostī, « apprentis-mandarins », apprennent le métier auprès d’un aîné, qu’ils soient eux-mêmes issu du mandarinat ou bien qu’ils y soient patronnés. Citons quelques extraits du satrā suostī – « traité pour les apprentis-mandarins » daté du XVIIe siècle – qui évoque à travers le discours d’un père à son fils les différentes étapes de la formation d’un apprenti mandarin. Celles-ci débutent par un apprentissage moral et intellectuel auprès d’un grū, un maître, qui transmet la sagesse – prājñā – à travers l’étude – rīen – qui permet à l’enfant de devenir un homme – manuss -, un être passé de l’état de nature – la laideur, āsrūv, ce qui n’est ni beau ni bien – à la culture : (…) Ô mon fils, retiens bien ces recommandations de ton père. Si un jour tu t’en vas à la recherche d’un être doué de sagesse, en quelque endroit que tu le rencontres, tu te courberas pour l’approcher.
Tu te prosterneras pour le saluer, tu demanderas à étudier, de toute ton âme, pour ne pas rester grossier [contraire au beau, au bien], ni gaspiller tes facultés. Apprends à bien réfléchir, ô mon fils : on dira alors que tu es bien un homme. (…)230 ».
L’État à maisons et son administration.
Le maṇḍala invoqué comme figure organisationnelle a-t-il donc jamais été autre chose qu’une structure idéalisée construite par l’idéologie royale ? Jacques Népote utilise ainsi le terme administration entre guillemets et l’assimile à une « fiction »252. Il considère alors qu’excepté une parenthèse marquante – la fameuse Cité hydraulique angkorienne – les régimes politiques cambodgiens ont plutôt pris la forme de : principautés héréditaires, plus ou moins fédérées autour d’un principe impérial tour à tour accaparé par telle ou telle lignée253 ». Les crises dynastiques de l’État royal khmer et leurs conséquences désastreuses pour l’administration du pays au XIXe siècle ne seraient donc pas conjoncturelles mais structurelles : les maisons royales, l’aristocratie, les mandarins s’affronteraient quotidiennement à échelle du Palais, des provinces et des territoires locaux, pour maintenir et développer le contrat social qui les associe d’une part à la royauté, d’autre part à leurs dépendants. La royauté considèrerait ainsi l’effectivité du pouvoir de ses partenaires sociaux en termes de maintien de l’ordre et de productivité économique : les maisons royales, les clientèles de l’aristocratie et des officiers de la cour lui permettent une gestion déconcentrée des territoires – administrativement et militairement – et un accès aux richesses à travers la collecte des impôts.
D’après les travaux de Jacques Népote, la société cambodgienne étant une société lignagère matrilinéaire, une maison peut être décrit comme l’espace social créé par les relations entre une lignée utérine considérée comme aînée et les familles de ses alliés masculins considérées comme cadettes254.
Cette maison dispose d’une clientèle : c’est-à-dire l’extension maximale d’un réseau de parenté à des groupes assimilés à des parents, par le biais de serments de fidélité ou d’adoptions255. Un réseau réunit ainsi des familles ayant une origine géographique commune qui se reconnaissent comme affiliées dans une « entité supra-familiale » hiérarchisée au sein de laquelle elles interagissent en s’apportant mutuellement de l’aide, de la force. Cet espace social est fondé sur les échanges matrimoniaux : les familles échangent des gendres et partagent ainsi services, biens, informations. Les maisons et leurs clientèles alliées sont des structures hiérarchiques valorisant la séniorité et la transmission : les hommes exercent des fonctions et disposent d’un statut au sein de ces groupes à travers leur degré d’affiliation à la parente la plus âgée et la plus respectée, la chef de la lignée aînée. Adhémard Leclère retranscrit comment la maison et la clientèle de Men (ID : 3) sont dépendants des relations sociales de sa grand-mère puis de son épouse avec la quatrième maison royale de la reine-mère : les qualités politiques de l’aïeule sont reconnues à sa cadette, digne héritière du réseau familial et actrice principale de la carrière de son époux256. Car le patronage entre les agents s’inscrit dans la hiérarchie de leurs relations. Celles- ci sont inégalitaires mais réciproques : les aînés ont préséance sur leurs cadets, qui leur doivent hommage, mais les anciens ont le devoir d’aider leurs cadets257. Les conditions par lesquelles un individu se positionne dans cet espace social – son statut, la nature de l’alliance qu’il a contractée ou dont il hérite déterminent son degré d’interaction en dedans et en dehors de celui-ci258.
Ces maisons sont territorialisées, hiérarchisées et spécialisées. Les familles aînées, leurs familles alliées, leurs familiers, dépendants et obligés – leurs clientèles -, en fonction de leurs étendues géographiques et de leurs importances démographiques, sont donc hiérarchisés entre eux à travers leur capacité à maîtriser les rapports de force – à la fois entre eux, d’un territoire à l’autre, et par rapport à la famille royale -, c’est-à-dire à mettre en œuvre un réseau social qui permette de faire un lien entre la capitale et les provinces cambodgiennes. Leur hiérarchie dépend de la performance du réseau, c’est-à-dire de sa capacité à faire profiter ses membres des interactions avec le Palais et à partager le contrôle des territoires. Cette performance s’estime en fonction des titres et dignités accordés par le Palais : honorabilité, valeurs, prestige social et moral des familles dépendent donc notamment de leur relation à l’État royal, de génération en génération. Ainsi le roi règne effectivement sur les territoires en reconnaissant aux maisons et à leurs clientèles un statut au sein du rājakār, l’administration quotidienne du royaume : les représentants des chefs des maisons sont titrés et disposent de fonctions au sein du gouvernement royal. Ils reconnaissent en retour une légitimité dynastique au souverain dont ils font respecter la loi259.
|
Table des matières
Avant-propos
Introduction
Partie I – Des maisons royales aux réseaux mandarinaux
Chapitre 1 – Le fonctionnement de l’État royal à la fin de l’époque moyenne : administration des maisons et pouvoirs des clientèles
Chapitre 2 – Démonstrations de forces à la cour du roi Norodom (1884-1904)
Chapitre 3 – Le mandarinat à l’ombre du protectorat (1897-1953)
Partie II – Les élites cambodgiennes en situation coloniale, portrait de groupe(s)
Chapitre 4 – Description du groupe social élitaire à travers la biographie de Thiounn.
Chapitre 5 – La formation des élites cambodgiennes, XIXe-XXe siècles
Chapitre 6 – Le ministre du Palais et la société élitaire au XXe siècle
Partie III – Descriptions des réseaux élitaires à partir des données de territorialisation
Chapitre 7 – Les territoires élitaires, géo-histoire des identités spatiales
Chapitre 8 – Habiter Bhnaṃ Beñ, les quartiers élitaires de la capitale
Chapitre 9 – Entrer dans la maison cambodgienne
Partie IV – Généalogies des maisons de l’élite cambodgienne (deuxième moitié du XIXedébut du XXe siècle)
Chapitre 10 – Hériter et transmettre : l’identité et la filiation par le nom
Chapitre 11 – S’allier, les mariages de l’élite cambodgienne
Chapitre 12 – Se raconter : mémoire familiale et mémoire sociale dans la société cambodgienne.
Conclusion
Épilogue
Lexique
Sources imprimées
Entretiens et correspondances
Archives
Bibliographie
Télécharger le rapport complet