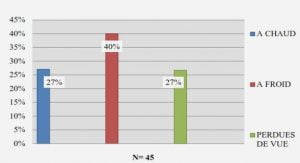Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Utilisation thérapeutique des plantes
L’utilisation des plantes médicinales, pourtant pratiquée depuis l’antiquité, est un sujet actuel qui intéresse de plus en plus les scientifiques du monde médical, mais surtout les populations de manière générale qui estiment souvent que ce qui est naturel est sans danger. Jusqu’au XVIIIème siècle, les hommes dans le monde entier, toutes origines confondues, ont utilisé essentiellement les plantes pour se soigner, comme le montrent les fresques égyptiennes et les livres iconographiques du Moyen-Age (Scimeca et Tétau, 2004). Ces plantes étaient utilisées en 1’état ou sous forme de préparations galéniques intermédiaires jusque vers la fin du XVIIIème siècle ou les pharmaciens surent en extraire les grands principes actifs tels que les alcaloïdes, les composés phénoliques, les terpenoïdes…qui sont également appelés métabolites secondaires par opposition aux métabolites primaire (glucides, lipides et acides aminés…) responsables de la survie de la plante. Le XIXème siècle voit apparaître le développement de l’industrie chimique qui a permis la synthèse des molécules (Fleurentin et al., 1990 ; Lehmann, 2013) telles que la morphine extraite de l’opium, l’émétine de l’ipéca, et en 1820 la quinine fut extraite du quinquina marquant ainsi un bond considérable dans la lutte contre la malaria (Scimeca et Tétau, 2004). Cela a permis d’aboutir plus tard, à dresser des inventaires et des répertoires dits Pharmacopées.
La Pharmacopée est un ouvrage réglementaire destiné aux professionnels de santé, qui définit les critères de pureté des matières premières ou des préparations entrant dans la fabrication des médicaments (à usage humain et vétérinaire) voire leur contenant et les méthodes d’analyses à utiliser pour en assurer leur contrôle (ANSM, 2017). Actuellement il existe trois pharmacopées reconnues comme référentiels et intégrées dans le Système d’harmonisation internationale des normes. Il s’agit de la Pharmacopée américaine, la Pharmacopée japonaise et la Pharmacopée européenne (ANSM, 2017). A cela il faut ajouter, qu’il existe une « Pharmacopée africaine » qui est définie comme étant un recueil des médicaments et autres ingrédients africains utilisés en medecine populaire traditionnelle (Fleurentin et al., 1990). Cependant, malgré l’importance et la diversité des ressources naturelles africaines, elle est insuffisamment connue, car, contrairement aux pays industrialisés, l’Afrique ne dispose pas des mêmes moyens d‘investigation pour se hisser à un niveau scientifique équivalent. En plus, dans nos pays , en général, aucune réglementation n’existe pour le contrôle de l’utilisation de ces plantes médicinales même si au niveau international l’OMS travaille depuis plusieurs années sur la reconnaissance de la médecine traditionnelle par les états membres afin qu’ils puissent considérer ces pratiques comme faisant partie intégrante du système de soin primaire (OMS, 2002 ; OMS, 2013). Récemment, l’OMS a rédigé la Stratégie de l’OMS pour la médecine traditionnelle 2014-2023 (OMS, 2013). Dans cette stratégie elle donne les outils nécessaires aux gouvernements pour mettre en place une politique intégrative de la médecine traditionnelle dans le système de santé national en renforçant la base de connaissances, l’assurance qualité, l’innocuité, l’usage approprié et l’efficacité de la médicine traditionnelle et complémentaire par la réglementation. Et elle encourage les états membres à l’adopter et à le mettre en œuvre.
Ainsi, il est nécessaire et urgent, si l’on veut atteindre les objectifs fixés par l’OMS, d’élaborer des pharmacopées conventionnelles officielles, pour fixer des normes médicopharmaceutiques et sanitaires précises, afin de proposer des médicaments d’usage courant, efficaces et surs. Le traitement par les plantes médicinales comprend la consommation de la plante entière (feuilles, racines, tronc, écorce…), des matières végétales (suc, gomme, huile,…), des préparations à base de plantes et des médicaments à base de plantes (OMS, 2000). Il y’a de cela 20 ans, on estimait que plus de 15 % des plantes à fleurs connues ont un emploi thérapeutique traditionnel (Fleurentin et al., 1990). Dans les pays développés le nouveau regain d’intérêt pour les plantes médicinales s’explique par le fait, d’une part, des scandales sanitaires causés par les médicaments dits modernes, constitués essentiellement de produits chimiques de synthèse, mais aussi du manque de remèdes satisfaisants pour certaines pathologies chroniques.
Et d’autre part, par le souci des utilisateurs d’avoir des composés « bio » qui leur semblent plus sûres. Par exemple en France, environ 45% des français ont recours à la phytothérapie et 28% lui donnent la priorité devant la médecine moderne (Adenot, 2014). Par contre dans les pays en voie de développement, les plantes médicinales ont toujours représenté une part importante dans la prise en charge de diverses maladies, plus encore aujourd’hui, ou d’après l’OMS, plus de 80% de la population y ont recours par manque de moyens (OMS, 2007).
Les propriétés thérapeutiques des plantes sont connues soit à partir :
– d’un savoir traditionnel, ancien et empirique de transmission orale
– d’études récentes par les scientifiques, de la composition des plantes et l’isolement des molécules actives qui ont permis de préciser et de prouver l’action de ces plantes
Principes actifs des plantes médicinales
Les principes actifs des plantes comprennent les métabolites secondaires qui sont des substances naturellement synthétisées par les plantes. Contrairement aux métabolites primaires classiques tels que les glucides, lipides, protéines et acides nucléiques dont le rôle est clairement défini (Hopkins, 2003), la fonction des métabolites secondaires reste encore mal connue. Leur définition fut donnée pour la première fois en 1891 par Kossel comme étant un groupe de composés qui regroupent des dizaines de milliers de molécules, retrouvées dans les tissus végétaux, dont la présence n’est pas essentielle à la croissance et au développement de la plante (Rhodes, 1994 ; Karlovsky, 2008). Cependant, à la lumière des résultats obtenus au cours des dernières décennies, il est maintenant établit, qu’ils serviraient de moyen de défense à la plante, et interviendraient dans la physiologie et dans différents aspects de la vie de la plante telle que la lignification, la couleur, la qualité nutritionnelle, l’amertume…(Macheix et al., 2005). Leurs compositions et nature seraient influencées par des facteurs abiotiques et environnementaux comme l’exposition au soleil, l’altitude, le climat, la saison, l’âge, et les microorganismes (Macheix et al., 2005 ; Zhi-lin et al., 2007). Ces composés représentent par contre une source importante de molécules aux activités physiologiques remarquables ce qui justifient leurs utilisations par l’Homme en thérapeutique.
Ces métabolites ou principes actifs, en raison de leurs activités biologiques, ont été à la base de plusieurs médicaments depuis la découverte de la morphine extraite du latex d’un végétal du genre Papaver (Bézanger-Beauquesne, 1958).
Nous pouvons citer entre autres la digoxine, la cocaïne, la quinine, l’artemisine,… qui sont des molécules qui ont été extraites de plantes.
Compte tenu de la sous exploitation des espèces des végétaux supérieurs présents sur terre, on peut supposer qu’il reste encore beaucoup à découvrir sur les principes actifs des plantes aussi bien sur le plan chimique que biologique.
Obtention des principes actifs
L’obtention des principes actifs contenus dans les drogues végétales fait intervenir différents procédés tels que l’extraction, le fractionnement, la purification, et la concentration. Pour extraire un principe actif d’une plante il est possible de recourir à plusieurs techniques notamment :
– la décoction qui consiste à faire bouillir dans de l’eau la matière végétale pendant quelques minutes, de laisser reposer puis de filtrer pour obtenir un décocté.
– L’infusion, dans ce cas, on verse de l’eau bouillante sur une quantité donnée de matière végétale puis on laisse reposer pendant quelques minutes et on filtre.
– La macération qui est une méthode d’extraction solide-liquide, qui consiste à laisser séjourner la matière végétale dans le solvant d’extraction durant un temps donné. On place la matière végétale et le liquide d’extraction (solvant organique, eau ou mélange d’un solvant organique et d’eau) dans un récipient fermé, puis laisser le tout reposer sous agitation à température ambiante pendant des heures voire des jours, puis filtrer.
– L’hydrodistillation : procédé principalement utilisé pour l’extraction des huiles essentielles. Il consiste à immerger le matériel végétal dans un alambic rempli d’eau qui est ensuite portée à ébullition. Les vapeurs sont condensés sur une surface froide et l’huile essentielle se sépare par différence de densité (Bruneton, 2009).
Après extraction on peut procéder à une concentration de l’extrait obtenu par évaporation du liquide d’extraction à une température qui ne soit pas nocive aux principes actifs. Il en résulte un extrait pâteux ou solide.
Les principe actifs sont classés en diverses familles chimiques dont les principales sont regroupées en trois grandes catégories : les alcaloïdes, les composés phénoliques (flavonoïdes, tanins, coumarines…), et les composés terpéniques (saponosides, hétérosides cardiotoniques…) (Bruneton, 2009).
Alcaloïdes
Les alcaloïdes sont un groupe hétérogène de produits azotés plus ou moins basiques, d’origine végétale, possédant une activité pharmacologique significative. Ils ont la propriété commune de réagir avec des réactifs dits généraux tels que le réactif de Bouchardât (iodure de potassium iodé), le réactif de Mayer (iodomercurate de potassium), le réactif de Dragendorff (iodobismuthate de potassium) pour donner des précipités à peu près insolubles permettant leur caractérisation (Bézanger-Beauquesne, 1958). Les vrais alcaloïdes ont leur azote inclus dans un hétérocycle et sont synthétisés à partir d’un acide aminé (Bruneton, 2009). Ces molécules peuvent être retrouvées dans toutes les parties de la plante. Cependant, en fonction de l’espèce, leur localisation peut être essentiellement les écorces, les racines, les pièces florales, les fruits ou graines même si plusieurs auteurs s’accordent sur le rôle primordial des racines dans l’élaboration des bases alcaloïdiques. Leur teneur varie aussi selon les conditions d’habitat et de culture. Leur extraction de la plante se fait habituellement selon deux schémas : par un solvant apolaire en milieu alcalin ou par un solvant polaire en milieu acide (Bézanger-Beauquesne, 1958).
Les alcaloïdes présentent une très grande diversité structurale entrainant des activités pharmacologiques diverses. On peut citer :
– les alcaloïdes pyrrolizidiniques et ceux dérivés de l’ornithine. Les alcaloïdes tropaniques sont les plus importants dérivés de l’ornithine, ils sont des parasympatholytiques à l’image de l’atropine isolée d’Atropa belladonna. L’atropine a des effets anticholinergiques avec une dilatation de la pupille, une activité antispasmodique du système digestif et une activité antisécrétrice d’où son utilisation en chirurgie. Nous avons aussi la cocaïne (Erythroxylum coca) connue pour son effet anesthésique local mais
qui s’est avérée neurotoxique. Par contre, les alcaloïdes pyrrolizidiniques à l’image de l’intermédine et de la lycopsamine isolées de la Symphytum officinale sont le plus souvent très toxiques (Bézanger-Beauquesne, 1958 ; Kinghorn et Balandrin, 1993 ; Bruneton, 2009).
– Les alcaloïdes dérivés de la lysine (pipéridiniques, quinolizidiniques et indolizidiniques) avec comme exemple la lobéline (Lobela inflata) qui est utilisée dans les préparations pour lutter contre le tabagisme.
– Les alcaloïdes dérivés de la phénylalanine et de la tyrosine dont les principales molécules de ce groupe sont : l’éphédrine (Ephedra sinica) qui présente des propriétés vasoconstrictrices et qui est utilisée dans la prise en charge de la sinusite et de la rhinite. La papavérine, la codéine et la morphine (Papaver somniferum) qui sont utilisées comme analgésiques et antitussives et la berbérine (Berberis vulgaris) comme antiinflammatoire et antiinfectieux (Kinghorn et Balandrin, 1993 ; Bruneton, 2009).
– Les alcaloïdes dérivés du tryptophane : les alcaloïdes indoliques dér ivés du tryptophane comme la réserpine, l’ajmalicine (Rauwolfia serpentina,) sont utilisées contre l’hypertension artérielle. La vinblastine et la vincristine isolées de Catharanthus roseus, sont deux molécules employées dans le traitement de la maladie de Hodgking et de la leucémie aiguë de l’enfant respectivement. Dans ce groupe nous retrouvons aussi les alcaloïdes quinoléiques avec la quinine très efficace contre Plasmodium falciparum largement employée dans le traitement du paludisme (Bruneton, 2009).
– Les alcaloïdes dérivés de l’acide anthranilique avec la fébrifugine (Dichroa fébrifuga) connue pour ses propriétés antipyrétiques (Kinghorn et Balandrin, 1993 ; Bruneton, 2009).
– Les alcaloïdes de l’acide nicotinique dont la nicotine retrouvée principalement dans les feuilles de tabac et qui serait un stimulant respiratoire d’où son utilisation comme alternatif dans le processus de sevrage tabagique.
– Les alcaloïdes dérivés de l’histidine avec la pilocarpine (Pilocarpus jaborandi) qui présente des propriétés sympathomimétiques (cholinergiques) utilisée en ophtalmologie dans le traitement du glaucome (Kinghorn et Balandrin, 1993).
Composés phénoliques
Les composés phénoliques sont un ensemble de substances caractérisées par la présence d’au moins un noyau aromatique portant un groupement hydroxyle libre ou engagé dans une fonction ester, éther ou hétéroside (Bruneton, 2009). La majorité des produits phénoliques est formée à partir de la tyrosine et de la phénylalanine qui sont deux acides aminés synthétisés par la voie de l’acide shikimique (Macheix et al., 2005 ; Bruneton, 2009). La formation du cycle aromatique peut également se faire par la voie des polyacétates, ou par la combinaison des deux voies. Les composés obtenus par les deux voies sont dits mixtes (flavonoïdes, stilbénes, pyrones…). D’autres voies de synthèse minoritaires sont également possibles : la voie du mévalonate et celles qui combinent le mévalonate et l’acide shikimique à l’origine de certaines quinones, furano et pyranocoumarines ou mévalonate et acétate donnant les composés tels que les cannabinoides (Bruneton, 2009). Les composés phénoliques sont abondants chez les plantes vasculaires et sont localisés dans les racines, les tiges, le bois, les feuilles, les fleurs et fruits. Ils sont généralement extractibles par les solvants organiques polaires (méthanol, acétone, solution hydro alcoolique…) pour extraire moins de substances lipophiles, et par l’eau pour les formes hétérosidiques. Les composés phénoliques sont instables, facilement oxydables d’où la nécessité de travailler à basse température dans une atmosphère inerte avec un pH adéquat (Bruneton, 2009). Leur utilisation en médecine s’est surtout accentuée avec la découverte de leur propriété antioxydante. On les retrouve sous forme de compléments alimentaires et dans les produits pharmaceutiques pour lutter contre le stress oxydant qui serait à l’origine de l’apparition de pathologies cardiovasculaires et dégénératives (Macheix et al., 2005). Compte tenu de la diversité structurale de cette famille de métabolites, des propriétés thérapeutiques leur sont attribuées en fonction du sous-groupe de composés (Bruneton, 2009). Les flavonoïdes retrouvés surtout dans les fruits, légumes, fleurs et feuilles et responsables de la coloration de ces derniers, auraient des activités antiallergique et antiinflammatoire en plus de leur très grande activité antioxydante (Middleton et al., 2001). On leur attribue également la propriété d’augmenter la résistance capillaire et de diminuer la perméabilité membranaire (Macheix et al., 2005).
Les tanins sont connus pour leurs propriétés à précipiter les protéines et de se lier aux macromolécules telless que les fibres et collagène et sont considérés comme antinutritionnels à cause de leur effet sur l’alimentation de certains animaux particulièrement les monogastriques (Blain, 1998 ; Macheix et al., 2005). Leur principale application en médecine concerne leurs activités anti diarrhéique et antiseptique dues à leur pouvoir astringent. On distingue les tanins hydrolysables et les tanins condensés ou tanni ns catechiques (proanthocyanidiols) qui different par leur structure chimique et leur origine biogénétique (Bruneton, 2009). Les tanins condensés sont connus pour leurs effets bénéfiques sur la digestibilité des aliments en faible quantité chez les ruminants.
Ceux du thé vert (gallate d’épicatéchine, gallate d’épigallocatéchine et l’épicatéchine) sont réputés être de puissants extracteurs des radicaux libres.
Cependant, la prise en grandes quantités des tanins condensés, serait nuisible à certaines espèces animales en réduisant l’apport d’aliments volontaire et la digestibilité des nutriments (Blain et al., 1998). Ces effets s’observent selon l’espèce animale concernée et la structure chimique des tanins. Ils se traduisent par une perte d’appétit, une réduction de la masse corporelle , des perturbations des muqueuses, une insuffisance hépatique et rénale ainsi que par des ulcérations au niveau du tube digestif (Blain et al., 1998 ; Frutos et al., 2004).
On attribue aussi aux composés phénoliques des propriétés antiinflammatoires avec les dérivés salicyliques des Saules (Salix puperea) et autres espèces de Salicacea, des propriétés laxatives avec les hétérosides qu’on retrouve dans les feuilles de Cassia senna par exemple, d’où son utilisation en infusion contre les constipations.
Les coumarines, ont peu d’indications en médecine. Leur pouvoir photo sensibilisant, particulièrement les furanocoumarines justifie leur utilisation dans le traitement du psoriasis, du vitiligo et autres dermatoses. Elles auraient également des propriétés vasculoprotectrices, neurosédatives, diurétiques, stomachiques , carminatives et antioxydantes (Bruneton, 2009).
Terpenoïdes et stéroïdes
Les terpènes sont des composés généralement lipophiles obtenus par deux voies, celle de l’acétyl CoA ou celle du malonyl CoA. En fonction du nombre d’unités isopréniques, on définit différentes classes de terpènes : monoterpénes (huiles essentielles), sesquiterpènes, diterpènes, triterpénes (Saponosides, hétérosides cardiotoniques) et tétraterpènes (Hopkins, 2003 ; B runeton, 2009). Les monoterpénes et sesquiterpènes sont retrouvés dans les huiles essentielles et sont à l’origine de l’odeur de certains végétaux d’où leur utilisation en alimentation et en cosmétiques (Hopkins, 2003). Ils auraient des propriétés sédatives antiseptiques, antifongiques et antiinflammatoires, par contre certaines peuvent être irritantes comme l’huile essentielle d’eucalyptus. Des effets allergiques sont observés avec les sesquiterpènes qui par ailleurs sont douées d’activités antimicrobiennes et antifongiques avec l’exemple de l’artémisinine isolée de l’Artemisia annua, une Asteraceae, très active sur le plasmodium (de Vries et Dien, 1996 ; Bruneton, 2009).
Les diterpènes isolées de Taxus baccata L., Taxaceae, se sont montrées particulièrement intéressantes en oncologie avec les spécialités telles que le Taxol et le Docétaxel utilisées dans la prise en charge du cancer des ovaires, des poumons et des seins. Cependant ces molécules, surtout celles isolées d’Euphorbiaceae et de Thymelaceae, peuvent se montrer toxiques en induisant des troubles digestifs violents ou des irritations cutanées ou oculaires graves (Kinghorn et Balandrin, 1993).
Les triterpénes et stéroïdes ont un intérêt thérapeutique important notamment les hétérosides cardiotoniques retrouvés dans la famille des Asclepiadaceae et celle des Apocynaceae avec la digitoxine, la digoxine et dérivés isolés de Digitalis purpurea et Digitalis lanata (Kinghorn et Balandrin, 1993). Les saponosides sont des triterpénes caractérisées par leurs effets tensio-actifs leur conférant la propriété de former des solutions moussantes lorsqu’ils sont dissous dans l’eau. Ils auraient des propriétés antitussives, anti-œdémateuses et analgésiques mais seraient aussi à l’origine de la toxicité de certaines plantes.
Les tétraterpènes ou caroténoïdes présentent un pouvoir antioxydant avec le bêta carotène qui après coupure et réduction donne la vitamine A (Bruneton, 2009).
Toxicité des plantes médicinales
Les plantes médicinales, en plus des champignons et algues, constituent le plus grand réservoir de matières premières médicamenteuses potentielles du monde au moment où le screening des médicaments chimiques ne produirait qu’une molécule médicamenteuse sur 20.000 molécules testées. Il est estimé entre 40 et 70% la part des médicaments qui proviendraient des substances naturelles (Fleurentin et al., 1990 ; Adenot, 2014). Toutefois, ces plantes ne sont pas dépourvues de toxicité, car parfois, il se pose un problème d’innocuité de ses substances qui peut être intrinsèque à la molécule ou liée soit à la posologie, soit à des contaminations extérieures. Le plus souvent la méthode d’utilisation n’est pas appropriée surtout dans les pays en voie de développement, d’autant plus que les utilisateurs croient que la phytothérapie est sans danger car « naturelle » alors qu’une mauvaise posologie peut être source d’effets indésirables. Les traditions thérapeutiques transmises jusqu’alors oralement par les guérisseurs, principaux détenteurs du savoir thérapeutique des plantes, disparaissent progressivement ce qui est également source de mésusage. Ce dernier étant la conséquence d’une automédication qui entraîne souvent une surconsommation, des prises prolongées, parfois non compatibles avec l’état physiologique (âges extrêmes de la vie, grossesse, allaitement) ou pathologique (insuffisances hépatique, rénale et cardiaque, diabète, immunodépression…) des patients (Lehmann, 2013). Une plante médicinale, utilisée même dans les conditions normales, est susceptible d’être à l’origine d’effets secondaires souvent indésirables (Scimeca et Tétau, 2004). Parfois, ce sont certaines substances non végétales, qui auraient contaminé la plante ou les produits à base de plantes, qui présentent un risque pour la santé. Ces effets indésirables, peuvent aller de simples réactions allergiques ou réactions cutanées de type photosensibilisation, aux atteintes de différents organes tels que le tractus gastro-intestinal, le foie, les reins, le cœur, le système nerveux central, etc.
Il a été montré que l’utilisation des plantes médicinales était la deuxième cause de trouble du foie dans les pays occidentaux, et de 2004 à 2013, on a observé aux États-Unis, une augmentation du pourcentage de ces troubles hépatiques causés par les produits à base de plantes qui est passé de 7% à 20% (Jalbert, 2018).
En 2003, la France avait interdit « l’importation, la préparation, la prescription et la délivrance de préparations…contenant de l’Ephédra » (Afssaps, 2003). L’Ephédra est une plante de la famille des Ephédracées, utilisée en médecine traditionnelle chinoise, et de nombreux incidents de type accidents cardiovasculaires cérébraux, des troubles psychiatriques allant jusqu’à la mort sont survenus à la suite de la consommation de compléments alimentaires à base d’Ephédra (Federal Institute for Risk Assessment, 2010).
Au Brésil, une revue de la littérature concernant des cas d’effet indésirables sur le rein, causés par les plantes médicinales, a révélé plus de huit plantes dont 50% causeraient une insuffisance rénale aigue (Figueredo et al., 2018).
Plusieurs plantes sont incriminées dans des cas d’hépatotoxicité. C’est le cas de certains alcaloïdes de la pyrrolizidine, de certaines plantes de la phytothérapie asiatiques et des plantes contenant de l’essence de pennyroyal (Larrey, 2005).
Au vu de ce qui est cité, il est clair que les plantes médicinales peuvent être toxiques et causer des dommages à l’organisme, voire la mort. Compte tenu de la fausse conception que l’on a de la médecine traditionnelle concernant sa sécurité comparée à la médicine moderne, par conséquent du nombre faible d’études effectué à ce niveau, il est important que des investigations soient effectuées. Les résultats de ces investigations permettront de mettre en œuvre les connaissances scientifiques qui aideront progressivement à démystifier le fait de considérer les produits naturels comme des composés inoffensifs.
|
Table des matières
INTRODUCTION GENERALE
PARTIE I : SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE
CHAPITRE I : PLANTES MEDICINALES
1. DEFINITIONS
2. UTILISATION THERAPEUTIQUE DES PLANTES
3. PRINCIPES ACTIFS DES PLANTES MEDICINALES
3.1 Obtention des principes actifs
3.2 Alcaloïdes
3.3 Composés phénoliques
3.4 Terpenoïdes et stéroïdes
4. TOXICITE DES PLANTES MEDICINALES
CHAPITRE II: DESCRIPTION BOTANIQUE ET INTERET THERAPEUTIQUE DES PLANTES ETUDIEES
1. CASSIA SIEBERIANA
1.1. Classification et noms vernaculaires
1.1.1. Classification
1.1.2. Noms vernaculaires
1.2. Morphologie et distribution géographique de C. sieberiana
1.3. Chimie
1.4. Utilisation traditionnelle
1.5. Pharmacologie
1.6. Toxicité
2. MAYTENUS SENEGALENSIS
2.1. Classification et noms vernaculaires
2.1.1. Classification
2.1.2. Noms vernaculaires
2.2. Morphologie et distribution géographique de M. senegalensis
2.3. Chimie
2.4. Utilisation traditionnelle
2.5. Pharmacologie
2.6. Toxicité
3. LEPTADENIA HASTATA
3.1. Classification et noms vernaculaires
3.1.1 Classification
3.1.2 Noms vernaculaires
3.2. Morphologie et distribution géographique de L. hastata
3.3. Chimie
3.4. Utilisation traditionnelle
3.5. Pharmacologie
3.6. Toxicité
1. TOXICITE IN VIVO
1.1. Toxicité aiguë
1.2. Toxicité à long terme
2. TOXICITE IN VITRO
2.1. Culture cellulaire
2.2. Tests de viabilité cellulaire / cytotoxicité
2.2.1. Aspect morphologique au microscope
2.2.2. Test au MTT
2.2.3. Test au Rouge Neutre (RN)
2.2.4. Détermination de l’activité de la LDH
2.3. Analyse du mécanisme de mort cellulaire par apoptose
PARTIE II : TRAVAIL EXPERIMENTAL
CHAPITRE I : METHODOLOGIE
1. OBTENTION DE L’EXTRAIT VEGETAL
1.1. Matériel végétal
1.2. Extraction
2. EVALUATION DE LA TOXICITE
2.1. Evaluation in vivo de la toxicité
2.1.1. Rats
2.1.2. Préparation de la prise d’essai
2.1.3. Evaluation de la toxicité aigüe : détermination de la DL50 par voie orale
2.1.4. Evaluation de la toxicité subaiguë
2.1.4.1.Dosage des paramètres biochimiques
2.1.4.2.Dosage des paramètres hématologiques
2.1.4.3.Examen macroscopique et histopathologique des organes prélevés
2.2. Evaluation in vitro de la toxicité
2.2.1. Cellules
2.2.2. Culture et entretien des lignées cellulaires
2.2.3. Evaluation de la viabilité cellulaire / cytotoxicité
2.2.3.1.Test au MTT
2.2.3.2.Test au RN
2.2.3.3.Détermination de l’activité de la LDH
2.2.4. Etude de la fragmentation d’ADN sur gel d’agarose
2.2.4.1.Extraction de l’ADN
2.2.4.2.Electrophorèse sur gel d’agarose
3. ANALYSE STATISTIQUE
CHAPITRE II : RESULTATS
1. CASSIA SIEBERIANA
1.1. Toxicité in vivo
1.1.1. Toxicité aiguë : DL50
1.1.2.1.Masse corporelle
1.1.2.2.Paramètres biochimiques
1.1.2.3.Paramètres hématologiques
1.1.2.4.Histopathologie
1.2. Toxicité in vitro
2. MAYTENUS SENEGALENSIS
2.1. Toxicité in vivo
2.1.1. Toxicité aiguë
2.1.2. Toxicité subaiguë
2.2. Toxicité in vitro
2.2.1. Viabilité cellulaire / cytotoxicité
2.2.2. Fragmentation de l’ADN
3 . LEPTADENIA HASTATA
3.1. Toxicité in vivo
3.1.1. Toxicité aiguë
3.1.2. Toxicité subaiguë
3.1.2.1 Evolution de la masse corporelle
3.1.2.2 Paramètres biochimiques
3.1.2.3 Paramètres hématologiques
3.1.2.4 Histopathologie
3.2. Toxicité in vitro
3.2.1. Viabilité cellulaire/cytotoxicité
3.2.2. Fragmentation de l’ADN
CHAPITRE III : DISCUSSION
1. TOXICITE IN VIVO
1.1. Cassia sieberiana
1.1.1. Toxicité aiguë
1.1.2. Toxicité subaiguë
1.1.2.1 Evolution de la masse corporelle
1.1.2.2 Atteintes fonctionnelles et anatomopathologiques du foie et des reins
1.2. Maytenus senegalensis
1.2.1. Toxicité aigue
1.2.2. Toxicité subaiguë
1.2.2.1.Evolution de la masse corporelle
1.2.2.2.Atteintes fonctionnelles et anatomopathologiques : foie, reins
1.3. Leptadenia hastata
1.3.1. Toxicité aiguë
1.3.2. Toxicité subaiguë
1.3.2.1.Evolution de la masse corporelle
1.3.2.2.Atteintes fonctionnelles et anatomopathologiques : foie, reins et estomac
2. TOXICITE IN VITRO
2.2. Maytenus senegalensis
2.3. Leptadenia hastata
CONCLUSION ET PERSPECTIVES
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ANNEXES
Télécharger le rapport complet