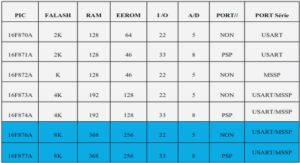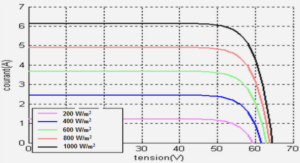Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Différentes applications pédagogiques de l’apprentissage par l’action (ou la co-action) sociale
L’apprentissage par l’action n’est pas l’apanage d’un courant théorique spécifique et fait partie d’une longue tradition allant d’Aristote à Rousseau ou Dewey dont la doctrine célèbre hands-on learning, a influencé de nombreux psychologues et pédagogues du 20ème siècle. La pédagogie du projet y trouve précisément ses racines.
La pédagogie du projet
Le projet, qui signifie étymologiquement « se jeter en avant », invite à une projection dans le futur. Une projection consiste en une anticipation des conduites, en une imagination des différentes étapes en vue de la réalisation. La pédagogie du projet est plus qu’une description opératoire d’une intention, il s’agit davantage d’une méthodologie basée sur le projet, ou d’un projet-méthode pour reprendre le terme de Boutinet (1990). L’accent est mis sur le processus du projet plus que sur le produit réalisé, sur le processus de réalisation des actions plus que sur leur finalité.
Quant aux projets eux-mêmes, Boutinet (1990) en recense trois types : le projet éducatif, le projet pédagogique et le projet d’établissement. Nous nous arrêtons sur les deux premiers qui nous intéressent directement. Selon Boutinet (1992), le projet éducatif vise l’insertion sociale, culturelle, professionnelle des participants ainsi que leur autonomie. Le projet éducatif peut dépasser le cadre de l’institution scolaire pour s’ancrer dans un contexte plus large. Le projet pédagogique se limite, lui, au contexte scolaire et donc aux acteurs apprenants et enseignants. Cette distinction sur la restriction des acteurs impliqués entre projet pédagogique et projet éducatif est toutefois arbitraire. Il est, en effet, possible d’envisager un projet pédagogique impliquant des acteurs hors du contexte scolaire et cela d’autant plus facilement que les technologies de l’information et de la communication (TIC) élargissent les possibilités de communication à distance ; il s’ensuit des possibilités d’implication de partenaires plus diversifiés, une ouverture des projets plus facilement envisageable.
Un projet peut être plus ou moins long (une semaine, un trimestre, une année) ; il peut également concerner une ou plusieurs disciplines. Les objectifs peuvent viser l’acquisition de connaissances ou de savoir-faire ou encore être envisagé comme projet extra-pédagogique sans objectif tout à fait précis. Enfin, le nombre d’acteurs peut varier et impliquer aussi bien les apprenants et les enseignants que la direction.
La pédagogie du projet se caractérise de la façon suivante : (Legrand, 1983 ; Krajcik & Blumenfeld, 2006) :
– un sujet d’étude motivant pour l’élève, démarrant par une question intéressante, un problème à résoudre ;
– un travail en équipes des élèves, assistés par l’enseignant, dans un environnement authentique ;
– une autonomie guidée des élèves dans la détermination du sujet, de la démarche et de la réalisation ;
– une démarche anticipée, en partie planifiée par l’enseignant ;
– une production concrète attendue, valorisée socialement, accessible au public.
« L’environnement authentique » implique un élargissement du contexte social de la classe à des contextes hors classe. Selon nous, cela implique d’établir des relations entre le contexte de la classe avec des contextes hors classe et non d’exclure le contexte « classe ». En effet, il n’est pas pertinent selon nous d’opposer le contexte de la classe aux autres contextes et encore moins de qualifier le contexte de la classe d’ « artificiel ».
La dimension sociale de la pédagogie du projet, très souvent soulignée, ne va pourtant pas de soi. En effet, un projet peut être à ce point morcelé entre les participants qu’il ne génère qu’une faible activité sociale. D’autre part, la thématique du projet et les disciplines convoquées influent sur la dimension plus ou moins sociale du projet. Dans le domaine de l’apprentissage des langues, la dimension sociale semble toutefois incontournable. Enfin, la production concrète du projet suppose une utilité sociale qui n’est pas simulée, ce qui la différencie de la simulation globale que nous abordons plus loin.
Bien que la pédagogie du projet soit reconnue utile en terme d’apprentissage, notamment pour la décontextualisation des savoirs, du fait entre autres que les connaissances de l’apprenant sont engagées dans l’action, les dérives sont nombreuses. Nous ne citerons que les plus connues que sont l’excès de centration sur les buts qui peut détourner du processus d’apprentissage, les dérives procédurales qui conduisent à planifier à l’excès et à ne laisser aucune place pour l’imprévu et peu d’initiatives aux apprenants ou tout au contraire, un projet déstructuré où il est malaisé pour les apprenants de discerner les enjeux.
Enfin, une critique faite à l’apprentissage par projet ou plus globalement à l’apprentissage par l’action, par Skinner entre autres, est qu’ « il ne suffit nullement de faire quelque chose pour apprendre quelque chose, il est faux […] que nous apprenions à jouer de la harpe en jouant de la harpe » (Skinner, 1968 : 11 cité par Rézeau, 2001 : 32). Le mobile de la critique, « l’action », n’est pas le bon selon nous. La critique porte sur l’articulation insatisfaisante de ce que les apprenants connaissent déjà et ce qu’ils ne connaissent pas encore, une mauvaise évaluation de la zone de proche développement des apprenants en quelque sorte. D’autre part, le mobile de l’action ne se réduit au « faire », il concerne aussi le « apprendre à faire ».
La simulation
Il est d’usage de distinguer la simulation de la simulation globale. La simulation tente de reproduire avec la plus grande authenticité des situations de communication auxquelles se prépare l’apprenant (Cuq, 2003). Quand la simulation devient globale, une communauté d’apprenants est amenée à créer un univers de référence appelé lieu-thème (un immeuble, une île, un établissement, etc.), à peupler ce monde. On invite les apprenants à se construire une identité fictive, à provoquer des événements et à faire interagir les personnages. De nombreux cadres ont été expérimentés et ont fait l’objet de publication qui ont servi de guide pour d’autres expérimentations (Debyser & Yaiche, 1986 ; Yaiche, 1996). La simulation globale reste toutefois un domaine peu théorisé. Couramment utilisée pour l’enseignement apprentissage des langues, l’enseignement de l’oral y a été nettement privilégié par rapport à l’écrit en raison de l’influence des méthodes communicatives qui l’ont largement exploitée. Mais l’utilisation des TIC pour la simulation globale change aujourd’hui l’ordre d’importance, avec une prédominance de l’écrit en raison des modes de communication qui restent assez majoritairement écrits (courriel, forum, clavardage). Bien que longtemps circonscrite à l’enseignement des langues, la simulation globale s’ouvre à d’autres disciplines, à l’histoire notamment, avec le projet mené au Luxembourg par Béliard et Gravé Rousseau (2008) : il s’agit d’une simulation globale historique sur le thème de la Grèce antique destinée à faire progresser les élèves d’une section bilingue en histoire, de développer la curiosité de l’apprenant en l’invitant à se poser des questions sur tous les aspects de la vie antique, des plus basiques (que vais-je manger ?) aux plus complexes (comment éviter la guerre ?) ; la simulation amène également les enfants à découvrir les limites de la connaissance historique, la nécessité d’imaginer et de pratiquer des reconstitutions qui se basent sur du plausible, non sur des certitudes. Ils s’approprient alors une autre valeur fondamentale de l’historien, le doute historique. La simulation globale, dans cette expérience, permet une approche moins événementielle de l’histoire et permet de reconstituer un univers plus complexe et global, plus proche de la réalité historique. L’effet « simulation » semble bien être un levier utile pour amener les apprenants à comprendre des réalités complexes et à modifier leurs représentations.
En effet, les potentialités d’apprentissage de la simulation, étudiées par les sciences cognitives et rapportées par Guichon (2006) montrent que la représentation d’un objet semble avoir la même charge cognitive que l’objet lui-même. La théorie de la simulation de l’objet étendu à l’action montre que les représentations d’action acquièrent ainsi les caractéristiques de véritables actions [… et constituent] de véritables préfigurations de l’action, qui permettront à celle-ci de se dérouler harmonieusement lorsqu’elle viendra à exécution (Jeannerod, 2002 : 155 cité par Guichon, 2006 : 60).
En formation, comme nous agissons en priorité sur les représentations, la simulation – ou représentation d’action – nous semble tout à fait pertinente. Nous reviendrons sur la notion de « simulation » quand nous aborderons le cadre narratif du scénario pédagogique.
Avant de clore cette partie consacrée à l’apprentissage dans un cadre socioconstructiviste, nous proposons une synthèse de ce que nous retenons prioritairement pour notre recherche.
Les conditions d’un apprentissage efficace
De corte (1996, cité par Legros, de Pembroke & Talbi, 2002) propose une synthèse des caractéristiques majeures d’un apprentissage efficace dans le paradigme socioconstructiviste, appelé également constructionnisme.
L’apprentissage efficace est constructiviste, cumulatif, autorégulé, intentionnel, situé et collaboratif (de Corte, 1996 : 99 cité par Legros, de Pembroke & Talbi, 2002 : 36).
En effet, selon notre perspective, l’apprenant est un agent actif qui, avec ses partenaires et les outils cognitifs dont il dispose, co-construit activement les connaissances et compétences nécessaires pour la réalisation d’une action. Les connaissances nouvelles s’appuient sur des connaissances « déjà-là » qui sont à la fois des appuis mais peuvent aussi résister aux changements. La médiation sociale et éducative (routines interactives, situations d’étayage et de désétayage, interactions entre pairs ou experts) peuvent déclencher l’apprentissage si elles conduisent à une réorganisation, par l’apprenant, des représentations antérieures intégrant les nouvelles connaissances. Cette réorganisation est d’autant plus aisée que le sujet est conscient, qu’il est capable d’accéder à sa propre pensée et capable d’agir sur elle, plus largement, qu’il est capable de pensées réflexives. Par pensée réflexive, nous entendons la capacité à exercer une pensée critique, créative et métacognitive (Pallascio, Daniel & Lafortune, 2004).
L’apprentissage efficace est situé car les situations d’apprentissage que nous proposons aux apprenants sont pour eux signifiantes. Elles établissent une relation entre le contexte scolaire et le contexte non scolaire et en cela, le projet ou la simulation peuvent être des applications pédagogiques adaptées. Les activités d’apprentissages sont, elles aussi, pertinentes et leur mobile peut très bien concerner l’acte même d’apprendre, un mobile cognitif, aussi bien que social ou lié au bien-être.
Enfin, l’apprentissage est collaboratif : il se produit par l’interaction du sujet apprenant avec les personnes, l’environnement, les évènements d’apprentissage, les situations, les outils et les machines. L’activité de langage, essentielle pour la communication entre les sujets, les situations, etc., suggère de recourir à une théorie linguistique capable d’étudier, de façon dynamique, l’activité des sujets dans la langue. Parler en termes « d’activités de langage », c’est se décaler au regard des problématiques qui ne traitent pas du processus de production des discours et des interactions mais des seuls produits. Et dans cette perspective, l’activité de langage se déploie sur un double plan : elle constitue une activité endogène, un processus spécifique nommé « énonciation » et dans le même temps elle contribue, par sa capacité de médiation symbolique, à la réalisation de l’activité en général. Nous expliquons alors notre choix énonciativiste.
Les linguistiques énonciatives
Les théories de l’énonciation étudient de quelle manière l’acte d’énonciation permet de référer, comment l’individuel s’inscrit dans les structures de la langue. C’est pourquoi la linguistique de l’énonciation place au premier plan la relation du sujet à son énoncé et ancre le texte dans la situation d’énonciation partagée par l’énonciateur et le co-énonciateur.
Roman Jakobson peut passer pour le grand ancêtre commun des théories énonciatives et du structuralisme qui sont nés à la même période. C’est à lui, en effet, que le terme énonciatif de « shifters » (ou embrayeurs en français) fut emprunté. Ce terme fut lui-même emprunté par Jakobson au linguiste danois Jespersen.
Deux grands courants se disputent « le champ énonciatif », le courant énonciatif au sens strict et le courant pragmatique : ces deux courants présentent des recoupements mais s’enracinent dans des terreaux historiques différents et poursuivent des objectifs également différents. Nous nous positionnons dans le premier courant, dans le courant énonciatif, courant qui recherche dans le système de la langue, les traces de ses conditions d’utilisation (embrayeurs, modalités par exemple) tandis que le courant pragmatique, lui, cherche plutôt à retrouver dans le langage en acte des traces linguistiques de mécanismes langagiers généraux comme l’argumentation, la conversation.
Bien que dans la théorie de l’énonciation, une langue ne soit plus un catalogue de mots et de règles de combinaisons, mais un ensemble d’unités qui permettent d’effectuer des opérations sur des notions, Benveniste, créateur du terme « énonciation », se positionne en héritier du structuralisme et en successeur. Benveniste, « en définissant de façon explicite la linguistique comme la science du langage et des langues a contribué à l’avènement de la linguistique théorique telle qu’elle existe » (Culioli, 1999b : 116) et a annoncé les développements formels de la linguistique. Benveniste a eu également un rôle important dans la transformation de la linguistique qui de classificatoire, va devenir théorie des procès et des actes à l’oeuvre dans l’activité de langage.
Ces amorces de développements formels seront théorisées, formalisées et développées par Antoine Culioli, fondateur de la Théorie des Opérations Énonciatives (TOE) et c’est dans ce courant énonciativiste, plus précisément, que nous allons ancrer notre travail pour plusieurs raisons. D’une part, parce que la TOE est une théorie de l’objet et une théorie de l’observation dotée d’un métalangage précis, d’autre part parce que les approches de la Pratique Raisonnée de la Langue (PRL), appelées aussi grammaire de l’énonciation ou encore approche conceptualisante de la construction de la langue, qui s’appuient sur la TOE, nous semblent prometteuses pour la didactique du français langue étrangère.
La linguistique énonciative culiolienne
Selon Culioli on ne peut pas simplifier l’activité de langage en ramenant le langage à un outil et la question de savoir comment articuler langage et langues (ou autrement dit, quel est l’objet de la linguistique) est centrale pour lui. Une autre question essentielle a été de savoir comment traiter de la relation entre la matérialité du texte et l’immatérialité de l’activité signifiante des sujets (Culioli, 1999b : 7). Culioli a donc tenté d’articuler le divers, l’intersubjectif et l’hétérogène à travers une métalangue cohérente, explicite et objective (Culioli, 1999b : 8).
Pour Culioli, la théorie des opérations énonciatives se définit comme une linguistique dont l’objet est l’étude de l’activité de langage à travers la diversité des langues, des textes et des situations. Le but de cette linguistique est l’étude du langage et plus précisément « de l’activité symbolique, d’ordre cognitif et affectif, de langage appréhendée à travers la diversité des langues, des textes et des situations » (Ducard, 2006 : 13). Il y a toujours une relation dialectique entre le langage (une double activité signifiante de production et de reconnaissance, c’est-à-dire la faculté universelle de produire et d’interpréter des textes) et les langues (systèmes ayant leurs lois propres d’organisation).
L’hypothèse fondatrice de sa recherche est que l’activité énonciative est une activité de production et de reconnaissance interprétative de formes abstraites. Cette double activité de production et de reconnaissance met en place les deux fonctions d’émetteur et de récepteur. Elle est compliquée par le fait que tout émetteur est simultanément son propre récepteur, c’est la raison pour laquelle Culioli les désigne comme « co-énonciateurs ». Au pluriel, ce terme désigne donc l’ensemble des deux partenaires (S0) et (S1) et sans co-énonciateurs, il n’y a pas d’énonciation. De ce fait, le dialogue est le fondement de la communication.
Les deux énonciateurs, ainsi que la situation d’énonciation (dont ils font partie) non seulement impriment leur marque dans les énoncés (en laissant des traces comme les indices de personnes, les modalités, les temps et les aspects…), mais doivent être intégrés comme concepts théoriques. L’énonciation se définit alors comme une suite d’opérations de détermination progressives par lesquelles sont produits (ou reconnus) des énoncés. Plus précisément, les énoncés potentiels prennent des valeurs référentielles à travers des systèmes de repérages par rapport aux points d’ancrage que constitue la situation d’énonciation (les sujets énonciateurs, le moment d’énonciation…) (Fuchs & LeGoffic, 1992 : 144).
En d’autres termes, chaque énoncé est le produit d’un événement unique, son énonciation, rapporté à une situation d’énonciation dont les paramètres sont les personnes, le temps et le lieu de la communication. Schématiquement, c’est la formule « Moi – ici – maintenant » qui sert de repère à l’énoncé. Dans ce système, l’énonciateur fait partie intégrante du système de repérage – qui est au centre de la théorie – et l’énonciateur constitue le repère d’origine absolu. L’énonciateur incarne la position énonciative à partir de laquelle une représentation linguistique est envisagée. Il joue un rôle fondamental dans la construction des valeurs référentielles et en tant que support des opérations de modalisation. On voit bien alors que cette théorie s’oppose à une conception instrumentale de la langue, tel un code neutre qui serait extérieur à l’humain qui l’instrumenterait et auquel les énonciateurs feraient appel pour encoder et décoder des messages.
Le langage n’est pas un instrument
« L’activité langagière est signifiante : c’est parce qu’il y a, dans la communication, des opérations aux deux bouts que les énoncés prennent un sens ». Mais on ne peut affirmer que les mots ont un sens sans être ramené à une conception outillère du langage (conçu comme un instrument). Or on peut montrer que le langage n’est pas extérieur au sujet mais est dans une relation complexe d’extériorité-intériorité (Culioli, 1999a : 19).
Dans une conception instrumentale du langage, la modulation du discours (rhétorique, style) risquerait de devenir « les vêtements qui habillent la pensée, un luxe surajouté à l’automate syntaxique » (Culioli, 1999b : 20) alors que la modulation est inhérente au système même. En effet, la théorie de Culioli va à l’encontre d’une appréhension instrumentale du langage qui code ou incarne un sens ou une pensée qui existerait indépendamment :
le langage constitue au contraire une forme de pensée spécifique (ce qui ne signifie nullement que toute pensée se réduise au langage !) et cette spécificité n’est atteignable que par l’analyse des opérations dont elle est constitutive (Paillard & Franckel, 1998 : 58).
En cela, la théorie culiolienne rejoint la conception vygotskyenne de la pensée et du langage du fait que le psychologue russe s’est efforcé de mettre au jour le lien interne et dynamique entre ces deux pôles, écartant une attitude intellectualiste pour qui il existerait des activités de pensée qui n’auraient pas besoin de s’incarner dans des formes langagières et écartant une attitude empiriste pour qui la pensée est un phénomène verbal et donc qu’il ne saurait y avoir une pensée en dehors du langage (Brossard, 2004).
Cette vision de la langue et du langage exclut donc pour notre recherche toute connotation utilitariste et cela écarte toute conception instrumentale où la langue est perçue comme un outil qui permettrait d’exécuter des actions. En effet, même dans les discours dits « scientifiques » réputés posséder un fort degré de neutralité et d’objectivité, les discours portent des traces de la présence de l’énonciateur et la subjectivité est bel et bien présente. Et quand bien même certains discours scientifiques comporteraient des traces d’énonciation peu visibles, cet effacement énonciatif est volontaire et traduit une intention énonciative.
Un sujet énonciateur en puissance
Les théories énonciatives se donnent comme objet non pas les systèmes linguistiques mais l’activité de langage. Avec une théorie linguistique qui envisage le fonctionnement de la langue du point de vue de l’activité du locuteur, ce qui est déterminant, ce sont les caractéristiques de l’activité cognitive qui la sous-tend. Cette intrication entre langage et cognition du modèle culiolien est susceptible de donner une épaisseur au concept de communication. En effet, communiquer est un acte complexe qui implique de construire et reconstruire du sens. Pour Culioli, l’interlocuteur n’est pas simplement un locuteur en miroir.
Culioli explique.
Tout énoncé suppose un acte dissymétrique d’énonciation, production et reconnaissance interprétative. Ramener l’énonciation à la seule production et l’énonciateur au locuteur, c’est, en fin de compte, ne pas comprendre que l’énoncé n’a pas de sens sans une double intention de signification chez les énonciateurs respectifs. Ces derniers sont à la fois émetteur et récepteur, non point seulement en succession, mais au moment même de l’énonciation. En bref, la communication à valeur référentielle strictement externe et explicite n’est qu’un cas limite (Culioli, 1999a : 47).
Il poursuit.
Il y a toujours, au sens le plus fort, construction interprétative des phénomènes de surface par les énonciateurs ; il y a toujours prolifération du langage sur lui-même ; nous avons toujours un jeu de formes et de significations. La communication se fonde sur cet ajustement plus ou moins réussi, plus ou moins souhaité, des systèmes de repérage des deux énonciateurs. Chaque opération est complexe […], se combine avec d’autres opérations et filtre relations et valeurs dans une suite de signes. Ainsi, on comprend mieux pourquoi un texte n’a de sens, en dehors de l’activité signifiante des énonciateurs, et pourquoi l’ambiguïté (et le malentendu) sont non seulement explicables mais partie intégrante du modèle, de même que les déplacements métaphoriques (Culioli, 1999a : 48).
La signification d’un énoncé provient donc de l’accommodation inter-sujective. Communiquer, c’est ajuster en permanence des formes que l’on reconnaît et des potentialités sémantiques de ces formes. Il nous semble que cette vision de la communication doit donner une épaisseur au sujet apprenant qui prend alors en charge à la fois le rôle de sujet parlant et celui de sujet structurant dans son activité langagière.
Mais pour aider l’étudiant à être un sujet énonciateur en puissance en LE, il lui faut des formes linguistiques pour communiquer. Comme le rappellent Demaizière et Berthoud (2005), à un moment ou un autre de toute démarche, il convient que l’apprenant repère et maîtrise des formes de la langue, les formes linguistiques. Et afin d’éviter le cloisonnement entre d’un côté le linguistique et de l’autre les fonctions sociales du langage comme cela a pu être le cas dans l’approche communicative et l’est encore avec le concept d’acte de langage devenu acte de parole (Springer, 1996), nous pensons, comme Berthoud et Demaizière (2005) qu’il peut être utile de recourir à une approche métalinguistique pour offrir aux étudiants des repères explicatifs, en les aidant à construire le système de la langue étrangère. L’orientation énonciative permet d’offrir des repères, de faire repérer des formes qui sont porteuses de traces et d’indices et d’amener l’étudiant à prendre en charge ses énoncés dans l’interaction.
En effet, la capacité à produire et à interpréter ou construire et reconstruire des formes linguistiques démontre une véritable appropriation de la langue. Cette appropriation consiste pour l’apprenant à avoir la liberté de faire des choix entre telle ou telle forme linguistique et de savoir pourquoi il en fait le choix. Or dans de nombreuses méthodes de FLE actuelles, la prise en charge énonciative de l’apprenant est limitée avec des blocs de paraphrases d’énoncés ou avec un patchwork de formes ou de réalisations linguistiques non motivées (Berthoud & Demaizière, 2005). Si nous voulons que les apprenants prennent en charge leurs énoncés et la relation avec les co-énonciateurs, la mise en valeur de catégories métalinguistiques comme l’aspect, la détermination, la modalisation, etc. et d’opérations de discours (opérations énonciatives, discursives, interactionnelles, cognitives, etc.) est utile. En didactique des langues, la pratique raisonnée de la langue (PRL) qui s’appuie sur la théorie des opérations énonciatives de Culioli, parce qu’elle vise l’aptitude de l’apprenant à se poser des questions et à se forger ses propres réponses et donc vise une certaine autonomie dans la construction du système langagier, répond à notre souhait d’aider l’apprenant à devenir un sujet énonciateur en puissance en langue étrangère.
Du français fonctionnel au français sur objectifs spécifiques : une didactique des langues spécialisée ?
Nous nous sentons concernée par le domaine du français sur objectifs spécifiques dans la mesure où la spécialité pratiquée par les étudiants de l’IFI est l’informatique, que les cours de cette discipline sont donnés en français et que l’institut se situe dans une zone où le français n’a jamais été une langue vernaculaire. Dans ces conditions, les étudiants de l’IFI sont ipso facto classés parmi « les publics spécifiques » ou « spécialisés » ou encore « publics non spécialistes de français » traduisant pour cette dernière expression une finalité de l’apprentissage du français autre que pour les publics dits « spécialistes » qui étudieraient la langue pour elle-même ou pour l’enseigner. Et en effet, pour certains, une marque distinctive du français sur objectifs spécifiques est d’apprendre le français « pour » quelque chose.
Le FOS ce n’est pas enseigner le français ou apprendre le français, mais c’est bien apprendre du français « pour ». C’est du français pour travailler – pour les uns – et pour suivre des études – pour les autres (Tauzin, 2003 : 82).
Concernant ces finalités différentes, certains s’interrogent : y a-t-il un français sans objectifs spécifiques ? C’est ainsi que s’intitulent les deux rencontres de l’Asdifle de juin et octobre 2002 où Drouère et Porcher (2002) dans une introduction aux actes donnent des éléments de réponse. D’une manière générale, il n’y a plus d’autre enseignement de français langue étrangère que des enseignements à objectifs spécifiques. […]. Et d’ailleurs, que signifierait aujourd’hui un enseignement sans objectif spécifique ? Il n’y a plus de place pour la gratuité de l’apprentissage et sa non-utilisation dans la vie concrète (Drouère & Porcher, 2003 : 8).
En effet, la démarche d’analyse des besoins qui implique d’investiguer les situations cibles d’utilisation de la langue dans lesquelles les apprenants sont susceptibles de se trouver, issue de l’entreprise et adaptée au champ de l’éducation par le français fonctionnel, absorbée et remodelée par l’approche communicative, fait aujourd’hui partie des thématiques clés de la didactique des langues qui s’attache de plus en plus à la spécificité des contextes d’enseignement / apprentissage. Le FOS, pour qui la question du contexte est centrale, n’est plus exclusivement préoccupé par cette question, ce qui laisse peut-être présager d’une plus grande ouverture, nécessaire selon nous, vers la didactique des langues.
Nous proposons un rapide contour des notions et des avancées ou semblants d’avancée que ces notions de « français fonctionnel », « français instrumental », « français scientifique et technique », etc. véhiculent.
Différentes dénominations pour une même notion
L’enseignement d’une langue étrangère sur objectifs spécifiques constitue aujourd’hui un domaine distinct dans le territoire couvert par la didactique des langues. Ce domaine recouvre des situations d’enseignement extrêmement variées auxquelles s’ajoutent des terrains à la complexité mouvante dans leurs aspects sociaux, culturels, politiques, etc. ce qui peut être en partie la cause du caractère éclaté du domaine et de l’imprécision des notions qui y renvoient (Holtzer, 2004).
Les dénominations du domaine ont changé selon les époques : « français fonctionnel » n’est presque plus d’usage et l’appellation « français sur objectifs spécifiques », abrégée en FOS – ce qui témoigne de son succès – représente aujourd’hui la terminologie consacrée. D’autres termes co-existent néanmoins sans pourtant toujours recouvrir des significations différentes.
L’entrée en scène dans les années 70 du « français fonctionnel » répond au besoin de reconnaître officiellement un secteur du FLE, l’enseignement à des non-spécialistes du français comme par exemple les étudiants des filières scientifiques et techniques pour qui l’apprentissage de la langue n’est pas la matière principale. Le critère opératoire est celui du public. Plusieurs appellations coexistent déjà, comme celle de « français scientifique et technique » qui délimite un critère lié aux savoirs (scientifiques et techniques) ou « français de spécialité » dont le critère, lié au code linguistique, établit une distinction entre un français usuel et un français de spécialité, distinction toujours discutée aujourd’hui. Quant à l’appellation « français instrumental », en raison des connotations trop utilitaristes de l’adjectif « instrumental », son existence a été brève. Pourtant, l’ensemble de ces appellations, « français fonctionnel », « français scientifique et technique », « français de spécialité » ou « français instrumental » renvoient toutes à une conception instrumentale de la langue que nous ne partageons pas.
La démarche méthodologique du français fonctionnel a pour élément central le public et elle est basée sur une analyse des besoins en langue étrangère qui se traduisent en objectifs fonctionnels préalables à la définition des contenus, des supports, etc. Il s’agit en fait, d’une méthodologie applicable à tout public, spécialisé ou non, et donc d’une méthodologie générale. Ce changement de sens va conduire à la chute du fonctionnel qui va être absorbé et remodelé par l’approche communicative qui triomphe alors (Holtzer, 2004). La notion d’analyse des besoins comme base de détermination des contenus perdure aujourd’hui mais elle ne se limite plus aux besoins langagiers et intègre des besoins de nature culturelle avec une meilleure prise en compte des contextes ainsi que des besoins d’ordre cognitif.
Comme le souligne Lehmann (1993), une des critiques adressée au français fonctionnel est d’avoir stigmatisé l’excessive linéarité de ces conceptions et le concept de « besoin » lui-même en a été rendu encore plus fortement ambigu. Or l’interrogation sur les besoins est liée à la définition des objectifs et à la construction des programmes de langues. Se demander ce que les apprenants ont besoin d’apprendre, pose implicitement que les apprenants ne peuvent pas tout apprendre et que des choix doivent être opérés. La notion de besoin se définit en partie, selon nous, par référence à des usages liés à des contextes spécifiques mais le futur supposé des apprenants tel qu’induit par la description des situations cibles ne suffit pas pour définir des situations d’apprentissage. En effet, une action de formation en langues s’inscrit dans un continuum qui dépasse les situations cibles à court terme d’usage de la langue. La notion de besoin doit s’ouvrir à ceux plus larges, de besoins d’apprentissage qui impliquent des opérations cognitives mises en jeu dans l’apprentissage, qui implique également une composante psycho-affective liée au sentiment d’insécurité face à l’apprentissage ainsi que l’insécurité linguistique dans la langue étrangère, de même qu’une composante langagière et socio-culturelle (Lehmann, 1993). Enfin, la notion de besoin en langue dépasse forcément, dans le cadre institutionnel tout au moins, les besoins « utiles » et s’ouvre aussi sur des besoins élargis aux situations informelles, aux productions culturelles de la langue étrangère ou à la curiosité intellectuelle, ce dernier critère étant tout à fait pertinent, selon nous, pour des étudiants qui se destinent en grande partie à devenir des chercheurs.
Cependant, avec Lehmann (1993), nous partageons l’avis selon lequel une centration uniquement sur les contenus linguistiques est tout autant à rejeter qu’un excès de centration sur l’apprentissage dans lesquelles programmation et contenu ont complètement disparu (Lehman, 1993). Ce débat sur la nécessité de donner aux actions de formation des objectifs dépasse le cadre du FOS et concerne tout autant les autres domaines de la didactique des langues.
L’utilité de la notion de besoins éclaircie, il s’ensuit une explication au sujet des outils organisationnels issus de l’ingénierie de la formation. En effet, pour la conception de notre dispositif de formation, des outils organisationnels issus de l’ingénierie de la formation ont été utilisés : analyse du contexte, identification de besoins, détermination d’objectifs généraux, rédaction d’un cahier des charges, rédaction d’un scénario d’apprentissage, anticipation des risques, etc. L’utilisation de ces outils de conception est subordonnée aux théories d’apprentissage retenues par le concepteur si bien que la notion de besoin peut renvoyer à des paradigmes d’apprentissage divers. Dans notre contexte, nous avons disposé de ces outils organisationnels, sur lesquels nous reviendrons lorsque nous aborderons la conception du scénario d’apprentissage à distance, en accord avec notre paradigme socioconstructiviste et énonciativiste. La notion de besoins, dans notre recherche, ne peut donc pas être associée à une approche relevant d’un autre paradigme.
La langue de spécialité existe-t-elle ?
Des contextes spécifiques entraînent-ils une langue de spécialité ? Pendant longtemps, on a cru pouvoir localiser dans la langue de spécialité un technolecte autonome caractérisé par des usages linguistiques particuliers, lexicaux et syntaxiques en particulier. La problématique des langues de spécialité s’est focalisée massivement sur le lexique.
S’il apparaît que la fonction référentielle propre à chaque langue se retrouve amplifiée dans les domaines spécialisés, où la caractérisation du réel joue un rôle important et où le caractère monoréférentiel est univoque pour éviter de substituer un terme à un autre, cette monosémie n’est pas systématique et n’exclut pas la polysémie et la métaphore (Richer, 2008). En effet, les termes ont leur histoire et migrent d’un domaine disciplinaire à un autre, effectuent des allers retours entre la langue courante et la langue d’un domaine spécialisé. De plus, le lexique des domaines spécialisés est également soumis à des variations dues au contexte sociolinguistique.
L’intense création verbale au travail aboutit à ce que s’y confrontent au moins trois ensembles lexicaux : le lexique commun, conventionnel, celui de l’ensemble des personnes qui parlent le français ; le lexique technique ou spécialisé, c’est-à-dire le lexique qui est prescrit par les offices de terminologie ou les directions d’entreprises ou les organismes de formation ; le lexique des salariés eux-mêmes, celui qu’ils ont créé, soit pour remplacer les dénominations communes, soit pour remplacer les mots techniques (Boutet, 2001 : 192).
Le contexte de l’entreprise transposé à celui du monde étudiant reste tout aussi pertinent et le lexique des « langues de spécialité » est soumis aux mêmes variations sémantiques et sociales que les langues ordinaires.
Des particularités des langues de spécialité ont aussi été recherchées dans le domaine de la syntaxe en traquant des fréquences élevées de certaines formes syntaxiques. Dans le domaine des sciences et des techniques, des travaux anglo-saxons et français ont relevé quelques caractéristiques syntaxiques comme la fréquence du présent de vérité générale qui s’expliquerait par la volonté de situer le travail technique dans une perspective atemporelle ou encore le recours important à la voix passive qui se justifierait par un effort d’objectivation. Mais ces travaux se sont limités à des analyses syntaxiques au niveau de la phrase et comme le souligne Richer (2008), n’ont pas fait l’objet d’enquêtes statistiques systématiques pour prouver leur pertinence en terme de fréquence. De plus, la conception de l’objectivité et du caractère essentiellement informatif des discours scientifiques et techniques ont été fortement remis en question par Moirand (1990) car, selon elle, ils affichent une pratique généralisée de la modalisation et sont traversés par la polyphonie énonciative. De leur côté, Latour et Wooglar (1988 : 87) précisent que dans un laboratoire, les chercheurs passent leur temps à effectuer des opérations sur les énoncés : ajout de modalités, citation, amélioration, diminution, emprunt, proposition de combinaison nouvelles.
Si la spécificité des langues de spécialité n’est pas à chercher du côté du lexique et de la syntaxe, il semble que ce soit dans les genres discursifs liés à des contextes que des spécificités sont bien présentes. Il pourrait s’agir dans notre contexte de particularités discursives liées aux discours pédagogiques dans le domaine informatique à destination des étudiants ou à produire par les étudiants, des discours informatiques spécialisés produits par des chercheurs à l’attention de la communauté scientifique du domaine (chercheurs, enseignants, étudiants), du discours informatique vulgarisé, des discours liés aux échanges en classe (en petit groupe pour la collaboration, en grand groupe avec la participation de l’enseignant), les discours informels des couloirs et hors de l’institution. Cette liste non exhaustive n’indique pas de priorité pour tel ou tel type de discours. En effet, pour les étudiants vietnamiens, la capacité à nouer des relations dans ou hors des couloirs avec des étudiants camerounais, belges, etc. peut avoir des retombées extrêmement bénéfiques sur les apprentissages (apprentissage plus solidaire, pratique de la langue cible, communication exolingue, etc.).
Nous retenons donc pour notre recherche que si les langues de spécialité comportent une spécificité, elle ne réside pas dans le lexique et la syntaxe mais dans des genres de discours spécifiques.
Le français sur objectifs spécifiques
Qu’en est-il alors des objectifs spécifiques et que recouvre la terminologie de « français sur objectif(s) spécifique(s) » (FOS) ? Calqué sur l’anglais ESP (English for Specific purposes), cette dénomination semble mettre l’accent sur les objectifs à atteindre. Comparée à « langue de spécialité », l’expression « français sur objectif(s) spécifique(s) » écarte le débat qui vise à distinguer langue particulière et langue générale, et indique qu’il s’agit d’usages particuliers de cette langue. Mais si des déplacements d’attention peuvent être constatés sur la notion de besoin par exemple ou encore sur celle de langue de spécialité, aucune rupture fondamentale par rapport au français fonctionnel n’est perceptible. C’est le point de vue adopté par Holtzer (2004) et que nous partageons. En effet, sur le plan didactique, les principes de l’enseignement fonctionnel sont toujours à l’oeuvre comme en témoignent quelques ouvrages récents du domaine où, si les intentions sont là, celles notamment d’intégrer la composante socioculturelle, de rares données socioéconomiques sont présentes et rien dans les activités ne donne à faire sentir « les évidences invisibles » (Carroll, 1987) qui agissent sur les conceptions du temps, de l’espace, de la hiérarchie, de l’autorité, de la conversation, etc essentielles pour pouvoir interagir et travailler avec l’autre. Pour le développement de la dimension cachée, le « langage silencieux » de la culture (Hall, 1966, 1981), c’est vers une approche comparative interculturelle, dont le projet Cultura (Furstenberg & English, 2006) est un exemple de choix, que nous nous tournons.
Même si dans le domaine du « français sur objectifs spécifiques », les objectifs sont valorisés et bien que parfois de nouveaux éléments comme la prise en considération du contexte ou de la culture sont proposés, la construction de modèles intégrant méthodologiquement ces facteurs sont absents. On peut également regretter le manque de réflexion didactique de la part d’acteurs de la formation dans le domaine du FOS et une application stricte d’outils organisationnels en guise de théorie d’apprentissage. En contexte institutionnel, de nombreuses questions ne sont pas particulières au FOS et elles ne peuvent que s’enrichir des recherches en didactique des langues. Pour conclure, nous reprenons ces termes de Holtzer (2004 : 22).
[…] Il apparaît assez clairement que les termes de « français fonctionnel », « français de spécialité », « français sur objectifs spécifiques » sont différents noms de baptêmes pour une même notion. [..] La notion reste en effet inscrite dans le même modèle global correspondant au grand changement de paradigme méthodologique des années 1970. L’ensemble notionnel dont elle fait partie est composé des mêmes objets centraux depuis trente ans : besoins, objectifs, publics, situation, langue spécialisée.
Ce constat nous invite à nous engager dans une réflexion didactique plus large pour prendre en compte la composante culturelle, pour la mise en place de contextes d’apprentissage pertinents pour l’apprentissage d’une langue, proches des situations discursives dans lesquelles les étudiants seront amenés à agir et interagir.
Quel positionnement par rapport à la perspective actionnelle ?
La parution en 2001 du Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECR), en introduisant des concepts nouveaux de « perspective actionnelle » et de « compétences plurilingues », a conduit à une réorientation de la didactique des langues bien au delà des frontières de l’Europe. Voici comment la perspective actionnelle est définie.
Un cadre de référence doit se situer par rapport à une représentation d’ensemble très générale de l’usage et de l’apprentissage des langues. La perspective privilégiée ici est, très généralement aussi, de type actionnel en ce qu’elle considère avant tout l’usager et l’apprenant d’une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement langagières) dans des circonstances et un environnement donnés, à l’intérieur d’un domaine d’action particulier. Si les actes de paroles se réalisent dans des activités langagières, celles-ci s’inscrivent elles-mêmes à l’intérieur d’actions en contexte social qui seules leur donnent leur pleine signification. Il y a « tâche » dans la mesure où l’action est le fait d’un (ou de plusieurs) sujet(s) qui y mobilise(nt) stratégiquement les compétences dont il(s) dispose(nt) en vue de parvenir à un résultat déterminé. La perspective actionnelle prend donc aussi en compte les ressources cognitives, affectives, volitives et l’ensemble des capacités que possède et met en oeuvre l’acteur social (Conseil de l’Europe, 2001a : 15).
Il est précisé d’emblée, qu’il s’agit d’un cadre très général et qu’en cela, les utilisations du CECR peuvent être multiples. Néanmoins, les notions « d’acteur social », « de tâche dans un environnement donné », « d’action en contexte social », « de résultats de l’action », « de mobilisation de stratégies et de compétences » renvoient aux notions clés des théories de l’action contextualisée et socialement située décrites dans le chapitre 2 de notre thèse. Ce modèle, en effet, prend en compte la complexité des situations sociales où les actes de communication langagière, qui ne sont plus autonomes et isolés, ne sont qu’une des composantes de la construction sociale et où leur signification se définit dans le cadre large de l’action collective d’où ils émergent et permettent de construire. Comme le souligne Springer (2009 : 15), « le CECR offre une entrée sociale et éducationnelle à la didactique des langues jusqu’ici enfermée dans la seule question disciplinaire de l’enseignement / apprentissage d’une langue ». Effectivement, le CECR ne s’appuie plus seulement sur une théorie de la langue mais semble entrer davantage dans une approche par compétences et la focalisation sur le langage qui constituait le principe de base des méthodologies antérieures (les approches communicatives), cède la place à une focalisation sur l’action.
Compétence et compétences
Issue des sciences de l’éducation, l’approche par compétences a pour vocation de rapprocher situations d’apprentissages scolaires et situations authentiques de la vie quotidienne et plus largement du monde professionnel. Voici comment Perrenoud (1999 : 16) définit la compétence. Concrète ou abstraite, commune ou spécialisée, d’accès facile ou difficile, une compétence permet de faire face régulièrement et adéquatement à une famille de tâches et de situations, en faisant appel à des notions, des connaissances, des informations, des procédures, des méthodes, des techniques ou encore à d’autres compétences, plus spécifiques.
Les compétences se manifestent dans l’action et si les ressources à mobiliser font défaut, il n’y a pas de compétence et si les ressources sont présentes mais pas mobilisées à bon escient ou en temps utile, tout se passe comme si les compétences n’existaient pas (Perrenoud, 1998). Perrenoud (1999 : 17) précise.
Le transfert de connaissance n’est pas automatique, il s’acquiert par l’exercice et une pratique réflexive, dans des situations qui donnent l’occasion de mobiliser ces savoirs, de les transposer, de les combiner, d’inventer une stratégie originale à partir de ressources qui ne la contiennent pas et ne la dictent pas. […] La mobilisation s’entraîne dans des situations complexes, qui obligent à poser le problème avant de le résoudre, à repérer les connaissances pertinentes, à les réorganiser en fonction de la situation, à extrapoler ou combler du vide.
Il ne s’agit donc en rien d’appliquer ni même d’utiliser de façon routinière des savoirs et savoir-faire qui viennent d’être appris. Mais qu’en est-il de la notion de « compétences » dans le CECR ? Est-ce un simple prolongement de la « compétence langagière » développée par l’approche communicative ?
Comme le précise Springer (2002), la littérature des années 80 et 90 est préoccupée par la compétence de communication. À la suite des travaux de Hymes (1984) et de Canale et Swain (1981), les composantes indispensables pour parler de communication tentent d’être définies : composante discursive, sociolinguistique, stratégique, pragmatique, etc. Il s’agit davantage de cerner l’aspect linguistico-communicatif et la compétence renvoie moins à la « compétence » définie plus haut mais davantage au couple chomskien de compétence / performance.
Le terme « compétence » revêt ensuite un sens différent, en rapport avec l’agir comme étant « l’ensemble des connaissances, des habiletés et des dispositions qui permettent d’agir » (Conseil de l’Europe, 2001a : 15) puisque la « compétence à communiquer langagièrement » se réalise à l’intérieur d’actions en contexte social. De plus, la « compétence à communiquer langagièrement », associée à la notion de « tâche » que nous explicitons plus loin, implique que l’activité langagière s’exerce dans l’agir social et non pour elle-même. Springer (2008), perçoit dans la « compétence » du cadre une modélisation raisonnée et plus uniquement descriptive de la compétence du fait qu’on y définit les compétences cognitives générales (savoir repérer et interpréter, savoir raisonner, savoir apprendre, etc.) et la compétence à communiquer langagièrement qui implique une composante sociolinguistique, pragmatique et linguistique. Springer (2008) y voit par conséquent un dépassement de la compétence linguistique / compétence de communication au profit d’un recentrage sur la relation entre les stratégies de l’acteur et les tâches à réaliser.
La réalisation d’une tâche est une procédure complexe qui suppose donc l’articulation stratégique d’une gamme de facteurs relevant des compétences de l’apprenant et de la nature de la tâche. Pour répondre aux exigences de l’exécution d’une tâche, l’utilisateur / apprenant de langues met en oeuvre celles de ses stratégies qui sont les plus efficaces pour la mener à bien. L’utilisateur ou l’apprenant adapte, ajuste, filtre naturellement les données de la tâche. […] Ce sont des stratégies (générales et communicatives) qui créent un lien vital entre les différentes compétences de l’apprenant (innées ou acquises) et l’exécution réussie de la tâche (Conseil de l’Europe, 2001a : 122).
De cette définition, il apparaît que les stratégies mises en oeuvre par l’acteur deviennent centrales et la compétence visée n’est plus tant communicative que stratégique, les compétences langagières n’étant qu’un moyen dont l’usager dispose pour mener à bien la tâche. Dans ces conditions, faut-il voir dans la perspective actionnelle un virage épistémologique et une filiation avec les théories de l’activité ?
|
Table des matières
CHAPITRE 1 DONNEES CONTEXTUELLES
1.1 L’Institut de la francophonie pour l’informatique (IFI)
1.2 Le public de l’IFI
1.3 La place des langues dans l’établissement
1.3.1 Un établissement bilingue ?
1.4 L’équipe pédagogique
1.5 L’enseignement des langues
1.5.1 L’espace multimédia d’apprentissage des langues
1.5.2 La création d’un cours de français informatique
1.5.3 Introduction de la pédagogie du projet
1.5.4 Pratique de l’auto-évaluation et de l’auto-réflexion
1.6 L’identification d’un problème
1.6.1 Dialang
1.6.2 L’auto-évaluation
1.6.3 Comparaison de deux résumés écrits
1.6.4 Comparaison de deux monologues oraux
1.6.5 Bilan de cette évaluation
1.7 Recherche-action ou recherche (quasi) expérimentale ?
1.8 Le choix d’une formation à distance utilisant le temps de vacances
PREMIERE PARTIE CADRE THEORIQUE
CHAPITRE 2 APPRENDRE DANS UN CADRE SOCIOCONSTRUCTIVISTE ET ENONCIATIVISTE
2.1 L’apprentissage dans le paradigme constructiviste
2.2 Les apports vygotskien et brunérien
2.2.1 La primauté du social sur le cognitif
2.2.2 L’héritage historico-culturel
2.2.3 Les concepts de format d’interaction et d’étayage
2.3 Quelques principes andragogiques
2.4 L’apprentissage collaboratif et coopératif
2.4.1 L’apprentissage collaboratif
2.4.2 L’apprentissage coopératif
2.5 Vers une théorie de l’activité sociale et située
2.5.1 Une activité sociale intentionnelle
2.5.2 Une activité socialement située
2.6 Différentes applications pédagogiques de l’apprentissage par l’action (ou la co-action) sociale
2.6.1 La pédagogie du projet
2.6.2 La simulation
2.7 Les conditions d’un apprentissage efficace
2.8 Les linguistiques énonciatives
2.9 La linguistique énonciative culiolienne
2.9.1 Le langage n’est pas un instrument
2.9.2 Un sujet énonciateur en puissance
CHAPITRE 3 POSITIONNEMENT DIDACTIQUE ET APPRENTISSAGE D’UNE LE
3.1 Du français fonctionnel au français sur objectifs spécifiques : une didactique des langues spécialisée ?
3.1.1 Différentes dénominations pour une même notion
3.1.2 La langue de spécialité existe-t-elle ?
3.1.3 Le français sur objectifs spécifiques
3.2 Quel positionnement par rapport à la perspective actionnelle ?
3.2.1 Compétence et compétences
3.2.2 Le concept de tâche sociale
3.2.3 Extension au « projet » et délimitation du concept de « tâche »
3.3 Des spécifications linguistiques et cognitives pour l’action sociale
3.3.1 Le rôle des activités métalinguistiques
3.3.2 La pratique réflexive des langues
3.4 Communication et acquisition
3.4.1 Interactions langagières et acquisition
3.4.2 La nature de l’activité et les conséquences sur les échanges
3.4.3 Les échanges entre pairs en milieu guidé
3.4.4 Communication exolingue et appropriation
3.5 Le rôle de la production pour un traitement significatif de l’input
CHAPITRE 4 LES PRINCIPES DE LA FAD
4.1 Les diverses « distances » de la formation à distance (FAD)
4.2 Les artefacts symboliques et matériels
4.2.1 La communication médiée par ordinateur (CMO)
4.2.2 Le forum
4.2.3 Le clavardage
4.2.4 L’audioconférence
4.2.5 Le courriel
4.2.6 Des particularités discursives pour le forum pédagogique en langue étrangère ?
4.3 Des exemples d’activités réflexives à distance médiées par le forum
4.3.1 Le dispositif Lexica Online
4.3.2 Un modèle collaboratif pour la réflexion métalinguistique à distance
4.3.4 Cultura, communication interculturelle et activité réflexive
4.4 Le rôle de l’ingénierie pédagogique
4.4.1 Le scénario pédagogique
4. 4. 2 Les apports de l’ergonomie
4.5 Le tutorat
4.6 La constitution des groupes
4.6.1 Libre choix ou assignation des groupes ?
4.6.2 Taille des groupes
4.6.3 Homogénéité ou hétérogénéité des groupes ?
DEUXIÈME PARTIE EXPÉRIMENTATION ET RÉSULTATS
CHAPITRE 5 DESCRIPTION DE FICTIF
5.1 Description globale du scénario
5.1.1 Cadre narratif de Fictif
5.1.2 Ergonomie de Fictif
5.1.3 Les consignes
5.2 Informations générales sur le déroulement de la FAD Fictif
5.3 Projet 1 : conception d’un cours informatique et du site web de l’université
5.3.1 Description du scénario du projet 1
5.3.2 Le tutorat proposé pour le projet 1
5.4 Projet 2 : Cultures francophones et vietnamiennes
5.4.1 Description du scénario du projet 2
5.4.2 Tutorat proposé pour le projet 2
5.5 Le projet 3 : résolution d’énigmes linguistiques de façon collaborative
5.5.1 Description du projet 3
5.5.2 Les interventions tutorales du projet 3
CHAPITRE 6 FICTIF, UN SCENARIO SOCIOCONSTRUCTIVISTE ET ENONCIATIVISTE PORTEUR D’APPRENTISSAGE ?
6.1 Rappels théoriques
6.1.1 Le socioconstructivisme
6.1.2 L’énonciativisme
6.2 Techniques de recueil et d’analyse des données
6.2.1 Échanges et production dans les forums et les clavardages de la plateforme Moodle
6.2.2 Le questionnaire de fin de FAD
6.3 Compatibilité du projet 1 aux principes retenus
6.3.1 Indices d’engagement et de satisfaction pour les activités de conception d’un cours et les activités de relecture d’un pair
6.3.2 Indices d’engagement et de satisfaction pour l’activité de conception collective de la page web de l’université
6.3.3 Des signes de co-énonciation et de co-construction ?
6.4 Compatibilité du scénario du projet 2 aux principes soumis
6.4.1 Indices d’engagement et de satisfaction pour les activités du projet 2
6.4.1 Traces de co-énonciation et de co-construction
6.5 Compatibilité du scénario du projet 3 avec les principes soumis
6.5.1 Indices d’engagement et de satisfaction pour les activités du projet 3
6.5.1 Traces de co-énonciation et de co-construction
6.6 Fictif, un scénario qui semble porteur d’apprentissage ?
6.6.1 Les compétences langagières
6.6.6.1 La rubrique « acquis » du questionnaire de fin de FAD
6.6.1.2 L’auto-évaluation des compétences langagières
6.6.2 Résultats
6.6.3 Le développement du sens des responsabilités dans les apprentissages
CHAPITRE 7 UNE EVOLUTION DE L’AISANCE METALINGUISTIQUE ET DES COMPETENCES A COLLABORER ?
7.1 Analyses linguistiques des groupes
7.1.1 L’énigme linguistique 4
7.1.2 Analyses proposées par les groupes à l’énigme linguistique 4
7.1.3 L’énigme linguistique 5
7.1.4 Analyses proposées par les groupes à l’énigme linguistique 5
7.1.5 Impact des formes analysées dans les échanges des forums
7.1.5.1 Structure « c’est + adj »
7.1.5.2 Structure « il est + adj + que / de… »
7.1.5.3 Structure « c’est + adj + que ou préposition + vb infinitif »
7.1.6 L’énigme linguistique 6
7.1.7 Analyse proposée par les groupes à l’énigme linguistique 6
7.1.7 Impact des formes analysées dans l’énigme 6 dans les forums et les clavardages
7.1.8 Conclusion de cette première partie
7.2 Analyse de la collaboration des groupes au fil des énigmes
7.2.1 Indicateurs de collaboration
7.2.2 Résultats par groupe et par énigme
7.3 Relation entre la qualité de la collaboration d’un groupe et la qualité des solutions
7.3 Relation entre la qualité de la collaboration d’un groupe et la qualité des solutions proposéesproposées
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
Télécharger le rapport complet