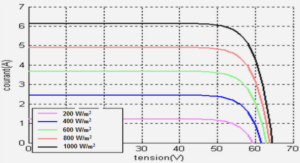Malgré ses vertus comme élément essentiel à la vie, le phosphore a aussi une réputation comme polluant. Dans les régions rurales, il ruisselle régulièrement des champs agricoles dans les eaux, et dans les régions urbaines, il vient des eaux usées, le principal ingrédient des excréments humains venant de la chasse d’eau des toilettes. Dans les deux cas, le phosphore peut augmenter les niveaux de concentration de nutriments de l’endroit, provoquant des floraisons d’algues dans les lacs et les rivières où il s’accumule: un procédé appelé eutrophisation. Ces croissances excessives d’algues peuvent éventuellement diminuer l’oxygène disponible dans l’eau, à tel point que certaines espèces de poissons ne peuvent plus survivre. C’est ce qui affligeait le Lac Érié dans les années 1970, ce qui attira l’attention de David Schindler, un biologiste de l’université de l’Alberta. En prenant un petit lac dans le nord de l’Ontario, il le divisa en 2 avec un rideau submergé et démontra que c’était le phosphate dans les détergents qui venaient des eaux usées municipales qui étaient les principaux coupables de ce qui affligeait le Lac Érié [1]. Les fabricants de détergents ont ensuite été motivés pour diminuer les quantités de phosphates dans leurs produits, ce qui a diminué de beaucoup l’eutrophisation du lac.
La croissance de la population urbaine et le développement des activités ont pour conséquence une surexploitation des nappes phréatiques et leur contamination ainsi qu’une augmentation importante des rejets dans le milieu naturel, et ce, bien au-delà des capacités d’auto-épuration des oueds. Sur l’ensemble de l’Algérie du Nord, 193 des 358 agglomérations urbaines (sur les 447 définies par l’ONS en 1987), sont situées à l’amont des barrages et des champs captant des nappes, représentant 6.288.000 habitants en 1995, soit 45% de la population urbaine totale et potentiellement 10.086.000 habitants en 2010 qui porteront atteinte à ces ressources directement ou indirectement [2]. Il faut rappeler que l’Algérie se situe, parmi les pays les plus pauvres en matière de potentialités hydriques ; le citoyen algérien ne dispose, que de 1/5000ème de la quantité moyenne mondiale, soit en-dessous du seuil théorique de rareté fixé par la Banque Mondiale à 1000 m3/hab/an.
Le volume distribué représente, 85% du volume produit, soit une perte de transfert et de traitement de près de 15 %. A ces pertes il y a lieu d’ajouter, pratiquement dans la quasi-totalité des villes, celles à l’intérieur des réseaux dont on n’a pas une évaluation précise mais qu’on peut estimer entre 40% et 50%, le niveau admissible des pertes se situant à hauteur de 15 à 20%. Les réseaux d’assainissement se sont développés de manière anarchique au gré du développement des villes, alors que toute élaboration d’un plan d’urbanisme repose en premier lieu sur un schéma d’alimentation et d’assainissement des eaux, et que d’autre part, les systèmes d’épuration adoptés (stations d’épuration dans la quasi-totalité des cas) ne résultaient pas d’études approfondies préalables à l’échelle du bassin.
LA COMPOSITION DES EAUX USEES
Les eaux usées urbaines arrivant aux stations d’épuration urbainessont majoritairement constituées d’eaux usées domestiques dans le cas de réseaux d’assainissement séparatifs, auxquelles viennent s’ajouter les eaux pluviales issues du ruissellement sur les ouvrages routiers, toitures. Dans le cas de réseaux d’assainissement unitaires ; dans les zones industrialisées, des eaux usées industrielles peuvent également arriver aux stations d’épuration [5]. De par les quantités d’éléments véhiculés dans les eaux usées et la toxicité de certains d’entre eux, les eaux usées doivent être épurées avant d’être rejetées dans les eaux naturelles .
Les principaux constituants des eaux usées que les traitements vont tenter de diminuer sont :
✦ les matières en suspension (MES),
✦ l’azote et le phosphore (mg/l),
✦ les métaux lourds, les graisses et détergents,
✦ les germes et les virus,
✦ les matières oxydables (pollution carbonée) caractérisées par :
1. la demande biologique en oxygène (DBO5 en mg O2 L-1 ), quantité d’oxygène consommée en 5 jours par une biomasse pour décomposer les matières organiques,
2. la demande chimique en oxygène (DCO en mg O2 L-1) qui représente la matière oxydable par voie chimique.
Ces constituants sont répartis dans différentes fractions :
• déchets flottants,
• particulaire (décantable en 2 heures),
• colloïdale (qui peut floculer et qui peut être retenue dans un filtre),
• soluble (ce qui reste en solution).
TRAITEMENT DES EAUX USEES
La station d’épuration d’une agglomération urbaine comporte une chaîne de traitement dont la complexité dépend du degré d’épuration jugé nécessaire. On classe habituellement ces traitements de la façon suivante :
Prétraitement
Avant leur traitement, les eaux brutes doivent subir un prétraitement. Les dispositifs de prétraitement sont présents dans toutes les stations d’épuration, quels que soient les procédés mis en œuvre, qui a pour objectif d’extraire la plus grande quantité possible de matières séparables pouvant gêner les traitements ultérieurs. On distingue quatre actions pour le prétraitement :
Dégrillage
Il s’agit de retenir les déchets solides qui peuvent arriver à la station d’épuration en faisant passer l’effluent à traiter à travers des grilles espacées de quelques centimètres, afin de protéger les ouvrages en aval. L’opération peut être plus au moins efficace en fonction de l’écartement des barreaux des grilles, on distingue :
● Dégrillage fin, pour un écartement de 3 à 10 mm,
● Dégrillage moyen, pour un écartement de 10 à 25 mm,
● Pré dégrillages, pour un écartement de 30 à 100 mm .
Tamisage
Cette opération constitue un dégrillage fin, elle est réalisée en faisant passer l’effluent à travers des grilles ayant des fins trous. Elle est mise en œuvre dans le cas d’eaux résiduaires chargées de matières en suspension de petite taille. On distingue:
● Le macro tamisage avec une dimension de mailles supérieur à 250µm,
● Le micro tamisage avec vide de maille entre 30µm à 150µm.
Dessablage
Le dessablage concerne de particules minérales de diamètre supérieur à 0.2 mm et de masse spécifique de l’ordre de 2.65 g/cm3 . Il est en effet souhaitable de les récupérer en amont de la station afin de :
• éviter les dépôts dans les canaux et conduites,
• protéger les pompes et les autres appareils contre la corrosion.
Dégraissage-déshuilage
Le dégraisseur a pour objet la rétention des graisses par flottation naturelle ou accélérée par injection de fines bulles permettant de faire remonter rapidement les graisses en surface. Il est essentiel pour limiter les problèmes de :
• Diminution des capacités d’oxygénation des installations de traitement biologiques.
• Mauvaise sédimentation dans les décanteurs.
• Bouchage des canalisations et des pompes.
• Pour qu’un dégraissage soit efficace, il faut que la température de l’eau soit inférieure 30 °C.
Traitement Primaire (Décantation Primaire)
Dans une station d’épuration, le décanteur est l’ouvrage fondamental qui assure la séparation gravitaire de la boue et de l’eau épurée, il a pour but:
➤ De retenir une fraction importante de la pollution.
➤ D’alléger la charge du traitement secondaire ultérieur.
➤ De réduire les risques de colmatage des systèmes de traitement.
On distingue deux types de matières décantables :
➤ Les particules grenues : qui conservent les mêmes dimensions au cours de leur chute, elles sédimentent indépendamment les unes des autres avec une vitesse de chute constante,
➤ Les particules coalescentes qui s’agglomèrent pendant la sédimentation.
|
Table des matières
INTRODUCTION GENERALE
Chapitre I : ANALYSE BIBIOGRAPHIQUE
I. La composition des eaux usées
II. Traitement des eaux usées
II. 1. Prétraitement
II. 1. 1. Dégrillage
II. 1. 2. Tamisage
II. 1. 3. Dessablage
II. 1. 4. Dégraissage-déshuilage
II. 2. Traitement primaire (décantation primaire)
II. 3. Traitement secondaire
II. 3. 1. Traitement physico-chimique
II. 3. 1. 1. Coagulation –floculation
II. 3. 1. 1. 1. Colloïdales en solution
II. 3. 1. 1. 2. Déstabilisation de colloïdales
II. 3. 2. Traitement biologique
II. 3. 2. 1. Le lagunage
II. 3. 2. 1. 1. Les types des étangs
II. 3. 2. 1. 1. a. Les étangs anaérobies
II. 3. 2. 1. 1. b. Les étangs facultatifs (aérobie – anaérobie)
II. 3. 2. 1. 1. c. Les étangs de maturation
II. 3. 2. 1. 2. Type de Lagunage
II. 3. 2. 1. 2. a. Lagunage naturel
II. 3. 2. 1. 2. b. Lagunage à macrophytes
II. 3. 2. 1. 2. c. Lagunage à microphytes
d. Lagunage aéré
e. Lagunage anaérobie
f. Lagunage à haut rendement
II. 3. 2. 1. 3. Avantages et inconvénients du traitement biologique par lagunage
II. 3. 2. 2. Boues activées
II. 3. 2. 2. 1. Description de procédé d’épuration par boues activées
II. 3. 2. 2. 2. Décanteur secondaire
II. 3. 2. 2. 3. Recirculation des boues
III. Traitement de phosphore
III. 1. Définition
III. 2. Source de phosphore
III. 3. Le phosphore dans le milieu aquatique
III. 4. Les formes de phosphore
III. 5. L’élimination biologique du phosphore
III. 5. 1. Mécanismes du processus de suraccumulation
III. 5. 2. Les phases distinguées au cours du relargage (la phase anaérobie)
III. 5. 3. Facteurs dont dépend le processus de suraccumulation
III. 5. 3. 1. Les bactéries déphosphatantes
III. 5. 3. 2. Les poly-β-alcanoates (PHA)
III. 5. 3. 3. La DCO facilement biodégradable
III. 5. 3. 4. Le glycogène
III. 5. 3. 5. Les ions calcium, magnésium et potassium
III. 5. 4. Facteurs influençant de la déphosphatation
III. 5. 4. 1. Le pH
III. 5. 4. 2. La température
III. 5. 4. 3. L’âge des boues
III. 5. 4. 4. Les métaux
III. 5. 4. 5. La Présence d’oxygène et de nitrate
III. 6. Traitement physicochimique (Elimination physico-chimique du phosphore)
III. 6. Principe
III. 6. 1. Réactifs utilisés
III. 6. 2. 1. Réactifs à base de fer
III. 6. 2. 2. Réactifs à base d’aluminium
III. 6. 2. 3. Réactif à base de calcium
III. 7. Avantages et inconvénients des procédés d’élimination des phosphores
IV. Eutrophisation
V. 1. Définition
IV. 2. Phénomène de l’eutrophisation
CHAPITRE II : CARACTERISATION DES EAUX USEES
I. Introduction
II. L’épuration des eaux usées en Algérie
II. 1. Station d’épuration des eaux usées par lagunage naturel –AdrarAlgérie
II. 2. Station d’épuration des eaux usées par boues activées de Zrizer EL-Taref
III. Analyses Chimiques
III. 1. Mesure du pH
III. 2. Matière en suspension
III. 3. Détermination de la demande chimique en oxygène (DCO)
III. 4. Mesure des Orthophosphates
III. 5. Mesure des Nitrites
III. 6. Mesure des Nitrates
III. 7. Mesure de l’azote ammoniacal
IV. Caractérisation des eaux usées de la ville El-Taref
IV. 1. Echantillonnage
IV. 2. Résultats et discussion
V. Caractérisation des eaux usées de la ville d’Adrar
V. 1. Echantillonnage
V. 2. Résultats et discussion
Chapitre III DEPHOSPHATATION PHYSICO-CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE DU PHOSPHORE
I. Introduction
II. Objectifs
III. Traitement du phosphore des eaux usées domestiques
IV. Procèdes classiques
IV. 1. Traitement physico chimique du phosphore
IV. 1. 1. Protocole expérimental
IV. 1. 1. 1. Recherche de la dose optimale
IV. 1. 1. 1. 1. Dose optimale du sulfate d’aluminium
IV. 1. 1. 1. 2. Dose optimale du chlorure ferrique
IV. 1. 1. 1. 3. Dose optimale de la chaux
IV. 1. 2. Rendement du traitement chimique des eaux résiduaires
IV. 2. Traitement biologique du phosphore
IV. 2. 1. Traitement des eaux usées par boues activées
IV. 2. 2. Traitement combinée : Physicochimique et biologique par boues activées
IV. 2. 3. Traitement des eaux usées par lagunage naturel
IV. 2. 4. Traitement combiné : Physico-chimique et biologique par lagunage naturel
CONCLUSION GENERALE
REFFERENCES BIBIOGRAPIYQUES