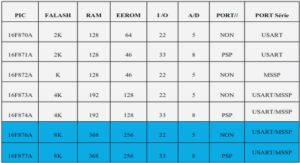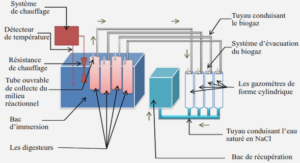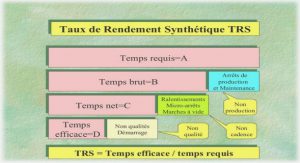Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Remarques préliminaires sur le fait linguistique dans les sociétés sud-asiatiques
Un multilinguisme séculaire
De la même manière que dans les autres grandes civilisations du monde, la langue occupe une place centrale dans la civilisation indienne. Une primauté est cependant accordée la transmission du savoir par l’intermédiaire de la langue orale, garante d’une certaine « pureté » que l’écrit désacraliserait (Tournadre, 2016: 71). La transmission des textes védiques s’est ainsi faite essentiellement à l’oral jusqu’à l’apparition tardive des premiers systèmes d’écriture indiens (vers le IIIe siècle avant J.-C.) qui, à partir de l’écriture brahmi (Coningham et al., 1996), se sont diversifiés pour transcrire une grande partie des langues parlées sur le sous-continent jusqu’à nos jours. R. Breton (1965: 195) répertorie 11 systèmes d’écriture d’usage courant en Asie du Sud continentale (écritures devanagari, gurmukhi, kannada, télougou, tamoule etc.), auxquelles s’ajoute le système d’écriture du maldivien qui est issu de l’alphabet arabe. Néanmoins, par contraste avec la tendance unificatrice et la forte valeur conférée à l’écriture qui ont habité la civilisation chinoise, la civilisation indienne s’est toujours caractérisée par une valorisation de la diversité et de l’oralité comme composantes quasi organiques de la société.
Malgré la persistance d’une vision parfois réductrice d’une Inde ancienne figée dans son passé védique et brahmanique associé à la langue sanskrite, « il ne faut jamais perdre de vue », comme nous le rappelle N. Balbir, « que l’Inde ancienne est un univers multilingue » (2014: 53). La diglossie y faisait office de norme sociale et l’éclatement dialectal a également été valorisé avec l’emploi de nombreux vernaculaires (prākrit ou apabhraṃśa5) dans certains genres théâtraux. C’est à partir de ces nombreuses variations régionales que se sont formées au fil du temps les langues indo-aryennes modernes (hindoustani, népali, bengali, marathi etc.) qui sont parlées comme langues premières par une très large proportion de la population mondiale, soit près de 500 millions de locuteurs pour le hindi-ourdou, 230 millions pour le bengali, 95 millions pour le panjabi, 75 millions pour le marathi, 45 millions pour le gujarati, et environ 13,5 millions pour le népali (Breton 2003: 55). Si l’on inclut les locuteurs du népali en tant que langue seconde au Népal, au Bhoutan, ainsi que dans les États indiens du Sikkim, du Bengale occidental et de l’Assam, le nombre pourrait s’élever à environ 30 millions de locuteurs présentant des degrés de compétence hétérogènes. Il ne faut pas non plus occulter la présence de langues génétiquement non apparentées au sanskrit et parlées dans les régions périphériques à ce qu’on désigne aujourd’hui par le nom de ceinture hindiphone (Hindi Belt), à savoir les langues dravidiennes de l’Inde péninsulaire (tamoul, malayalam, kannada, télougou essentiellement), de nombreuses langues tibéto-birmanes (tibétain, ladakhi, lepcha, sherpa, etc.) et plusieurs langues austro-asiatiques parlées dans les régions des contreforts de l’Himalaya. Parmi toutes ces langues, certaines ont une littérature ancienne particulièrement riche. C’est le cas par exemple du tamoul, dont la tradition écrite remonte à une période proche de celle du sanskrit classique6.
Une diversité – ou pluralité7 – sociolinguistique d’une telle ampleur représente le fruit de l’enracinement séculaire d’une véritable culture du plurilinguisme (Schiffman, 1999: 431), en son sens premier de « mise en valeur » d’un terrain linguistique fertile, que des politiques d’anglicisation comme la circulaire sur l’éducation de T. B. Macaulay de 1835 (Sarangapani, 2015: 108) ont finalement assez peu ébranlé en substance pendant la période coloniale. C’est après l’indépendance (1947) que des politiques linguistiques postcoloniales influencées par le dogme monolingue occidental de l’association d’une langue à un État-nation (Schiffman, 1999: 439) ont accéléré certains processus de conversion linguistique (au niveau des communautés) ou d’attrition (au niveau individuel). D’autre part, si l’usage de l’anglais a pris progressivement une place prépondérante dans l’économie générale des échanges linguistiques dans les sociétés sud-asiatiques, particulièrement en milieu urbain, celui-ci s’est néanmoins retrouvé incorporé dans une dynamique communicative qui se soucie assez peu, dans l’usage quotidien de la parole, de prétendues frontières qui sépareraient les langues. Ainsi F. Grosjean (1982: 22) relève, en contexte sud-asiatique, que :
Le même constat est fait par B. Kachru (1977) qui remarque que de nombreux locuteurs ne manifestent pas nécessairement une conscience très marquée de leur capacité de communiquer en plusieurs langues en fonction de leurs différents interlocuteurs au cours de leurs interactions quotidiennes. Cette dynamique continue d’intégration de ressources linguistiques plurielles s’observe de manière assez générale dans l’ensemble des sociétés sud-asiatiques.
Une aire linguistique intégratrice
Le Sprachbund sud-asiatique
Le linguiste russe N. Troubetskoï (1928: 17-18) avait employé pour la première fois en 1928, au Congrès des Linguistes de La Haye, l’expression allemande de Sprachbund pour désigner une aire ou zone linguistique dans laquelle des langues génétiquement non apparentées s’influencent réciproquement jusqu’à développer des caractéristiques phonologiques, morphologiques ou syntaxiques communes. Si cette notion avait à l’origine été forgée en référence à l’aire linguistique balkanique en Europe, elle s’est imposée avec une acception plus large dès les années 1950 et a été employée pour désigner d’autres aires, comme en particulier celle du sous-continent indien. A. Montaut retrace de manière exhaustive la genèse de l’application de cette notion en contexte sud-asiatique (depuis la proposition de M. Emeneau en 1956 : « India as a linguistic area ») et évoque l’existence de « traits pan-indiens » (Montaut, 1997: 20). Un nombre important de caractéristiques phonologiques, morphologiques et syntaxiques communes se retrouvent dans la majorité des langues sud-asiatiques, en dépit de leur absence d’affiliation génétique. Deux exemples particulièrement notables sont la présence de consonnes rétroflexes et d’un ordre syntaxique non marqué SOV. Il est bien souvent difficile d’affirmer dans quelle direction s’est effectuée la diffusion de tel ou tel trait, mais une homogénéité à la fois de structure et de substance demeure perceptible d’une langue à l’autre.
Cet ensemble homogène, « dont la cohérence prime sur les particularités distinctives de chaque famille » (Montaut, 1997: 22), semble également avoir intégré au fil du temps des apports issus du contact avec des langues étrangères, les deux exemples les plus notables étant le persan et l’anglais.
Le persan
Le persan, langue de la cour des premières élites musulmanes en Inde du Nord (sultanat de Delhi, XIIIe-XVIe siècles) et des empereurs moghols (XVIe-XIXe siècles), a exercé une influence considérable sur le lexique des langues indo-aryennes du nord du sous-continent indien. Par l’intermédiaire de cette langue étaient transmises les connaissances littéraires et scientifiques pendant cette période. C’est pendant le règne d’Akbar (1556-1605) que le persan devint officiellement la langue de la cour impériale (Alam, 1998: 325) et que les codes stylistiques de la poésie indo-persane furent adoptés par les élites8 . De nombreux termes honorifiques et d’adresse respectueuse appartenant au langage de cour sont restés en usage dans la plupart des langues indo-aryennes modernes9. La culture indo-persane eut comme caractéristique de se détacher du cadre musulman strict et le persan des Moghols était aussi la langue principale de transmission des savoirs et la langue de l’administration. Il était également la langue première de nombreux hindous et un nombre important de textes religieux hindous ont été traduits en persan (1998: 328). L’ourdou, langue nationale et officielle du Pakistan ainsi que de plusieurs États indiens, représente un cas particulier de langue indo-aryenne relexifiée par le persan. Il s’agit plus précisément d’un registre de l’hindoustani tout à fait intercompréhensible avec le hindi et surtout adopté par les locuteurs de culture musulmane. Le lexique d’autres langues indiennes (indo-aryennes comme dravidiennes) s’est aussi trouvé enrichi d’unités lexicales et de locutions issues du persan qui sont aujourd’hui encore complètement intégrées dans ces langues et employées comme variantes dans le vocabulaire des échanges conversationnels quotidiens (Khansir & Mozafari, 2014: 2364).
La forme poétique la plus représentative en est indubitablement le ghazal (poème d’amour chanté). De nombreux poètes népalais l’ont également adoptée pendant la période Rāṇā (1846-1951), notamment Motirām Bhaṭṭa (Hutt, 1988: 127).
C’est le cas en népali. Par exemple, le verbe honorifique baksinu ou baksanu employé pour s’adresser au roi jusqu’à la chute de la monarchie en 2008 serait dérivé du persan bakhshīdan (Matthews, 1997: 239).
L’anglais
Quant à l’anglais, omniprésent à des degrés divers dans l’ensemble des sociétés sud-asiatiques depuis la présence coloniale britannique (env. 1750-1947), son influence a été particulièrement significative en raison des choix effectués par les Britanniques en matière de politique linguistique. Si l’implantation de l’anglais a d’abord eu lieu de manière progressive pendant les premières décennies de la présence britannique, c’est surtout à partir de la circulaire sur l’éducation de T. B. Macaulay en 1835 que la langue s’impose davantage au sein de la classe des élites indiennes. Lord G. Curzon, vice-roi des Indes entre 1899 et 1905, plaide plus tard pour un retour à un enseignement dans les langues premières (Sarangapani, 2015: 109). Lorsque l’Inde indépendante s’est dotée d’une constitution en 1950, la place de l’anglais s’est maintenue comme langue officielle au niveau fédéral et dans certains États dans un souci d’apaisement face aux mouvements d’opposition à l’usage du hindi. C’est le cas en particulier dans les régions de langues et cultures dravidiennes. La politique éducative dite des « trois langues » mise en place sous Indira Gandhi peu de temps après la deuxième guerre indo-pakistanaise de 1965 prévoyait un enseignement trilingue dans tous les États indiens, soit en hindi, en anglais et dans une langue locale (Keay, 2010: 529, Sarangapani, 2015: 168). Aujourd’hui, plus d’un demi-siècle plus tard, l’anglais est toujours employé comme langue administrative en Inde (et au Pakistan) et sa présence est toujours aussi prégnante dans le système éducatif. Le sociolinguiste indien R. K. Agnihotri (2018: 104) estime que « la classe moyenne ne voulait jamais sortir de l’anglais et [qu’] ainsi l’anglais est devenu partie intégrante de la mosaïque multilingue en Inde ». La dynamique d’implantation de l’anglais en contexte sud-asiatique postcolonial est toutefois à rattacher au prestige associé à l’image de pouvoir lié cette langue que les élites indiennes proches du pouvoir britannique maîtrisaient. Dès 1965, R. Breton prédisait que le rôle de l’anglais comme « principale langue administrative, juridique, scientifique et technique, [n’était] pas près d’être éclipsé » (1965: 194) en Inde.
Il convient néanmoins d’établir une distinction entre les locuteurs confirmés et indépendants de la langue qui sont en mesure d’en faire un usage professionnel avéré, soit entre 3 et 11% des Indiens (Montaut, 2004: 68), et une grande majorité de locuteurs qui utilisent rarement l’anglais seul mais très souvent dans leur vie quotidienne en combinaison avec leur langue première (hindi, tamoul, marathi, panjabi, népali etc.). C. P. Masica (1991: 49-50) résume cette impression générale par les mots suivants :
La vision de l’anglais dans le sous-continent indien présentée ici laisse percevoir le caractère quelque peu paradoxal de la présence de cette langue. L’anglais est présent de manière généralisée sur un vaste ensemble géographique, mais il s’agit souvent d’une présence superficielle, d’une dissémination sporadique (« sprinkled »). M. Liechty (2006: 3) emploie une métaphore similaire lorsqu’il observe, dès le début des années 1990, la tendance très marquée qu’ont les jeunes des classes moyennes à Katmandou de « poivrer » ou « épicer » (peppering) leurs conversations quotidiennes avec des mots anglais. L’anglais est intégré, voire phagocyté pour nourrir un besoin d’expressivité et de variété dans le discours, mais son usage semble avoir un caractère parcimonieux qui s’inscrit dans une dynamique proprement sud-asiatique et séculaire. C’est ainsi que l’on trouve un certain nombre de triplets lexicaux tantôt vernaculaires, tantôt d’origine arabo-persane, tantôt d’origine anglaise, la plupart du temps employés de manière courante dans la conversation quotidienne. Un Népalais dispose de plusieurs expressions alternatives pour exprimer l’action d’aller « faire des achats » : kinmel garnu11 (vernaculaire indo-aryen), (sāmān) kharid garnu (emprunt persan) ou encore shopping garnu (emprunt anglais). S. Romaine (1989: 131), observant les mêmes possibilités en panjabi, en conclut qu’il s’agit là d’une caractéristique aréale sud-asiatique. Nous verrons toutefois, à l’observation du corpus constitué dans le cadre de cette étude, que l’emploi de l’anglais ne saurait se limiter à de simples aspects d’ordre lexical, surtout dans le cas de conversations en contexte médiatique.
Langues, institutions et société au Népal : quelques éléments d’analyse en termes écolinguistiques
Langue « première », bilinguisme et plurilinguisme
La pluralité ethnolinguistique du Népal
Le dernier recensement national réalisé en 2011 nous permet d’avoir un aperçu global de la pluralité linguistique déclarée au Népal. Une courte moitié (44,6%) de la population népalaise considère le népali comme sa langue première ou « maternelle », adjectif qu’il convient cependant de soumettre à un examen critique lorsqu’on observe les usages quotidiens des langues dans une nation aussi multilingue. Le nombre de langues recensées au Népal, d’après le recensement de 2011, s’élèverait à 123. En termes de nombre de locuteurs, les langues les plus représentées sont les langues appartenant à la branche indo-aryenne de la famille indo-européenne (népali, maithili, bhojpuri, awadhi etc.) et, en seconde position, les nombreuses langues tibéto-birmanes (néwar, tamang, magar, limbu, gurung, sherpa, tibétain etc.). Il existe également des locuteurs de quelques langues austro-asiatiques (santhali, langues munda) et d’une langue dravidienne (kurukh nepali). La langue première est parfois délicate à déterminer dans la mesure où le bilinguisme est fréquent et concerne la majeure partie de la population népalaise comme le rappellent les auteurs d’un rapport de l’UNESCO sur la diversité linguistique au Népal, émis en 2005 après la proclamation de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle :
Bilingualism is prevailing all over the country. In urban areas and wherever there is access to schools, bilingualism is prevalent among young people of all ethnic groups who acquire knowledge of Nepali in school or through work (Toba & Rai, 2005: 14).
La langue première en contexte népalais désigne bien souvent la langue par laquelle un locuteur parvient à s’identifier. Cette notion remplit une fonction de désignation identitaire et se superpose souvent à celle de communauté ethnique. Cependant, en raison de l’omniprésence du népali dans le système éducatif et administratif, ainsi que dans les échanges intercommunautaires, la langue officielle et nationale s’impose comme la langue de communication privilégiée pour les dernières générations de Népalais urbanisés et scolarisés bien des égards, un nombre important de communautés linguistiques au Népal se trouve déjà dans une situation de transfert linguistique (language shift) et l’usage de la langue première décroît considérablement (Toba & Rai, 2005: 15). Certains groupes, en particulier locuteurs de langues tibéto-birmanes, n’emploient presque plus ces langues dans le cadre de la communication quotidienne. C’est le cas par exemple des Chantyals et des Tarangurs (Eagle, 2008a: 187) ou des Gurungs de l’ouest du Népal (Regmi, 1990: 61). En ce qui concerne les groupes dont les pratiques langagières s’apparentent à un bilinguisme fonctionnel (langue première à la maison, népali à l’extérieur), T. A. Ragsdale (1989: 49) juge que le népali « langue seconde » de ces groupes s’éloigne souvent du népali formel et sanskritisé (variété haute) et correspond davantage à un népali d’appoint, oral et communicatif (variété basse).
Depuis les années 1980 se sont mis en place plusieurs mouvements de revitalisation de langues minorées au Népal. L’exemple du néwar (nepāl bhāsā) en est certainement le plus représentatif (Shrestha, 1999 ; Eagle, 2008a: 192) et va souvent de pair avec la revitalisation de certaines formes de bouddhisme (Moronval, 2017), mais c’est aussi le cas pour d’autres langues comme pour le magar avec le mouvement « Nepal Langhali Association » ou le tamang avec le mouvement « Nepal Tamang Ghedung » (Rana, 2008: 85). Ces mouvements reposent sur trois idées principales énoncées par K. P. Malla (1989: 482) : tout d’abord, le principe selon lequel toutes les langues sont considérées comme égales, ensuite celui selon lequel aucune langue ne devrait être promue au rang de langue nationale au détriment d’autres langues, et enfin l’idée que si une « langue de contact » doit voir le jour, cela ne peut se produire que de manière spontanée (« a contact language will emerge on its own ») et l’État ne devrait pas interférer en faisant la promotion de telle ou telle langue. Des tentatives de réaménager une place centrale pour les langues minorées au sein du système éducatif ont été envisagées, notamment pour le néwar dans les années 1990 avec la création d’écoles où l’enseignement avait lieu entièrement dans cette langue (Eagle, 2008a: 192) mais, bien souvent, la loyauté linguistique (au sens de Fishman 1989) se heurte au souci de pragmatisme et aux impératifs financiers des familles qui préfèrent voir leurs enfants étudier en népali ou en anglais (Eagle, 2008a: 197). Ces considérations placent souvent les locuteurs de langues minorées devant un sentiment paradoxal car la pensée du déclin de leur langue, c’est-à-dire d’un moyen d’identification en termes culturels, leur procure malgré tout une forte insatisfaction (Khati, 2013: 88 ; Moronval, 2017: 276).
La relative inopérance de la notion de « langue première » en contexte népalais
La notion de « langue première » est généralement mieux acceptée que celle de langue maternelle » dans la recherche en sociolinguistique. Cette dernière correspond en effet déjà à une préconception identitaire qui impliquerait que la première langue de socialisation pour un individu est celle de sa mère. Dans un cadre familial biculturel ou binational, il arrive cependant qu’un enfant acquière des ressources communicatives bilingues simultanément dans la langue de la mère et dans celle du père. La langue la plus employée dans les échanges familiaux peut aussi, dans certaines sociétés, être uniquement celle du père. L’ambiguïté de cette notion a été signalée par exemple au Rwanda (Niyomugabo, 2014: 149) ou au Sénégal (Dreyfus & Juillard, 2005: 67). Dans le cas d’un mariage interethnique de locuteurs de langues différentes à l’intérieur d’une société patriarcale, la transmission de la langue de la mère à l’enfant n’est pas toujours garantie. En outre, une autre confusion naît souvent de la quasi-universalité du concept de « mère-patrie14 » qui assimile l’État-nation à une figure maternelle. S. Romaine (1989: 21) attire l’attention sur le fait que de nombreux immigrés pakistanais au Royaume-Uni décrivent l’ourdou (langue officielle du Pakistan) comme leur langue maternelle, quand bien même ceux-ci ne parlent que le panjabi dans leur environnement familial quotidien. Ces exemples nous confortent dans l’intention de raisonner en termes de pratiques et de ressources langagières, et non pas strictement de langues. Plutôt que de chercher à isoler la langue maternelle, O. García (2009a: 58) propose par ailleurs de décrire ces processus comme des « pratiques langagières en milieu familial » (« home language practices »).
Parler de « langue première » peut au premier abord paraître plus neutre, au regard des problèmes posés par l’expression de « langue maternelle ». Il s’agit là d’une perspective qui associe des adjectifs numéraux ordinaux aux langues en fonction de leur ordre d’acquisition par le locuteur. Ces adjectifs nous semblent néanmoins peu propices à un emploi au pluriel lorsque l’on cherche à décrire la teneur du répertoire langagier d’un individu plurilingue ayant acquis des ressources communicatives simultanément. L’utilisation d’une telle expression expose également à des risques d’ambiguïté, comme c’est le cas dans le constat suivant :
In Asian countries such as Nepal, India, Pakistan and China, speakers who are bilingual usually have English as their second language (L2) and their first language (L1) is their mother tongue and dialect (Bista, 2010: 2).
L’auteur choisit de caractériser la « langue maternelle », dont nous sommes en droit de supposer qu’il faut entendre ici la langue de la patrie, et le « dialecte » (langue du contexte familial) comme des sous-catégories de la « langue première ». Quant à la « langue seconde », celle-ci correspond à une autre langue que le locuteur s’est appropriée dans un contexte de scolarisation (ici l’anglais). Une telle classification repose donc essentiellement sur la distinction entre acquisition et apprentissage. Dans le cas du Népal, le népali peut toutefois correspondre à une langue de scolarisation (L2) et n’être pas employée dans les échanges en contexte familial. Et à l’inverse, une langue supposément « première » peut n’avoir jamais été parlée par un locuteur mais être liée de manière indissociable avec son appartenance ethnique. Cela donne parfois lieu à des représentations socio-langagières rattachées à une perception ostracisante et peut générer un refus assumé de contribuer à la préservation de la langue en question :
Younger people from minority language communities sometimes feel humiliated with their own ethnic identity and they use Nepali and English at different social contexts. It ultimately leads to the neglect of their mother languages (Khati, 2013: 87).
A. R. Khati a étudié les représentations socio-langagières auprès de groupes d’étudiants locuteurs de langues minorées du Népal (tamang, magar, hayu, sunuwar, majhi, néwar) et a observé que les enquêtés ne témoignent que très peu d’intérêt envers les langues associées à leurs ethnicités. Il précise également que le refus de parler dans ces langues correspond à une tendance qui gagne également le milieu familial (« The trend of not using mother tongue, not only in wider social contexts but also at home, is increasing », 2013: 77). La désignation de « langue première », pour toutes les raisons qui viennent d’être énoncées, ne permet pas selon nous de décrire de manière satisfaisante la complexité des répertoires langagiers et les représentations qui leur sont associées dans la société népalaise contemporaine.
D’autres outils descriptifs, issus également de travaux en acquisition du langage (The Douglas Fir Group, 2016) mais comportant un degré de flexibilité supérieur, peuvent être mis ici à contribution. Il s’agit de la distinction entre, d’une part, langue(s) initiale(s) et, d’autre part, langue(s) additionnelle(s). Ces catégories nous semblent renfermer moins de présupposés et s’accommodent plus aisément de la marque du pluriel. Elles traduisent également mieux la nature de l’expansion des ressources du répertoire langagier des locuteurs plurilingues : celle-ci a lieu de manière holistique et les langues sont parfois acquises simultanément. Nous proposons, afin d’en renforcer la portée et toujours dans le souci de décrire les phénomènes langagiers en termes dynamiques, d’employer les désignations de ressources langagières initiales et de ressources langagières additionnelles.
Il importe cependant de veiller à articuler constamment des éléments d’analyse à la fois micro et macro-sociolinguistiques afin d’appréhender les pratiques langagières mixtes népali-anglais de manière multidimensionnelle. Il nous faut alors repasser momentanément, dans les paragraphes qui suivent, à un point de vue qui est celui des « langues » et des politiques linguistiques. Quelques précisions d’ordre socio-historique vont ainsi nous permettre d’apporter un éclairage sur le rôle central du népali dans l’idéologie nationale népalaise.
Le népali : une lingua franca des régions centrales du flanc sud de l’Himalaya
Le rôle du népali dans la formation de l’État-nation népalais
Le népali s’est imposé comme langue de la nation népalaise depuis l’unification du pays dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Au cours des siècles qui ont suivi, plusieurs régimes politiques ont continué d’affirmer son rôle de langue unificatrice d’une nation encore en formation, en particulier le régime des premiers ministres Rānā (1846-1951) et les années du Panchayat (1961-1990). Aujourd’hui, le népali est devenu la langue véhiculaire et administrative dominante au Népal.
Le « Népal » était à l’origine un mot utilisé pour désigner un territoire plus restreint, concentré autour de la vallée de Katmandou, et dont les premiers habitants à avoir constitué une société urbaine étaient les Néwars. Cette communauté parle encore aujourd’hui une langue tibéto-birmane qui a la particularité d’avoir un lexique enrichi de très nombreux apports sanskrits. Cette langue, le néwar, était désignée également par une autre appellation, celle de nepāl bhāsā, littéralement la « langue du Népal ». En revanche, la langue que l’on appelle népali de nos jours était celle d’un peuple vivant à l’ouest de la vallée de Katmandou dans le royaume de Gorkha. Cette langue indo-aryenne était alors désignée par les noms de gorkhāli ou de khas15 kurā, voire khay bhay dans la langue des Néwars (Hutt, 1988: 29). Peu après la conquête de la vallée de Katmandou en 1768, le roi gorkhali Prithvi Narayan Shah fit transférer le pouvoir central dans la capitale actuelle. Le modèle culturel et les institutions des Gorkhalis se diffusèrent ensuite rapidement dans la vallée et dans les autres royaumes voisins qui furent rattachés à celle-ci. Leur langue s’imposa alors comme langue nationale et sa place centrale dans l’administration se renforça encore pendant les siècles suivants.
Après le coup d’État perpétré par Jang Bahādur Rānā en 1846, plus connu sous le nom de « massacre du Kot16 », le gouvernement autoritaire des Rānā adopte des mesures particulièrement répressives à l’égard des minorités linguistiques. Une volonté concertée d’imposer le népali marque le début de la mise en place d’un modèle d’assimilation linguistique qui se poursuit jusqu’à la chute de ce régime en 1951. C’est plus précisément à partir de 1905, année pendant laquelle la langue gorkhāli prit le nom de népali (Shrestha, 1999: 87), que toute une série d’efforts furent mis en œuvre pour standardiser la langue nationale (réalisation de dictionnaires, ouvrages de grammaire). Le nom donné à cette langue témoigne, comme le démontre P. B. Phyak (2016: 107) de l’influence de l’idéologie occidentale de l’État-nation qui fonde l’identité nationale en partie sur une « communauté imaginée » (au sens d’Anderson 1983) de locuteurs d’une langue nationale. Les très nombreuses autres langues du Népal, en revanche, commencèrent à être perçues par le pouvoir dominant comme une menace à l’unité de la nation et certaines furent interdites dans le domaine public (médias, expression artistique et littéraire etc.). Les mots de l’historien S. Lévi, observateur direct du Népal de cette période, illustrent de manière expressive la place occupée par le népali à l’aube du XXe siècle : il a refoulé les langues tibétaines des vallées, et couvrait déjà tout l’Himalaya inférieur, à l’ouest du Népal, au temps de Prithvi Narayan. […] La conquête gourkha l’a introduit dans la vallée centrale, où le névari, plus vigoureux que ses voisins, le tient encore en échec ; mais la centralisation du gouvernement assure son triomphe ; il est la langue des rares écoles, et aussi des communications officielles ; s’il n’est pas encore parlé partout, il est compris plus ou moins d’une extrémité à l’autre du royaume ; les soldats gourkhas l’ont porté jusqu’à la frontière du Sikkim, jusqu’aux abords de Darjiling (Lévi, 1905: 276).
Après la chute du régime en 1951, une première tentative de gouvernement démocratique eut lieu pendant une décennie sous l’influence du roi Tribhuwan. Une plus grande attention fut alors accordée à la question de la pluralité linguistique et d’autres langues que le népali furent utilisées dans les médias (Shrestha, 1999: 90). Mais des désaccords entre les différents partis nouvellement établis amenèrent le roi Mahendra, fils de Tribhuwan, à modifier en profondeur le régime politique en 1961.
Le rapport de stage ou le pfe est un document d’analyse, de synthèse et d’évaluation de votre apprentissage, c’est pour cela chatpfe.com propose le téléchargement des modèles complet de projet de fin d’étude, rapport de stage, mémoire, pfe, thèse, pour connaître la méthodologie à avoir et savoir comment construire les parties d’un projet de fin d’étude.
|
Table des matières
INTRODUCTION GÉNÉRALE
PREMIÈRE PARTIE : CONTEXTUALISATION DE L’ÉTUDE ET CADRAGE THÉORIQUE
1. Contexte socioculturel et sociolinguistique
1.1. Remarques préliminaires sur le fait linguistique dans les sociétés sud-asiatiques
1.2. Langues, institutions et société au Népal : quelques éléments d’analyse en termes écolinguistiques
1.3. Espace(s) socio-langagier(s) et terrain(s) de recherche
2. Cadre théorique et conceptuel
2.1. Considérations introductives
2.2. Les approches interactionnistes
2.3. La linguistique praxématique
2.4. Vers un dépassement de la notion de frontière
3. Problématisation
3.1. Le sujet dans son espace langagier
3.2. Propositions exploratoires
DEUXIÈME PARTIE : DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE ET DESCRIPTION DU CORPUS D’ÉTUDE
1. Posture épistémologique
1.1. Une démarche ethnographique, qualitative et empirico-inductive
1.2. Le chercheur extérieur à l’espace socio-langagier observé
1.3. L’intégration de la perception de la recherche par les locuteurs
2. Collecte et traitement des observables
2.1. Paramètres recherchés
2.2. Pour une diversification des observables
TROISIÈME PARTIE : ANALYSE DES OBSERVABLES
1. État des lieux des pratiques déclarées et des représentations associées
1.1. Résultats de l’enquête par questionnaires en milieu scolaire
1.2. Réponses aux questions ouvertes du questionnaire
1.3. Entretiens exploratoires et exemplarité expérientielle
2. Procédés récurrents impliqués dans le maillage des ressources communicatives
2.1. Aspects sonores
2.2. Syntaxe et morphosyntaxe
2.3. Lexique
3. Stratégies de négociation, processus identificatoires et construction translingue du sens social
3.1. Quelques éléments de réflexion autour de la notion de « confort de parole »
3.2. Translocalisation et manipulation de la charge socio-culturelle du matériau langagier
3.3. L’ancrage du sujet parlant dans le réel et la stylisation du dicible
CONCLUSION GÉNÉRALE
BIBLIOGRAPHIE
Télécharger le rapport complet