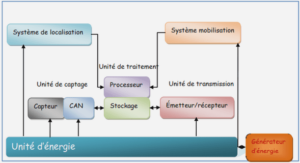Les sciences sociales, l’espace et les mouvements sociaux : un état des savoirs
Dans ce chapitre on va présenter les différentes théories mobilisées par ce travail, en s’arrêtant tout d’abord sur les théories notamment sociologiques, qui ont amené à la définition des « mouvements sociaux » et de « politiques contestataires » en tant que catégories d’analyse.
Par la suite nous allons regarder une typologie spécifiquement urbaine de mouvements sociaux, en montrant l’émergence de cette dimension spatiale particulière, tant dans la production scientifique que dans le plan empirique.
Pour conclure, la partie finale du chapitre, sera dédiée à l’analyse des liens entre l’espace et les politiques contestataires. Le bagage théorique et conceptuel présenté dans cette partie est particulièrement relevant, pour le fait que la notion d’espace, dans sa complexité, occupe une place particulièrement centrale au sein de ma recherche.
Des éléments relatifs au développement théorique de ma problématique de recherche seront également développés dans ce chapitre.
La théorie des mouvements sociaux
Le politiste et sociologue français Erik Mathieu définit les mouvements sociaux en tant que « forme d’action collective concertée en faveur d’une cause » ; pour lui « il s’agit d’un agir ensemble intentionnel, marqué par le projet explicite des protagonistes de se mobiliser de concert. Cet agir-ensemble se développe dans une logique de revendication, de défense d’un intérêt matériel ou d’une “cause”» (Neveu, 2005, cité dans Starck, 2005, p.85).
Cependant, ce terme n’a pas toujours été mobilisé par les sciences sociales. En effet, de manière générale, on peut identifier un tournant majeur dans l’étude de ces phénomènes quand l’approche en termes de « foules » et de « comportements collectifs », dominé par une interprétation des contestations comme des phénomènes largement irrationnels, a été abandonnée au profit d’approches articulées en termes de « mouvements sociaux », « mobilisations protestataires » ou encore « d’action collective » (Le Saout, 1999).
La naissance de la « Théorie des Mouvements Sociaux », peut être faite remonter à quand on assiste, à partir de la fin des années 1960, à l’émergence des mouvements contestataires marqués par une forte discontinuité avec les mobilisations ouvrières qui avaient dominé lepanorama politique radical occidental jusque-là. D’un point de vue conceptuel, ces changements impliquent la nécessité d’élaborer des nouveaux schèmes théoriques. Plusieursthéories se développent ainsi, notamment entre la France et les Etats-Unis (Staricco, 2012).
Alain Touraine, est un des initiateurs de la théorie des Nouveaux Mouvements Sociaux (NMS).
Cette théorie, malgré ses limites en termes de compréhension globale du phénomène, se révèle particulièrement intéressante pour son approche comparative et historique (Pruijt, 2013). Selon cette théorie, le passage de la « société industrielle » à la « société postindustrielle », se caractérise, du point de vue empirique, par la crise du marxisme « orthodoxe » au sein des mobilisations sociales, qui se traduit sur le plan théorique, par le dépassement de l’hégémonie du matérialisme historique au sein des penseurs radicaux, laissant la place à ce qu’Inglehart a appelé l’approche « postmatérialiste » (Inglehart, 1977; Mathieu, 2007; Staricco, 2012). Cette théorie voit la « culture » comme élément principal des revendications des NMS, qui abandonnent ainsi la sphère économique pour se lancer sur des thématiques spécifiques liée notamment à l’identité. Les bases théoriques de cette approche peuvent être trouvées notamment dans la « théorie de l’action communicative » d’Habermas, ou des critiques à l’économicisme marxiste proposés par des intellectuels comme Michel Foucault (Staricco,2012).
Cependant, cette théorie, malgré sa valeur « historique », rencontre nombreux limites dans une situation où les enjeux et les pratiques des mouvements sociaux ont radicalement changé. En effet, comme souligné par Della Porta (2001) ou Chatterton (2010), dans les dernières décennies on a assisté à un retour des thématiques économiques et du travail et à une nouvelle centralité des processus consensuels et de démocratie directe (Risanger, 2012).
Pour expliquer les phénomènes contemporains, les théories rassemblées sous le nom de Théorie du Processus Politique (TPP) (Neal, 2007) – et qui peuvent être vues comme bases de la « sociologie des mouvements sociaux » (Revillard, 2003) – paraissent les plus adaptées à la tâche.
Cette approche théorique a été nourrie notamment par les travaux de Charles Tilly, Tarrow et McCarthy (Neal, 2007). L’ouvrage From Mobilization to Revolution de Tilly (1978) peut être considéré comme le travail fondateur de cette école (Neal, 2007). McAdam, McCarthy et Zald, dans l’ouvrage Comparative perspective on social movements. Political opportunities, mobilizing structures, and cultural framings (McAdam, McCarthy, & Zald, 1996), présentent « les trois grands facteurs permettant de rendre compte de l’émergence et du développement de ces mouvements : les structures de mobilisation, les opportunités politiques et les processus de cadrage » (Revillard, 2003). A ces trois éléments – dont les opportunités politiques constituent l’élément plus marquant tant d’être souvent utilisé comme synonyme de TPP – se sont ajoutés également les concepts de « cycles de proteste » (protest cycles) et de « répertoirecontestataire » (repertoire of contentious) (Neal, 2007).
Le premier, développé au sein de la théorie de la « Mobilisation des Ressources », prône une « étude des protestations comme formes rationnelles produites par l’action d’organisations [et] rompt ici clairement avec les analyses des foules comme comportements irrationnels » (Le Saout, 1999). Développée notamment par McCarthy, cette théorie donne une grande centralité au rôle des organisations et à leur structure, et marque le pas par lequel les chercheurs commencent à s’interroger non seulement du « pourquoi » des mobilisations mais aussi du « comment » (Revillard, 2003).
Les mouvements (sociaux) urbains et le « droit à la ville »
A partir du tournant politique et théorique représenté par les mobilisations de la fin des années 1960, les chercheur.e.s ont commencé à prendre en compte la dimension spécifiquement urbaine de certains mouvements sociaux.
Manuel Castells a été parmi les premiers à avoir abordé la question de « l’économie politique du développement urbain et les conflits d’intérêts » qui en découlent (Pruijt, 2007) et à proposer une définition des mouvements qui s’y opposent. Dans son ouvrage The urban Question (1972), il reste attaché à une vision assez ‘orthodoxe’, affirmant que « l’impact social » de ces mouvements dépendrait de leur affiliation avec des « organisations dans le conflit de classe inhérent à la sphère productive » (Pruijt, 2007, p. 5117). Dans son ouvrage majeur, The city and the grassroots: a cross-cultural theory of urban social movements (1983), il se rapproche au contraire, de la ligne théorique des « Nouveaux Mouvements Sociaux », et de l’œuvre d’auteurs comme Foucault, Touraine et Melucci (Brun, 1986; Castells & Kumar, 2014). C’est ainsi que sa définition classique des « Mouvements Sociaux Urbain », se caractérise par une mise en avant du caractère « culturel » et « identitaire » de ces mouvements (Mayer, 2006a). Si l’utilisation de l’adjectif « social » parait superflue pour certains auteurs, comme par exemple Pickvance (Pruijt, 2007), Castells, de son côté, a défini spécifiquement quelles conditions devaient remplir les « mouvements urbains » pour être qualifié en tant que MSU. En effet, le sociologue réserve la qualification de « sociaux », exclusivement à ces mouvements urbains « qui combinent des luttes pour un usage collectif amélioré avec des luttes pour la culture de la communauté ainsi que pour l’autodétermination politique » (Mayer, 2006b, p. 202). Pour lui, il est donc possible de définir « sociaux », exclusivement ces mouvements urbains qui seraient « multi-dimensionnels » (multi-issue) et qui poursuivraient donc ces trois enjeux qui, encore aujourd’hui, se révèlent particulièrement représentatifs de ce type de mobilisation (Mayer, 2006a; Pruijt, 2007), y compris celle de mon cas d’étude.
Effectivement, les enjeux individués par Castells, même à l’épreuve de « la globalisation et de la restructuration capitaliste », se révèlent assez « prophétiques ». Cela est vrai notamment concernant l’enjeu de « l’usage collectif » des ressources, des biens et des services -revendication centrale dans un contexte contemporain marqué par la privatisation du « secteur public » – ou la « contestation du pouvoir de l’état », par rapport à son rôle dans l’application des politiques (néo)libérales mais aussi par rapport à la captation édulcorée des instances des mouvements à travers « la mode des discours sur l’engagement citoyen » (Mayer, 2006b, p. 204).
Si la nature « locale » de ces mouvements, qui ressort de la définition de Castells, semble décrire des mouvements incapables à transformer radicalement la société – et notamment les sphères productives, de la communication et du gouvernement – ils seraient capables, cependant, à transformer les « signifiés urbains » (urban meanings). Par cela, Castells entend la possibilité de « produire une résistance à la domination », capable de produire des « utopies réactives » (Pruijt, 2007), qui viserait à miner les bases hiérarchiques de l’organisation sociale de la vie urbaine revendiquant, à l’opposé, « une ville organisée sur la base de la valeur d’usage, les cultures locales autonomes et la démocratie participative décentralisée » (Mayer, 2006a).
Le débat autour de « l’impact » de ces mobilisations sur le « changement social », par rapport à leurs enjeux et, surtout, à leur « échelle », caractérise une bonne partie des travaux qui, depuis, ont été mené dans les sciences sociales et particulièrement en sociologie (Pruijt, 2007; Purcell, 2009). Les rapports entre les MSU et les institutions (locales), peu pris en compte par Castells, méritent aujourd’hui une plus grande attention selon Mayer (2006), à la lumière du fait que leur perte de pouvoir en a mitigé le « caractère d’antagonistes directs pour les mouvements urbains » (p.205).
D’autres auteurs, tout en reconnaissant la valeur du travail de Castells en tant « qu’outil conceptuel » dans la compréhension du fonctionnement et des enjeux de ces mouvements, en soulignent le manque d’attention envers le contexte. Nombreuses études ont donc été menées en cherchant à comprendre les autres facteurs qui ont un rôle dans l’émergence, le déroulement et les impacts des mouvements urbains, mobilisant d’autres approches issus de la théorie générale des mouvements sociaux. Ainsi le facteur de « l’état de privation » (state of deprivation), de la « mobilisation des ressources », et, surtout de la « political opportunity structure » ont été adoptés au fil des années, dans l’étude des mobilisations urbaines (Pruijt, 2007).
Un terrain « militant » : méthodologie et réflexivité
Dans ce chapitre je vais présenter le déroulement du terrain de recherche et les questionnements que cette expérience m’a poussé à me poser. Par la suite, je proposerai un rapide panoramique des techniques par lesquelles cette recherche a pu être réalisée.
En dernière instance, ce sera la question du rapport à l’objet de recherche, de mon positionnement épistémologique et politique, afin de présenter les éléments nécessaires à la compréhension de l’analyse ici présentée.
Spécificités du terrain
Le terrain de recherche a eu lieu entre février et août 2016. Le choix a été le fruit d’une série de contingences qui m’ont amené à participer, en observant, à la naissance et au développement de la mobilisation Decide Roma, Decide la Città .
Mon idée initiale était de faire une recherche sur les centri sociali (centres/espaces sociaux), ces lieux occupés qui en Italie, et à Rome en particulier, sont très nombreux et très actifs dans les territoires et dans la scène culturelle. J’ai milité pendant quelques années avant d’arriver àParis, dans l’un d’entre eux, Communia dans le quartier de San Lorenzo. La conviction que ces espaces constituent une sorte de « contre-pouvoir » politique et culturel dans la planification et production de la ville me poussait à vouloir enquêté sur cette réalité depuis désormais assez longtemps.
Sauf que, en arrivant à Rome et en recommençant à fréquenter Communia, je me suis trouvé devant quelque chose qui n’existait pas au moment où j’avais quitté Rome pour Paris. C’était la Rete per il Diritto alla Città (DaC – réseau pour le droit à la ville). Considérant le fait que je voulais étudier le rapport entre les espaces sociaux et la ville je me suis dit que je devais suivre les réunions de ce groupe.
La sensation que j’ai eue quand j’ai commencé à bien comprendre de quoi traitait le DaC, a été de surprise. Les espaces-mêmes étaient en train de produire collectivement la réflexion que je voulais produire singulièrement à travers ma recherche. A travers le Réseau pour le Droit à la Ville, en effet, chaque espace mirait à aller au-delà de sa propre situation spécifique pour sortir de ses propres murs afin de réfléchir et agir ensemble sur la ville.
J’ai donc décidé de suivre toutes les réunions de ce réseau inter-espaces et j’ai commencé à connaitre aussi les activistes des autres espaces sociaux que je connaissais seulement de vue ou que je ne connaissais pas du tout. Outre ces réunions, je suivais aussi toutes les autres internes à Communia, devenant ainsi – même pour ceux qui ne me connaissaient pas – « Simone di Communia », donc une des personnes qui suivait le DaC pour mon collectif/espace, Communia. Avec le passage à Roma Non Si Vende (RNSV) et par la suite à Decide Roma Decide la Città (DR), la mobilisation autour des thèmes qui étaient d’abord soulevés exclusivement par le DaC a atteint une ampleur et une ambition inattendue. A ce moment-là, il était devenu clair pour moi que cette mobilisation n’était pas seulement un des nombreux projets menés par les espaces sociaux, mais quelque chose qui, si bien conduit, aurait pu véritablement marquer une étape historique pour les expériences de l’autogestion à Rome. Le fait que ce processus s’était accéléré sous mes yeux, pendant mon terrain, et qui avait tout d’un coup acquis beaucoup de centralité dans l’activité de tout le monde – même des autres de Communia – m’a de facto convaincu que je devais profiter de ce moment et regarder de près, sinon de l’intérieur, le déroulement d’une métamorphose historique du monde de l’autogestion romaine.
Et cela a produit un changement de perspective : il ne s’agissait plus d’étudier des lieux qui existaient déjà et d’en comprendre l’impact sur la ville au statut actuel, mais d’étudier ce que les personnes qui animent ces espaces voulaient faire pour accroitre leur impact sur la ville, au travers même de sa propre remise en cause, à travers un travail sur soi-même. En d’autres mots, mon terrain a été bouleversé par la prise de conscience de m’être trouvé dans une temporalité privilégiée pour comprendre l’évolution des expériences autogérées romaines, impliquant cependant un changement d’objet, une nouvelle entrée par laquelle affronter ma problématique.
Posture et positionnement : une recherche (géographique) « engagée »
Cette recherche n’a pas seulement comme objectif de produire un travail académique, mais, également, de produire des matériaux qui puissent être utiles au(x) mouvement(s) comme éléments d(’auto)critique et réflexion et qui puissent aussi être un témoignage, l’archive d’une histoire qui pour la nature grassroots de ses acteurs et de ses modalités risquerait sinon d’être très fragmentée ou même de tomber dans l’oubli. Le grand recours au web par ces mouvements risque en effet de ne pas être suffisant pour la tâche, considérant la grande fragmentation des sources et des formes des restitutions numériques, outre un manque d’automatisme du compte rendu qui a été un élément fréquent des autocritiques méthodologiques des activistes. Pour cette raison, je m’excuse déjà avec le lecteur.e, si la partie dénommée « histoire de la mobilisation » peut sembler trop longue et ennuyante, mais c’est justement sa valeur de première (et probablement quasi-unique) histoire de cette expérience – qui risque d’être éphémère et oubliée dans sa progression – qui m’a fait me sentir autorisé à concéder autant d’espace. (Outre bien sûr son importance pour bien cerner les dynamiques analysées). L’histoire de ce type de mobilisation – comme témoigné par ma recherche infructueuse sur des précédents – est rarement mise noir sur blanc et reste quasi toujours reléguée à la transmission orale.
Si je tiens autant à cette histoire et à cette expérience que j’ai suivi intensément pendant sept mois, c’est aussi parce que je crois beaucoup à l’importance de confronter et prendre exemple des expériences de mobilisation et d’activation politique. Cette recherche vise donc aussi, pour le futur proche et à longue terme, à être aussi une modeste boite à outil pour les mouvements.
Comme le lecteur.e aura déjà bien compris, cette recherche est effectivement une recherche engagée, ce qui ne signifie pas pour autant qu’elle n’est pas une recherche critique. Au contraire, une des raisons pour laquelle j’ai trouvé cohérent de mener cette recherche était d’être le plus (auto)critique possible, de ne pas avoir peur de parler des choses qui ne marchent pas ou que je trouve mal faites, injustes ou peu transparentes. C’est une attitude que je me suis donné comme garantie de la scientificité de mon travail mais aussi de cohérence avec mes propres convictions.
De plus, comme a bien montré Fabrice Ripoll, « il est en revanche très difficile d’imaginer ce que pourrait être un chercheur qui ne serait pas ‘militant’ ou ‘engagé’ d’une façon ou d’une autre » (2006, p.1). Chaque point de vue est en effet, la théorie féministe enseigne, un point de vue bien situé, et jamais neutre (Collins, 2009).
Comme j’ai déjà partiellement expliqué à propos de la PO, je crois avoir su tenir un bon équilibre entre immersion et recul, même si à des moments différents, mais je crois que cela aurait été nécessaire dans l’étude des mouvements sociaux, comme dans n’importe quel autre thématique.
L’étude des mouvements sociaux se caractérise souvent par une implication et un engagement du chercheur (Pruijt, 2007). Cette connotation d’engagement n’est pas nouvelle non plus au sein de la géographie où des branches entières se revendiquent intrinsèquement engagées.
Malgré les difficultés que, pour mon propre parcours personnel caractérisé par un certain nomadisme académique, j’ai rencontrées à me situer dans une discipline, revendiquant au contraire une approche transdisciplinaire témoignée aussi par la pluralité de spécialistesmobilisés pour cette recherche (politistes, juristes, anthropologues, sociologues, urbanistes, ingénieurs, géographes etc), je crois important de situer ce travail à l’intérieur d’une tradition géographique particulière.
En effet, l’indéniable attention portée dans cette recherche à la « dimension spatiale » de la société et de ce phénomène – qui lui-même se caractérise par une centralité de l’approche spatiale dans l’action sociale – me pousse à placer cette recherche à l’intérieur de la « géographiesociale » et à la fois de celle qu’aujourd’hui on appelle la « géographie critique » ou, encoreplus spécifiquement, la « géographique critique de l’urbain » (Giroud & Gintrac, 2014).
La géographie sociale, prise par le côté du tournant dimensionnel, impulsé par le travail d’auteurs comme Vincent Deschambres ou Fabrice Ripoll, rompt en effet avec la tendance à concevoir l’espace en disjonction avec la société, pour promouvoir une prise en compte de l’espace en tant que « dimension » de la société, au même titre par exemple du temps (Ripoll, 2006; Veschambre, 2006). Il s’agit alors pour la géographie de ne pas questionner le « rôle de l’espace », en tant que « facteur » déterminant le social, mais plutôt de comprendre la« dimension spatiale de la société » à partir du constat que « il n’y a rien de social qui ne soit pas spatial, le social est toujours déjà spatial » (Ripoll, 2006, p.201). « L’approche dimensionnelle » proposée par Ripoll, est « donc d’abord une intention, celle de sortir de la disjonction (du dualisme) espace/société et de la contradiction qu’elle participe à forger » (Ripoll, 2006, p.205). Une approche capable de sortir du déterminisme spatial et du déterminisme rationnel qui pourrait découler d’une théorie des acteurs qui ne prennent passuffisamment en compte le contexte. Une voie, celle proposée par Ripoll, et que j’ai également cherché à adopter, qui puisse « prendre le point de vue des ‘acteurs’, sans oublier qu’il n’est qu’une vue partielle et partiale sur le monde, mais une vue réelle et potentiellement performative, donc prendre au sérieux leur subjectivité tout en la situant dans l’espace et dans le temps » (Ripoll, 2006, p. 205).
Pour ce qui concerne la « géographie critique », elle se succède à la « géographique radicale » des années 1960-70 – bien plus centrée sur une approche « explicitement marxiste », donc largement économique – et, à travers une pluralité d’approches, s’attaque aux « théories hégémoniques issues du néolibéralisme (compétitive, classe créative, régénération urbaine) et contre leur mise en pratique dans le cadre des politiques urbaines métropolitaines » (Giroud &Gintrac, 2014, pp. 14–15). La géographie critique, pour ses thèmes et ses enjeux sociaux et scientifiques, est donc le champ dans lequel cette recherche s’insère.
L’espace et la politique à Rome : éléments de mise en contexte
L’espace urbain de la ville de Rome est le théâtre de la mobilisation Decide Roma, decide la città, le cas d’étude de cette recherche. Dans cette partie seront donnés les éléments de mise en contexte visant à éclaircir certains aspects particulièrement marquants pour la compréhension de mon analyse.
Les dynamiques de pouvoir qui s’exercent sur (et par) l’espace urbain seront le prisme par lequel on présentera deux caractéristiques qui marquent profondément l’environnement politique et culturel de la capitale auquel se réfère cette étude.
En premier lieu, nous allons regarder quelles dynamiques politiques et spatiales ont façonné la capitale italienne, qui aujourd’hui vit une forte crise économique, institutionnelle, culturelle et sociale. Les mécanismes concernant l’urbanisation et la gestion des territoires – marqués par un laissez-faire de part les institutions – auront une centralité particulière dans cette première partie.
Par la suite, à travers le prisme de ce laissez-faire, on affrontera le côté positif de l’anarchie urbanistique romaine : le détournement de ces contraintes qui a permis l’émergence d’importantes pratiques d’auto-organisation et autogestion des territoires.
Conscient que ces éléments de mise en contexte pourraient ne pas être suffisants, j’ai retenu nécessaire d’annexer à ce travail un petit glossaire avec les termes les plus marquants et les plus utilisés dans cette recherche, afin de permettre au lecteur de se repérer au mieux le long de ce texte.
Les politiques (urbaines) à Rome : l’espace urbain comme marchandise
Rome est une ville très complexe. Il suffit de regarder un plan pour s’en rendre compte. Sa particularité est évidente, déjà dans sa morphologie urbaine qui relève à un œil attentif les dynamiques de pouvoir qui l’ont façonnée et qui, encore aujourd’hui, en conditionnent l’identité et le développement.
Ville très étendue, bien plus que Paris, la surface de la ville de Rome pourrait contenir en son intérieur toutes les cinq premières villes italiennes. A cette étendue gigantesque ne correspond pas une population aussi grande . En effet, ni le nombre de ses habitants ni son dynamisme culturel et économique en font une métropole de premier rang.
La caractéristique plus évidente de la morphologie de Rome est son extraordinaire fragmentation, l’irrationalité qui parait, regardant un plan de la ville, caractériser sa forme et son développement. Tant fragmenté de paraitre un archipel aux formes sinueuses : des îles de béton dans une mer qui – une fois – était une campagne constellée de ruines archéologiques et qui désormais, s’est réduite peu à peu d’une série infinie de friches, chantiers et campagne polluée.
Comme nombreux auteurs ont souligné (Erbani & De Lucia, 2016; Guareschi & Rahola, 2015; Pasquinelli D’Allegra, 2006), la forme de la ville parle. Dans le cas de Rome, elle raconte une histoire de pouvoir bien précise. Une histoire qui voit primer, avec beaucoup de désinvolture, une structure économique et entrepreneuriale basée sur le bâtiment, et pour laquelle donc,l’espace constitue une véritable marchandise, une ressource sur laquelle faire du profit (Fig.1).
Decide Roma, une plateforme collective pour la construction une alternative urbaine d’autogouvernement métropolitain
Cette partie du travail est consacrée essentiellement à l’analyse des matériaux recueillis pendant mon terrain. Il s’agit de comprendre la mesure dans laquelle les mouvements sociaux urbains romains peuvent conditionner et ré-signifier l’apparat politique local, à travers un « saut d’échelle » (scale jumping) (Sewell, 2001), en adaptant donc, leur propre mode de fonctionnement – « l’autogestion » – aux autres échelles spatiales qui les concernent, à partir de la ville et, en perspective, jusqu’au global. Une « politique scalaire », donc, qu’il ne faut pas cependant comprendre dans des termes unidimensionnels, mais dans une dynamique d’imbrication de différentes stratégies spatiales (Leitner, Sheppard, & Sziartot, 2008).
Dans tous les cas, cet ambitieux changement d’échelle implique, cependant, d’élargir la communauté active au-delà de ses délimitation actuelles. Comprendre comment la mobilisation s’est formée, qui la compose et comment elle vise à s’élargir ultérieurement est donc particulièrement important.
Par la suite, les thématiques et les perspectives politiques de « Decide Roma » seront au centre de l’analyse, cherchant à comprendre quelles sont les modalités par lesquelles, cette plateforme hétérogène mire à conditionner et transformer la gouvernance urbaine à travers une généralisation de l’autogestion sous la forme de l’autogouvernement des quartiers et duterritoire.
Les enjeux sont particulièrement intéressant à comprendre dans une perspective géographique parce que, à travers une remise au centre de l’espace urbain, de sa fruibilité et de son accessibilité, les activistes proposent une conceptualisation (« multi-scalaire ») du changement social qui va au-delà de la simple question locale, mais vise au contraire à influencer le mode de fonctionnement de la société comprise au sens large.
La dimension géographique locale de la question, donc la ville de Rome, est particulièrement importante, parce que le terrain de jeu est le territoire, la ville, le quartier, entendu comme prétexte, levier, objet des politiques et des mobilisations qui en découlent.
La partie se joue au même temps sur le plan des institutions de la ville, de leur rapport aux mouvements sociaux, à la citoyenneté, et de leur fonctionnement, que les activistes proposent à revoir dans une perspective « dialectique ». La stratégie que les activistes proposent va au- delà de « l’antagonisme » auquel leur milieu politique était traditionnellement rattaché, pour parcourir la voie de la « lutte institutionnelle » (institutional struggle cf. Lopes De Souza, 2010), comme outil visant à légitimer d’un point de vue législatif les pratiques « autonomes » d’autogouvernement que les activistes se proposent d’impulser à travers une ouvertureultérieure de leur « activisme social » envers les quartiers et la ville toute.
Composition et fonctionnement de la mobilisation
« Decide Roma, Decide la Città » (DR) est une plateforme revendicative et organisationnelle autour de la gestion de la ville et des politiques municipales. C’est une plateforme issue de la lutte conjointe d’un groupe – aux frontières perméables – de centres/espaces sociaux, qui s’étaient déjà coalisés autour de différents fronts et spécifiquement autour de « Réseau pour le Droit à la Ville » (Rete per il Diritto alla Città), qui s’est « dissolu » en DR, avec d’autres espaces/sociaux qui s’étaient « perdus des radars », des groupes des mouvements sociaux et un groupe très varié d’associations et de travailleurs mobilisés. De manière générale, on peut définir ses acteurs comme étant issus de « l’espace des mouvements sociaux » (Mathieu, 2007). Plus spécifiquement, il s’agit surement de « mouvements urbains » (Pruijt, 2007) ou encore « mouvements sociaux urbains » (Brun, 1986; Castells, 1983; Kumar & Castells, 2014; Mayer, 2006), même si certaines composantes – comme on verra – peuvent être associées plus facilement à la notion générale de mouvements sociaux et non à sa variante spécifiquement urbaine.
Ce front hétérogène s’est organisé – dans son fonctionnement interne – autour de différents groupes de travail (patrimoine, services publics, dette publique), d’assemblées plénières et de moments de travail informels.
Avant de rentrer dans le détail de la série d’événements qui ont amené à la naissance de Decide Roma, on va réfléchir sur sa composition et sur les dynamiques qui ont amené à la constitution de cet hétérogène front de lutte.
|
Table des matières
Sommaire
Introduction générale
1 – Les sciences sociales, l’espace et les mouvements sociaux : un état des savoirs
1.1 – La théorie des mouvements sociaux
1.2 – Les mouvements (sociaux) urbains et le « droit à la ville »
1.3 – La dimension spatiale des mouvements sociaux
2 – Un terrain « militant » : méthodologie et réflexivité
2.1 – Spécificités du terrain
2.2 – Techniques d’enquête
2.3 – Posture et positionnement : une recherche (géographique) « engagée »
3 – L’espace et la politique à Rome : éléments de mise en contexte
3.1 – Les politiques (urbaines) à Rome : l’espace urbain comme marchandise
3.2 – Le monde de l’autogestion à Rome : l’espace urbain comme ressource collective
4 – Decide Roma, une plateforme collective pour la construction une alternative urbaine d’autogouvernement métropolitain
4.1 – Composition et fonctionnement de la mobilisation
4.2 – Histoire de la mobilisation
4.3 – Thèmes et perspectives de la mobilisation
4.4 – Les multiples spatialités de Decide Roma
Conclusion
Glossaire
Bibliographie
Matériaux produits sur le terrain
Table des matières
Table des illustrations
Annexes
Annexe 1: Entretien avec Alessandro “Esc”
Annexe 2: Retranscription V assemblée d’autogouvernement
Résumé / Abstract