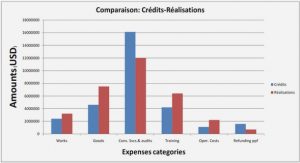LE FILMAGE COMME PREMIÈRE PHASE D’ÉCRITURE
La caméra
Retrouver quelque chose de l’étomiement… Cette phrase magnifique me possédait. Plus qu’à mon tour, je me baladais dans les rues de Chicoutimi, comme ça, pour me laisser surprendre. J’avais développé ce réflexe lors de mon existence à Montréal. Parfois, j e m’étonnais à passer de longues heures, sans bouger, maudissant le fait que mes yeux ne pouvaient guère faire mieux que de convertir en souvenirs ces spectacles dont les passants ignoraient la gratuité. C’est de cette frustration qu’est germé en moi ce besoin viscéral de m’équiper d’une caméra numérique ; non pas afin de produire des films, mais simplement afin de faire voir, de fournir un regard à ceux qui s’oublient .
Dans un premier temps, forcément, Matière première devait reposer sur cette instantanéité du regard, et sur une prise de vue, elle, qui épouserait l’inconnu. Pour ce faire, j e devais donc poser l’étape du filmage comme phase initiale d’écriture de mon film. Ce premier pas, qui longtemps m’ a semblé délicat, n’en demeure pas moins la clef de voûte sur laquelle repose toute ma recherche, car il remet en question l’évidence acceptée selon laquelle tout film, fictionnel comme documentaire, émerge d’un scénario, ou du moins d’un plan établi et déterminé par les scénaristes et le metteur en scène. Il suffit de s’imaginer la conception d’un casse-tête afin de saisir rapidement la structure actuelle de production cinématographique : d’abord, il faut penser à une image, c’est l’étape de la scénarisation ; ensuite, on conçoit des pièces qui devront soigneusement s’emboîter les unes aux autres, c’est le tournage ; et finalement, on assemble les pièces du casse-tête afin de reconstituer l’image de départ, c’est le montage.
De toujours, la narration tend à s’organiser en récit, c’est un fait anthropologique, dirait Roland Barthes, dû à notre sens inné de l’organisation et à notre volonté d’établir des liens ; nous voulons nous faire raconter une histoire, et nous aimons en partager. À l’opposé, que le récit filmique se soit plié au romanesque littéraire du XIXe siècle demeure un pur fait historique. En Amérique, on dit de The Birth of a Nation, de David Wark Griffith (1915), qu’il marque le premier pas irréversible vers la normalisation des oeuvres cinématographiques, tant sur le plan de l’histoire à raconter que sur celui des formes d’expression (gros plan, travelling, flash-back, etc.). Mais cette tendance qu’ont fiction et documentaire à se coder consciemment ou inconsciemment à ce type de récit romanesque (introduction, développement et conclusion) se remet volontiers en question, car de même qu’il est impossible de décrire à l’avance le temps qu’il fera, il est impossible d’écrire à l’avance l’intrigue de la vie quotidienne, et comme le monde ne se possède pas, il ne peut qu’échapper à ceux qui veulent le décrire.
Comme les Kinoks, ces cinéastes de l’école vertovienne qui se livraient directement à l’étude des phénomènes vivants, j’allais donc m’attaquer au plus coriace des remparts de la cinematographic : le scénario littéraire. Cette distance volontaire avec cette pratique partagée déphasé les étapes de production, reléguant l’écriture du film aux deux stades ultérieurs de création, et dérangeant au passage le vocabulaire filmique accepté ; c’est pourquoi, encore aujourd’hui, je préfère l’emploi de « filmage» à celui de « tournage », s’en démarquant comme phase initiale d’écriture de l’œuvre. Alors que selon moi tourner revient à figer sur pellicule l’imaginaire d’un scénariste ou le réel envisagé d’un documentariste, par filmer, j’entends bien plutôt une attitude, celle du cinéaste prenant contact avec un lieu. Cette prise avec le lieu est un moment d’ouverture aux possibles, un déclencheur de potentialité, une prise directe sans interventions ni questions ; c’est un état d’esprit que j’ai entretenu tout au long de l’année accordée au filmage de Matière première. Ainsi, une à deux fois par semaine, j’arpentais les rues à la recherche de ce je-ne-sais-quoi-encore ; il ne se passe pas grand-chose à Chicoutimi, mis à part les saisons, ce qui était déjà bien.
Toutes les semaines, à une ou deux reprises, je sortais de chez moi accompagné seul de ma caméra. Mes séances de filmage se présentaient comme une façon de me situer physiquement et mentalement dans un espace sous le regard absorbé de ma caméra. Il faut savoir à ce point-ci que pour moi, la caméra est, un peu comme l’entend Dziga Vertov, l’extension de l’œil du cinéaste : elle « scrute attentivement le milieu et les gens qui l’entourent, […] elle voit et entend la vie, note ses méandres, ses détours, et surprend le craquement des vieux os du quotidien » . Le s convictions de Dziga Vertov l’avaient poussé, au début des années vingt, à publier de nombreux écrits, véritables manifestes d’où émergea le concept de Ciné-Œil. Lors de chacune de mes sorties, les mots d’ordre du cinéaste soviétique me guidaient, et confortaient mon désarroi lorsque je remettais indubitablement en cause ma présence et mon entreprise.
L’attitude du cinéaste
L’idée était simple : partir de ma caméra, oublier tout scénario ; ne pas rechercher à, mais partir à la recherche de. Partir en terrain inconnu, y tracer un trajet, poser quelques balises, puis demander à ma caméra de se raconter. Mais alors, comment faire en sorte que s’opère sur mes images la première phase d’écriture ? Et comment s’imaginer qu’une caméra puisse ainsi passer au crible son environnement, et en retenir d’instinct le bon grain du mauvais ?
Les premières semaines de mon aventure furent désastreuses, pour moi comme pour ma première cueillette. À peine quelques allers et retours, et déjà toute la confiance que mes lectures m’avaient donnée s’était dissipée ; à trop penser, j’en avais oublié la pratique. J’étais loin d’être ce crible de l’image, cet esthète à l’oculaire en verre et à la gâchette dorée : ma caméra m’était étrangère, et mes images indifférentes. Il me fallait prendre une pause, lire, y voir un peu plus clair, rapprocher ma pensée du savoir technique de certains documentaristes de la seconde moitié du XXe siècle. Des Lamothe, Wiseman, Rouen et Van der Keuken, de ceux grâce à qui l’on n’envisage pas seulement le documentaire comme une étude de la représentation de îa réalité, mais aussi comme une étude de l’usage de la cinematographic et de son écriture.
Pour Arthur Lamothe , découper le monde afin de parvenir à le percevoir et d’arriver à en parler efficacement est l’affaire de la caméra, du rapport que l’on entretient avec la caméra : « Un film dans lequel on tourne du vingt pour un ou même du dix pour un n’a pas du tout la même philosophie que quand on tourne du deux ou du trois pour un. Ça ne participe pas à la même éthique du cinéma » . J’y comprends qu’un cinéaste de fiction qui se garde la possibilité de trier à travers l’ensemble de son matériau filmique afin d’en chercher une signification s’offre l’opportunité de reprendre une scène, d’y opérer plusieurs choix, et de revenir constamment sur ces derniers ; à l’inverse, dans l’œuvre d’Arthur Lamothe, l’opérateur de la caméra entretient une relation privilégiée avec son sujet ; il participe à ce cinéma, ce qui lui permet de définir le signifiant à l’instant même où il filme.
Dans sa Chronique des Indiens du Nord-Est du Québec (1973-1983), notamment, cette vision de l’image où le cinéaste est «dans» la caméra joue un rôle déterminant. Pour m’approcher d’une telle esthétique visuelle, je devais à mon tour prendre le temps d’observer attentivement ce qui allait se dérouler dans mon objectif ; aussi, je me suis mis à suivre les conseils de Lamothe ; j’ai gardé ma caméra le plus stable possible, même pendant les mouvements, j’ai déployé la profondeur de champ la plus étendue possible, préconisé l’emploi constant du plus grand angulaire, évité dans la mesure du possible les gros plans, et, par-dessus tout, je me suis abstenu d’utiliser le zoom, terrible invention. L’image ainsi captée se prolonge, et épuise davantage ce que l’on pourrait appeler des significations du réel observé, proposant ainsi au spectateur « le temps de rencontrer le monde et de se souvenir de certaines images » .
|
Table des matières
RÉSUMÉ
REMERCIEMENTS
TABLE DES MATIÈRES
LISTE DES FIGURES
INTRODUCTION
AVANT PROPOS
PROBLÉMATIQUE
CHAPITRE I : LE FILMAGE COMME PREMIÈRE PHASE D’ÉCRITURE
1.1 La caméra
1.2 L’attitude du cinéaste
1.3 L’image descriptive
CHAPITRE II : LE MONTAGE COMME SECONDE PHASE D’ÉCRITURE
2.1 Le théâtre de la mémoire
2.2 Le récit sans histoire
2.3 Le montage mosaïque
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
FILMOGRAPHIE
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet