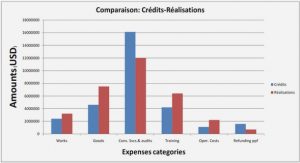Pendant de nombreux siècles, les maladies à transmission vectorielle parmi toutes les maladies infectieuses humaines ont constitué une cause majeure de mortalité et de morbidité humaines. Même avec les progrès récents dans les sciences biomédicales, les maladies à transmission vectorielle menacent encore sérieusement la santé mondiale. Par exemple, selon les estimations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) publiées en décembre 2015, il y a eu 214 millions de cas de paludisme en 2015 et 438 000 décès [1]. Le paludisme ou malaria est une érytrocytopathie fébrile et hémolysante dû à un hématozoaire du genre Plasmodium avec quatre espèces décrites chez l’homme : P. falciparum [2], la plus dangereuse et responsable de plus de 99% des décès causés par le paludisme en Afrique [3], P. malaria [2], P. ovale [2] et P. vivax [2]. Une cinquième espèce, Plasmodium knowlesi, déjà connue chez les primates, a été décrite comme infectant l’homme récemment [4]. Des efforts significatifs ont été déployés par l’OMS dans la lutte aboutissant à une réduction dans de nombreux pays où la transmission du paludisme est en cours, de leur charge de morbidité de manière significative. À l’échelle mondiale, le taux de nouveaux cas de paludisme a diminué de 21% entre 2010 et 2015. Le taux de mortalité dû au paludisme a baissé de 29% dans la même période de 5 ans [3]. Ceci grâce à l’utilisation de Moustiquaires Imprégnées à Longue Durée d’Action (MILDA), d’une augmentation de la disponibilité des tests de diagnostic du paludisme et des moyens préventifs surtout pour les femmes enceintes en Afrique subsaharienne [3]. Et enfin, les recommandations que chaque personne exposée au risque dorme toutes les nuits sous une moustiquaire, faire une pulvérisation d’insecticides sur les murs intérieurs et plafonds des habitations où les moustiques vecteurs du paludisme sont susceptibles de se poser. Malgré tous ces efforts le paludisme reste toujours un problème de santé publique dans les régions tropicales du monde plus particulièrement en Afrique subsaharienne car l’Afrique représentait 76% des cas de paludisme du monde en 2015 et 75% de ses décès étaient causés par cette maladie [3]. Cette persistance peut être expliquée par la subsistance d’importantes lacunes dans la couverture causée par l’accès limité des moyens de prévention dans certaines zones endémiques [5], par la résistance croissante des moustiques vecteurs face aux insecticides [6], l’absence de vaccins disponibles pour lutter contre cette maladie ainsi que par la résistance des parasites à plusieurs molécules qui commencent à montrer leurs limites [7]. Face au double défi de la résistance des parasites aux médicaments antipaludiques et des vecteurs face aux insecticides, il est devenu évident qu’une amélioration dans la stratégie de lutte est nécessaire.
Paludisme
Le paludisme est transmis par un protozoaire appartenant au genre Plasmodium. Il existe de très nombreuses espèces de Plasmodium (plus de 140), impliquant diverses espèces animales mais seulement cinq de ces espèces sont retrouvées en Plasmodium ovale, Plasmodium malariae et Plasmodium knowlesi, parasite habituel des singes (macaques) d’Asie qui vient de passer récemment chez l’homme. Les cinq espèces diffèrent par des critères biologiques, cliniques, par leur répartition géographique et par leur capacité à développer des résistances aux antipaludiques. D’emblée il faut différencier P. falciparum des autres espèces. En effet P. falciparum est celui qui est le plus largement répandu à travers le monde, qui développe des résistances aux antipaludiques et qui est responsable des formes cliniques potentiellement mortelles [9].
Cycle de développement de Plasmodium sp
Le cycle se déroule successivement chez l’homme et chez l’anophèle. Chez l’homme le cycle est lui-même divisé en 2 phases :
– La phase hépatique asymptomatique : elle survient après une piqûre infectante d’anophèle qui injecte avec sa salive quelques dizaines de parasites (stade de sporozoïtes). Ceux-ci pénètrent, en l’espace de quelques minutes, les hépatocytes dans lesquels ils se transforment en schizontes pré-érythrocytaires qui, après 7 à 15 jours de maturation asymptomatique (incubation), éclatent et libèrent quelques milliers de mérozoïtes dans le sang [12].
– La phase sanguine ou érythrocytaire : très rapidement, les mérozoïtes pénètrent dans les globules rouges pour une nouvelle transformation et une multiplication (stade de trophozoïtes puis transformation en schizontes) qui prend 24 heures pour (P. knowlesi), 48 heures pour (P. falciparum, P. vivax, P. ovale) et 72 heures pour (P. malariae). Ces trophozoites conduisent à la destruction du globule rouge hôte et à la libération de 8 à 32 nouveaux mérozoïtes.
Ces mérozoïtes pénètrent dans de nouveaux globules rouges et débutent un nouveau cycle de réplication. Cette partie correspond à l’évolution cyclique variable de la fièvre : toutes les 24 heures (P. knowlesi), tierce (P. falciparum, P. vivax, P. ovale) ou quarte (P. malariae). En pratique, on observe que la fièvre tierce due à P. falciparum est rarement synchrone. Après un certain nombre de cycles érythrocytaires, certains mérozoïtes subissent une maturation d’une dizaine de jours, les gamétocytes apparaissent dans le sang et vont rester en circulation pendant 10 à 15 jours [12]. Cette étape est succédée par une phase sexuée chez le moustique suite à une piqûre d’une personne infestée.
En effet, les gamétocytes, ingérés par le moustique lors d’un repas sanguin sur un sujet infecté, se transforment en gamètes mâles et femelles qui fusionnent en un œuf libre, mobile appelé ookinète. Cet ookinète quitte la lumière du tube digestif, se fixe ensuite à la paroi externe de l’estomac et se transforme en oocyste. Les cellules parasitaires se multiplient à l’intérieur de cet oocyste, produisant des centaines de sporozoïtes qui migrent ensuite vers les glandes salivaires du moustique. Ces sporozoïtes sont les formes infectantes prêtes à être inoculées avec la salive du moustique, lors d’un repas sanguin sur un hôte vertébré. La durée du développement sporogonique des Plasmodium varie en fonction des conditions climatiques : entre 9 et 20 jours pour P. falciparum (entre, respectivement, 30 °C et 20 °C), un peu plus rapide pour P. vivax à températures équivalentes, plus long pour P. malariae [9].
Prise en charge du paludisme
Moyens de diagnostic
Diagnostic direct
– Diagnostic microscopique direct par frottis sanguin et goutte épaisse
L’examen microscopique certifie le diagnostic du paludisme en mettant en évidence le parasite dans le sang circulant. Il doit être réalisé avant tout traitement antipaludique et immédiatement sans attendre un pic thermique [13]. Le sang est recueilli par ponction veineuse sur tube contenant un anticoagulant (EDTA) ce qui permet de multiplier les techniques diagnostiques avec le même prélèvement. Les étalements peuvent être réalisés à partir d’un prélèvement capillaire par piqûre au bout du doigt. L’examen microscopique du frottis et la goutte épaisse est la technique de référence préconisée par l’OMS (Gold Standard) [14]. Il a une bonne sensibilité et une bonne spécificité pour la détection du Plasmodium. Il permet un diagnostic rapide et un contrôle de l’efficacité du traitement antipaludique par le suivi de la parasitémie [13]. C’est un examen peu coûteux en moyens et en réactifs et demeure la technique la plus utilisée. Cependant, ses performances en termes de sensibilité et de fiabilité dépendent directement de l’expérience du microscopiste et du niveau de la parasitémie du sujet infecté [15].
Diagnostic indirect
Il s’agit d’une détection d’antigènes palustres par un test de diagnostic rapide (TDR), Plusieurs tests de ce type sont commercialisés. Ils reposent sur le principe de l’immunochromatographie en utilisant des bandelettes sensibilisées par des anticorps monoclonaux spécifiques détectant des antigènes plasmodiaux [16]. Ils sont réalisés avec une goutte de sang déposée sur une bandelette et ne nécessitent aucun appareillage. Détection de l’Ag histidine rich protein 2 (HRP2) : cette glycoprotéine spécifique de l’espèce P. falciparum est produite dans tous les stades érythrocytaires asexués du parasite. Plusieurs tests sont disponibles dont le ParaSight (Becton Dickinson, France) et l’ICT Malaria Pf test (Fumouze, France) [16]. Ces tests sont crédités d’une sensibilité supérieure à 96% par rapport aux techniques microscopiques classiques. Le TDR, le plus accessible malgré l’existence d’autres méthodes telles que la PCR, le QBC Malaria test ou quantitative buffy coat et surtout l’illumigen malaria qui est une nouvelle méthode de diagnostic mise au place récemment par Ndiaye et al.
Traitement
Il existe plusieurs molécules antipaludiques, qui peuvent être utilisées soit en prophylaxie (prévention lors d’un voyage en pays endémique), soit en curatif. Le choix du traitement curatif dépend avant tout de l’évaluation de la gravité clinique de la maladie. Un accès palustre simple à P. falciparum sera traité per os par une combinaison de soit artémether + luméfantrine (Coartem®) ; ou atovaquone + proguanil (Malarone®) ; ou quinine + doxycycline ou clindamycine ou artemisinine + piperaquine (Eurartesim®). Une forme grave de paludisme par P. falciparum est traitée en hospitalisation, avec artésunate (voie IV), artémether ou quinine (voie IV) [12].
L’objectif du traitement du paludisme à P. vivax et à P. ovale est double : traiter l’infection aigue et prévenir les épisodes de reviviscences tardives dû aux formes dormantes intrahépatiques. Pour un accès palustre simple à P. vivax et P. ovale, la chloroquine est le traitement de choix. La primaquine y est associée pour obtenir une guérison radicale. La chloroquine est également recommandée pour le traitement du paludisme à P. malariae [12].
|
Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE
I. Paludisme
I.1. Agents pathogènes
I.2.Vecteur
I.3. Cycle de développement de Plasmodium sp
I.4. Prise en charge du paludisme
I.4.1. Moyens de diagnostic
I.4.1.1. Diagnostic direct
I.4.1.2. Diagnostic indirect
I.4.2. Traitement
I.4.3. Prophylaxie
II. Répulsifs
II.1. Historique des répulsifs
II.2. Classification des répulsifs
II.2.1. Agents répulsifs d’origine naturels
II.2.2. Agents répulsifs d’origine synthétiques
II.2.2.1. N, N-Diéthyl-M-Toluamide
II.2.2.2. Icaridine ou picaridine
II.2.2.3. Dimethyl phtalate
II.2.2.4. P-menthane-3, 8-diol
II.2.2.5. Permethrine
II.2.2.6. Ethyl butyl acetyl amino propionate
II.3. Mécanisme d’action des répulsifs
DEUXIEME PARTIE : ENQUETE ETHNOBOTANIQUE
I. Objectifs et cadre d’étude
I.1. Objectifs de l’étude
I.2. Cadre d’étude
II. Méthodologie
II.1. Matériel
II.2. Choix du site
II.3. Choix des cibles
II.4. Méthodes d’étude
II.4.1.Type d’étude
II.4.2. Méthodes de recueil de données
II.4.3. Identification botanique des plantes
III. Résultats et discussion
III.1. Résultats
III.1.1. Données sur la population interrogée
III.1.2. Connaissance de la population sur les plantes répulsives
III.1.3. Evaluation de la connaissance des plantes répulsives en fonction du genre
III.1.4. Données sur les tradipraticiens
III.1.4.1. Répartition des tradipraticiens en fonction du genre
III.1.4.2. Connaissance des tradipraticiens sur les plantes repulsives
III.1.5. Plantes recensées
III.1.5.1. Répartition des plantes recensées selon la fréquence de citation
III.1.5.2. Répartition des plantes recensées en fonction des parties utilisées
III.1.5.3. Répartition des plantes recensées en fonction du mode d’utilisation
III.1.5.4. Répartition des plantes recensées en fonction de l’efficacité répulsive
III.2. DISCUSSION
CONCLUSION
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ANNEXES