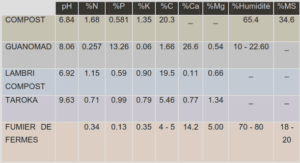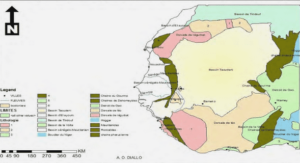Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Critique des interprétations linguistiques du Cogito
La représentation cartésienne s’appuie sur un sujet donné dans une expérience fondatrice et origine du sens et de la connaissance. Une représentation criticable en raison d’un primat de la pensée sur le langage. Une représentation criticable car soumise à des tropismes grammaticaux qui font de la philosophie du sujet une métaphysique substantialiste. Une représentation où le sens de l’ego ergo sum pourra être reconsidéré au moyen du crible de son analyse logique.
Descartes affirme le primat de la pensée du sujet sur lequel il fonde la connaissance : d’une part, la chose pensante se pense elle-même et pense le monde à l’aide de ses idées, d’autre part, tout savoir trouve sa source dans l’expérience intuitive d’un cogito immédiatement certain de lui-même. Une critique majeure adressée à cette configuration classique est de poser l’indépendance de l’idée par rapport au langage. Pour Bruaire160, cette critique ne peut être, chez Descartes, dissociée de celle de la liberté. Si l’in-dépendance signifie adéquatement être libre, la liberté trouve son chemin dans l’exclusion d’autrui et son immédiate vérité est l’individualisme. Mais isolé et seul avec moi-même, je dois m’exiler de tout le cortège de l’extériorité et me réfugier dans ma vie intime. Cependant, le repli intérieur trouve l’asile de ma pensée propre. Là semble t-il je ne puis être séparé de moi, selon les mots de Descartes. Peu importe que ma pensée soit fausse ou trompée, dès lors qu’elle est mienne, en première personne, ne relevant que de mon jugement absolument autonome : pour autant et dans le temps que je pense, je suis identique à moi-même, fermé à tout ce qui n’est pas moi, y compris à la nature dont le corps fait partie et avec lequel je fais deux161. Seulement, réfugié en ma pensée, j’y découvre encore l’autre, l’étranger162. En effet, il m’est impossible de penser hors les mots d’un langage où de leurs images et le langage me lie invinciblement aux autres, souscrire aux lois invincibles de la logique universelle : alors même que je pense en première personne, l’arbitraire même de mes jugements exige, pour ma propre intelligence de leurs insertions, le respect du principe d’identité indispensable mais venu d’ailleurs, imposé à l’intérieur de mon refuge. Toute pensée intime et solitaire est ainsi solidaire, dépendante, liée de multiples manières par d’irréductibles contraintes : c’est toute la nature, son ordre extérieur et son pouvoir de manifestation auxquels je suis relié alors que j’imaginais en être séparé. Le solipsisme cartésien n’est pas absolu.
Le tournant linguistique et l’analyse logique du cogito ergo sum
Avec les logiciens du cercle de Vienne168, se manifeste une volonté de rupture avec une certaine dérive de la philosophie incarnée par les métaphysiques héritées des siècles passés. Frege169 dénonce les propositions métaphysiques comme de pseudo-énoncés dépourvus de signification dès lors que se pose la question du sens. Au modèle grammatical est substitué le modèle mathématique et toute référence au sujet est écartée même dans la caractérisation de la pensée, pour ne s’intéresser qu’à la composante purement logique de celle-ci. C’est ainsi que l’analyse logique de l’usage du concept d’existence permet de dénoncer l’inanité de la « preuve ontologique de l’existence de Dieu ». Pour le premier Wittgenstein170, la syntaxe logique, avec la distinction « douée de sens /dénuée de sens », fournit le seul critère objectif du sens. Or, selon Wittgenstein, nombre de formulations philosophiques, à commencer par celle du Cogito, violent171 manifestement les règles logiques.
Pour les logiciens, la plupart des fautes logiques commises dans les simili-énoncés métaphysiques172 reposent sur des vices logiques inhérents à l’emploi du verbe « être » dans notre langue. La première faute est liée à l’ambiguïté du verbe « être » qui joue tantôt le rôle de copule pour un prédicat « je suis affamé », tantôt celui d’indicateur d’existence « je suis ». La seconde faute tient à la forme du verbe pris dans sa seconde acception, celle d’existence. Cette forme produit l’illusion d’un prédicat là où il n’y en a pas. Or on sait depuis longtemps que l’existence n’est pas un caractère attributif173.
L’analyse logique du Cogito ergo sum cartésien illustre un exemple de cette faute. Considérons les deux énoncés du point de vue de la logique formelle. Deux fautes logiques essentielles sautent tout de suite aux yeux. La première dans la conclusion « je suis » : le verbe « être » est sans doute pris au sens de l’existence, car une copule ne peut aller sans prédicat. On n’a d’ailleurs jamais entendu le « je suis » de Descartes autrement. Cet énoncé viole alors la règle logique en vertu de laquelle l’existence ne peut être affirmée qu’en liaison avec un prédicat, nullement avec un nom (sujet, nom propre). Un énoncé existentiel n’est pas de la forme « a existé » (comme ici dans le « je suis », c’est-à-dire « j’existe ») mais : « il existe une chose dont la nature est telle ou telle ». La seconde erreur réside dans le passage du « je pense » au « j’existe ». Si en effet, de l’énoncé « P(a), : a « a la propriété P », on doit déduire un énoncé existentiel, alors ce dernier peut affirmer l’existence relativement au prédicat P et non relativement au sujet de la prémisse. De « je suis un Européen » ne suit pas « j’existe », mais « il existe un européen ». Du « je pense » ne suit pas « je suis », mais « il y a quelque chose qui pense »174, ce qui écarte là aussi toute présomption de subjectivisme ! Mais l’erreur du positivisme logique, comme du premier Wittgenstein, n’aura-t-elle pas été de croire que l’usage du langage est purement véridictionnel et que la logique est la seule mesure du sens ?
Critique morale du subjectivisme cartésien
Quelles questions posons nous à travers cette critique ? S’agit-il de savoir si le sujet cartésien est moral ou « sujet » d’une morale ? Dès lors, qu’elle serait-elle et que désignerait-on par l’agir moral ? Pour Descartes qui définit la sagesse par la connaissance, philosopher c’est chercher à connaître. La morale, en tant que la plus haute branche du savoir, n’échappe pas au champ de la connaissance. La philosophie cartésienne du sujet se donnant pour but la maîtrise par la raison humaine de la totalité du réel, cette maîtrise assigne t-elle à sa conscience d’être comme seule présence à soi, se contentant pourrions nous dire d’un que sais-je, ou peut-elle ouvrir aussi sur une présence au monde, présence qui préfigurerait un que dois-je faire ? L’examen minutieux de la morale cartésienne pourra nous en donner une idée claire et distincte.
La morale chez Descartes
Dans la troisième partie du Discours
Descartes cherche quelques unes des règles de la morale « par provision » tirée de sa méthode. Redoutant l’irrésolution en ses actions que le doute peut entraîner, il propose quatre règles afin de pouvoir continuer à vivre. La première est d’obéir aux lois et coutumes de son pays, la seconde est d’être ferme et résolu en ses actions, la troisième est de se persuader soi-même de changer ses désirs que l’ordre du monde et de considérer que seules les pensées sont en son pouvoir, la quatrième, présentée comme la conclusion de sa morale car ne concernant que son propre choix de vie, est de cultiver sa raison suivant sa méthode pour avancer dans la connaissance de la vérité. Descartes n’utilise le terme « moral » dans le Discours qu’à une seule occasion avec une acception qui renvoie au domaine de l’action : « car encore qu’on ait une assurance morale de ces choses »175. La fonction de la morale est claire : qu’elle soit suffisante pour régler nos moeurs, nos actions. Elle répond à une question, celle du « comment faire », englobée dans celle du « vouloir faire ».
En 1649, dans le Traité des Passions de l’âme
On s’attend à ce Descartes expose enfin sa morale définitive. Le texte apporte certes des connaissances nouvelles sur la nature humaine et la genèse des sentiments et des passions, classées depuis les plus fondamentales (amour, haine, tristesse et joie), jusqu’aux passions morales, articulées à la liberté (prudence, science et générosité), mais de l’aveu même du philosophe, trop de problèmes concernant la psychologie humaine demeurent encore sans réponse. Ce traité ultime ne saurait satisfaire le projet initial cartésien concernant la morale définitive et la connaissance de la vraie sagesse. Seul Dieu est capable d’atteindre les plus hautes branches de l’arbre, et l’homme doit se contenter du « contentement » !
Une morale qui appelle quelques commentaires
La morale cartésienne : une science morale ou une morale scientifique ?
Dans les deux premiers textes, Descartes distingue entre un ordre chronologique pour devenir sage, qui l’oblige à adopter une morale provisoire pour vivre et avancer, et entre un ordre philosophique, logis de la vraie sagesse, reposant sur les seules forces de la raison. Selon cet ordre, la métaphysique est première et fonde toutes les autres connaissances : elle représente les racines d’un savoir qui nourrissent l’arbre et ses plus hautes branches. En effet, la méthode cartésienne constitue une véritable chaîne de raisons : à partir des premiers principes ou encore de ce que Descartes appelle les premières semences de vérité, c’est-à-dire l’ensemble des idées innées, on peut connaître les formes les plus complexes de la nature. La mathesis universalis qui s’exprime dans le modèle mécaniste pour expliquer tous les phénomènes de la nature semble réaliser la métaphore de l’arbre de la connaissance utilisée par Descartes pour souligner l’unité du savoir : « Ainsi, toute la philosophie est comme un arbre, dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences qui se réduisent à trois principales, à savoir la mécanique, la médecine et la morale »179.
La question que nous nous posons n’est pas que cette morale moderne issue de la méthode n’ait pas vue le jour, mais pourquoi Descartes l’a-t-il conçue et présentée comme complémentaire, car encadrée, de la médecine et de la mécanique. Une morale qui suppose donc une mécanique et une médecine scientifique déjà établies. La morale cartésienne : science morale ou morale scientifique ?
Descartes reçoit de Kepler et de Galilée une nouvelle lecture des phénomènes naturels dont il tire la première exploitation du principe de subjectivité. Le sujet est donné dans une expérience fondatrice : il est l’origine du sens et de la connaissance qui se fonde méthodiquement elle-même. La subjectivité peut se définir alors comme l’activité d’une conscience qui pose devant-elle l’objet à connaître. Mais pour que cette subjectivité fonctionne, il faut qu’il existe les éléments constitutifs de la relation sujet-objet, à savoir : d’un côté une âme humaine dont l’être est identique à la pensée, indépendamment de toute réalité corporelle, de l’autre, cette réalité corporelle, indépendante elle aussi de l’âme. Le fameux dualisme ontologique clivage fondateur pour la science, exprime ces distinctions substantielles de l’âme et du corps. Etre qui pense, le sujet cartésien, est un être qui possède un esprit, une raison ou entendement, lequel doit nécessairement considérer les substances comme séparées. La substance étendue, et à ce titre de nature homogène, devient alors naturellement accessible à la science de l’ordre et de la mesure180. C’est donc en dissociant, en séparant, en divisant, que l’entendement accédera à une connaissance claire et distincte. Le connaître est donc le résultat d’une élaboration, d’une attitude et d’une action méthodique de la part du sujet.
Mais que veut dire une science morale ? Le sujet cartésien n’est pas assujetti à une morale mais il est un sujet moral en ce qu’il réforme méthodiquement les conditions d’accès à la connaissance, une connaissance qui sera utile pour tous. L’agir moral digne de ce nom, consiste à déployer la méthode pour se représenter l’action comme une évidence. Ce n’est pas dans ses conséquences que l’agir sera moral ou non mais dans sa manière de faire. L’agir moral, pour Descartes c’est maîtriser rationnellement le savoir pour savoir faire, un savoir faire engageant un vouloir faire. L’agir moral engage un vouloir pour imposer la vérité181. Or si pour Descartes la volonté du sujet comme « puissance de vouloir » est infinie et égale à la volonté divine, son entendement comme « puissance de connaître » est limité. L’homme est un être fini182. Il en résulte que l’on ne sait pas tout mais qu’on veut quand même. Une puissance d’agir qui ouvre la porte à l’activisme de tous poils, et particulièrement à la médecine scientiste moderne. Agir moralement, c’est déployer la méthode du savoir. Reformer son jugement, distinguer le vrai d’avec le faux, est pour Descartes une exigence non seulement épistémologique mais aussi morale. Mais savoir pourquoi faire ? L’agir moral cartésien ne répond pas à cette question : le sujet a le devoir moral d’agir en conformité avec cette connaissance.
La morale scientifique comme résultat méthodique conditionne la science morale comme agir moral. Un savoir, comme action tournée vers le monde et qui pourrait aussi se retourner contre lui.
La morale cartésienne n’a pas pour objet de réguler les moeurs
L’analyse de ses textes montre que Descartes laisse aux souverains, par la loi, le soin de régler les moeurs des autres. « Il est vrai que j’ai coutume de refuser d’écrire mes pensées touchant la morale, et cela pour deux raisons : l’une qu’il n’y a point de matière d’où les malins puissent plus aisément tirer des prétextes pour calomnier ; l’autre, que je crois qu’il n’appartient qu’aux souverains, ou à ceux qui sont autorisés par eux, de se mêler de régler les moeurs des autres 183». Il en appelle au poids des corps politiques et à la possibilité avec le temps de corriger ses défauts, au nom d’un principe de prudence. Il affirme les droits de la raison à instaurer un régime nouveau, par un « prudent législateur » n’ayant rien des « qualités brouillonnes et inquiètes » ressortissant aux agitateurs dont il ne veut pas.
En mon âme et conscience
De quel droit une telle association tiendrait-elle sa légitimité ? Elle est impensable par ceux qui, confinant les sciences de l’esprit au modèle naturaliste, interdisent à la psychologie d’inclure dans son thème de réflexion l’âme, le moi qui agit et qui souffre200. Elle l’est également pour les tenants du neurobiologisme pour lesquels c’est un double non sens que d’associer à la conscience un objet métaphysique : l’âme. Elle interpelle aussi tous ceux qui, faisant de la conscience un emblème de la subjectivité et se référant à son étymologie d’un savoir partagé (une connaissance, scientia, que l’on a en commun, cum), s’interrogent sur l’objet du savoir et du partage entre l’âme et la conscience. Qui partage quoi et comment ? Qu’aurait l’âme à partager avec la conscience ?
De quelle âme s’agit-il ? Pourrait-il être question de l’âme grecque, immortelle et divisée201 ? Pour les sages d’autrefois, le problème était de mettre l’âme en conformité avec la réalité et les moyens d’y parvenir requerraient les chemins de la connaissance pour les platoniciens, l’autodiscipline pour les stoïciens202 et la vertu pour les aristotéliciens. Comment caractériser cette psuché grecque ? Dans l’Ethique à Eudème, Aristote, tenant de l’immortalité de l’âme, compare l’âme et le corps à une union contre nature, suivant la thèse platonicienne du Phédon : la vie de l’âme incarnée dans un corps y est présentée comme un malheureux épisode qu’il convient de rendre le plus bref possible. C’est avec le De Anima qu’il fait un pas dans le sens de l’unité substantielle de l’âme et du corps en faisant de l’âme la forme du corps vivant, tout comme la vision est la forme de l’oeil, ou la « hachéïté » celle de la hache. Dès lors, l’âme est immanente au corps et lui tient lieu de principe vital, principe qui a pour fonction le maintien constamment en acte d’un corps organisé ayant la vie en puissance. Cette âme n’a pas d’attributs et ne constitue pas un être subsistant par lui-même. L’intellect patient, passif, lieu des formes, les reçoit sans matière, alors que l’intellect agent, actualise les intelligibles. Mais ceux-ci, engagés dans les sensations et les images, ne sont pas des Idées à la manière platonicienne, qui existent « au dessus et en dehors » du sensible. Aristote pense tandis que Platon contemple ! L’âme est divisée et plusieurs sortes d’âmes correspondent aux diverses sortes de vivants. Pour Aristote, l’homme est l’« animal des animaux », celui dont l’âme possède toutes les fonctions des autres êtres, mais aussi des fonctions spécifiques, d’ordre intellectuel et spirituel. Immortelle et liée au corps203, elle n’était ni manière d’être, ni phénomène mais principe de vie, une vie d’autant plus vivante qu’elle est plus intelligente204 ! Finalement l’âme grecque est une chose « spirituelle »205 avec un rapport exclusivement corporel. Elle ne peut donc s’associer à la conscience : en effet, nulle trace de conscience ou d’intériorité chez les Grecs mais un être, un anthropos 206 dont l’identité correspond à la place qu’il occupe dans la cité.
S’agit-il alors de l’âme d’inspiration chrétienne, fondamentalement indivisible et indissolublement liée au corps ? Pour Thomas De Koninck207, cette indivision, non quantitative, assigne l’âme à sa spiritualité et son union ineffable au corps investi ce dernier de dignité, laquelle, selon lui, gagerait de son immortalité208. Ainsi tout dualisme ôte t-il au corps sa dignité, celle-ci étant le fait de l’âme. Pour l’auteur, la dignité ne se dévoile pleinement qu’à l’étude de l’âme humaine comme telle, de l’esprit et de ses implications. Qu’entendre par esprit ? S’agit-il de l’Esprit Saint ou de l’esprit comme conscience humaine ? Il reste alors à tenter d’expliquer la nature de ce lien tendu entre l’âme et la conscience.
Si l’on considère la tradition chrétienne, et en particulier Saint-Augustin, c’est dans la temporalité que se noue ce rapport. En effet, pour lui, le temps est à la fois ce qu’on connaît le mieux et ce qui ne peut-être expliqué, si bien qu’en tenter une explication reviendrait à détacher la conscience d’elle-même. Saint Augustin célèbre l’intériorité de l’âme qui renvoie à Dieu, lequel est plus présent à moi-même que je ne le suis moi-même à moi même. Le saint répond ainsi aux incroyants qui lui demandaient ce que faisait Dieu avant la création, confondant temporalité et éternité. Alors que passé, présent, futur sont des créations temporelles, seule l’éternité est divine et se trouve en permanence à l’intérieur de tout un chacun, présente en son âme. La conscience rejoint l’âme et Dieu chaque fois qu’elle se tourne vers elle. La distensio animi illustre les capacités de l’âme à unir dans un même présent le pur divin et sa créature. La tradition médiévale poursuit avec Maître Eckart209, l’inhérence de l’intériorité à l’âme. Le mystique rhénan considérait la conscience comme une puissance de l’âme, c’est-à-dire, à l’instar de la volonté, comme une propriété secondaire de l’âme. Pourquoi ? En faisant dépendre la conscience de l’âme, il signifiait à celle là sa place à l’extérieur de celle-ci, réservant son centre, ou château-fort, exclusivement à Dieu. Maître Eckart supplante Saint Augustin en proclamant possible la béatitude sur terre210. Temporalité et intériorité constituent le lien chrétien unissant l’âme et la conscience. Dans cette perspective, « en mon âme et conscience » pourrait signifier alors une union entre ce noyau fondamental de l’âme, ce « fort intérieur » et le monde humain extérieur. Une union rendue efficiente par l’Esprit-Saint assignant l’esprit humain chancelant à l’expérience d’une même temporalité, l’autorisant à revendiquer d’une conviction intime ne laissant aucune place aux doutes d’un esprit fini. Un autre rapport du temps à la conscience, profane, nous est également donné par l’expérience musicale : le temps est en quelque sorte la matière privilégiée de la musique, puisque l’expérience musicale est constituée au départ de mémoire, d’attention et d’attente, les trois actes de l’âme qui fondent simultanément le temps en notre conscience. Ce serait donc encore le temps qui relierait l’âme et la conscience. Elles feraient ensemble dans une même temporalité une même expérience, profane : celle de l’intériorité.
La conscience comme conscience morale
– Comment vous appelez-vous lui demandais-je ?
– Brigitte me répondit-elle un peu surprise. Vous êtes son fils ? Je suis là depuis 10 ans, et j’ai bien connu votre maman quand elle marchait encore ! Je ne vous ai jamais vu !
Je revivais alors le temps qui venait de s’écouler depuis l’entrée de ma mère dans cette institution. Sa réticence à y venir, l’organisation de sa vie, puis cette fracture de fémur, il y a un an, pathologie du vieillard dont on sait qu’elle est pour eux un marqueur de fin de vie. Ma mère venant d’accéder au troisième étage, endroit réservé aux pensionnaires handicapés physiquement ou intellectuellement, je n’avais pas encore été en mesure de croiser Brigitte.
– Je viens, lui dis-je, aux heures du repas, car elle ne dors pas.
Ma mère ayant manifesté inopinément son désir d’aller aux toilettes, j’étais allé à la recherche d’une aide-soignante : Brigitte.
– Il faut attendre ma collègue : nous devons être deux !
Je lui suggérais mon aide en songeant brusquement à mon père : je me rappelais alors son angoisse à l’idée de se souiller, faute de pouvoir se déplacer, puis sa révolte devant le fait accompli : être langé à heure fixe le désespérait. Enfin sa renonciation progressive devant la triste réalité à laquelle il avait dû se résigner en désespoir de cause. Evidemment je n’avais rien compris à cette légitime pudeur. Je l’aidais alors à la tâche, attentif à ses instructions.
Je lui demandais si elle avait encore ses parents. Ils étaient encore vivants et elle allait les voir tous les ans. Puis nous parlâmes de la vieillesse, du besoin de soin des personnes âgées dépendantes, de l’inéluctable déchéance. Enfin, j’en vins à la remercier de ce qu’elle faisait pour eux et de la façon dont elle s’y prenait.
J’entends encore résonner à mes oreilles un éclat de rire tonitruant. Un rire illustrant la signification qu’en donnait Bergson229, comme une condamnation par la société des comportements qui lui échappent : l’idée même d’être remerciée pour l’ordinaire de son action apparaissait totalement inouï à Brigitte.
– Mais c’est tout à fait normal ! C’est notre tour à présent de nous occuper de nos parents ! Pour elle, normalité et spontanéité étaient synonymes et s’inscrivaient dans une temporalité circulaire avec son présent annonciateur d’une mise en demeure attendue devant laquelle personne ne saurait se dérober, comme rendez-vous fondamental avec le sens de la vie, avec la vie même.
La période de réveil
Notre patient se réveille : cette période est cruciale pour tout le monde ! Pour lui, bien évidemment qui aura traversé sans dommage une épreuve dont il se serait bien passé, pour le chirurgien qui attend avec anxiété de savoir si ses gestes opératoires dans des zones hautement fonctionnelles n’auront pas aggravé son patient, et pour l’anesthésiste, lequel, en tant que directement responsable de l’entrée dans le coma l’est aussi naturellement de sa sortie. Période à risque pour le patient qui émerge de l’inconscience pharmacologique dans laquelle il a été plongé et se retrouve soudainement livré à toutes sortes d’agressions, visuelles, sonores, algiques, sans immédiatement recouvrer toute sa lucidité et sa mémoire. C’est le moment où peut se libérer chez lui toute une anxièté sous-jacente et jusqu’ici contenue, avec des conséquences physiologiques et neurovégétatives à type d’agitation, de poussées hypertensives fugaces mais néanmoins parfois préjudiciables, tant pour l’hémostase de la zone opératoire, que pour sa fonction myocardique. Le réveil est en cela crucial pour le patient qu’il représente pour lui son retour dans le monde. Va-t-on savoir l’y accueillir comme il se doit ?
La procédure du réveil est conditionnée par le recueil objectif délivré par les signaux du monitorage des systèmes nerveux central et végétatif antérieurement mis en place. La « reprise de la conscience » s’effectue alors selon des critères numériques de pression respiratoire, de mesure de pression artérielle, d’évaluation de l’indice bi-spectral de son activité cérébrale, du moniteur de décurarisation, de valeurs pharmacocinétiques de demi vie contextuelle des agents anesthésiques prédictives de leur durée d’action, jusqu’à pouvoir déclarer en toute sérénité, les valeurs s’étant normalisées : il a repris conscience ! Lors de cette anesthésie, le médecin s’est appuyé, accroché, exclusivement sur des données positives de nature scientifique. Ce médecin, absolutiste, a oublié le patient. Il a endormi et réveillé un automate ! Et cela mécaniquement, comme aussi un automate ! Une telle procédure de réveil se référant exclusivement à une relation de type sujet-objet est an-éthique en ce qu’elle ignore le patient et se contente de sa simple représentation numérique. Issue de la science galiléenne, elle peut être taxée de scientiste.
|
Table des matières
I La conscience comme éveil et présence au monde
L’éveil et la conscience-éveil : de quoi parle t-on ?
La notion d’éveil
La conscience-éveil ou la conscience comme être conscient
L’être conscient
Le champ de la conscience
Le Moi et le champ
La structure dynamique du Moi
Conception naturaliste de la conscience
Critique d’une telle conception
Les apories du neurobiologisme
La conscience-éveil et la tradition philosophique du sujet
La conscience-éveil et la philosophie grecque du sujet
La connaissance et le sujet de la connaissance selon Platon
La subtance-sujet chez Aristote est-elle subjective ?
Le réveil comme expérience de consciences de soi
Comme le sentiment biranien d’exister
Comme conscience posant devant elle l’objet à connaître
Comme conscience pour soi appartenant à un sujet libre
Comme conscience phénoménale de soi
Critique du Cogito comme saisie empirique de la conscience de soi
Critique du solipsisme cartésien : la conscience-éveil comme présence à soi est-elle aussi présence au monde ?
Critique des interprétations linguistiques du Cogito
Critique pragmatique du Discours
Critique nietzschéenne de la métaphysique substantialiste et de la philosophie du sujet
Le tournant linguistique et l’analyse logique du Cogito ergo sum
Critique morale du subjectivisme cartésien
La morale chez Descartes
Dans la troisième partie du Discours
Dans la lettre Préface des Principes de la philosophie
Dans la lettre à Elisabeth
En 1649, Traité des Passions de l’âme
La morale cartésienne : une science ou une morale scientifique ?
La morale cartésienne n’a pas pour objet de réguler les moeurs
Descartes se détourne de la morale pour prôner la sagesse
Conclusion
Apposition du subjectivisme et du personnalisme
Qu’est ce qu’une personne ?
Qu’est ce qu’être personne ?
Le sujet cartésien peut-il sans contradiction se représenter comme une
personne ?
Conclusion
La conscience et l’âme
En mon âme et conscience
L’animal éveillé, est-il pour autant doué d’une conscience ?
Conclusions
II La conscience comme conscience morale
Quand je dis que mon malade est réveillé, je dis qu’il existe entre lui et moi une relation qui n’est plus simplement sujet-objet.
L’anesthésie cartésienne
La période de réveil
Le regard phénoménologique
Phénoménologie du réveil
Cette intentionnalité, c’est d’ailleurs ce que j’observe dans ma pratique
Approche phénoménologique du patient en état végétatif
Critique du terme « état »
Approche phénoménologique
Le problème de la reconnaissance
Peut-on définir l’humanité par son degré de conscience ?
Le problème de la reconnaissance
La question de la dignité : origine et fondement
Est-ce la conscience qui motive le respect et qui fait la dignité ?
La peur des blouses blanches
Stupeur et incompréhension cliniques initiales
Questionnement éthique à propos de l’esthétique
Le phénomène et ses manifestations
Le rapport véritatif
L’être-auprès
L’être-avec
Après l’incompréhension initiale, une interrogation : que dire au non dit ?
L’intentionnalité est productrice d’éthique
L’impossible saut ontologique
L’éthique pose la question du Qui avant celle du pourquoi : de ce fait
l’indicible n’est pas incompréhensible
La conscience (éveil) implique donc une historicité, une parole, une attestation : elle n’est pas seulement une présence au monde mais une co-présence
C’est pour ce soir ?
La consultation comme parole qui vaut engagement
La consultation comme interlocution
L’information, corollaire de l’interlocution
Une information loyale
Au patient
Dans les règles de l’art
Avec ses limites éthiques
Une information qui appelle un consentement
Un consentement qui peut-être donné ou repris
Conclusions
III La conscience et l’Etre
L’Être et l’être-humain
L’Être : objet métaphysique ou réalité ontologique ?
Préambule
L’être et l’être-humain
Heidegger et la question du sens de l’Être
Le Dasein comme accès à l’être
Le Dasein n’est pas le sujet
Le Dasein n’est pas la manifestation de l’Être .
Levinas et l’Être
La question de l’Être pour nous .
Manifestations de l’Être
Vérité de l’Être à travers la musique
Pensée et vérité de l’Être chez le poète
Vérité de l’Être chez Dostoïevski
L’amitié comme expérience de l’Être
Le tutoiement
Conclusion
Possibilité de vivre ontologiquement cette conscience morale
De l’Être-en-faute-heideggérien à l’Être « authentique »
Les limites de la solution heideggérienne de la « faute » ontologique
La relation clinique comme ouverture à l’Être d’autrui
La Pangoisse comme modalité d’ouverture de la conscience morale à l’Être
Critique de la consultation d’anesthésie
Peur et Angoisse : Manifestations psychologique ou déterminations ontologique ?
La Peur comme énoncé ontologique
L’inquiétude de la conscience comme inquiétude morale
De l’inquiétude à l’in-quiétude
Qu’est-ce qu’exister et qu’est-ce qu’être
Et pour nous, qu’est-ce qu’exister et qu’est-ce qu’être
Conclusion
La responsabilité comme modalité de réponse de la conscience morale à l’être
Examen des fondements moraux de la responsabilité
Responsabilité autonomique kantienne fondée sur le devoir
Les critiques adressées à la conception kantienne de la morale portent
aussi bien sur ses fondements que sur la moralité en soi
Limites de la moralité kantienne
Responsabilité hétéronomique selon Levinas : la prise en otage
Une thèse qui recueille des critiques
Limites de la morale de Levinas
Responsabilité fondée sur le « que-faire » aristotélicien
Remarques à propos de la morale aritostélicienne
La responsabilité : affaire de morale ou de droit ?
Le faux débat : autonomie contre hétéronomie
Le vrai débat : déontologie et morale
Deux exemples de responsabilité de la conscience morale reposant sur le devoir
Que feriez-vous à ma place ?
Critiques formelles du parternalisme avec ses apories
Protections juridiques et déontologiques du patient
Que feriez-vous à ma place ?
Le débat éthique est lancé
Le paternalisme comme réponse pratique de responsabilité
Conclusion
Prélèvement d’organes et donneur potentiel
Télescopage de temporalités
Un type de prélèvement modifiant la tonalité du terme potentiel
Une modalité problématique de prélèvement posant les rapports de l’éthique et du droit
Conclusion
Conclusions
Bibliographie citée dans le texte
Télécharger le rapport complet