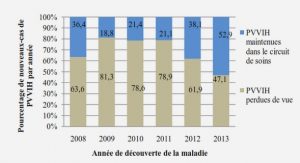Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
La pluviométrie1
Les isohyètes annuelles sont au niveau 800-900 mm dans la région de la Haute Matsiatra, avec une légère augmentation jusqu’à 1.400 mm au fur et à mesure que l’on monte vers le Nord et en allant jusqu’à 2.000 mm à la fro ntière Est de la région.
Vers le Sud et le Sud-Ouest de la région, on remarque une nette stabilisation des courbes isohyètes avec leur étalement dans l’espace. La période pluvieuse commence en Octobre. La quantité des pluies reçues est la plus importante en Décembre – Janvier. Celle-ci décroît rapidement aux mois d’Avril – Mai.
La période sèche coïncide avec les mois de Mai à Octobre au cours de laquelle sont enregistrées des précipitations sous forme de crachins.
Hydrologie
L’hydrographie de la Région de la Haute Matsiatra est conditionnée par le bassin versant du MANGOKY.
Le réseau hydrographique de ce bassin versant prendsa source dans les régions de la Haute Matsiatra et d’Ihorombe (rivières Manantanana- Zomandao et Ihosy). Son parcours total est de 55.750 km² et il se déverse dans le canal du Mozambique une fois récupéré par le fleuve MANGOKY1. Les principaux cours d’eau sont :
• Mitody, Manambaroa et Fanindrona ;
• Fisakana traversant Fandriana et Manandriana .
Sols et végétations
Pédologiquement, la région de la Haute Matsiatra est caractérisée par des sols ferralitiques jaunes/rouges et rouges, de superficies assez importantes, mais discontinues. En outre, on remarque la présence de sols ferrugineuxtropicaux couvrant la partie centrale de la région de la Haute Matsiatra, et des îlots d’association de sols ferralitiques rouges et jaunes/rouges et des sols faiblement ferralitiques et ferrisols.
Cet ensemble est réuni dans l’espace de la région par des sols peu évolués et rankers, ainsi que des sols peu évolués dunaires sableux.
Présentation globale du projet
Les bas-fonds portent essentiellement des sols hydromorphes à gley. Leur mise en valeur a commencé depuis l’installation de la population dans la zone et comporte deux aspects : aménagement et mise en culture.
Les terrasses rizicoles (kipahy) constituent une particularité de la région. Pour pallier l’insuffisance des bas-fonds et profitant des possibilités de captage d’eau en hauteur, les paysans ont installé des terrasses irrigables sur les flancs des collines.
La région est caractérisée par la prédominance derandesg superficies de savanes à savoir :
• savanes herbeuses à Hyparrhenia rufa et Heteropogon ;
• savanes herbeuses de l’ouest à Hyparrhenia rufa, Hyparrhenia dissoluta et Heteropogon.
Ces deux types de savanes couvrent les parties centrales de la Région, dans la partie orientale de la région et parallèlement à la côte Est sont localisées des savanes et steppes à Aristida et Ctenium ou Loudetia.
Ces types de savanes sont délimités par un mince filet de forêt ombrophile de moyenne altitude.
POTENTIALITESECONOMIQUESDELA REGION
La région Haute Matsiatra est caractérisée par unegrande variabilité du milieu naturel et physique (relief, sols, climat, rivières, sous-sols), ce qui offre des conditions favorables à des activités économiques diversifiéeset complémentaires entre les sous régions.
Même si le contexte global du développement est contrasté et complémentaire d’une zone à une autre, les secteurs productifs principau x restent toujours l’agriculture et l’élevage. L’agriculture est partout dominée par les cultures vivrières. On constate une évolution positive, mais lente et/ou très localisée (Fianarantsoa II, Ambalavao), vers la diversification en cultures de rentes et industrielles plus ou moins spécifiques à la région : la vigne, le thé, et le tabac. L’élevage est dominé par le cheptel bovindans la partie Ouest (Ikalamavony) et Sud (Ambalavao) et le petit élevage dans la partie Centre et Est (Fianarantsoa I, II et Ambohimahasoa).
L’agriculture
Densité agricole et vocation régionale hétérogènes.
Le pourcentage de superficie totale cultivée (pâturages exclus) était en moyenne de 6% en 1999. Il varie énormément de 1 % à Ikalamavony à plus de 10 % à Fianarantsoa II et Ambohimahasoa. Le district d’Ambalavao se trouve en situation intermédiaire (6%).
Le taux d’utilisation effective du potentiel en terres exploitables en agriculture dépasse les 75 % dans les hautes terres centrales, et représente à peine 20 % dans la partie occidentale de la région. Dans certaines sous régions de Fianarantsoa II, Ambohimahasoa et Ambalavao, il existe des localités relativement surpeuplées qui ont une très forte densité agricole. Même les terrains sur des pentes supérieures à 12 % sont aménagés en gradins et exploités pour les cultures vivrières.
La vocation agricole qui se dessine divise la région en deux catégories de sous régions :
• La première concerne les districts à prédominance cultures vivrières dans lesquels la présence de cultures de rentes reste faible (inférieure à 20 % des exploitations). Ce groupe est composé des districts de Fianarantsoa II, Ambohimahasoa et Ikalamavony, et caractérisé par la prédominance de la riziculture.
• La seconde étant les districts disposant des poches de cultures de rente et industrielles. Elle concerne essentiellement les districts de Fianarantsoa II et d’Ambalavao. Ce qui sera expliqué par la suite.
Une agriculture essentiellement vivrière
La superficie globale des principales cultures les plus pratiquées par la plupart des exploitations paysannes a été estimée à 116 480 hectares en 2003. L’évolution de ces dernières années n’a pas apporté de grands bouleversements sur les tendances et les hiérarchies présentées ci-après :
Répartition par catégorie de cultures :
• Cultures vivrières : 114 715 hectares
• Cultures de rente (Café) : 1 070 hectares
• Cultures industrielles (Canne à sucre) : 695 hect ares
La riziculture constitue le système de base de la production vivrière de la région (50% du total des superficies ci-dessus). Elle est suivie de loin par la plantation de la pomme de terre (17%) et la culture du haricot (14%). Les autres cultures de diversification alimentaire sont : le maïs (5%), l’arachide (4%), l a pomme de terre (2%), la patate douce et la culture de voanjobory.
Répartition par district :
• Fianarantsoa II : 57 125 hectares (49 %)
• Ambalavao : 26 010 hectares (22 %)
• Ambohimahasoa : 21 935 hectares (19 %)
• Ikalamavony : 11 410 hectares (10 %)
Le district de Fianarantsoa II assure à lui seul un peu moins de 50% des superficies cultivées de la région. Ambalavao et Ambohimahasoale suivent de loin avec 20% environ des superficies annuellement cultivées. Le districtd’Ikalamavony ne représente que 10% de l’agriculture malgré le potentiel immense qui s’y présente en termes de superficie exploitable
Le potentiel en agriculture commerciale existe par endroit, mais mal valorisé. La région a des vocations spécifiques en cultures de entesr et industrielles telles que la vigne (Fianarantsoa II, Ambalavao), le thé de Sahambavy (Fianarantsoa II), le tabac (Ambalavao) et le café (Fianarantsoa II). Malheureusement, aucune de ces filières n’est pas pour l’instant suffisamment développée pour créer un véritable sautur dans le développement industriel et la croissance économique de la région. Les culturesmaraîchères et fruitières (pêches et agrumes) sont relativement anciennes et assez répandues sur les hautes terres centrales.
La structure amont d’accompagnement à la piscic ulture
La Région dispose de deux stations piscicoles étatiques : Ampamaherana (Fianarantsoa II) et Ialatsara (Ambohimahasoa) qui concentrent leurs activités à la production de géniteurs de carpes royales, à la production et la redistribution d’alevins pour satisfaire les besoins des paysans dans les zones non couvertes par les producteurs privés.
§4 Les ressources minières
La région de la Haute Matsiatra est riche en ressources minières. On peut rencontrer :
• Dans le district d’Ikalamavony : fer (à Bekisompa ), gommes, béryl, tourmalines et phonolite
• Du graphite dans les districts d’Ambalavao et d’A mbohimahasoa
• Des tourmalines à Alakamisy Itenina (Fianarantsoa II).
Le secteur minier a connu un développement informel considérable depuis 1998, sous l’effet d’entraînement de l’ouverture au publi c de l’exploitation du saphir d’Ilakaka (Région Ihorombe) ; entraînant par la suite la prolifération des explorations et des trafics de tout genre dans d’autres régions. La filière est actuellement en cours d’assainissement. Larégion Haute Matsiatra a connu une exploitation de 347 carrières en 20041, soit deux fois moins de celles de la région Ihorombe (818 carrières), pas loin de celles de la région Amoron’i Mania (468 carrières)
Réseau de transport
Réseau routier
Les indications de la Direction Régionale des Travaux Publics de Fianarantsoa permettent de hiérarchiser comme suit l’état général du réseau routier de la région Haute Matsiatra :
• Longueur totale : 1 580 km
• Routes bitumées : 540 km (34%)
• Pistes praticables en toutes saisons : 240 km (15 %)
• Pistes difficilement praticables en saison de plu ie : 80 km (5%)
• Pistes praticables seulement en saison sèche : 720 km (46%)
En dehors de la RN.7 (route nationale bitumée), la plupart des voies de communication sont classées dans la catégorie des outesr ou pistes en terre à praticabilité saisonnière. Elles comportent des sections dégradées et des tronçons impraticables en saison des pluies.
Le pourcentage des communes accessible toute l’année à partir du Chef-lieu de district est très faible en dehors de Fianarantsoa I 1:
• Fianarantsoa I plus de 70 %
• Fianarantsoa II moins de 30 %
• Ambalavao 30 à 70 %
• Ambohimahasoa moins de 30 %
• Ikalamavony moins de 30 %
Cet état déplorable des routes a des retombées négatives sur la fluidité de la circulation des biens et des personnes d’une part, les coûts des transports et donc des transactions commerciales d’autres part. Les frais de transport peuvent être multipliés par 1,5 pour les marchandises, et doublés pour les passager
Transport aérien
Les lignes aériennes régionales sont de petite capacité et de faible fréquence. Il n’y a pas de liaisons internes à la région. La ligne existante relie Antananarivo (Ivato) et la ville de Fianarantsoa (Idanda).
L’aéroport d’Idanda n’a qu’une piste d’atterrissage de 1.250 m de long sur 25 m de large. La piste n’est pas sécurisée de la divagation des animaux. Seuls les Twin Otter et les ATR peuvent y atterrir. La fréquence de vols est passée de 4 fois la semaine en 1999 à 2 fois la semaine en ce moment. A noter qu’il existe une piste d’atterrissage non revêtue et non fonctionnelle à Ambalavao.
Transport ferroviaire
La ligne FCE (Fianarantsoa/Côte-Est), qui relie Fia narantsoa à Manakara sur une distance de 163 km, a été construite entre 1926 et1936. Actuellement, l’état de dégradation de la voie et la vétusté des locomotives ne permettent guère d’assurer plus d’une liaison hebdomadaire. Elle traverse 19 communes et constitue la seule voie de désenclavement pour une centaine de milliers de personnes n’ayant d’aut res moyens de transport que le chemin de fer.
La ligne a enregistré en 1989 près de 900.000 voyageurs et 30.000 tonnes de marchandises (produits pétroliers en provenance de Manakara, produits agricoles tels que le café, les bananes et letchis, autres marchandises)
Le trafic a été interrompu durant plusieurs annéesIl. a de nouveau repris en 1999 sous l’impulsion de « l’Association pour la Défensede la ligne de chemin de fer Fianarantsoa-Côte Est » ou ADIFCE, qui réunit actuellement 179 membres actifs et plus de 3000 membres sympathisants (opérateurs économiques, élus, clergé, enseignants, employés de la FCE, paysans, acteurs de la société civile, chefs traditonnels).
Le trafic actuel prend en charge annuellement une centaine de milliers de passagers et un peu plus d’une dizaine de milliers de tonnes de marchandises.
ETUDE DE MARCHE
L’étude de marché est une véritable fonction de ceprojet qui consiste à analyser l’évolution qualitative et quantitative du marché, pour élaborer les programmes de marketing dont dépendent la production et l’administration financière.
En d’autre terme, l’étude de marché permet de se renseigner sur :
Le type de produit rizicole et piscicole qui se vendrait le mieux.
Les consommateurs pour prévoir des débouchés, le mode d’achat et le prix.
La distribution à établir ou adapter selon la force de vente, les charges commerciales et de promotion.
Les concurrences pour adopter la meilleure stratégie (selon le cycle de vie du profit).
L’information économique de tout ce qui influence l’offre et la demande par la suite des fluctuations monétaires, politiques…
Pendant l’étude de marché, pour la réalisation de ec projet, nous avons utilisé les techniques et méthode du système d’information marketing notamment l’enquête par sondage, c’est-à-dire enquête par interview directe.
Par conséquent, ce chapitre se rapporte en trois sections :
• L’analyse de l’offre et de la demande
• La politique de marketing mix
• La stratégie de commercialisation
ANALYSEDE L’OFFRE ETDELADEMANDE
Analyse de l’offre
L’offre représente les fournisseurs du produit.
Elle comprend donc tous les intervenants qui apportent les présidents sur le marché, à savoir le producteur et le distributeur.
Les producteurs ou concurrents sont les entreprises qui offrent des biens et services répondant au même besoin satisfait par le produitt ele service de l’entreprise
Les distributeurs sont les personnes ou entreprises qui commercialisent et rendent disponible auprès du consommateur du président de ’entreprisel .Ils sont beaucoup plus proche des consommateurs.
Etude du comportement des consommateurs
L’étude du comportement des consommateurs consiste à identifier leurs besoins face à l’achat d’un produit. Le but de cette étude est de déterminer pourquoi un consommateur achète ou n’achète pas un produit, ainsi de déterminer pourquoi un consommateur achète un produit par rapport à un autre.
Dans la région de Fianarantsoa, il est constaté quele niveau de consommation de poissons d’eau douce est encore faible, et cela est dû à :
L’augmentation du prix du poisson sur le marché.
L’insuffisance de quantité et qualité des produitsvendus sur les marchés.
Sensibilisation des consommateurs
Pour assurer l’écoulement et la vente de nos produits, il faut sensibiliser les consommateurs à l’aide de la communication.
Toute action de communication permet de faire connaître aux clients l’existante de produits, sa performance, ses avantages qui les poussent à acheter.
Exemple : publicité, affichage, carte de visite …
Part du marché
La part du marché est le pourcentage des ventes totales d’un produit réalisé par le producteur ou l’entreprise sur un marché donné.
C’est un indicateur important sur ce projet car elle permet de déterminer la force ou l’importance de notre entreprise sur le marché.
Par conséquent, notre objectif est d’augmenter la part de marché.
POLITIQUEDEMARKETINGMIX
Le mix marketing correspond à l’ensemble des outils dont l’entreprise dispose pour atteindre ses objectifs au près du marché cible. McCarthy a proposé de regrouper ces variables en quatre catégories, qu’il a appelées les « 4 P »: le produit, son prix, sa mise en place ou distribution et sa promotion ou communication.
Politique de Qualité (produit)
Nos produits sont parmi les produits de meilleure qualité du fait que l’entretien des rizières pour la santé des poissons et l’amélioration de leur nourriture est primordial et non négligeable.
La ration alimentaire contient des aliments riches en protéines, sels minéraux, lipides, glucides ainsi que des éléments énergétiques. Doncl’amélioration de notre qualité entraîne la hausse de la part du marché.
Politique de prix
Elle conduit à établir la tarification des produits offerts par l’entreprise en tenant compte des pratiques du marché et de la concurrence.
Pour notre projet, les poissons Carpe sont offerts à un prix avantageux aussi bien pour les distributeurs que pour les consommateurs finals.
Concernant la fixation de prix sur le marché, nous essayons nos prix de vente de la manière la plus rationnelle possible afin de garantir que l’activité ne court pas à sa perte.
Mais comme nous ne sommes pas les seuls producteurs sur le marché, nous ne pouvons pas fixer nos prix uniquement à partir de c es facteurs inhérents à l’entreprise.
En effet, nous devons prendre en considération les prix affichés par les concurrents ainsi que le pouvoir d’achat des consommateurs ciblés. Ce qui nous conduit à élaborer une stratégie de prix que nous jugeons plus efficace.
Politique de distribution
Elle vise à assurer concrètement la place ou la présence sur le marché des produits offerts. Elle englobe le choix des canaux de distribution adaptés aux objectifs commerciaux de l’entreprise et aux caractéristiques de ses produits.
Pour notre projet, nous appliquons la politique de proximité pour la distribution : c’est tout simplement se mettre en contact direct avec les clients et consommateurs. En effet, les clients apprécient les conseils et avis des producteurs sur leurs achats. Les produits vendus deviennent alors plus personnalisés.
D’après la politique de proximité, nous sommes en ontact direct avec nos clients, ceci permet de recevoir très rapidement leurs réactionset d’éviter que le prix de vente n’augmente. En effet, comme nous le savons bien, les marges commerciales prises augmentent à chaque fois qu’il y a d’intermédiaires.
Nous pouvons affirmer que cette politique de proximité pour la distribution permet de fidéliser plus rapidement les clients.
Politique de communication
Elle vise à susciter dans le public des représentations favorables de l’entreprise et de ses produits et à stimuler la demande de ces dernie rs, comporte le choix des « concepts » et « messages » à faire passer, la sélection des canaux de communication (médias, relations publiques, promotion, sponsoring,…)
Les canaux de communication utilisés par notre ferme sont les médias. L’objectif de l’utilisation des médias est d’attirer de plus en plus de consommateurs à partir du choix des messages à faire passer.
Les médias servent aussi à faire reconnaître la motivation des consommateurs et l’image de la ferme. Les outils nécessaires pour arriver à cet objectif, sont les radios et les télévisions puisqu’il s’agit de véhiculer un messag axé sur la vente auprès d’un marché déterminé.
Nous pouvons affirmer que c’est actuellement le vecteur le plus opérationnel vu que la majorité de la population possède un poste radio ou/et un poste de télévision, et pour que ça soit plus efficace, il suffit de chercher à quelle heure on peut atteindre le plus grand nombre d’auditeurs (par exemple le midi et le soir avant le journal ou après…)
STRATEGIEDECOMMERCIALISATION
Définir une stratégie de commercialisation, c’est hoisirc un ou plusieurs segments de marché et élaborer des programmes de commercialisation capables de les servir c’est à dire capables de répondre à certains besoins suffisamment similaires ou non encore satisfaits.
L’entreprise adopte la stratégie « PULL » qui nécesite un investissement assez élevé à l’intention des consommateurs de façon à développ er chez eux une préférence pour la marque et créer des évènements « PULL » sous formede publicité hors médias, elle englobe des formes multiples de transmission de message. Certaines de ces formes sont directement associées à un objectif de vente c’est à dire les c onsommateurs finals.
C’est le cas pour la stratégie « PUSH » qui s’adresse directement au client potentiel, à domicile ou sur son lieu de travail, pour l’informer, mais aussi pour susciter ses commandes.
Ainsi, notre projet va adopter les deux stratégies « PUSH » et « PULL » pour avoir une bonne commercialisation envers les clients potentiels et pour accroître les réseaux de distribution sur le marché.
En tant que fonction de l’entreprise au même titreque la comptabilité, la production et les finances, la commercialisation se place suivant le schéma ci-dessous.
ETUDE TECHNIQUE ET ORGANISATIONNELLE
TECHNIQUEDEREALISATION
Choix du site et la technique à appliquer
Choix du site
La rizière doit pouvoir retenir l’eau à un niveau c onstant pendant toute la période de la culture du riz. Plus elle peut le faire longtemps, mieux elle s’adapte à la pisciculture. Les meilleurs champs sont situés juste au-dessus de la haute ligne de partage des eaux où sont entourées de hautes digues qui les protègent des inondations. Ici le choix du site est très important. En effet, toutes les rizières ne sont pas convenues pour l’élevage des poissons.
Voici les conditions nécessaires et suffisantes pour le choix du site :
Avoir une bonne maîtrise d’eau pendant au moins 4 mois entre novembre et juin proche de la maison de l’éleveur pour éviter le risque de perte à l’insécurité et pour faciliter la bonne surveillance des poissons et entretien du lieu ;
à proximité d’un cours d’eau permanente pour assurer le remplissage des rizières ;
un sol argileux qui retient l’eau ;
sur un terrain légèrement en pente (2 à8%) pour pouvoir vider les rizières. bien ensoleillée.
Choix de rizipisciculture à appliquer
D’après notre étude sur les différents systèmes desrizipiscicultures cités ci-dessus, nous avons retenu comme système pour ce projet : « La rizipisciculture intensive » car elle rapporte beaucoup de rendement et donne une meilleure récolte de riz en même temps des poissons.
Les différents types d’espèce
On rencontre différents espèces à Madagascar tel que :
Le Tilapia
Ce sont des groupes d’espèces tropicales de poissons d’eau douce originaires d’Afrique et de Moyen-orient.
Ce sont des poissons robustes et peuvent supporter des températures extrêmes de l’eau et de bas niveau d’oxygène. Ils commencent leur croissance et leur reproduction a une température entre 20 et 30°C.
Ils supportent des températures d’eau descendant jusqu’à 12°C, mais ils ne survivent pas a des températures inférieures à 10°C.
L’avantage c’est qu’ils mangent presque tout et se nourrissent surtout des plantes aquatiques. Ils sont favorables à la culture et son t des espèces idéales pour la pisciculture.
L’inconvénient c’est qu’ils se reproduisent presque continuellement et rapidement. Ils sont sexuellement matures dès qu’ils atteignent la taille de 10cm (environ 30g du poids du corps). Ceci provoque la surpopulation des étangs des jeunes poissons et entraîne la concurrence alimentaire entre les nouveau-nés et les poissons mis en charge.
Cela entraîne la baisse du taux de croissance de tilapia et de la récolte d’un grand nombre de tilapia de petite taille.
La Carpe
La carpe appartient à la famille des cyprinidés d’eau douce. C’est une famille très rependue et très abondante dans sa distribution naturelle.
Elle se divise en trois groupes :
– La carpe commune
– La carpe indienne
– La carpe chinoise
La carpe commune est un poisson uniquement d’eau douce, cultivé un peu partout dans le monde. Elle peut atteindre une longueur de 80cm et un poids de 10 à 31kg. Elle supporte des températures qui varient entre 1 à 40°C. Elle commence sa croissance à des températures supérieures à 13°C et se reproduit à des températures supérieures à 18°C.
Grâce à sa rapidité de croissance, elle peut attein dre un poids de 400 à 500g en 6 mois. Elle commence sa maturité après 2ans, à un poids de 2 à 3kg. La femelle produite entre 100000 et 150 000 œufs par kg de son poids corpore l.
La carpe commune est une espèce robuste et résistante à la plupart des maladies grâce à une bonne condition environnementale.
Pour la carpe indienne et la carpe chinoise, ces poissons sont aussi uniquement d’eau douce. Ils ne résistent pas aux basses températuresde l’eau et ont un niveau de croissance optimal vers 25°C. L’âge de maturité dépend du sexe et du niveau de croissance. Les mâles sont matures plus tôt que les femelles car ils se d éveloppent plus vite. Le poids de la maturité est de 5kg au moins pour la carpe chinoise et entre 2 à 4 kg pour la carpe indienne. Elles pondent des œufs qui flottent sur l’eau.
Choix des espèces à élever pour le projet
Sur les Hautes Terres de Madagascar, la meilleure espèce de poisson est la carpe, ainsi, notre analyse sur les différentes espèces citées ci-dessus et dans le cadre de ce présent projet, nous avons choisi la « carpe commune » car elle possède plus de caractéristiques différenciées aux autres.
Méthodes de production des poissons en rizières irriguées :
La rizière se présente comme un milieu favorable à la croissance des poissons malgré la faible profondeur de l’eau. Donc il est impératif de valoriser ce milieu pour l’amélioration de la chaîne alimentaire des poissons et pour une production plus améliorée.
Adaptation du rizipisciculture en fonction de la riziculture irriguée :
En riziculture, le niveau de l’eau est de 3 à 5cm a u départ et progressivement selon la croissance du riz ce niveau peut atteindre 20cm jusqu’à la phase de productivité. Alors certains poissons ne tolèrent pas cette hauteur d’eau qui présente des inconvénients pour eux. Idéalement la hauteur de l’eau en rizipisciculture devrait être de deux ou trois fois plus haute que celle en riziculture seulement.
Aménagement des rizières pour la pisciculture
Maîtrise d’eau :
On ne doit empoissonner la rizière que s’il y a une parfaite maîtrise d’eau aux risques soit l’inondation avec fuite des poissons d’élevages, soit d’assèchement prématuré de la rizière et asphyxie des poissons.
Chaque rizière est munie d’un dispositif d’alimentation et de contrôle d’eau ainsi que d’un système de vidange fonctionnant en même tempscomme trop plein. Il faut absolument installer des grillages à l’entrée et à la sortie d ’eau de la rizière. Ces grillages empêchent l’intrusion des poissons sauvages non désirés dansla rizière et la fuite des poissons élevés. Et il faut nettoyer les grillages régulièrement.
|
Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE: PRESENTATION GLOBALE DU PROJET
CHAPITRE I : RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Section I : HISTORIQUE DE LA RIZIPISCICULTURE DANS LE MONDE
§1 Objectifs généraux
§2 Avantages de la rizipisciculture
§3 Inconvénients de la rizipisciculture
§4 Analyse stratégique
Section II : GENERALITES DE L’AQUACULTURE D’EAU DOUCE A MADAGASCAR
§1 Système de la rizipisciculture
1.1 Système extensif
1.2 Système semi – extensif
1.3 Système intensif
Section III: PRESENTATION DE LA REGION HAUTE MATSIATRA
§1 Localisation géographique
§2 Le district d’Ambalavao
§3 Superficie et situation administrative
§4 Les unités climatiques
4.1 Les températures
4.2 La pluviométrie1
4.3 Hydrologie
4.4 Sols et végétations
Section IV: POTENTIALITES ECONOMIQUES DE LA REGION
§1 L’agriculture
1.1 Densité agricole et vocation régionale hétérogènes
1.2 Une agriculture essentiellement vivrière
§2 L’élevage et les ressources animales
2.1 Les ruminants
2.2 Les petits élevages
§3 Ressources halieutiques :
3.1 La production de poissons d’eau douce
3.2 La structure amont d’accompagnement à la pisciculture
§4 Les ressources minières
§5 Réseau de transport
5.1 Réseau routier
5.2 Transport aérien
5.3 Transport ferroviaire
CHAPITRE II : ETUDE DE MARCHE
Section I : ANALYSE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE
§1 Analyse de l’offre
§2 Etude de la concurrence :
2.1 Concurrents directs :
2.2 Concurrents indirects
§3 Analyse de la demande
3.1 Clients
3.2 Etude du comportement des consommateurs
3.3 Sensibilisation des consommateurs
§4 Part du marché
Section II : POLITIQUE DE MARKETING MIX
§1 Politique de Qualité (produit)
§2 Politique de prix
§3 Politique de distribution
§4 Politique de communication
Section III : STRATEGIE DE COMMERCIALISATION
CHAPITRE III : ETUDE TECHNIQUE ET ORGANISATIONNELLE
Section I : TECHNIQUE DE REALISATION
§1 Choix du site et la technique à appliquer
1.1 Choix du site
1.2 Choix de rizipisciculture à appliquer
1.3 Les différents types d’espèce
Le Tilapia
La Carpe
1.4 Choix des espèces à élever pour le projet
§2 Méthodes de production des poissons en rizières irriguées :
2.1 Adaptation du rizipisciculture en fonction de la riziculture irriguée :
2.2 Aménagement des rizières pour la pisciculture
2.2.1 Maîtrise d’eau :
2.2.2 Surélévation des diguettes :
2.2.3 Etangs-refuges :
§3 Construction de compostière dans l’étang refuge :
3.1 Fabrication de compost :
3.2 Technique de contrôle de la qualité d’eau :
3.2.1 Le Disque de Secki :
3.2.2 Le pH mètre :
Section II : PROCESSUS ET STRATEGIE DE PRODUCTION
§1 Les différents processus
1.1 Empoissonnement :
1.2 Traitement par les produits phytosanitaires :
1.3 L’eau :
1.4 Phase introductive:
1.5 Sarclage :
§2 Alimentation et traitements
2.1 Les ingrédients qui donnent de l’énergie :
2.2 Les ingrédients qui contiennent beaucoup des protéines:
2.3 Composition d’aliment supplémentaire pour les poissons :
2.4 Distribution des aliments de la carpe
§3 Maladies de la carpe
3.1 Maladies nutritionnelles
3.2 Maladies infectieuses
§4 Prévention des maladies
§5 Récolte des poissons
Section III : ETUDE ORGANISATIONNELLE
§1 Forme juridique et capital
§2 Structures organisationnelles
§3 Les principales attributions
§3 Chronogramme d’action de la première année
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
DEUXIEME PARTIE: CONDUITE ET ETUDE FINANCIERE DU PROJET
CHAPITRE I : COÛT D’INVESTISSEMENT ET COMPTE DE GESTION
Section I : LE COÛT DES INVESTISSEMENTS
§1 Nature des immobilisations
1.1 Les immobilisations incorporelles
1.2 Les immobilisations corporelles
1.2.1. Terrains
1.2.2. Les constructions
1.1.3. Agencement et installation
1.2.4. Matériels et mobiliers du bureau
1.2.5. Matériels et outillages (M&O)
1.2.6. Matériels informatiques et de communication
1.2.7. Matériel de transport
§2 Tableau d’amortissement
Section II : LES COMPTES DE GESTION
§1 Compte des charges
1.1 Les achats consommés de matière et main d’œuvre
1.2 Les achats non stockés
1.3 Les services extérieurs
1.4 Les autres services extérieurs
1.5 Les charges de personnel
1.6 Impôts et taxes
1.7 Les autres charges
§2 Les comptes de produits
Section III: FINANCEMENT ET BILAN D’OUVERTURE DU PROJET
§1 Financement du projet
1.1 Le Financement interne
1.1.1. La Formation du Capital :
1.1.2. L’Autofinancement :
1.2 Le Financement externe
1.2.1. Financement par fonds propres
1.2.2. Financement par dettes
§2 Conditions d’octroi de crédit bancaire
2.1 Critères Subjectifs
2.2 Critères Objectifs
§3 Durée et le taux de crédit
§4 Remboursement des dettes
§3 Détermination du fonds de roulement
§4 Bilan d’ouverture
CHAPITRE II : ANALYSE ET ETUDE DE FAISABILITE FINANCIERE
Section I : ANALYSE DE LA RENTABILITE
§1 Les flux de trésoreries prévisionnelles
§2 Le compte de résultat prévisionnel et la rentabilité :
Section II : BILANS PREVISIONNELS
Section III : LES RATIOS
§1 Ratio de rentabilité commerciale
§2 Ratio de rentabilité économique
§3 Ratio de rentabilité financière
§4 Ratio d’autonomie financière
CHAPITRE III : EVALUATION ET IMPACT DU PROJET
Section I : EVALUATION FINANCIERE DU PROJET
§1 Outils d’évaluation
1.1. Valeur actuelle nette (VAN)
1.2. Taux de rentabilité interne (TRI)
1.3. Indice de profitabilité (I.P)
1.4. Délai de récupération du capital investi (DRCI)
§2 Critères d’évaluation
2.1. Pertinence
2.2. Efficacité
2.3. Efficience
2.4. Durée de vie
Section II : EVALUATION ECONOMIQUE
§1 Notion de la valeur ajoutée
§2 Projection de la valeur ajoutée
Section III : EVALUATION SOCIALE
§1 La création d’emploi
§2 L’autofinancement nutritif
§3 Développement des capacités techniques
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
Télécharger le rapport complet