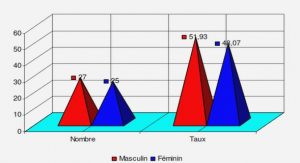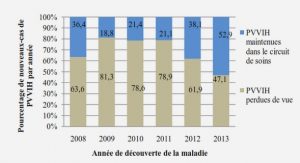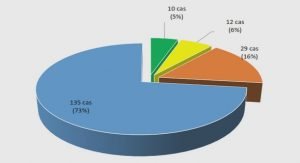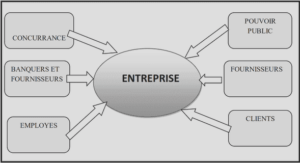Ce début du troisième millénaire est marqué par la dominance de la hausse des produits pétroliers. La recherche d’énergie de substitution est devenue ainsi au cœur des préoccupations des chercheurs.
L’origine de l’idée se tourne autour de cette recherche combien importante pour le secteur énergie.
De l’autre coté, les bénéfices espérés dans le cadre de la politique énergétique à Madagascar, sont considérables :
– la diminution des risques pour la santé du fait de l’usage du bois énergie pour la cuisson et le chauffage ;
– la diminution de la déforestation, de l’érosion et des pertes de la biodiversité ;
– la diminution des gaz à effet de serre ;
– la diminution des dépenses d’énergie dans le budget des ménages ;
– la création d’emplois et génération des revenus pour améliorer le niveau de vie dans les campagnes.
Une étude sur la faisabilité de transformation du charbon de terre pour usages domestiques a été récemment réalisée par un centre de recherche.
Présentation
Cadre administratif et socio économique
Sur le plan administratif les bassins houillers de la Sakoa se localisent au Sud-Ouest de Madagascar, dans la commune rurale de Soamanonga, district de Betioky, région Atsimo Andrefana, accédés par :
✔ la RN 7 sur 850km (bitumée) jusqu’à Andranovory,
✔ la RN 10 sur 90km (en terre battue) jusqu’à Betioky Sud,
A partir de Betioky, trois chemins mènent à Soamanonga :
– le premier, en suivant l’axe RN 10, avec une bifurcation dans le village d’Ambatry;
– le second, en suivant l’axe RN 10; la bifurcation se situe à Beahitse à 57 km de Betioky, reliant Beroy et Soamanonga ;
– le troisième, reliant Ambatry-Beroy- Soamanonga –Ankinany. Actuellement, les accès aux différents sites sont presque en mauvais état.
Sur le plan environnemental, la déforestation de la région et culture sur brûlis figurent parmi les sources de la dégradation de l’environnement de la zone. Cela entraîne la réduction de la surface cultivable due à l’ensablement des rizières pendant les périodes de pluies.
La forêt dans commune rurale de Soamanonga est classée forêt naturelle (Ala Sakoa), d’une superficie totale de 254ha, de type claire avec de présence de grands arbres.
Du point de vue activités économiques, l’agriculture et l’élevage sont les plus pratiqués. La surface agricole représente environ 20% de la superficie communale: chaque ménage détient en moyenne 0,5 ha de terrain agricole. La surface irriguée est estimée à 0,1 ha par ménage.
Les cultures vivrières pratiquées sont :
• le manioc : 75 à 100% des ménages, avec un rendement de 10 à 15 t/ha et dont plus de la moitié est destinée à la vente;
• le riz : 75 à 100% des ménages, avec un rendement de 3 à 5t/ha dont 50 à 75% de la production est destinée à l’autoconsommation ;
• la patate douce : avec un rendement de 10 à 15 t/ha où les 10 à 25% est destinée à la vente ;
• le maïs : 75 à 100% des ménages, avec un rendement de 3 à 5 t/ha et dont les 5 à 10% est destinée à la vente .
Quant à l’élevage, chaque famille possède en moyenne 11 têtes de bovidés en pâturage nocturne en utilisant le système de gardiennage. L’effectif de la population de Soamanonga est aux environs de 11000 habitants en 2006. C’est une population jeune avec une densité de population de 55 hab/km2 ; la taille de ménage varie de 4 à 5 selon la richesse (le nombre de bétails) de chaque famille.
Cadre géographique
Les bassins houillers de la Sakoa s’étendent sur plus de 100 km suivant la direction N.NE, de l’Imaloto aux sources de la Sakamena. Les affleurements se répartissent en quatre bassins qui sont, du NE au SW :
– le bassin de l’Imaloto, situé au Nord de l’Onilahy. Les couches subhorizontales se suivent sur une dizaine de kilomètres le long de l’Imaloto et ses affluents de rive droite ;
– le bassin d’Ianapera, à 40 km au Sud du bassin de l’Imaloto. Les affleurements de charbon sont irrégulièrement distribués sur la bordure du bassin ;
– le bassin de la Sakoa qui s’étend de l’Onilahy au village de Beroy, sur une soixantaine de kilomètres. On y distingue, du Nord au Sud:
– secteur du Vohibory ;
– secteur de la Sahaazy ;
– secteur de Beroy ;
– secteur de la Sakoa.
– le bassin de la Sakamena, de direction parallèle à celle du bassin de la Sakoa, mais décalé de 6 km vers l’Ouest.
Les études et les exploitations
Les études entreprises
Parmi les documents disponibles, l’on peut relever les conclusions suivantes :
Etudes réalisées par KOPEX et SAARBERG-INTERPLAN
Les bureaux d’études polonais KOPEX, en 1978 et allemand SAARBERG INTERPLAN, en 1979 ont établi des rapports techniques concernant la mise en exploitation du gisement de charbon de la Sakoa. Étant entendu que la production, tout en satisfaisant en priorité les besoins intérieurs relativement limités, serait surtout destinée à l’exportation.
D’abord, ils ont relevé deux points importants :
– difficultés d’évacuation du charbon vers la côte, que ce soit par voie routière ou par voie ferrée,
– importance des aménagements portuaires nécessaires, que ce soit sur le site de Toliara (Tuléar) ou sur le site de Soalara.
Ensuite, ils définissent des schémas d’exploitation minière complétés par des évaluations de coût. Ils précisent les méthodes et structures d’exploitation, les travaux préparatoires et les équipements nécessaires pour différentes hypothèses de tonnages d’extraction et fournissent des plans de développement de la production.
Ces deux rapports portent sur le secteur de la Sakoa, car à cette époque c’est le mieux connu et le seul qui renferme des réserves probables en quantités suffisantes. Il est limité au Sud au niveau du lieu-dit Mahasora, et au Nord au niveau du lieu-dit Mavonono. Les dimensions du domaine ainsi défini sont d’environ 8 x 3 km.
Tel qu’il est actuellement délimité, le gisement de la Sakoa est allongé suivant la direction SO-NE, avec un pendage de 20° à 30° W. Le s veines de charbon affleurent à l’Est et s’ennoient à l’Ouest sous un recouvrement de morts-terrains. Il a été reconnu par une dizaine de sondages, des tranchées, des petites descenderies et par les travaux miniers de l’exploitation pilote ouverte de 1941 à 1953 au lieu-dit Andranomanitsy.
Études réalisées par le consortium WPN – PEG-SIP
Il s’agit des études techniques et économiques réalisées en 1981 aboutissant à des possibilités d’exploitation et de mise en valeur du gisement. Deux variantes ont été retenues à cet effet :
– variante A : production de charbon destinée à couvrir les besoins nationaux estimés à 0,3Mt/an; c’est une exploitation à ciel ouvert étant donné que ce type d’exploitation permet une mise en valeur rapide du gisement et que cette solution s’avère adéquate pour la demande intérieure.
– variantes B : production de charbon avec possibilité d’exportation ; c’est une exploitation souterraine avec une capacité annuelle de production utile de 4 Mt.
Études réalisées par le syndicat BME-CFE- COCKERILL
L’étude réalisée en 1981 par le Syndicat belge composé de Belgian Mining Engineers, de la Compagnie d’Entreprises CFE et de la Société COCKERILL constitue également une étude économique préliminaire qui repose sur des consommations internes de 200 000 t/an . Celles-ci pourraient se superposer sur une production à l’exportation qui ne peut s’envisager que pour des quantités justifiant la construction d’infrastructures lourdes, c’est à- dire un minimum de 2 Mt/an.
Etudes réalisées par NORWEST
Cette étude a été réalisée par NORWEST en 1989 (North American consulting group). Elle a utilisé les informations de forage entreprises par le Bureau Minier Français de 1949 à 1953 et l’OMNIS de 1986 à 1988.
|
Table des matières
INTRODUCTION GENERALE
PREMIERE PARTIE : CONTEXTE GENERAL
Chapitre 1 : Présentation
1 . 1 – Cadre administratif et socio économique
1 . 2 – Cadre géographique
1 . 3 – Cadre géologique
1 . 4 – Cadre historique
Chapitre 2 : Les études et les exploitations
2 . 1 – Les études entreprises
2 . 1 . 1 – Etudes réalisées par KOPEX et SAARBERG-INTERPLAN
2 . 1 . 2 – Études réalisées par le consortium WPN – PEG-SIP
2 . 1 . 3 – Études réalisées par le syndicat BME-CFE- COCKERILL
2 . 1 . 4 – Etudes réalisées par NORWEST
2 . 2 – Les exploitations et utilisations
Chapitre 3 : Problématique
Les hypothèses
DEUXIEME PARTIE : METHODOLOGIE ET ANALYSE
Chapitre 4 : Présentation
Chapitre 5 : Approche classique (outils classiques utilisés)
5 . 1 – Phase de documentation
5 . 2 – Phase d’investigations sur terrain
5 . 3 – Phase d’expérimentations
Chapitre 6 : Les outils scientifiques utilisés
6 . 1 – Le cadre logique
6 . 1 . 1 – Définition et présentation
6 . 1 . 2 – Utilité de la méthode
6 . 1 . 3 – L’Approche Cadre Logique
6 . 2 – Facteurs de réussite d’un projet
6 . 3 – L’analyse de la valeur
6 . 3 . 1 – Définitions
6 . 3 . 2 – Notion de valeur
6 . 3 . 3 – Champ d’application de la notion de valeur
6 . 3 . 4 – Qu’est ce qu’on attend de l’AV ?
6 . 4 – Arbre à problèmes – diagramme d’ ISHIKAWA
6 . 5 – Méthode comparative
6 . 5 . 1 – Essai de définition et présentation
6 . 5 . 2 – Élaboration et étapes
6 . 6 – Méthode d’évaluation périodique (MEP)
6 . 6 . 1 – Définition
6 . 6 . 2 – Démarche générale
6 . 6 . 3 – Approche
6 . 7 – La méthode d’évaluation financière
Chapitre 7 – Les différents coûts dans un projet industriel
7 . 1 – Investissements et amortissements
7 . 2 – Les coûts de production
Chapitre 8 – Méthode de management d’un projet
8 . 1 – Le cadrage du projet
8 . 2 – Le management du projet
TROISIEME PARTIE : APPLICATIONS ET RESULTATS
Chapitre 9 – Présentation succinte du projet
9 . 1 – Aspect technique et technologique
9 . 2 – Aspect financier
9 . 3 – Aspect socio environnemental et organisationnel
Chapitre 10 – Exploitation industrielle ou artisanale du gisement
10 . 1 – Généralité
10 . 2 – Le Choix du scénario « optimal »
Chapitre 11 – Identification des axes stratégiques de recherche
11 . 1 – Analyse des problèmes : application de la méthode d’Ishikawa
11 . 2 – Le cadre logique
Chapitre 12 – Application de l’analyse de la valeur
12 . 1 – Analyse de la valeur sur le coût du projet (application en amont)
12 . 1 . 1 – Analyse de la valeur sur la stratégie d’investissement
12 . 1 . 2 – Application de l’AV sur la stratégie technique et organisationnelle
12 . 1 . 3 – L’AV sur la stratégie comptable et financière
12 . 2 – Analyse de la valeur en aval du produit
Chapitre 13 – Optimisation et chiffres
13 . 1 – Impacts de l’AV sur les indicateurs de projet
Chapitre 14 – Application de la méthode d’évaluation périodique
14 . 1 – Identification et analyse des impacts
14 . 2 – Élaboration des mesures d’atténuation
14 . 3 – Évaluation des impacts résiduels
Chapitre 15 – Recommandations
15 . 1 – L’aspect technique et technologique
15 . 2 – L’aspect financier
15 . 3 – L’aspect social
15 . 4 – L’aspect organisationnel et administratif
15 . 5 – L’aspect environnemental
15 . 6 – Recommandations
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES