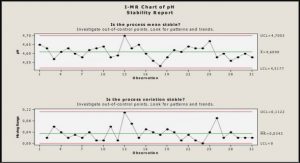Classifications selon l’échelle spatiale du modèle
• Les modèles globaux : On parle de modèles globaux quand les considérations concernant la variabilité de l’espace et des entrées ne sont pas prises en compte. Le bassin réagit dans sa totalité à l’évènement climatologique d’entrée. La prise en compte de la fonction « organisation » se fait d’une manière simplifiée puisque aucune répartition spatiale n’est prise en compte. Il s’agit de définir une unité spatiale telle que la variabilité des données d’entrée peut être négligée. On dispose ainsi d’une unité physiographiquement homogène et réagissant d’une manière globale par rapport aux autres unités. Ainsi la variabilité spatiale des systèmes participants aux phénomènes hydrologiques, et l’hétérogénéité du cadre géographique sont réduites à des considérations globales. C’est le cas de GR3J ou CEQUEAU qui considèrent une seule unité de production.
• Les modèles distribués : On parle de discrétisation de l’espace, « modèle à discrétisation spatiale », car il faut diviser le bassin en surfaces élémentaires sur lesquelles on peut simuler le comportement du bassin d’une façon homogène. Il existe plusieurs manières de discrétiser le bassin, la plus courante est celle du découpage par mailles carrées emboîtées (une maille = une unité), c’est le cas par exemple pour le Modèle Hydrologique Maillé (MHM). Elles peuvent également être regroupées en classe dont le fonctionnement hydrologique est considéré comme identique : au lieu d’être calculé en chaque point, le bilan hydrologique est établi pour chaque classe. Chaque modèle a ses propres critères pour définir les classes hydrologiques (critères topographiques, critères de couverture sol/ végétation).Pour SWAT, on parle d’Unité de Réponse Hydrologique (HRU) que l’on explicitera ultérieurement. Actuellement avec le développement de l’infographie, on peut faire appel à des outils plus performants tels que le SIG (Système d’Information Géographique), qui seront couplés avec le modèle.
• Les modèles semi – distribués : Quand on a plusieurs unités de production dont les localisations géographiques ne sont pas connues, on parle de modèle « semi-distribué ». Afin de mieux expliquer, prenons le cas du modèle VIC : la fonction de production est dépendante de la profondeur du réservoir qui n’est pas homogène sur le bassin. Ainsi, la variable est distribuée mais la localisation de la portion du bassin présentant une profondeur donnée n’est pas connue. L’établissement de carte représentant la profondeur n’étant pas possible, le modèle ne sera pas qualifié de « distribuer », par contre il est « semi-distribué » car il considère que le bassin n’a pas le même fonctionnement en tout point.
Hydrotel : l’intégration des données de télédétection
Ce modèle a été conçu en collaboration entre l’INRS EAU Canada et Laboratoire d’Hydrologie et Modélisation de Montpellier (Fortin et al., 1995), dans le but de créer un outil capable d’intégrer et de gérer la spatialisation des données et des processus physiques. Il utilise ainsi les données issues de la télédétection et les SIG. Il se décompose en 2 modules : PHYSITEL (pour le traitement du MNT en vue de la détermination des unités hydrologiques du bassin et de son réseau de drainage) et HYDROTEL (pour la simulation hydrologique). Ce dernier module intègre, en plus des résultats de PHYSITEL, le type de sol, sa profondeur racinaire, la pluie (sous forme de pluviographes), l’occupation des sols et les caractéristiques de la végétation (albédo, indice foliaire). Il simule l’ETP, la fonte des neiges, le ruissellement superficiel (par l’onde cinématique), la propagation de la crue dans la rivière avec l’onde cinématique ou l’onde diffusante. Ce modèle présente l’avantage d’intégrer l’imagerie satellitale, d’utiliser des équations physiques pour modéliser les processus de genèse et de propagation de crues et de se présenter sous la forme d’une interface conviviale. Toutefois, il nécessite une grande quantité d’informations pour son calage initial. De plus, son pas de temps horaire est très limitatif pour la prévision des crues éclair.
ANALYSE DE LA GESTION DU BARRAGE RESERVOIR D’ANTARAMANANA
D’après l’estimation des débits des crues de l’IKOPA par la méthode statistique pour différentes périodes de retour selon la loi de PEARSON 5. Et vue de l’intensité exceptionnelle de l’ordre de 980 m3/s en 1959(crue historique), à Antananarivo, ainsi que la possibilité d’apparition de l’étiage et le développement de l’activité économique de la région d’Analamanga, ont rendu nécessaire la régularisation du bassin de l’Ikopa en vue d’un double objectif de protection de cette région contre les crues et de soutien des étiages [Villion, 1997 ; Meybeck et al., 1998]. On a vu que lors du passage d’un bassin, d’un état naturel à un état influencé, les paramètres du modèle étaient largement affectés, notamment le paramètre de capacité du réservoir de production. Dans le cas de construire un nouvel ouvrage, en vue d’assurer la protection contre les inondations et la régularisation des débits des rivières à l’étiage, on souhaite d’optimiser les lâchures et le réservoir est géré suivant un règlement d’eau qui détermine des débits réservés à laisser en rivière. L’exploitation journalière des réservoirs est conduite localement en respectant au mieux une consigne d’évolution des volumes du réservoir.
CONCLUSION
On a présenté dans le cadre de ce travail, une application de modélisation des pluies – débits dans le bassin du barrage d’Antaramanana, qui a pour objectif général, de parvenir à proposer une approche méthodologique pour la prédétermination des débits afin d’avoir une meilleure compréhension du comportement hydrologique du bassin versant de l’Ikopa; on a entamé l’application du modèle génie rural au pas du temps journalier (GR4J). Des multiples applications des modèles pluie-débit existent: simulations de crues à court terme, prévision d’étiages, prédétermination des crues et dimensionnement d’ouvrages, mise en évidence du non stationnarité du comportement hydrologique sous l’effet du changement climatique ou de l’évolution de l’occupation du sol…. Les paramètres d’entrés utilisés sont les précipitations avec l’ETP calculée par la méthode de Penman pour l’application du modèle du génie rural. Le paramètre de sortie étant la lame d’eau écoulée au niveau de la station d’Ambohimanambola. Dans notre étude nous pouvons proposer, un modèle pluie-débit plus fiable et plus robustes capable de représenter la réponse hydrologique du bassin versant, GR4J (version de Perrin et al 2003). Les formulations mathématiques des quatre paramètres du modèle correspondant à la fonction de production et la fonction de transfert qui représentent les processus de génération des débits ont été regroupés. On a testé la sensibilité du modèle par rapport à chaque paramètre comme on a testé les données des couples pluie-débit observés afin de comprendre son fonctionnement. Les résultats au calage sur la fonction objective Q, et la validation des résultats obtenus donnent des résultats permettant de constater que la modélisation pluie-débit élaborée par l’utilisation de GR4J présente des résultats très acceptables pour les pluies moyennes de l’IKopa. Par ailleurs les modèles pluie-débit sont des outils qui permettent de simuler les débits en un point donné d’un cours d’eau sur le bassin versant correspondant. Afin d’améliorer la gestion du risque d’inondation au niveau du barrage d’Antaramanana, cette modélisation permet aussi de simuler les débits pour différents volumes de lâchers au barrage. La gestion du barrage serait améliorée, permettant à la fois de maximiser le remplissage du réservoir et de minimiser les risques de déversement et d’inondations en aval. Enfin, nous pouvons dire que les résultats pour l’application des modèles du Génie Rural aux données du bassin versant de l’Ikopa sont très satisfaisants et ceci pour le pas de temps utilisé (Journalier)
|
Table des matières
INTRODUCTION
Chapitre I – PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE
I – LE MILIEU PHYSIQUE
a – Situation générale
b – Relief-Sol et sous-sol
c – Le réseau hydrographique
d – Végétations et occupations des sols
II – CARACTERISTIQUES DES PARAMETRES CLIMATIQUE
a – CARACTERISTIQUES DES PARAMETRES HYDROLOGIQUE
b – CARACTERISTIQUES DES PARAMETRES DE TEMPERATURE ET DE L’EVAPOTRANSPIRATION
III – LE REGIME HYDROLOGIQUE
a- Le réseau d’observation
b- Caractéristiques hydrologiques
IV – PRESENTATION DE LA SITUATION DE LA PLAINE D’ANTANANARIVO
a – Cadre Physique
b – Situation de la plaine d’Antananarivo
c – Situation actuelle
V – CONTEXTE ET OBJECTIFS
a – Contexte du sujet
b- Définition du sujet et objectifs
VI – LA GESTION DU BARRAGE-RESERVOIR VIS-A-VIS DU RISQUE D’INONDATION
VII – DIFFERENTS MODES DES SOLUTIONS DE MODELISATION EXISTANTES
a- Les modèles hydrauliques
b- Les modèles hydrologiques
c – Les modèles alliant hydraulique et hydrologie
Chapitre II – GENERALITES SUR LA MODELISATION HYDROLOGIQUE
I – INTRODUCTION
II – LA MODELISATION HYDROLOGIQUE
a – Définition
b – Objectifs
c – Approche utilisée par les modèles
III – CLASSIFICATIONS DES MODELES
a – Classifications selon les approches
b – Classifications selon l’échelle spatiale du modèle
c – Classifications selon la nature des variables intégrées au modèle
d- Classification basée sur la représentation des processus hydrologiques
e – Autres présentations de quelques modèles
f – Les modèles génie rural GR
IV – CHOIX DU MODELE UTILISE
V – LA MODELISATION PLUIE-DEBIT
a – Généralité sur modélisation pluie – débit
b- Objectif de la modélisation
c- Les applications de la modélisation pluie-débit
Chapitre III – PRESENTATION DU MODELE UTILISE
I – STRUCTURE DU MODELE
II – SCHEMA STRUCTUREL DU MODELE GR4J
III – PRINCIPE ET FONCTIONNEMENT DU MODELE
IV – PRINCIPE D’UTILISATION DU MODELE GR4J
V – CALAGE ET VALIDATION DU MODELE
VI – CHOIX DES CRITERES D’EVALUATION EN CONTROLE
Chapitre IV – RESULATS DE LA MODELISATION AVEC GR4J
I – GENERALITES
II – RESULATS OBTENUS AVEC LE MODELE INITIAL
a – Résultats obtenus avec la simulation du modèle initial
b – Résultats retenus au calage
c – Résultats retenus en contrôle à la performance
III – ANALYSE EN CAS DE LA PRESENCE D’UN BARRAGE
IV – ANALYSE DE LA GESTION DU BARRAGE RESERVOIR D’ANTARAMANANA
ANALYSE ET SUGGESTION
CONCLUSION
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ANNEXES
RESUME
Télécharger le rapport complet