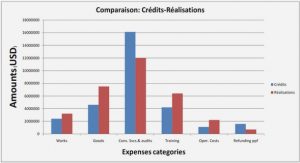La ville en extension
La période dans laquelle nous vivons est marquée par une modification sans précédents des écosystèmes sous l’effet des activités humaines, mais aussi d’un changement majeur de l’environnement dans lequel la majorité de l’humanité vit. On estime qu’environ 43% de la surface de la Terre ont directement subis des transformations dues à l’activité anthropique. Ces transformations sont principalement liées à l’expansion des zones urbanisées et des grandes agglomérations. Ainsi, en 2014, 54% de l’humanité vivait en ville. Selon les prévisions avancées par les Nations Unies, cette proportion devrait atteindre les 66% d’ici 2050, et la surface couverte par les villes, quant à elle, devrait doubler à l’échelle mondiale d’ici 2025 (United Nations, 2014). L’urbanisation est un mouvement historique de transformation des sociétés humaines, qui désigne le processus de croissance de la population urbaine et d’extension des villes. Si ce phénomène a lieu de façon continue en Europe et dans les pays dit du « Nord » depuis la première révolution industrielle, l’urbanisation a tendance à y ralentir, et ce sont les pays en développement qui connaissent aujourd’hui la croissance urbaine la plus forte. Ainsi, selon les projections de l’ONU, l’effet combiné de l’urbanisation croissante et de la croissance contribuera à une augmentation de 2,5 milliards de personnes supplémentaires dans les villes d’ici 2050, dont 37% en Inde, qui a actuellement la plus grande population rurale, suivi par la Chine et le Nigeria (United Nations, 2014). Une urbanisation rapide est généralement vue comme une des conséquences d’une forte augmentation de la population, la croissance urbaine étant alimentée de manière directe par la croissance démographique en milieu urbain et, de manière indirecte, par l’exode rural résultant d’une pression démographique toujours plus intense dans les campagnes (Véron, 2007). L’exode rural et le développement d’une société tournée vers l’industrie et les services ont fait des centres urbains la source principale d’emploi salarié (Julien et al., 2004). L’attrait culturel et politique de ces centres, en particulier des capitales, encourage l’arrivée de nouveaux habitants, malgré des hausses chroniques de loyers et de prix du foncier. On constate ainsi un désir de ville, « une valorisation des spécificités locales, de la culture et du patrimoine, la recherche de la socialité et de la centralité, d’une jouissance des aménités dans la ville » (Dubois et al., 2001, p. 832). D’autre part, l’urbain s’étale, à la fois en raison de l’évolution des modes de vie (désirs d’un habitat individuel, généralisation de l’automobile et développement des transports en commun) et de manifestations nouvelles de l’économie de marché (centres commerciaux, logiques d’implantation des entreprises) (Haase and Nuissl, 2010). Cependant, si l’urbanisation peut présenter de réels avantages et des opportunités de développement sur les plans économiques et humains, ses conséquences sur la santé humaine, son mode de vie, sont nombreuses. Kumaresan (2011) déclare que «le monde s’urbanise rapidement, d’où d’importants changements dans nos niveaux de vie, nos modes de vie, notre comportement social et notre santé». Il ajoute que «même si la vie en ville offre toujours de nombreuses possibilités, dont celle d’accéder à des soins de meilleure qualité, les environnements urbains actuels peuvent aussi concentrer les risques sanitaires et être à l’origine de dangers nouveaux». Les problèmes sanitaires les plus manifestes dans les villes sont ainsi liés à l’eau, à l’environnement, à la violence et aux traumatismes, aux maladies non transmissibles (maladies cardio-vasculaires, cancers, diabète et maladies respiratoires chroniques) en grande partie liées à une mauvaise alimentation, à l’absence d’exercice physique, ou à la pollution de l’air.
Au-delà de l’impact que l’urbanisation a sur les populations humaines, elle provoque également de nombreuses conséquences écologiques : bien que les villes n’occupent que 3% de la surface terrestre, elles consomment 78% de l’énergie et émettent 60% du dioxyde de carbone produit par l’humanité. En France, Les sols artificialisés continuent de gagner des surfaces, passant de 8,4 % en 2006 à 9,1 % du territoire métropolitain en 2012, et ils continuent de s’étendre aux dépens des milieux naturels et des terres agricoles (Bottin et al., 2014). Ainsi, l’urbanisation est sans doute la forme la plus importante d’utilisation de terres et de changement d’occupation du sol, son développement ayant des effets considérables sur la structure, la dynamique et la fonctionnalité des écosystèmes (Elmqvist et al., 2013). De plus, ce développement urbain consomme de grandes quantités de ressources naturelles à l’échelle globale, dont l’eau et les matériaux de construction tels que le bois d’œuvre. La consommation alimentaire des urbains est également plus coûteuse pour l’environnement, la ville n’étant par essence pas un bassin de production alimentaire. Par conséquent, toute la nourriture consommée doit être importée, et la production –notamment avec l’utilisation de phosphate minier pour la fertilisation des plantes, de même que le conditionnement et l’acheminement des denrées, qui consomment des quantités d’énergies fossiles considérables, sont d’importantes sources de pollutions (Bricas, 2017). Ces pollutions mettent fortement en péril les écosystèmes qu’elles touchent, et ont déjà un fort impact sur la biodiversité à l’échelle mondiale (Mcdonald et al., 2013; Pimm et al., 2014).
La crise de la biodiversité
La biodiversité peut être définie comme la diversité du vivant à différents niveaux d’intégration, comme la variabilité génétique, spécifique, ou écosystémique -telle que définie dans l’article 2 de la Convention sur la diversité biologique (United Nations, 1992)-, mais elle comprend également d’autres niveaux de variabilité, telles que la variabilité des traits d’histoires de vie (Cardinale et al., 2012). La biodiversité comprend surtout les interactions et les phénomènes évolutifs qui existent au sein et entre les différents niveaux d’intégration (Mace et al., 2012). Ainsi, les pressions exercées par l’humain sur la biodiversité peuvent être mesurées de plusieurs manières et à différents niveaux. Parmi les échelles étudiées, celle sur laquelle la communication au grand public est la plus importante est l’échelle spécifique. A cette échelle, le taux actuel d’extinction est de 100 à 1000 fois plus élevé que le taux d’extinction avant la révolution industrielle (Pimm et al., 2014). Au niveau mondial, 41% des espèces d’amphibiens, 13% des espèces oiseaux, 25% des espèces de mammifères et 20% des espèces végétales connues sont menacées d’extinction. Monastersky (2014) estime ainsi que 690 espèces disparaissent par semaine dans le monde, et qu’à ce rythme, 75% des espèces connues seraient perdues d’ici 2200. A d’autres niveaux d’intégration de la biodiversité, les phénomènes d’homogénéisations génétiques ou fonctionnelles (Olden et al., 2004), ou encore la perte d’interactions et de fonctions écologiques (Millenium Assessment Board, 2008), se traduisent par une baisse générale et une réorganisation des interactions entre espèces (ex : mutualisme, prédation, pollinisation) et entre les espèces et leurs environnements (ex : flux de carbone, cycle de l’eau) ; ceci entraîne des déséquilibres et des dysfonctionnements d’écosystèmes entiers. A terme, ces écosystèmes pourraient cesser de fournir toute une gamme de services dont dépendent les sociétés humaines. Ainsi, les sols drainent moins les eaux de pluie quand ils sont bétonnés et imperméabilisés, ce qui amplifie d’éventuelles inondations (par ex . Ishimatsu et al., 2017). De même, des coteaux ou des flancs de montagne déforestés perdent la capacité des racines des arbres à retenir le sol et à éviter glissements de terrain et coulées de boue en cas de fortes pluies. Enfin, les animaux pollinisateurs aident à la production de 75% des fruits et légumes que nous consommons (Klein et al., 2007)et dont nous tirons certaines vitamines et minéraux essentiels (Eilers et al., 2011).
Ce déclin généralisé est aujourd’hui considéré comme la sixième crise écologique majeure qu’a connu la biodiversité (Barnosky et al., 2011; Pimm et al., 2014; Wake and Vredenburg, 2008). D’après l’UICN et le WWF, l’exploitation des espèces (ex : chasse, pêche, abattage) ainsi que la dégradation et la destruction d’habitats (Figure 1) seraient les principales causes de la crise de la biodiversité.
De plus, l’urbanisation, qui se fait souvent au dépend des milieux naturels (forêts, zones humides…) des sols et des autres espèces, est une des cause majeures de la dégradation et perte des habitats De nombreuses voix se font entendre depuis longtemps sur le besoin urgent de freiner, si ce n’est de stopper le déclin de la biodiversité, en défendant différents types de valeurs de la biodiversité (par ex. Montgomery, 2002). En restant très simple et au risque d’être caricatural, la biodiversité est reconnue par certains pour sa valeur intrinsèque : elle doit être protégée pour ce qu’elle est. Pour d’autres, elle possède une valeur utilitaire : elle rend un certain nombre de services écosystémiques économiques, esthétiques ou récréatifs à l’humanité. Ici, l’argument défendu est qu’il faut sauvegarder les espèces pour les services rendus par les écosystèmes aux humains. De son coté, May écrit que l’humanité a une « responsabilité de transmettre aux générations futures une planète aussi riche en merveilles de la nature que celle dont elle a hérité » (2011, p.349) lui donnant ici une valeur éthique. Chan et coll. (2016) suggèrent que considérer la considérer la protection de la nature pour son bien (valeur intrinsèque) ou celui de l’humanité (valeur utilitaire) n’est pas suffisant, et qu’un autre type de valeur devrait être considéré : une valeur relationnelle. Ainsi, ils proposent de considérer une valeur prenant en compte les relations entre les humains à la nature, mais aussi les relations entre humains, et impliquant la nature.
Cette volonté de faire face à la crise de la biodiversité s’est manifestée au niveau international par le Sommet de la Terre des Nations Unies, à Rio en 1992, qui a abouti à la Convention sur la Diversité Biologique, premier traité international sur la conservation, l’utilisation et le partage de la biodiversité. En 2010, la dixième conférence des parties à Nagoya a donné lieu à l’adoption d’un Plan stratégique pour la Biodiversité 2011-2020. Ce plan, sous-titré « Vivre en harmonie avec la nature », a pour objectif que « d’ici à 2050, la diversité biologique [soit] valorisée, conservée, restaurée et utilisée avec sagesse, en assurant le maintien des services fournis par les écosystèmes, en maintenant la planète en bonne santé et en procurant des avantages essentiels à tous les peuples ». Pour cela, le Plan stratégique est décliné en 5 buts stratégiques, eux-mêmes scindés en 20 objectifs, nommés les « Objectifs d’Aichi ». Certains d’entre eux prennent en compte la part que l’humain a à jouer dans la conservation de la biodiversité, notamment par son comportement. Par exemple, l’objectif 1 vise à ce que « d’ici à 2020 au plus tard, les individus sont conscients de la valeur de la diversité biologique et des mesures qu’ils peuvent prendre pour la conserver et l’utiliser de manière durable » (Secretariat de la Convention sur la diversite biologique, 2012).
Avant les mobilisations politiques et aux conférences internationales, cette conscience croissante de la crise la biodiversité a mené au rassemblement des scientifiques de plusieurs disciplines – principalement l’écologie – dans la formation d’un nouveau champ de recherche, dit « de crise » et plus engagé, la biologie de la conservation (Figure 2). En se focalisant sur les impacts des activités humaines et du réchauffement climatique sur la biodiversité, la biologie de la conservation vise à produire et à mettre à disposition des scientifiques et des décideurs des théories et des outils pour la préservation de la biodiversité (Soulé, 1985).
|
Table des matières
Introduction
1. Contexte
a. La ville en extension
b. La crise de la biodiversité
c. L’émergence de la psychologie de la conservation
d. Les services que nous rendent les espaces de nature
e. Les espaces de nature en ville
2. Les expériences de nature
a. Connexion(s) et relation(s) humain-nature
b. L’expérience de nature aujourd’hui : extinction ou transformation ?
3. La place du sensoriel dans l’expérience de nature
a. Une expérience multi-sensorielle ?
b. Quelle place pour l’olfactif ?
Résumé de la thèse
Chapitre 1: L’expérience olfactive de nature : une expérience individuelle ?
Résumé graphique
1. L’odorat: un sens individuel
a. La perception olfactive
b. Des différences entre individus
2. Une expérience culturelle
3. L’identité environnementale
4. Analyse des relations entre expérience olfactive, identité environnementale et comportements sensoriels dans un espace de nature
a. Pourquoi un questionnaire en ligne
b. Sensibilité aux odeurs
c. Mesure de l’Identité Environnementale
d. Usages sensoriel d’un espace de nature
e. Synthèse des résultats
5. Vers une identité environnementale plus incarnée ?
a. Mise en évidence d’une composante sensorielle de l’identité environnementale
b. Intégrer une part d’incarné dans la mesure de l’identité environnementale
c. Usages sensoriels dans les espaces de nature: quel lien entre notre identité environnementale et nos expériences incarnées ?
d. Du potentiel négatif de l’expérience olfactive
e. Perspectives : Pour une redéfinition de l’identité environnementale
Chapitre 2: L’expérience olfactive de nature : une expérience au monde
Résumé graphique
1. De l’importance du contexte dans l’expérience
2. Place de la perception sensorielle de l’environnement dans l’expérience de nature
3. Saisir l’expérience olfactive de nature
4. Etudes sur l’expérience olfactive de nature dans les espaces de nature urbains : Méthodes
a. Parcours olfactifs commentés dans les Grandes Serres du Jardin des Plantes
b. Expérience olfactive de nature dans trois parcs urbains
c. Expérience olfactive de nature dans les espaces de nature domestiques : jardins, terrasses et balcons
d. Iramuteq et la méthode Alceste
5. Résultats : L’expérience olfactive de nature, une expérience complexe
a. Creuser la piste des caractéristiques écologiques ?
b. La part multi-sensorielle de l’expérience olfactive de nature : l’importance de l’haptique
c. Une dimension fonctionnelle de l’expérience olfactive : mise en évidence de la qualité de l’air
d. L’expérience par l’expertise et le vécu
Chapitre 3: l’expérience olfactive de nature : une expérience pour soi
Résumé Graphique
1. Bien-être induit par l’expérience olfactive de nature
2. Expériences de nature, restauration psychologique et bien-être individuel
3. Quid de l’olfactif dans les environnements restaurateurs urbains?
4. Qui vit ces expériences olfactives comme restauratrices?
5. Exemple d’une expérience olfactive de nature pour soi : importance des phytoncides dans le Shinrin-Yoku, « bain de forêt »
Discussions
Conclusion
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet