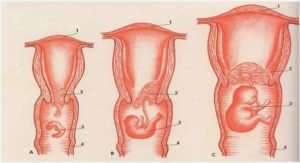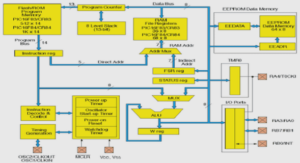Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Des situations à risque
En France, on dénombre en 2008 environ 669 000 personnes nées en Afrique subsaharienne, soit 13 % des immigré•e•s (Borrel, Bouvier et Lhommeau, 2012). On estime que 10 % de l’ensemble des étrangers d’Afrique subsaharienne sont en situation irrégulière (Lessault et Beauchemin, 2009). Les pays d’origine sont principalement le Cameroun, la Côte d’Ivoire et la République Démocratique du Congo (Borrel, Bouvier et Lhommeau, 2012). En cinquante ans, les flux des immigré•e•s venant de cette région du monde ont augmenté et les profils des candidat•e•s à la migration se sont diversifiés.
C’est à partir des années 1960 que l’immigration d’Africain•e•s subsaharien•ne•s vers la France devient importante (Lessault et Beauchemin, 2009). Dans un contexte de croissance élevée, les entreprises recrutent dans les anciennes colonies des hommes, majoritairement, venant pour travailler, rejoints au cours des années 1970 par leurs femmes et leurs enfants au titre du regroupement familial (Beauchemin, Borrel et Regnard, 2013 ; Lessault et Beauchemin, 2009). À partir des années 1980, on assiste à une diversification des pays d’émigration ainsi qu’à l’apparition d’un nouveau profil d’immigré•e•s, les étudiant•e•s, rajeunissant par là-même la population venue d’Afrique subsaharienne (Barou, 2002). Par la suite, d’autres raisons ont motivé la migration telle que la demande d’asile, ou, depuis 1998, l’obtention d’un titre de séjour pour « raisons médicales » (Couillet, 2010). Si les motifs de migration ont changé, les conditions d’accès et de résidence sur le territoire français aussi, celles-ci s’étant nettement durcies dans les années 1970. Si certains individus venus d’Afrique subsaharienne ont obtenu la nationalité française, d’autres détiennent des titres de séjour de 10 ans, d’autres encore ne possèdent que des titres temporaires dont la validité varie entre 3 mois et 1 an. Enfin, certaines personnes arrivent en France sans autorisation de séjour. Les immigré•e•s d’Afrique subsaharienne sont à la fois proportionnellement plus nombreux•ses à être diplômé•e•s du supérieur que les personnes non-immigrées, mais aussi moins nombreux•ses à n’avoir aucun diplôme (Borrel, Bouvier et Lhommeau, 2012). Le ralentissement de la croissance économique a donné lieu à un chômage de masse, et les immigré•e•s ont été les premièr•e•s touché•e•s (Insee, 2005), notamment celles et ceux sans diplômes et exerçant dans des secteurs d’activité à faible niveau de qualification.
Si les motifs de la migration ne sont pas les mêmes pour toutes et tous, et que leurs caractéristiques sociodémographiques diffèrent, la plupart des immigré•e•s d’Afrique subsaharienne qui arrivent en France sont confronté•e•s aux discriminations raciales (Beauchemin, Hamel et Simon, 2016), à une précarité administrative, une ségrégation spatiale et une segmentation professionnelle (Brinbaum, Primon et Meurs, 2016 ; Jounin, 2014 ; Meurs, Pailhé et Simon, 2006 ; Pan Ké Shon, 2009). Les conditions de vie dans lesquelles elles et ils évoluent s’en trouvent dégradées sur une période de temps relativement longue (Gosselin et al., 2016). La mise en avant de l’hétérogénéité de la catégorie « migrant•e•s d’Afrique subsaharienne » d’une part, et le constat de leurs conditions de vie généralement difficiles les premières années de leur arrivée en France d’autre part, ont conduit les chercheurs et les chercheuses à appréhender l’infection au VIH au sein de cette population comme relevant de « situations à risques ». Des analyses récentes ont montré que les femmes qui avaient connu des périodes d’insécurité administrative19, professionnelle et résidentielle après leur arrivée en France avaient davantage de risques d’avoir subi des violences sexuelles (Pannetier et al., 2018) d’une part, et d’avoir été infectées par le VIH d’autre part (Desgrées du Loû et al., 2016). Chez les hommes, le risque de contamination par le virus du sida après la migration semble être aussi bien corrélé au fait d’être en insécurité administrative et résidentielle que d’avoir un emploi stable et un titre de séjour de longue durée (Desgrées du Loû et al., 2016).
Interroger les effets de la migration et du diagnostic d’infection au VIH sur la sexualité
Les études épidémiologiques de la sexualité des migrant•e•s d’Afrique subsaharienne vivant en Europe ont permis d’analyser des pratiques sexuelles à un moment donné, c’est-à-dire à l’enquête, et donc après la migration. Le recueil des données ne permet que rarement de comprendre le rôle que jouent la mobilité spatiale et le franchissement des frontières politiques sur les pratiques sexuelles des personnes, et les prises de risques par rapport à l’infection au VIH. Il s’agirait de savoir si certains comportements, comme le multipartenariat ou les relations sexuelles transactionnelles, sont favorisés par la migration. De même, les contacts sexuels entre personnes nées dans des pays d’Afrique subsaharienne différents sont-ils effectivement plus nombreux après la migration ? Parce que les mouvements migratoires internes au sous-continent sont loin d’être négligeables (Flahaux, Beauchemin et Schoumaker, 2013 ; Lalou et Piché, 1994), il se pourrait que les rencontres sexuelles entre Africain•e•s originaires de pays différents existent avant même la migration vers l’Europe, et ce dans des proportions non négligeables. Enfin, il est possible que la raison de la migration et les conditions d’arrivée limitent le risque d’infection au VIH en Europe. La question se pose notamment chez les femmes, celles venues pour rejoindre un conjoint (que ce dernier soit né en France ou ailleurs), parce qu’elles ont moins de chance de connaître des situations d’instabilité économique, pourraient être moins soumises au risque d’être infectées par le VIH.
Les études épidémiologiques qui traitent de la sexualité des migrant•e•s d’Afrique subsaharienne vivant en Europe sont restées centrées sur une analyse des risques avant le diagnostic d’infection au VIH. C’est donc davantage la sexualité avant l’infection et la découverte de la séropositivité qui ont été analysées, et non après le diagnostic. Si certaines recherches en épidémiologie sociale ont permis de mesurer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH dans une perspective de « prise en charge globale » de la maladie, en étudiant par exemple la prévalence des symptômes dépressifs (Feuillet et al., 2016), mais aussi la pratique sportive (Ferez, Pappous et Ruffié, 2010) et l’accès à l’emploi (Annequin, 2016), peu d’études ont permis de connaître leur vie sexuelle et conjugale suite au diagnostic20. Pourtant la question se pose puisque le VIH, en tant qu’infection sexuellement transmissible, affecte directement le rapport à la sexualité et le rapport au couple. Les personnes nouvellement diagnostiquées pourraient être davantage soumises au risque de rupture d’union à la suite de l’annonce de leur séropositivité à leur partenaire et avoir des difficultés à trouver un•e conjoint•e qui accepte leur maladie. Les rares études qualitatives effectuées mettent d’ailleurs en évidence le fait que les migrant•e•s d’Afrique subsaharienne vivant avec le VIH font face à diverses formes de reconfigurations conjugales après le diagnostic (Doyal et Anderson, 2005 ; Doyal, Anderson et Paparini, 2009 ; Pourette, 2006, 2008a). Cependant, aucune étude n’a permis de connaître la part des personnes qui connaissaient une évolution de leur situation de couple après la découverte de la séropositivité, ou de savoir si certaines d’entre elles étaient davantage concernées par une recomposition conjugale que d’autres.
De l’analyse de la mixité culturelle au sein des couples, celle-ci étant pensée comme indicateur d’intégration, à l’étude de la sexualité des migrant•e•s d’Afrique subsaharienne pour appréhender les risques d’infection au VIH, il ressort que la conjugalité des personnes né•e•s en Afrique subsaharienne et ayant fait l’expérience de la migration est mal connue.
Considérer les trajectoires conjugales
La plupart des études menées sur la conjugalité des immigré•e•s, ou la sexualité des migrant•e•s d’Afrique subsaharienne, ont bien souvent observé la situation sexuelle ou conjugale des personnes au moment de l’enquête, c’est-à-dire après la migration dans le pays d’immigration pour la plupart, ou au retour dans le pays d’origine pour certaines. Le recueil de données ne permet pas de retracer les trajectoires conjugales des personnes enquêtées. Pourtant, il semble que l’analyse de données longitudinales sur la situation de couple des personnes immigrées, c’est-à-dire avant, pendant et après la migration ou le diagnostic d’infection au VIH, permette de mieux appréhender l’effet de ces deux évènements sur les manières de faire ou de défaire les unions chez ces personnes.
Le fait de considérer les trajectoires conjugales plutôt qu’un état matrimonial à un moment donné, c’est-à-dire bien souvent celui de l’enquête et donc après la migration, permet de savoir qui sont les individus qui sont arrivé en union et qui sont ceux qui sont arrivé seuls. Il est alors possible de suivre l’évolution de leur situation de couple au fil du temps et d’observer les évènements conjugaux, c’est-à-dire les mises en couple ou les ruptures d’union, que ces derniers connaissent. Enfin, le recueil des histoires conjugales des personnes ainsi que les caractéristiques de chacun•e des partenaires des personnes interrogées permettent de savoir si les partenaires rencontré•e•s après la migration sont identiques à celles et ceux connu•e•s avant. L’analyse des trajectoires conjugales donne la possibilité de comprendre l’effet de la migration sur les réseaux sexuels des personnes immigrées. Supposer que la migration des Africain•e•s subsaharien•ne•s augmenterait les contacts sexuels avec des partenaires également né•e•s en Afrique nécessite de connaître la part des couples mixtes de ce type chez les immigré•e•s avant l’arrivée dans le pays de destination. En effet, comment savoir si l’arrivée en Europe favorise ce type de mixité alors même que l’on ne connaît pas la situation dans le pays de naissance ? C’est oublier que les circulations des Africains se font essentiellement au sein même du continent entre pays limitrophes pour l’essentiel (Flahaux, Beauchemin et Schoumaker, 2013). Par ailleurs, le fait de considérer les trajectoires conjugales des personnes plutôt que leur situation de couple permet d’appréhender la survenue d’autres évènements que la migration, et qui peuvent potentiellement donner lieu à des mises en couple ou à des ruptures d’union. C’est particulièrement le cas du diagnostic d’infection au VIH, qui survient généralement peu de temps après l’arrivée en France chez les immigré•e•s d’Afrique subsaharienne (Limousi et al., 2017).
L’analyse des trajectoires conjugales autour du diagnostic d’infection au VIH permet d’étudier les évolutions des situations de couple des personnes autour de cet évènement de santé. Il s’agit alors de savoir si les unions survivent à la découverte de la séropositivité de l’un des partenaires et si le fait de révéler son statut sérologique augmente le risque de séparation. Deux études récentes montrent que la majorité des immigré•e•s d’Afrique subsaharienne vivant en France et diagnostiqué•e•s pour une infection au VIH ont annoncé leur statut sérologique à leur partenaire, entre 75 % et 80 % parmi les femmes et entre 69 % et 78 % parmi les hommes (Kankou et al., 2017 ; Pannetier, 2018). Ces proportions élevées de révélation à la/au conjoint•e interrogent sur la survie des unions, et les éventuelles recompositions conjugales suite à la découverte de la séropositivité. Par ailleurs, il semble nécessaire de savoir dans quelles mesures les personnes sans partenaires au moment du diagnostic rencontrent des difficultés à entrer en union et qui sont les nouveaux•elles conjoint•e•s des personnes séropositives. L’analyse quantitative des trajectoires conjugales autour du diagnostic d’infection au VIH devrait pouvoir permettre de connaître la part des personnes qui font effectivement l’expérience d’un changement de situation conjugale après le diagnostic d’infection au VIH, et de montrer les liens statistiques entre certaines situations migratoires et matérielles et la probabilité d’une recomposition conjugale.
Finalement, il semble nécessaire de savoir dans quelles mesures les trajectoires conjugales des immigré•e•s d’Afrique subsaharienne vivant en France sont remodelées par la migration d’une part, et le diagnostic d’infection au VIH d’autre part.
Une appr che matérialiste des changements conjugaux lors de deux ruptures biographiques
L’analyse des modalités de formation ou de dissolution des unions chez les immigré•e•s n’a été que rarement mobilisée pour étudier la manière dont ces dernièr•e•s modifient leur façon de faire union afin de s’adapter au régime conjugal du pays d’arrivée. Pourtant, la conjugalité, en tant que forme particulière de la sexualité, est empreinte des rapports sociaux qui se jouent dans les autres dimensions de la société (Foucault, 1976). L’analyse des transformations des manières de faire ou de défaire le couple permet donc d’observer les mutations sociales et notamment l’évolution des rapports sociaux de sexes (Bozon, 1990a ; Hertrich, 2007a). Elle permet également de voir de quelles manières ceux-ci s’articulent les uns avec les autres en donnant lieu à formes de domination qui diffèrent selon la position sociale des individus (Crenshaw, 2005 ; Kergoat, 2011). Les rapports sociaux donnent lieu à des inégalités structurelles légitimées par des représentations stigmatisantes (Guillaumin, 1972), qui se combinent, se traversent, se renforcent et prennent des formes particulières (Hamel, 2003). En effet, une même position sociale n’est pas appréhendée de la même manière par les femmes et les hommes, et l’expérience des rapports sociaux de sexe diffère selon la classe sociale à laquelle les femmes appartiennent (Kergoat, 1978). L’accès aux capitaux économique, social et culturel dans une société donnée n’est pas le même pour toutes les personnes (Bourdieu, 1986) et dépend des multiples rapports sociaux auxquels les personnes sont soumises. Or, la mise et le maintien en couple semblent dépendre des ressources matérielles dont les individus disposent (Oppenheimer, 1994).
Dans ce chapitre, nous commencerons par replacer la conjugalité dans le contexte plus large des échanges économico-sexuels (Tabet, 2004), permettant par là-même d’appréhender la manière dont les rapports sociaux de sexe et de classe structurent le rapport à la sexualité et à la conjugalité des femmes et des hommes. Puis, nous envisagerons la migration et le diagnostic d’infection au VIH comme des ruptures biographiques pouvant amener les individus à se confronter à de nouveaux rapports de domination. Ensuite, nous montrerons comment les rapports sociaux auxquels sont soumis les immigré•e•s d’Afrique subsaharienne affectent leur accès à ressources matérielles. Enfin, nous nous interrogerons sur les possibles conséquences sur leur conjugalité.
La conjugalité au sein du continuum des échanges économico-sexuels
La division sexuelle du travail, caractérisée par l’assignation des hommes à la sphère productive, et des femmes à la sphère reproductive (Kergoat, 1993), a pour conséquence de créer une inégalité d’accès aux biens matériels entre les sexes. Il existe alors une interdépendance entre les sexes qui donne lieu à des « échanges économico-sexuels » (Tabet, 2004).
Le concept d’échanges économico-sexuels
Dans La grande arnaque, Paola Tabet (2004) montre que la domination économique des femmes par les hommes est la cause principale de la structuration des rapports de pouvoirs entre les sexes, donnant lieu à des « échanges économico-sexuels ». Pour l’anthropologue, l’hétérosexualité est structurée autour d’échanges. Les femmes ont un accès restreint aux technologies (Tabet, 1998), aux ressources économiques (Delphy, 1998), et aux biens matériels nécessaires à leur subsistance, ceux-ci étant essentiellement détenus par les hommes. Ces derniers sont alors en mesure de les distribuer aux femmes en échange de leur sexualité, de leur capacité procréative et de leur travail domestique. L’anthropologue poursuit son analyse en montrant que ces échanges économico-sexuels s’organisent le long d’un continuum borné par le couple marital, où les termes de l’échange sont implicites, et la prostitution, où la collusion entre les sphères économique et sexuelle est clairement établie. Pour elle, la conjugalité est donc bien une forme particulière de la sexualité humaine, celle-ci faisant toujours l’objet d’échanges entre biens matériels détenus par les hommes et travail domestique (Delphy, 1998) des femmes. Elle montre également que si les échanges économico-sexuels prennent davantage la forme d’unions, c’est parce que la prostitution est stigmatisée, ce qui permet de contrôler la sexualité féminine, renforçant par là-même la domination des hommes sur les femmes (Pheterson, 2001). Pour préserver leur valeur d’échange, les femmes seraient alors amenées à se protéger d’une éventuelle réputation de « salope », ce qui les conduirait à circonscrire leurs rapports sexuels au cadre conjugal uniquement. Paola Tabet interroge également la possibilité pour les femmes de s’extraire du continuum des échanges économico-sexuels lorsque ces dernières accèdent à suffisamment de ressources économiques permettant d’assurer leur autonomie matérielle. Elles seraient alors en mesure d’accéder à une sexualité non conditionnée par l’échange.
Une notion sous-utilisée ?
Si la notion « d’échanges économico-sexuels » a su séduire la communauté scientifique21, Paola Tabet dit regretter que celle-ci ait très vite été réduite à un synonyme des diverses formes de prostitution, et qu’elle ne soit pas utilisée pour explorer les échanges qui ont lieu au sein des couples (Trachman, 2009). Pour elle, « tandis qu’il y a un nombre considérable de travaux sur la prostitution, sur les différentes formes de travail sexuel dans des contextes différents, il est plus rare de trouver des travaux qui s’occupent de l’ensemble du continuum et surtout qui portent sur la forme des échanges dans les relations “légitimes” ». Elle précise également que c’est seulement pour la sexualité des femmes immigrées que « l’on trouve l’arc complet du continuum » (Trachman, 2009).
La notion d’échanges économico-sexuels a en effet été particulièrement utilisée pour analyser les diverses formes de sexualité dans lesquelles les femmes immigrées s’engagent, celles-ci allant de la prostitution (Lévy et Lieber, 2009 ; Moujoud, 2005 ; Musso, 2007 ; Oso-Casas, 2006) aux mariages avec des hommes nationaux22 considérés comme un moyen pour ces dernières de bénéficier plus facilement d’une régularisation administrative (Lévy et Lieber, 2009 ; Weber, 2006), en passant par des relations avec des partenaires également en migration pour lesquels les termes de l’échange étaient parfaitement explicites (Guillemaut, 2008 ; Lévy et Lieber, 2009 ; Pian, 2010). Ces analyses permettent, entre autres, de relativiser le processus d’émancipation des femmes par la migration, et mettent en évidence que le recours aux formes de sexualité de type prostitutionnelles leur accorde davantage d’autonomie que la mise en couple (Lévy et Lieber, 2009 ; Moujoud, 2008), notamment parce leur accès aux ressources 51 couple et in fine au travail domestique des femmes. Chez d’autres, l’instabilité matérielle amènerait à une inversion des rôles dans l’échange, les hommes échangeant leur sexualité contre l’accès aux biens matériels détenus par des femmes (Salomon, 2000).
L’utilisation de la notion d’échanges économico-sexuels dans une recherche quantitative
La notion d’échange économico-sexuel a été largement mobilisée dans les analyses qualitatives ayant comme objet d’étude la sexualité. En revanche, elle est largement absente des études quantitatives qui traitent de la sexualité ou de la conjugalité. Plusieurs analyses mettent pourtant en évidence des échanges économico-sexuels au sein des couples mariés. C’est particulièrement le cas de François de Singly (1987) qui montre les diverses formes d’investissements des femmes en France, sous forme de travaux domestiques, au sein de la structure familiale, et leur rétribution par l’accès aux ressources économiques détenues par leurs maris. Sans le mentionner comme tel, l’auteur esquisse un échange entre le travail productif des hommes, transformé en ressources économiques et matérielles, et le travail reproductif des femmes, que celui-ci prenne la forme de production d’enfants ou de leur élevage. De même, Michel Bozon (1990a, 1990b), en étudiant les différences d’âge entre conjoint•e•s, parvient à montrer que si les femmes sont plus souvent en couple avec un homme plus âgé qu’elles, c’est bien souvent parce que ce dernier bénéficie de la stabilité économique qu’elles recherchent. Par ailleurs, les analyses mettant en évidence un lien chômage masculin et divorce (Jones, 1989 ; Paugam, 1994), tendent à rendre visible les échanges économiques et sexuels qui s’effectuent au sein des couples. Lorsque les hommes sont privés de ressources économiques, ils ne sont plus en mesure d’assurer l’échange avec la sexualité de leur conjointe, ce qui mettrait fin à l’union. En Afrique subsaharienne, plusieurs études ont mis en évidence le fait que la stabilité économique des hommes favorise leur mise en couple (Antoine et Béguy, 2014 ; Antoine, Djire et Laplante, 1995 ; Calvès, 2007) ce qui , là aussi, tend à montrer que c’est précisément cette ressource qu’ils échangent avec leur partenaire.
Avec une approche quantitative, il apparaît difficile d’appréhender la manière dont s’effectuent les transactions entre biens matériels et sexualité entre les partenaires, notamment au sein des relations conjugales où les échanges économico-sexuels ne sont pas pensés comme tels par les personnes en union (Zelizer, 2005). La notion d’échanges économico-sexuels peut néanmoins être utilisée de deux manières. Elle permet d’avoir à l’esprit que ces échanges existent, et qu’ils structurent les relations entre les sexes. Il s’agira donc de penser notre objet d’étude, c’est-à-dire la conjugalité, comme une forme particulière des échanges qui s’effectuent entre partenaires. La notion d’échanges économico-sexuels permet donc d’appréhender les relations conjugales comme un lieu de transactions entre femmes et hommes structurées par des rapports sociaux (de sexe, de classe, de race). Par ailleurs, avec une approche quantitative, il est possible de tester le lien entre disposition de ressources matérielles et entrée en union d’une part, et rupture conjugale d’autre part. En d’autres termes, il s’agira de savoir de quelles ressources disposent les femmes et les hommes lorsqu’elles et ils se mettent en couple ou quand elles et ils se séparent de leur partenaire, si celles-ci sont de même nature pour les deux sexes, ou si au contraire elles sont différentes, et impliquent un échange entre conjoint•e•s. Cela permettra également d’appréhender les éventuelles ruptures dans le continuum des échanges économico-sexuels : l’acquisition par les femmes de ressources suffisantes leur permet-elle de s’extraire de l’échange ? La rupture d’union chez ces dernières est-elle associée au fait d’avoir obtenu une certaine stabilité économique ? Cela dit, l’étude des échanges économiques et sexuels entre la classe des femmes et celles des hommes ne doit pas faire oublier que les individus sont soumis à d’autres rapports de domination.
Les ruptures biographiques comme moment de redéfinition des rapports de domination
Lorsque l’on cherche à analyser les effets d’un évènement sur la conjugalité, il est avant tout nécessaire de s’interroger sur la manière de montrer ces effets. En d’autres termes, il s’agit de savoir avec qui, ou avec quoi, comparer les situations conjugales des personnes. Lorsque l’on souhaite étudier les effets de la migration sur la formation et la dissolution des unions, il est possible de confronter les résultats entre immigré•e•s et non-immigré•e•s. Deux populations non-immigrées sont alors disponibles : celle du pays d’émigration, et celle du pays d’immigration. Le plus souvent, et ce parce que la collecte des données à lieu après la migration, la comparaison est faite avec la population du pays d’arrivée. Dans tous les cas, il s’agit de savoir si les immigré•e•s adoptent le régime conjugal du pays où elles et ils résident. Mais il est également possible de comparer les situations avant et après la migration et entrevoir de possibles évolutions. De même, afin de savoir si le diagnostic d’infection au VIH modifie les façons de faire ou de défaire les unions, il est possible de comparer leurs situations de couple avec des personnes non diagnostiquées ou séronégatives, ou encore d’analyser l’évolution de leurs trajectoires conjugales. Le fait de comparer les situations de couples des personnes avant et après un évènement donné, ici la migration et le diagnostic d’infection au VIH, nécessite de considérer celui-ci comme un point de rupture susceptible de modifier la vie des personnes.
Migration et diagnostic d’infection au VIH : des ruptures biographiques
Abdelmalek Sayad a présenté la migration comme une « rupture, rupture avec un territoire, et par la même avec une population, un ordre social, un ordre économique, un ordre politique, un ordre culturel et moral » (1999, p. 165). De même, le diagnostic d’infection au VIH apparaît comme un moment charnière de la vie des personnes (Ciambrone, 2001 ; Pourette, 2006). Il y a un avant et un après l’annonce de la séropositivité. C’est le passage d’un corps (supposé) sain à un corps infecté, dangereux pour soi et pour les autres, qu’il faut réinvestir et se réapproprier. Dans ce sens, le départ du pays d’origine et la découverte de la séropositivité marquent la vie des personnes et deviennent des points de repère chronologiques, et sont donc à considérer comme des ruptures biographiques.
Par ailleurs, ces deux évènements peuvent être rapprochés l’un avec l’autre. La migration et le diagnostic d’infection peuvent signer la fin d’un processus, celui-ci pouvant s’étaler sur une période de temps relativement longue. Le départ du pays d’origine est généralement précédé d’une phase de préparation consistant à rassembler les ressources économiques permettant de payer le voyage, l’installation dans le pays de destination et les visas autorisant l’entrée ou la résidence sur un territoire. Puis, vient le voyage, celui-ci pouvant prendre quelques heures, plusieurs mois voire plusieurs années avant d’atteindre le pays de destination. Le diagnostic d’infection au VIH peut être précédé d’une prise de risque suscitant la décision de se faire dépister, qui finalement donnera lieu à l’annonce de la séropositivité. S’ils possèdent des similitudes, ces deux évènements sont également différents. Si la migration conduit les personnes à se confronter à un nouvel environnement social (Sayad, 1999), c’est moins le cas du diagnostic d’infection au VIH. Après la découverte de leur séropositivité, les personnes restent, pour la plupart d’entre elles, dans le même pays que celui où elles résidaient avant. Cependant, les personnes vivant avec le VIH peuvent connaître tant une ouverture vers de nouveaux espaces de sociabilité (Gerbier-Aublanc, 2017), qu’une fermeture de certains autres, du fait de la stigmatisation associée au VIH (Herek et Glunt, 1988). Enfin, la migration provoque, dans certains cas, l’éloignement géographique des partenaires. Le diagnostic d’infection au VIH, quant à lui, peut provoquer une autre forme de prise de distance, moins physique qu’émotionnelle, ou tout aussi physique mais à des échelles diverses, du fait de la peur de la contamination.
La migration et le diagnostic d’infection au VIH peuvent conduire les individus à changer leurs manières d’être, de penser, d’agir. Ces deux évènements ont en effet pour caractéristique de confronter les individus à de nouvelles expériences sociales susceptibles d’exacerber certains rapports de domination.
L’expérience d’une condition minoritaire
En franchissant des frontières politiques, les femmes et les hommes traversent également une frontière sociale en passant du groupe des nationaux au groupe des immigré•e•s (Guillaumin, 1985 ; Sayad, 1999 ; Simmel, 1908). L’expérience migratoire peut alors conduire les individus à prendre conscience de leur position sociale minoritaire, et à faire l’expérience d’une appartenance à un groupe socialement dominé : celui d’immigré•e dans un espace social majoritairement occupé par des non-immigré•e•s. Au sein de la population immigrée, il est possible de distinguer deux groupes d’individus : les étrangèr•e•s d’une part, et les personnes ayant acquis la nationalité du pays dans lequel elles résident d’autre part. À noter que ces dernières, en dépit de leur naturalisation, ne font jamais pleinement partie du groupe des nationaux (Sayad, 1999). L’acquisition de la nationalité n’ayant vraisemblablement pas la même force de légitimité que le fait de l’avoir dès la naissance23. Le statut d’étrangèr•e•s nécessite de se plier aux règles administratives conditionnant la présence sur le territoire, et d’être muni•e d’un titre de séjour24. Par ailleurs, le fait d’être étrangèr•e exclut du droit à la citoyenneté du pays dans lequel on réside25. Pour les personnes nées en Afrique subsaharienne qui migrent en Occident, et particulièrement en Europe, la catégorisation d’immigré•e est doublée par celle de racialisé•e (Dorlin, 2009). Si dans leurs pays, elles étaient d’abord perçues au prisme de leur appartenance de sexe et de classe, en Europe elles sont également appréhendé•e•s en tant que noir•e•s (Ndiaye, 2008) et perçu•e•s à l’aune de stéréotypes culturalistes portant, entre autres, sur leur sexualité (Dorlin, 2006 ; Fanon, 1952) ou les rapports entre les sexes (Mohanty, 1988 ; Moujoud, 2008). Le fait que, dans le pays d’immigration, la population soit majoritairement blanche conduit à rendre visible leur statut d’immigré•e26, et les exposent davantage aux discriminations que les immigré•e•s blanc•he•s (Défenseur Des Droits, 2017).
Le diagnostic d’infection au VIH conduit lui aussi à un franchissement de frontière sociale, les personnes passant de la catégorie des individus considérés comme « sains », à celle des individus considérés comme malades. C’est dans ce sens que les personnes vivant avec le VIH expérimentent une nouvelle forme de minorisation de leur position sociale. La possibilité d’obtenir la qualification de travailleur•euse handicapé•e lorsque l’on est infecté•e par le VIH (Annequin, 2016) donne une réalité juridique à cette condition minoritaire non visible par les autres. Si l’infection au VIH peut être cachée, il n’en reste pas moins que le fait de garder le secret de sa maladie n’est pas facile et peut conduire les individus à s’éloigner de leur entourage (Doyal et Anderson, 2005 ; Poglia Mileti et al., 2014). Par ailleurs, pour certaines personnes immigrées, la découverte de la maladie peut être synonyme d’échec de la migration. Corps infecté, corps malade ou pensé comme défaillant, les immigré•e•s diagnostiqué•e•s pour une infection au VIH pourraient parfois être amené•e•s à considérer leur retour au pays comme impossible.
La migration et le diagnostic d’infection au VIH sont susceptibles de reconfigurer le rapport au monde des individus puisque l’une comme l’autre peuvent les amener à faire l’expérience d’une nouvelle condition sociale, celle de l’appartenance à un groupe minoritaire. Que les individus aient conscience ou non de cette appartenance, ils sont néanmoins soumis au risque de subir des discriminations liées au statut d’immigré•e (Beauchemin, Hamel et Simon, 2016) ou à celui de séropositif•ve (Herek et Glunt, 1988). Celles-ci, parce qu’elles existent dans toutes les sphères sociales, peuvent limiter l’accès aux individus qui les subissent à certains environnements sociaux et à certaines ressources matérielles.
Le contrôle administratif d’installation sur le territoire
Suite à la crise pétrolière de 1974, les États occidentaux ont durci leurs politiques migratoires en appliquant une « fermeture sélective des frontières » (Spire, 2016). En conséquence, le profil des candidat•e•s à la migration a évolué. Si dans les années 1960-1970, les immigré•e•s venu•e•s d’Afrique étaient plutôt des paysans algériens privés de terre venant gagner leur vie en Europe (Sayad, 1999), ce sont désormais de plus en plus souvent des personnes diplômées qui traversent les frontières nationales pour s’installer dans un autre pays que le leur (Ichou, 2016 ; Moguérou, Brinbaum et Primon, 2016 ; Wagner, 2016).
L’obtention d’une autorisation de résider sur un territoire, que celle-ci soit provisoire de courte ou de longue durée, ou encore définitive27, semble s’inscrire dans un processus de sélection dépendant de plusieurs critères présentés comme objectifs et décidés par l’administration de l’État pour lequel on requiert la demande d’accès ou de maintien sur un territoire. Une autre frontière sociale s’établit entre les étrangèr•e•s « avec papiers » et « sans papiers », pouvant avoir pour conséquence d’affaiblir leur conscience de « classe », c’est-à-dire de groupe soumis à des rapports de domination spécifiques et pouvant avoir des revendications communes (Falquet, 2009). Les personnes sans-papiers, aussi appelées « clandestin•e•s »28, sont « exclu•e•s » (Fassin, 1996) du droit d’accès ou de maintien sur le territoire national. En migrant, les personnes étrangères sont donc subordonnées aux politiques migratoires qui produisent de l’irrégularité (Fassin, 1996).
Si l’article 13 de la « Déclaration Universelle des Droits de l’Homme » de 1948 affirme la libre circulation et le libre de choix du pays de résidence, les personnes en situation de migration restent soumises à restriction dans la majorité des États signataires qui invoquent le principe de souveraineté nationale pour justifier des diverses formes de contrôles aux frontières qu’ils appliquent. Dans les faits, les personnes qui souhaitent entrer dans un pays pour lequel elles n’ont pas la nationalité doivent se soumettre aux règles administratives et faire une demande d’accès au territoire dans lequel elles souhaitent se rendre en justifiant de leurs intentions. Les politiques de gestion des flux migratoires créent une distinction de droits entre les individus étrangers, qui doivent faire la demande d’accès ou de maintien sur le territoire, et les nationaux qui jouissent « naturellement »29 de ce droit. Un premier critère pouvant fortement accroitre, ou au contraire limiter, l’accès à un territoire étranger est la nationalité d’origine des personnes. Pour effectuer un voyage touristique de courte durée, et qui n’implique pas l’installation sur le territoire de destination, une demande de visa pour entrer sur le territoire est parfois nécessaire et dépend de la nationalité de la/du demandeur•se. Par exemple, si les personnes de nationalité française (uniquement) peuvent voyager dans 170 pays sans faire de demande de visa préalable, les personnes de nationalité sénégalaise (uniquement) ont, quant à d’installation, semble également dépendre de la nationalité des personnes. Les politiques européennes de recrutement des « talents »30 apparaissent être davantage à l’adresse des immigré•e•s venus de pays au revenu élevé31, « certaines nationalités, celles des pays pauvres ou des anciennes colonies notamment, ont plus de difficultés que d’autres à faire reconnaître un statut social privilégié » (Wagner, 2016). Il semble aussi que l’obtention d’une autorisation de résidence sur le territoire pour une personne étrangère dépend des capitaux économiques, sociaux et culturels détenus par les individus. Quel que soit le motif de la demande de titre de séjour, les immigré•e•s ou les candidat•e•s à la migration doivent être en mesure de connaître les procédures administratives des recours, ce qui demande une connaissance parfaite de la langue du pays dans lequel elles et ils ont fait leur demande (Spire et Weidenfeld, 2009). Certaines personnes ont besoin d’une aide extérieure pour mener à bien leurs démarches administratives. Il est également nécessaire de payer les frais afférents à la demande de titre de séjour, que ce soit pour le transport ou le dépôt du dossier. Dans le cas où l’autorisation de résidence doit être assortie d’un permis de travail, les personnes sont parfois amenées à justifier d’avoir déjà trouvé un emploi dans le pays d’immigration. De même, pour justifier d’une demande de regroupement familial, les candidat•e•s à la migration doivent faire preuve de leurs liens de parenté avec une personne vivant dans le pays dans lequel elles souhaitent se rendre. L’accès à une autorisation de résider sur le territoire donne accès à des droits et notamment celui de travailler légalement mais aussi dans le cas de l’acquisition de la nationalité du pays d’immigration, d’avoir accès à des meilleurs emplois (Spire, 2005), mieux rémunérés (Fougère et Safi, 2005). Dans cette perspective, le titre de séjour apparaît donc comme une ressource inégalement distribuée parmi les individus dont l’obtention dépend des capitaux économique, social et culturel détenus par les individus, et qui permet d’accroitre leurs rendements.
Le déclassement professionnel et le maintien de la hiérarchie
Pour maintenir ou améliorer leur position sociale à travers la migration, les individus doivent être en mesure, une fois arrivés dans le pays de destination, de faire valoir les capitaux économiques, sociaux et culturels qu’ils ont pu, et su, mobiliser avant et après leur départ du pays d’origine. Cependant, certains mécanismes, qui peuvent prendre la forme de mesures institutionnelles, permettent d’annuler la valeur des capitaux détenus par les personnes, de les réduire, ou encore de rendre difficile leur mobilisation, conduisant alors à leur déclassement social (Mahut, 2017).
Les diplômes obtenus à l’étranger sont rarement reconnus dans le pays d’immigration, et conduit à priver les personnes immigrées d’une partie de leur capital scolaire. Les compétences acquises par l’immigré•e à l’étranger sont alors non reconnues (ou reconnues sans valeur) sur le territoire sur lequel elle ou il réside. Ils ne sont alors pas monnayables sur le marché du travail, ce qui limite leur accès aux ressources économiques. Les personnes venues pour étudier et donc détenteurs•trices d’un diplôme obtenu dans le pays d’immigration échappent à ce mécanisme de dévalorisation des diplômes et sont donc généralement mieux inséré•e•s sur le marché du travail (Annequin, Gosselin et Dray-Spira, 2017). D’autres mesures institutionnelles peuvent limiter l’accès des personnes étrangères à certains emplois. C’est par exemple le cas dans certaines administrations françaises et pour certains métiers du secteur privé où il est nécessaire de justifier de l’emploi d’une personne étrangère (Morice, 2014).
Le déclassement social que connaissent les immigré•e•s peut également être le résultat de divers types de discriminations, c’est-à-dire d’actions individuelles de la part des personnes ayant une position sociale dominante, et qui ont une répercussion à l’échelle populationnelle. Parce que les personnes immigrées d’Afrique subsaharienne sont largement pensées, par les personnes non-immigrées, comme étant peu diplômées (Héran, 2004), elles sont encore largement assignées à des secteurs d’activités pour lesquels les emplois sont plus souvent précaires, peu qualifiés, mal rémunérés (Annequin, Gosselin et Dray-Spira, 2017 ; Glenn, 2009 ; Meurs, Lhommeau et Okba, 2016 ; Meurs, Pailhé et Simon, 2007 ; Piore, 1980) et qui correspondent à des « niches ethniques » (Fullin et Reyneri, 2011), ce qui limite leurs accès aux ressources matérielles.
La prise en compte des conditions de la migration
L’analyse que nous nous proposons de mener devra tenir compte du poids des discriminations que peuvent subir les immigré•e•s d’Afrique subsaharienne sur leur position sociale après leur arrivée en France sur leur position sociale, et in fine sur leur vie conjugale. Pour ce faire, il sera nécessaire de tenir compte de la partie visible de ces discriminations, c’est-à-dire des conditions matérielles d’existence des personnes à chaque étape de leur vie. Il s’agira de penser la conjugalité des immigré•e•s d’Afrique subsaharienne comme étant en proie à de multiples rapports sociaux, ces derniers influençant l’accès aux ressources matérielles qui elles-mêmes conditionnent la mise en couple ou la dissolution des unions. Nous tenterons alors de mettre en liens les conditions matérielles d’existence et les pratiques conjugales des personnes et de voir dans quelles mesures elles les premières agissent sur les secondes, afin d’appréhender les rapports sociaux qui se jouent au sein des couples.
Mais la prise en compte de l’accès aux ressources matérielles ne saurait être suffisante. Les analyses portant sur les immigré•e•s ont en effet tendance à expliquer leurs différences de conduites soit par des conditions d’existences différentes, soit à faire de leur culture d’origine la réponse à tous leurs « manquements » (Sayad, 1999), et oublieraient généralement de tenir compte des conditions de l’émigration. Considérer l’immigré•e sans tenir compte des conditions de son émigration coupe l’individu d’une partie de son existence, celle vécue avant la migration. Si notre but est de mettre au jour des effets des conditions de vie sur les trajectoires conjugales des immigré•e•s d’Afrique subsaharienne, il s’agira également de toujours tenir compte des conditions de leur migration, c’est-à-dire la raison de leur venue, la période de leur arrivée sur le territoire français et de leur situation conjugale au moment où elles et ils quittent leur pays.
Mettre en regard les effets de deux ruptures biographiques sur la conjugalité
S’ils ne sont pas comparables en soi, la migration et le diagnostic d’infection au VIH ont toutefois en commun de conduire les individus à se confronter à de nouveaux rapports de domination, et de potentiellement modifier les trajectoires conjugales des personnes. C’est donc l’évolution de ces dernières autour de la migration et du diagnostic d’infection au VIH qu’il s’agit de mettre en regard.
Du fait des discriminations auxquelles elles et ils sont confronté•e•s, les immigré•e•s d’Afrique subsaharienne ont, pour la plupart d’entre elles et eux, une situation économique dégradée, ce qui peut affecter d’autres dimensions de leur vie, et notamment leur conjugalité. Parce que les hommes sont généralement enjoints à prouver leur capacité à entretenir un foyer tant en Europe (Bozon, 1990b, 1990a ; Bozon et Héran, 2006) qu’en Afrique subsaharienne (Marcoux et Antoine, 2014) pour faire couple, ceux étant au chômage ou avec des ressources économiques limitées pourraient avoir des difficultés à entrer ou à se maintenir en union. Les femmes quant à elles, pourraient peiner à atteindre une autonomie financière suffisante qui leur permettent de s’affranchir de la nécessité d’être en union pour accéder aux ressources détenues par les hommes. Par ailleurs, plusieurs analyses ont mis en évidence le fait que les immigré•e•s ayant une position sociale élevée sont davantage en union avec un•e conjoint•e non-immigré•e que leurs homologues moins bien dôté•e•s en capitaux économique, social ou culturel (Muñoz-Perez et Tribalat, 1984 ; Neyrand et M’Sili, 1997 ; Tribalat, 1995). Ces résultats interrogent alors sur les liens entre trajectoires professionnelle et conjugale, et ce d’autant plus pour les personnes immigrées d’Afrique subsaharienne qui connaissent des difficultés d’installation et un déclassement professionnel (Annequin, Gosselin et Dray-Spira, 2017 ; Gosselin et al., 2016). Leurs possibilités de rencontre avec une personne non-immigrée pourraient être réduites. Il semble alors nécessaire de mettre en lien plusieurs dimensions de la vie des personnes immigrées afin de voir comment elles interagissent les unes par rapport aux autres. Il s’agit également de savoir comment la migration d’une part, et la position sociale d’autre part, modèlent les trajectoires conjugales des personnes. Autrement dit, nous tenterons de comprendre comment les couples se composent et se recomposent à l’aune de ce changement d’environnement social et des difficultés d’installations que les immigré•e•s d’Afrique subsaharienne rencontrent.
L’analyse de la manière dont se recomposent les trajectoires conjugales des personnes autour de la migration seule ne nous semble cependant pas suffisante en soi. En effet, comment savoir ensuite si la migration modifie un peu, beaucoup ou indubitablement les trajectoires conjugales des individus ? Pour ce faire, nous avons choisi de confronter les évolutions des situations de couples autour de la migration avec celles observées autour du diagnostic d’infection au VIH, cet évènement pouvant lui aussi mener à de possibles recompositions conjugales.
Les enquêtes qualitatives ayant exploré les recompositions conjugales après le diagnostic d’infection au VIH chez les immigré•e•s d’Afrique subsaharienne vivant en France (Pourette, 2006, 2008a) ou au Royaume-Uni (Doyal et Anderson, 2005 ; Doyal, Anderson et Paparini, 2009) évoquent les multiples évolutions des situations de couples des personnes suite à la découverte de la séropositivité. Elles mettent également en évidence que la mise en couple ou la rupture d’union chez les personnes immigrées vivant avec le VIH dépendent des motifs de migration et des conditions de vie (Pourette, 2006, 2008b). Lorsqu’elles sont en couple, les femmes immigrées d’Afrique subsaharienne nouvellement diagnostiquées expriment une certaine réticence à annoncer leur statut sérologique à leur partenaire par peur d’être rejetée et de se retrouver sans ressources (Pourette, 2008b). Les personnes sans partenaire stable au moment du diagnostic font elles aussi face à la peur d’annoncer leur séropositivité aux partenaires rencontré•e•s après la découverte de leur séropositivité (Doyal et Anderson, 2005), et sont souvent présentées comme ayant des difficultés à entrer en union (Ciambrone, 2001 ; Poglia Mileti et al., 2014 ; Ross et Ryan, 1995). Les femmes séropositives qui n’étaient pas en union au moment du diagnostic ne seraient alors plus en mesure d’accéder aux ressources détenues par les hommes et connaitraient des conditions de vie particulièrement instables. Quant aux hommes, il est possible que la détention de ressources matérielles ne soit plus une condition suffisante à leur mise en couple.
Les enquêtes qui ont précédé l’étude ANRS-Parcours
Connaissances sur les migrations en France
Au cours des dix dernières années, les connaissances sur les migrations en France ont été actualisées par le biais de deux enquêtes quantitatives dont la richesse des données et des analyses ont permis de mieux comprendre les circulations migratoires entre l’Afrique et l’Europe, la vie après la migration et de montrer les discriminations dont étaient victimes les immigré•e•s et leurs descendants.
De 2008 à 2010, l’enquête MAFE (Migrations entre l’AFrique et l’Europe) a été menée dans trois pays d’Afrique subsaharienne (le Ghana, la République Démocratique du Congo et le Sénégal) et six pays d’Europe (la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni). Cette étude avait pour but de mieux connaître les flux migratoires entre ces deux continents (Beauchemin et al., 2013), en s’intéressant particulièrement aux migrations de retour. Pour ce faire, il était nécessaire d’interroger des Africain•e•s dans leur pays de naissance et en Europe et de retracer leurs trajectoires migratoires35. Le recueil de données se présentait sous la forme de deux questionnaires : le premier permettait de collecter des informations relatives à la composition du ménage, et un autre interrogeait les individus à l’aide d’une grille biographique de type Ageven (Encadré 3-1, p. 67). Cet outil a permis de collecter des informations sur les trajectoires des individus en migration dans des contextes de vie différents. Ce recueil des données favorise la construction d’indicateurs qui gardent une certaine uniformité dans leur définition alors même qu’ils se réfèrent à des environnements sociaux différents. Grâce à ce recueil biographique des données, l’enquête MAFE a permis de mettre en évidence l’importance des migrations internes au continent (Flahaux, Beauchemin et Schoumaker, 2013), et de montrer l’effet de sélection de la migration intercontinentale. Ce sont en effet les personnes les plus diplômées qui viennent s’installer en Europe (Ichou, 2016). Enfin, l’étude permet de rompre avec une vision linéaire des déplacements entre pays, généralement présentés comme une allée parfois suivie, quelques années plus tard, par un retour au pays, en faisant apparaître des trajectoires migratoires marquées par de multiples « va-et-vient » entre pays d’origine et pays de destination.
|
Table des matières
RCIEMENTS
PRÉCISIONS TERMINOLOGIQUES
INTRODUCTION GÉNÉRALE
P A R T I E 1 CONJUGALITÉ ET RAPPORTS SOCIAUX
C H A P I T R E 1 Conjugalité des immigré·e·s et sexualité des migrant·e·s d’Afrique subsaharienne : approches par l’intégration et les risques d’infection au VIH
C H A P I T R E 2 Une approche matérialiste des changements conjugaux lors de deux ruptures biographiques
C H A P I T R E 3 Étudier les trajectoires conjugales avec l’enquête ANRS-Parcours
CONCLUSION DE LA PARTIE 1
P A R T I E 2 CONJUGALITÉ ET MIGRATION
C H A P I T R E 4 Migration, mises en couple et ruptures d’unions : De l’influence des conditions de vie sur l’évolution des situations conjugales après l’arrivée en France
C H A P I T R E 5 Le « choix du conjoint » après l’arrivée en France ou la permanence des rapports sociaux de sexe à travers la migration
CONCLUSION DE LA PARTIE 2
P A R T I E 3 CONJUGALITÉ ET DIAGNOSTIC D’INFECTION AU VIH
C H A P I T R E 6 Mieux définir pour mieux classer : Mise en application de différentes méthodes de détermination des coûts de substitution lors de l’analyse de séquences
C H A P I T R E 7 Des recompositions conjugales autour du diagnostic d’infection au VIH qui dépendent des conditions de vie
C H A P I T R E 8 Le « choix du conjoint » après le diagnostic d’infection au VIH : entre accès à de nouveaux espaces de sociabilité pour les femmes et nécessité de faire couple pour les hommes ?
CONCLUSION DE LA PARTIE 3
CONCLUSION GÉNÉRALE
BIBLIOGRAPHIE
Télécharger le rapport complet