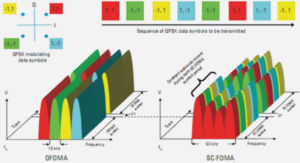Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Contexte physique et géologique
Cadre géographique
La concession de Pout se situe au Nord-Est de Pout, à 6 Km au Nord de la nationale n°2 de Dakar. Elle comprend deux périmètres (300 et 110 ha), séparés par une route goudronnée qui font 410 ha (figure 2).
Le secteur est plus ou moins plat et fortement raviné par de multiples Thalwegs qui déversent les eaux de pluies collectées au pieds de la falaise de Thiès pendant la saison des pluies vers le lac Tanma situé au Nord-Ouest.
Le climat comme dans l’ensemble du pays est marqué par la succession de la saison des pluies et de la saison sèche. Ainsi, de juin à octobre correspondant à l’hivernage, le climat est chaud, les températures varient entre 25°C et 40°C, alors que de novembre à avril le climat est plus frais avec des températures variant entre 18°C et 25°C. La saison des pluies se situe entre juillet et octobre.
La végétation est de type savane et le sol sablo-argileux noirâtre. Il est colonisé principalement par des arbustes épineux (Accacia seyal)
Pout est entouré de deux forêts classées. Une forêt de 11 000 hectares qui appartient à la région de Thiès et une autre de 8 000 hectares, dont 4 000 hectares sont sur le territoire communal de Pout (SONEPI, 1971).
Ces deux forêts qui sont appelées communément Allou Kagne par les habitants se situent à environ 1 Km de la ville. Une pépinière forestière tenue par les services des eaux et forêts est implantée à Pout pour satisfaire les besoins de la population de la commune et de la région de Thiès en matière de production de plantes forestières et fruitières.
C’est une zone caractérisée par une faune à poils constituée de petits ruminants et de rongeurs.
Cadre géologique
Généralités sur la presqu’île du Cap-Vert
La presqu’île du Cap-Vert, (Sarr, 2012), constitue la pointe la plus occidentale du bassin sédimentaire du Sénégal et forme un éperon bordé par l’océan Atlantique.
Selon un profil W-E, s’y reconnaissent plusieurs régions naturelles : la tête de la presqu’île du Cap-Vert (région de Dakar) limitée par de petites falaises côtières et dominée par les deux collines volcaniques des Mamelles, dont la plus grande culminant à 105 m, est surmontée par le phare. L’isthme de la presqu’île du Cap-Vert (Rufisque, Bargny), d’altitude basse (20 à 30 m) est bordé au nord par la région des Niayes, à l’est par le horst de Diass qui forme un relief peu accentué d’une centaine de mètres d’altitude, et qui plonge vers le nord en direction de Kayar et culmine à 130-140 m d’altitude.
La morphologie de la presqu’ile du Cap-Vert se caractérise par la présence de deux reliefs principaux reliés par une zone dunaire déprimée : A l’Est, le massif de Diass représente un compartiment soulevé et limité par des failles. Ce massif s’élève d’Ouest en Est et culmine près de Thicky (108 et 102 m). Au Nord, il s’abaisse entre Gap et Sandock et s’interrompt sur la ligne de la falaise côtière. En dehors de la région de Dakar qui est dominée par les formations volcaniques du système éruptif des Mamelles, la géologie de la presqu’île du Cap-Vert est marquée par une sédimentation plus ou moins continue d’âge Crétacé-Pliocène, dont la structure présente par endroit des blocs nettement soulevés et effondrés (figure 3).
Cadre litho-structurale de la zone de Pout Ce secteur se situe à l’Ouest du horst de Diass.
La série stratigraphique débute par le Crétacé supérieur avec le toit du Campanien reconnu au Cap de Naze (Popenguine) sous un faciès argileux. Les formations secondaires se terminent par une épaisse série détritique sableuse d’âge crétacé supérieur (Maastrichtien). Localement ces sables s’indurent et passent à des grès (Sarr, 1998).
Ces sables constituent un réservoir aquifère exploité dans la plus grande partie du Sénégal.
Le caractère argileux de cet aquifère s’affirme au fur et à mesure que l’on se rapproche de l’océan en même temps que s’accroit la profondeur du toit et la puissance de cette formation (Martin, 1967).
Le Paléocène surmontant les sables du Maastrichtien, est représenté essentiellement par des calcaires organogènes.
A l’Ouest du massif de Diass il n’affleure qu’à Pantior (actuelle carrière de Ndoukhoura), à la faveur de l’entaille d’un marigot. A l’Est, il affleure, ou est sub-affleurant, suivant une bande étroite depuis Fouloum au Nord jusqu’à Bandia au Sud.
Au-delà au Sud, grâce à l’effacement de la falaise de Thiès, il s’étale largement jusqu’au littoral Sud.
Au Nord de la route de Dakar-Thiès, les affleurements sont nombreux.
Tous les marigots qui descendent de la falaise les entaillent. Certains de ces marigots disparaissent d’ailleurs totalement au profit de dolines ou d’avens. Entre Fouloum et Ngomène, le Paléocène est interrompu brusquement vers l’Ouest par le jeu de la faille Ngomène (figure 5) et se trouve en contact avec les marnes blanches papyracées de l’Eocène inférieur.
Cette faille est plus marquée au SSE de Fouloum (figure 5) par un pointement de basalte et par des pendages SSW qui affectent les bancs de calcaires marneux de la base de l’Eocène inférieur.
Au Sud de Ngomène, une faille ou plutôt un réseau de faille met en contact le Paléocène latéralement avec le Maastrichtien ; au Sud de la route Dakar-Thiès, les affleurements deviennent plus rares, les calcaires n’affleurent qu’à la faveur de dolines ou dans les entailles des marigots importants (Somone, marigot de Ndiogoye, marigot de Balling).
Le recouvrement quaternaire est beaucoup plus important dans cette zone (10 m et plus). Sur la route Thiès Mbour, entre Bandia et Thiéo, affleurent les calcaires Paléocènes dits de Bandia ; ils émergent des recouvrements sous la forme d’un dôme circonscrit et sont hachés par des dépressions rectilignes NNW. Au Sud de la route de Dakar-Thiès, de même qu’au Sud de Ngomène, l’Eocène est en contact avec le Maastrichtien par la faille de Ngomène (Martin, 1967).
Vers la fin du Paléocène, une émersion a par la suite provoqué la karstification du niveau supérieur du calcaire, jusqu’à une profondeur d’environ 7 m (Dieye, 2000).
Le gisement calcaire de Pout appartient aux formations paléocènes du horst de Diass : partie orientale de la presqu’ile du Cap-Vert qui forme la partie la plus occidentale du bassin sédimentaire Sénégalo-Mauritanien. Le secteur des calcaires paléocènes de Pout est limité à l’Ouest par la faille de Ngoméne et surplomb la dépression du lac Tanma et du petit fleuve de la Somone. Vers l’Est se trouve la « Cuesta de Thiès »
Le paléocène supérieur est constitué de calcaires zoogènes très karstifiés qui affleurent et largement autour de Mbour et jusqu’au Nord de Pout L’épaisseur moyenne des calcaires zoogènes karstifiés en bordure orientale du horst de Diass varie entre 40 et 80m.
ANALYSE ET INTERPRETATION DES DONNEES
Cette étude porte sur la concession calcaire de SOCOCIM qui fait 410 ha.
Ce secteur a été l’objet de plusieurs campagnes de prospections qui ont abouti à l’obtention de données dont l’utilisation servira à la caractérisation géologique, géochimique et quantitative du secteur.
Sur ce chapitre, nous allons procéder à une analyse et une interprétation des données requises sur le terrain afin de pouvoir les comparer.
Pour ce faire, nous allons procéder de la manière suivante :
– l’étude de la structure du gisement ;
– la détermination de la hauteur du décapage sera faite ;
– l’ étude comparative des données afin de pouvoir certifier leur fiabilité ;
– l’étude géochimique de la zone.
Ce qui nous permettra d’en déduire une orientation de l’exploitation et de donner des recommandations pour une étude plus précise que possible des réserves intéressantes.
Présentation des données
La fabrication du ciment nécessite au préalable des réserves importantes de matières premières dont la plus importantes est le calcaire.
Ainsi, dans le cadre de la recherche de nouvelles carrières de calcaire, une campagne de prospection a été entreprise par la direction des carrières de la SOCOCIM :
– En 2004 une série de sondages destructifs analysés a été effectuée dans la zone. (Figure 6)
– En 2018 une série de sondages destructifs et géophysiques a été effectuée dans le secteur.
Cette dernière s’est déroulée en une phase de prospection géophysique et une phase de sondages destructifs logués et analysés (figure 6).
Sondages miniers
Sondages destructifs logués et analysés
Ces sondages sont profonds de 25 m sur les points où on a trouvé du bon calcaire et de moins de 20 m sur les zones où on n’a pas trouvé du bon calcaire.
Ces sondages étaient au nombre de 14 dans le périmètre 300 et au nombre de 7 dans le périmètre 110 ha (Figure 7).
Ainsi, sur chaque mètre, les résultats obtenus ont été interprétés en nous donnant le type de roche obtenu et la composition des éléments chimiques.
Sondages destructifs analysés
Ces analyses sont effectuées sur chaque mètre et nous procurent la composition et le pourcentage d’éléments chimiques qui y sont présents avec leur LSF respectif.
Parmi ces analyses chimiques, 14 ont été faites sur le périmètre 300 et 7 sur le périmètre 110.
Synthèse des résultats obtenus
L’analyse et l’interprétation des résultats obtenus nous ont permis d’en déduire que :
• Les sondages destructifs analysés et logués nous ont permis de définir la structure et l’épaisseur de la couverture du périmètre 300 mais ne nous permettent pas de distinguer les types de faciès de calcaire.
Il serait alors important :
– d’augmenter les sondages destructifs pour la caractérisation géologique et géochimique du reste de la zone.
– De réaliser des sondages carottés sur les deux périmètres pour pouvoir déterminer de façon plus concrète les types de faciès de calcaire,
• Les sondages électriques nous ont permis de déterminer l’épaisseur de la couverture et
d’en déduire l’épaisseur du calcaire sur une profondeur de 30 m pour les deux périmètres.
Cependant, cette méthode présente des limites, à savoir :
– Efficacité maximale : hétérogénéité se traduisant par des résistivités plus faibles que l’encaissant (par exemple si les cavités sont noyées) ;
La méthode est moins efficace si l’hétérogénéité « cible » a une résistivité plus forte que l’encaissant ;
– Les terrains à reconnaitre doivent être suffisamment contrastés, en terme électrique pour pouvoir être différenciés. ;
– Les sites ne doivent pas être trop « bruyants » (présence de canalisation ou des réseaux en profondeur, lignes à haute tension, forts courants telluriques, …), ceci limite l’utilisation de cette méthode en contexte fortement urbanisé ou industrialisé.
Donc, il serait important de tester la méthode sismique réfraction et de comparer à la méthode électrique. La méthode sismique réfraction pourrait nous permettre de déterminer avec précision l’épaisseur de chaque couche.
Caractérisation géologique
Cette caractérisation géologique a été faite sur la base de la cartographie des fronts de taille mais principalement, des études antérieures qui ont étaient faites dans la zone.
Ainsi, la coupe géologique de la région présente :
Stratigraphie du secteur
L’observation des fronts de taille et l’exploitation des données de sondages destructifs ont montré du bas vers le haut la succession suivante : du calcaire gréseux, du calcaire massif, de l’argile noire, de la latérite et de la terre noire.
Calcaire gréseux
C’est un calcaire contenant des grains de quartz en quantité suffisante (30 à 50 %) généralement pour lui donner l’aspect d’un grés.
Ce type de calcaire est dû aux sables du Maastrichtien. En effet, le volcanisme du tertiaire était accompagné d’une transgressions marine.
Toutefois, il est rare de rencontrer ce calcaire gréseux dans notre secteur et son épaisseur maximale est de 2 m.
Calcaire massif
Généralement de couleur blanchâtre en haut et jaunâtre en bas, c’est un calcaire dur à tendre, franc et se présente en plusieurs faciès.
De bas en haut, on rencontre la succession suivante :
Calcaire coquiller
Il débute par un calcaire macro-coquiller blanchâtre à jaune clair, dur à tendre. Ce calcaire est plus ou moins massif, fracturé et parfois friable. Il est fossilifère, plus ou moins cristallin et comporte des recristallisations calciques
Le calcaire macro-coquiller est constitué de débris de coquilles de gastéropodes et de lamellibranches. Il présente la base des formations de calcaire massif.
Sur ce faciès macro-coquiller repose un calcaire micro-coquiller fossilifère avec des recristallisations calciques. Ce faciès est blanchâtre parfois jaunâtre et poreux. Il est franc, dur à tendre, le plus souvent fracturé.
Calcaire crayeux
Le calcaire crayeux est fin à grossier massif, non cristallin, plus ou moins dur, parfois tendre. C’est un faciès très homogène sans recristallisation calcique, ni fossiles Il est le plus souvent crayeux. Ce calcaire de couleur blanchâtre et rarement jaunâtre présente parfois des karsts ou/et micro karts. Il est fracturé et rognoneux par endroits. Bien qu’étant poreux et perméable, ce calcaire ne présente aucun indice d’eau. Le faciès est plus ou moins friable aux joints de fractures. Au sein de ce calcaire quelques rares poches d’argile peuvent se rencontrer.
Calcaire karstique
Il se retrouve au sommet. C’est un faciès de couleur blanchâtre, il est cristallin, fin, dur et massif. Ce calcaire présente des intercalations d’argile. Il renferme des recristallisations calciques plus ou moins importantes.
Au toit de ce calcaire massif, nous remarquons la présence d’une intrusion de basalte altéré.
Elle est de couleur gris verdâtre et de direction Nord-Est.
Argile noire
Présente dans presque la totalité des sondages destructifs logués et analysés, c’est une formation qu’on peut retrouver aussi bien en surface qu’en profondeur.
Elle est imperméable, compacte de couleur noire comme l’indique son nom et est souvent associée à des pisolithes de latérite ou même de calcaire.
Cette argile est glissante et gonflante en présence d’eau.
Latérite
Souvent non consolidée, elle se rencontre dans la partie sud-ouest de la concession où elle repose sur la couche d’argile et au nord où elle surmonte la terre noire. Elle atteste d’une altération chimique et mécanique des formations argileuses et est parfois associée à des pisolithes de calcaires et aussi à de l’argile.0
|
Table des matières
INTRODUCTION
CHAPITRE 1 : GENERALITES
1.1.Problématique
1.2. Présentation des carrières
1.3. Généralité sur le ciment
1.3.1. Définition
1.3.2. Technique de fabrication du ciment
1.4. Présentation de l’entreprise
1.5. Ciment à SOCOCIM
1.6.Contexte physique et géologique
1.6.1.Cadre géographique
1.6.2.Cadre géologique
1.6.2.1.Généralités sur la presqu’île du Cap-Vert
1.6.2.2.1.Cadre litho-structurale de la zone de Pout
Conclusion partielle
CHAPITRE 2 : ANALYSE ET INTERPRETATION DES DONNEES
Introduction
2.1. Présentation des données
2.1.1. Sondages miniers
2.1.1.1. Sondages destructifs logués et analysés
2.1.1.2. Sondages destructifs analysés
2.1.1.3. Interprétation des données
2.1.2. Sondages électriques
2.1.2.1. Interprétation des données
2.3. Comparaison entre sondages électriques et sondages destructifs logués
2.3.1. Corrélation des données de prospection
2.3.2.Synthèse des résultats obtenus
2.4. Caractérisation géologique
2.4.1. Stratigraphie du secteur
2.4.1.1.Calcaire gréseux
2.4.1.2.Calcaire massif
2.4.1.2.1. Calcaire coquillers
2.4.1.2.2. Calcaire crayeux
2.4.1.2.3.Calcaire karstique
2.4.1.3. Argile noire
2.4.1.4. Latérite
2.4.1.5. Terre noire
2.5. Conclusion
2.6.2 Etude des oxydes majeurs et leur distribution dans le gisement
2.6.2.1.Distribution latérale
2.6.2.1.1 Distribution latérale du CaO
2.6.2.1.2. Distribution latérale du SiO2
2.6.2.1.3. Distribution du Al2O3
2.6.2.1.4. Distribution du Fe2O3
2.6.2.1.5. Distribution du MgO
2.6.2.1.6. Distribution de P2O5
2.7. Conclusion
CHAPITRE 3 : MODELISATION GEOLOGIQUE DU GISEMENT
Introduction
3.1. Procédure de modélisation du calcaire de Pout
3.1.1. Collecte des données de travaux de prospection
3.1.2. Réalisation des sections
3.1.3. Validation du solide
3.1.4. Modélisation du gisement de Pout
3.2. Estimation des réserves
3.2.1 Conception de « bloc model »
3.3. Esquisse d’un schéma d’exploitation
CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Télécharger le rapport complet