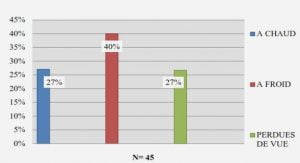Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Généralités sur les vecteurs du paludisme
Position systématique
Les vecteurs du paludisme humain appartiennent tous au genre Anopheles et à la famille des Culicidae. Celle-ci comprend près de 3300 espèces regroupées en 37 genres (Carnevale & Robert, 2009). Parmi les 484 espèces décrites dans le genre Anopheles (Harbach, 2004), une soixantaine sont des vecteurs dont seulement une vingtaine sont connus comme de bons vecteurs. En Afrique, au sud du Sahara, une douzaine d’espèces sont connues comme bons vecteurs parmi lesquels An. gambiae, An. coluzzii, An. arabiensis, An. funestus, An. nili et An. moucheti.
Morphologie
Les anophèles sont des insectes à métamorphose complète (insectes holométaboles) : l’adulte, la larve et la nymphe ont des morphologies très différentes et adaptées à leurs modes de vie. Le cycle de vie des anophèles se déroule dans deux milieux (Figure 1). En milieu aquatique, le développement se fait en trois étapes avec trois stades qui se succèdent: œuf, larve et nymphe. Les œufs sont pondus isolément à la surface de l’eau. Ils possèdent des flotteurs latéraux qui leur permettent de rester à la surface de l’eau grâce à un phénomène de tension superficielle. Ils ne résistent pas à la dessiccation et éclosent en général 48 heures après la ponte de la femelle et donnent naissance à des larves.
Les larves sont caractérisées par l’absence de pattes et de siphon respiratoire et la présence d’un thorax globuleux. Au cours du développement, la larve d’anophèle subit 4 mues et passe ainsi par quatre stades.
À la fin de la vie larvaire survient une métamorphose complète. La larve se transforme en nymphe qui diffère morphologiquement de la larve. Cette nymphe est caractérisée par la fusion de la tête et du thorax pour donner naissance à un céphalothorax globuleux et par une respiration à travers deux trompettes respiratoires. A maturité, la nymphe est l’objet de modifications internes très importantes qui permet la transformation en adulte ailé.
L’adulte possède une morphologie particulière avec trois parties bien individualisées. La tête porte deux yeux composés, deux antennes avec des soies (longues et nombreuses chez les mâles), une trompe ou proboscis et deux palpes maxillaires situés de part et d’autre de la trompe. Le thorax comprend trois segments soudés (prothorax, mesothorax et metathorax) et porte une paire d’ailes, une paire de balanciers et 3 paires de pattes. L’abdomen comporte 10 segments dont 8 sont visibles. A son extrémité se trouvent les organes de reproduction (génitalia chez les mâles et cerques chez les femelles).
Biologie
Chez les anophèles les mâles ne sont pas hématophages, ils se nourrissent de sucs d’origine végétale et leur longévité est relativement faible. Les femelles se nourrissent également de sucs d’origine végétale mais ont besoin de sang pour assurer la maturation de leurs œufs. En général, chaque prise de repas sanguin est suivie d’une ponte dans les 2 à 3 jours qui suivent (cycle gonotrophique). Après chaque ponte, le moustique se met à la recherche d’un nouvel hôte. La ponte ainsi que les deux stades suivants (larve et nymphe) se font en milieu aquatique et durent en tout entre 7 jours et 5 semaines selon l’espèce et, surtout la température ambiante. Le stade adulte se déroule en milieu aérien et dure environ une semaine pour le mâle et jusqu’à deux mois pour la femelle.
Les gites larvaires sont presque toujours des collections d’eau calme (les larves sans siphon se noient dans les eaux agitées): mares permanentes ou temporaires, anses de rivières, bords de lacs, empreintes de pas….
Les femelles sont attirées par différents stimuli dégagés par l’hôte: le CO2, la sueur, la taille entre autres. Les préférences trophiques varient suivant les espèces de moustiques et la disponibilité des hôtes vertébrés. Les moustiques zoophiles se nourrissent exclusivement sur des animaux et les moustiques anthropophiles presque exclusivement sur homme. Selon le lieu de la prise du repas sanguin on distingue des moustiques endophages (piquant à l’intérieur des habitations) et des moustiques exophages (piquant à l’extérieur des habitations). De la même façon, selon le lieu de repos après la prise du repas sanguin on distingue des moustiques endophiles c’est à dire ceux qui une fois gorgés restent à l’intérieur des habitations pour digérer leurs repas de sang (faune résiduelle), et des moustiques exophiles, qui restent hors des habitations humaines pour digérer leurs repas de sang.
Les vecteurs du paludisme au Sénégal
Une vingtaine d’espèces anophéliennes ont été décrites au Sénégal (Diagne et al., 1994). Parmi ces espèces, six sont connues pour leur implication dans la transmission du paludisme : An. gambiae s.s, An. arabiensis, An. funestus , An. melas, An. nili et An. pharoensis (Dia, 2007). An. gambiae s.s, An. arabiensis et An. funestus sont les trois vecteurs majeurs alors que An. melas, An. nili et An. pharoensis sont considérés comme des vecteurs secondaires du fait de leur implication faible et localisée. An. gambiae s.s et An. arabiensis sont sympatriques dans toutes les zones climatiques du Sénégal (Faye et al., 2011). Leurs fréquences relatives dépendent des conditions climatiques (Fontenille et al., 2003).
An. gambiae s.s est prédominant dans les zones de savanes humides alors que An. arabiensis est plus abondant en zones sahéliennes et soudano-sahéliennes (Dia et al., 2008). Leurs gîtes larvaires sont constitués principalement par des collections d’eau peu profondes et ensoleillées : empreintes de pas, de sabots, petites mares, marécages aménagés, rizières … (Gillies & De Meillon, 1968).
An. melas est localisé le long du littoral mais également à l’intérieur des terres le long des cours d’eau du Sine Saloum et de basse Casamance jusqu’aux limites atteintes par la remontée des eaux marines.
An. funestus a été absent auparavant des zones sahéliennes suite à la sécheresse des années 70. Il est actuellement présent dans toutes les zones biogéographiques du Sénégal (Konaté et al., 2001; Dia et al., 2003, 2008). Ses gîtes caractéristiques sont des collections d’eau profondes permanentes ou semi-permanentes avec une végétation émergente ou dressée.
An. pharoensis est présent dans toutes les régions climatiques du Sénégal mais avec une faible abondance, à l’exception du delta et de la moyenne vallée du fleuve Sénégal particulièrement dans les zones de riziculture irriguée.
An. nili est connu surtout dans la zone du sud-est du Sénégal où son rôle dans la transmission du paludisme a été décrit (Dia et al., 2003).
Méthodes d’estimation de la transmission
Le taux d’inoculation entomologique (TIE) est le principal paramètre utilisé en entomologie du paludisme pour estimer la transmission du paludisme. Il exprime le nombre de piqûres d’anophèles infectés que reçoit un individu pendant une période donnée. Il est calculé par la formule: TIE = ma x s avec ma = taux d’agressivité et s = indice sporozoitique.
Le taux d’agressivité (ma)
Il correspond au nombre de piqûres reçues par homme durant une période considérée (nuit, semaine, mois, saison, année…). Plusieurs méthodes permettent de l’évaluer dont la plus connue (méthode «gold standard») est la méthode de capture sur homme (OMS, 1975). Dans la pratique, les moustiques venant se poser sur les jambes ou bras dénudés d’un homme qui sert à la fois d’appât et de «captureur» sont collectés dans des tubes à hémolyse. Bien qu’elle soit une méthode de mesure directe du taux d’agressivité, cette méthode pose des problèmes éthiques dus à l’utilisation des «captureurs» comme appât ce qui les expose à la transmission d’autres affections.
C’est ainsi que plusieurs méthodes alternatives ont été proposées pour estimer le taux d’agressivité:
– la méthode de collecte au repos dans les habitations humaines : le taux d’agressivité est estimé dans ce cas par le produit entre le nombre moyen de moustiques collectés par dormeur et l’indice d’anthropophilie (Toure et al., 1996 ; Dia et al., 2011). C’est cette méthode qui a été utilisée au cours de cette étude.
– l’utilisation des pièges CDC couplés à des dormeurs sous moustiquaires non imprégnées (Mathenge et al., 2005).
– le piège à odeur (Costantini et al., 1993).
– le Mbita trap (Mathenge et al., 2004).
L’utilisation de ces méthodes dans plusieurs contextes a cependant montré que la méthode de capture sur homme reste encore la méthode de référence pour évaluer le contact homme-vecteur.
L’indice sporozoïtique
Il correspond au pourcentage de moustiques portant des sporozoïtes dans leurs glandes salivaires. La détection des sporozoïtes peut être faite par trois méthodes principalement :
– dissection des glandes salivaires et observation au microscope (OMS, 1975).
– méthode immuno-enzymatique basée sur l’utilisation d’anticorps monoclonaux dirigés contre des protéines des Plasmodium : exemple la méthode ELISA CSP de Wirtz et al., (1987). C’est cette méthode qui a été utilisée au cours de cette étude.
– méthode moléculaire (Bass et al., 2008 ).
MATERIELS ET METHODES
Origine des échantillons
Les échantillons sur lesquels l’étude a été réalisée proviennent de 11 villages situés dans l’arrondissement de Toubacouta (Figure 2). L’étude a été menée pendant le mois de septembre 2012 ;Cette zone est caractérisée par un climat de type savane soudanienne avec une saison des pluies qui dure entre 4 et 5 mois dans l’année. Les premières pluies apparaissent généralement à la fin du mois de juin et les dernières dans la première moitié du mois d’octobre. Selon les villages et leur localisation spécifique, les principales activités humaines sont partagées entre l’agriculture, l’élevage et le commerce. Les animaux domestiques rencontrés incluent moutons, chèvres, bœufs, chevaux et ânes. Les principales caractéristiques des villages sont présentées dans le tableau 1.
Collecte et traitement des moustiques sur le terrain
Les repas sanguins analysés au cours de cette étude proviennent de femelles collectées au repos dans les habitations humaines par la méthode de récolte après pulvérisation d’insecticide. Pour ce faire, des draps blancs ont été étalés sur tout le plancher des chambres sélectionnées puis deux opérateurs ont pulvérisé l’insecticide simultanément, l’un à l’intérieur sur les parois de la pièce et sur le toit, et l’autre à l’extérieur sur les issues (portes et fenêtres) par lesquelles les moustiques pourraient éventuellement s’échapper. Après une dizaine de minutes d’attente, les draps ont été soigneusement sortis puis les moustiques agonisant sur les draps ont été récupérés et placés dans des gobelets portant le numéro de la concession et de la pièce. Les moustiques ont ensuite été triés puis identifiés suivant la clé de Gillies & De Meillon (1968) puis ont été conservés individuellement dans des tubes contenant un dessiccateur (gel de silice) pour les analyses ultérieures.
Dans chacun des 11 villages, 10 cases ont été sélectionnées pour l’échantillonnage.
Le nombre de dormeurs (occupants) la veille de chacune des pièces sélectionnées a été relevé.
Traitement au laboratoire
Identification des repas de sang
Au laboratoire, les moustiques ont été sortis des tubes puis les abdomens des femelles collectées à l’état gorgé ont été séparés du reste du corps, puis placés dans des tubes Eppendorf. L’identification des repas sanguins a été effectuée en utilisant la technique ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) directe de Beier et al., (1988) légèrement modifiée. Cette technique consiste à faire agir sur le sang absorbé par les moustiques des anticorps spécifiques d’hôtes potentiels (homme, bœuf, mouton, poule et cheval). Ces anticorps sont marqués par une enzyme (peroxydase) qui en présence de son substrat donne une réaction colorée qui révèle la présence de l’antigène à identifier (Figure 3).
Chaque abdomen a été broyé dans 800 µl de PBS 1X (Phosphate Buffered Saline) puis 50 µl de chaque broyât ont été distribués par puits pour chacun des 5 hôtes à tester. Pour les témoins positifs, 50 µl de sérum homologue dilué au 1/100 ont été utilisés alors que pour les témoins négatifs, 50 µl de PBS 1X ont été utilisés (Figure 4).
Les plaques ont été recouvertes et incubées à température ambiante pendant 3 heures. Après incubation, elles ont été vidées et lavées 2 fois au PBS/Tween 20. Dans chaque puits (sauf pour les témoins négatifs où l’on ajoute 50µl de tampon repas de sang), 50 µl d’anticorps conjugués à la peroxydase ont été ajoutés. Au bout d’une heure d’incubation à température ambiante et après vidange et lavage 4 fois au PBS/Tween 20, 100 µl de substrat de la peroxydase ont été ajoutés dans chaque puits. Les plaques ont été ensuite incubées à l’obscurité pendant 30 minutes au bout desquelles 50 µl d’acide sulfurique 4N ont été ajoutés par puits pour arrêter la réaction (Figure 3).
La lecture des résultats a été faite d’abord visuellement puis au spectrophotomètre à 450 et 620 nm et le seuil de positivé fixé à 2 fois la moyenne des témoins négatifs plus 3 écart-types.
Recherche des anophèles infectés
Les têtes et thorax des femelles d’anophèle devant servir à la recherche d’infection à Plasmodium falciparum ont été individuellement placés dans des tubes Eppendorf numérotés. La recherche d’infection a été effectuée par la technique ELISA de Burkot et al., (1984) modifiée par Wirtz et al., (1987).
Le principe est identique à celui de l’ELISA pour la recherche de l’origine des repas de sang mais la technique est différente. La protéine CSP (Circumporozoite protein), si elle est présente, est d’abord couplée à un anticorps monoclonal de capture préalablement fixé sur les parois de la plaque. L’éventuel complexe CSP-anticorps ainsi formé est révélé par un anticorps monoclonal conjugué à une peroxydase (Figure 5).
Les têtes et thorax ont été broyés dans 20µl d’IGEPAL CA-630 (détergent) et 380µl de BB (Blocking Buffer) puis conservés à –20°C. Les plaques devant servir aux tests ont été sensibilisées par ajout de 50µl d’une solution d’anticorps monoclonaux de capture par puits (Figure 6). Après incubation durant toute la nuit, les plaques ont été vidées puis 205µl de BB ont été ajoutés pour saturer les sites non occupés par les anticorps de capture. Après une heure d’incubation, 50µl de broyât ont été distribués dans chaque puits à l’exception du témoin positif (H12 où 50µl de broyat d’un moustique déjà positif ou 50 µl d’un contrôle synthétique) et des témoins négatifs (colonne 1 où 50 µl de BB ont été ajoutés). Au bout d’une heure d’incubation, les plaques ont été vidées et lavées 2 fois au PBS/Tween 20 puis 50µl d’une solution d’anticorps monoclonaux conjugués à une peroxydase ont été distribués par puits. Après deux heures d’incubation, les plaques ont été vidées puis lavées 4 fois au PBS/Tween 20 puis 100 µl de substrat de la peroxydase ont été ajoutés dans chaque puits. Les plaques ont été ensuite incubées à l’obscurité pendant 30 minutes au bout desquelles 50µl d’acide sulfurique 4N ont été ajoutés par puits pour arrêter la réaction.
La lecture des résultats a été faite d’abord visuellement puis au spectrophotomètre à 450 et 620 nm et le seuil de positivé fixé à 2 fois la moyenne des témoins négatifs plus 3 écart-types.
Identification des espèces du complexe d’Anopheles gambiae
L’identification des espèces An. gambiae a été faite au laboratoire en utilisant les techniques de Scott et al., (1993) et Fanello et al., (2002).
Extraction de l’ADN
L’extraction de l’ADN a été faite par la méthode de Collins et al., (1987). L’ADN génomique a été extrait à partir des pattes, des ailes ou un bout de l’abdomen des moustiques. Les tissus ont été broyés dans 100µl de tampon de broyage puis le broyât a été incubé au bain sec à 65°C pendant 30 minutes au bout desquelles 14µl d’acétate de potassium ont été ajoutés par tube. Les tubes ont ensuite été incubés dans de la glace pendant 30 mn puis ont été centrifugés à 14000 tours pendant 15 minutes. Le surnageant a ensuite été retiré puis transféré dans un nouveau tube numéroté dans lequel 200µl d’éthanol pur ont été ajoutés pour précipiter l’ADN génomique. Les tubes ont été ensuite conservés au congélateur pendant au moins 20 minutes au bout desquelles ils ont été centrifugés à 14000 tours pendant 20 minutes puis l’alcool a été retiré et le culot à peine visible, séché pendant 20 minutes au Speed Vac et l’ADN extrait, reconstitué dans 50µl d’eau bi-distillée.
L’amplification de l’ADN
L’ADN extrait a été amplifié à partir des méthodes de Scott et al., (1993) et Fanello et al., (2002). L’ADN a été amplifié dans un mélange comprenant de l’eau, un tampon de réaction, des desoxynucléotides, 4 amorces dont une commune aux 3 trois espèces du complexe An. gambiae présentes au Sénégal (amorce UN) et trois spécifiques (AR pour An. arbiensis, GB pour An. gambiae et ML pour An. melas ), du MgCl2 et une ADN polymérase (Taq Polymerase ).
L’amplification a été effectuée selon les conditions suivantes : 2 minutes à 94°C pour la dénaturation initiale de l’ADN, suivies de 30 cycles comprenant chacun 15 seconde de dénaturation à 94°C, 15 secondes pour l’hybridation des amorces à 50°C et 15 secondes d’élongation à 72°C. Cette étape du dernier cycle a été prolongée par 72°C d’élongation finale pendant 10 minutes. Pour l’identification complémentaire avec la méthode de Fanello et al., (2002), 1 unité de l’enzyme Hha I dans son tampon de réaction a été directement ajoutée aux produits de la réaction de PCR (pour tous les individus An. gambiae s.s ) incubés à 37°C pendant au moins 4h.
|
Table des matières
I. INTRODUCTION
1. Généralités sur les vecteurs du paludisme
1.1. Position systématique
1.2. Morphologie
1.3. Biologie
1.4. Les vecteurs du paludisme au Sénégal
2. Méthodes d’estimation de la transmission
2.1. Le taux d’agressivité (ma)
2.2. L’indice sporozoïtique
II. MATERIELS ET METHODES
1. Origine des échantillons
2. Collecte et traitement des moustiques sur le terrain
3. Traitement au laboratoire
3.1. Identification des repas de sang
3.2. Recherche des anophèles infectés
3.3. Identification des espèces du complexe d’Anopheles gambiae
3.3.1. Extraction de l’ADN
3.3.2. L’amplification de l’ADN
3.3.3. La migration
4. Analyse des résultats
III. RESULTATS
1. Composition spécifique et abondance
2. Identification des espèces du complexe An. gambiae
3. Préférences trophiques et taux d’anthropophilie
3.1. Préférences trophiques
3.2. Taux d’anthropophilie
4. Taux d’agressivité
5. Taux d’infection plasmodiale
6. Taux d’inoculation entomologique (TIE)
IV. DISCUSSION
V. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Télécharger le rapport complet