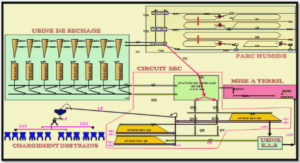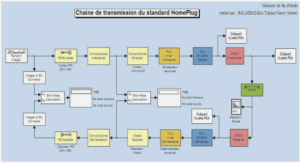Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Souffrance des intervenants et contre-transfert
Dans les années 90, cette souffrance a d’abord été identifiée du côté des intervenants. Ceux-ci disaient autant souffrir d’une incapacité à mobiliser des professionnels dans une perspective de travail pluridisciplinaire que de celle à faire émerger des demandes d’accompagnement ou de soins chez les usagers. Confrontés à des échecs récurrents, au manque de moyens dont ils disposaient, ils questionnaient peu à peu leurs capacités relationnelles vis-à-vis des personnes effondrées qu’ils rencontraient. Ces personnes auxquelles ils avaient affaire ne présentaient pas, à leurs yeux, de signe particulier d’inaptitude ni de signes de psychopathologie classique mais paraissaient être dans la fuite. Néanmoins, ne parvenant pas à déployer leur pratique habituelle, ils pensaient que ces personnes relevaient plutôt de la psychiatrie. Autrement dit, la tentation était forte de les renvoyer vers d’autres professionnels (vers les psychiatres), sans doute pour tenter d’écarter ce problème sans solution apparente. La psychiatrie n’acceptait toutefois pas de se substituer au champ social pour prendre en charge des personnes qui (1) ne demandaient pas de soins ; et (2) ne semblaient pas souffrir davantage que la population générale en terme de maladie mentale classique. La non acceptation de la psychiatrie à sortir hors de ses murs pour aller collaborer avec les dispositifs sociaux entraînait du côté des professionnels du social un sentiment d’isolement et d’impuissance.
L’on remarque alors des ressentis similaires entre usagers et intervenants. Nous pouvons ainsi comprendre les difficultés qui sont les leurs à contenir ce qui s’impose à eux tandis qu’ils éprouvent de grandes difficultés à trouver des supports d’étayage à leurs pratiques professionnelles. Les exemples sont nombreux pour décrire ce manque : absence fréquente de supervision, temps d’élaboration remplacés par l’urgence administrative, manque de moyens financiers (et donc humains) accordé au champ social, etc. Plus qu’ailleurs, les lieux censés accueillir la détresse humaine souffrent d’attaques contre le lien et contre la pensée. Ces attaques peuvent provenir des usagers eux-mêmes comme des instances supérieures qui confondent rentabilité et nécessité de prendre le temps d’accueillir/d’accompagner/de soigner. Or, quand la créativité des intervenants ne trouve pas les moyens de s’exprimer, voire qu’elle se trouve implicitement interdite par des mouvements psychiques violents, cela suscite des représentations de « mise en péril, voire en échec » (Pinel, 2007a, p. 13) des fonctions professionnelles. Ces attaques peuvent atteindre le narcissisme de ces professionnels engagés dans une pratique peu gratifiante, où la gratitude du sujet peut ne jamais être ressentie (Roussillon, 2005). En effet, même quand ces derniers peuvent nouer une relation avec l’usager, celui-ci peut, et c’est souvent le cas, ne pas changer suffisamment, assez pour devenir indépendant et le professionnel de se sentir inutile, voire « mauvais ». Ces attaques narcissiques peuvent favoriser des réactions contre-transférentielles négatives et délétères, autant pour l’usager que pour le professionnel et aboutir à une dégradation de la situation. Autrement dit, le professionnel se trouve parfois dans une forme de survie (Roussillon, 2005) face à l’usager avec lequel il est difficile d’établir une alliance et qui le constitue souvent comme « le bourreau actuel » (ibid., p. 237) de sa souffrance.
La souffrance des personnes précarisées
Du côté des personnes démunies, Lazarus et Strohl (1995) ont repéré une interaction entre conditions de vie et mal être, notamment au niveau des efforts demandés pour l’insertion, plus coûteux pour les personnes démunies que pour des personnes bien intégrées socialement. Il pouvait leur être demandé de gérer des budgets familiaux très serrés, de s’adapter aux complexités administratives ou, encore, d’élaborer des projets auxquels se tenir sans que ne soient nécessairement prises en compte leurs capacités actuelles et durables. En somme, de fournir tout un ensemble d’efforts pour parvenir à une place que la société n’était paradoxalement pas toujours en mesure de leur offrir (un logement, un contrat, une formation adaptée). Leur malaise se manifestait alors sous diverses formes pas toujours consécutives d’une pathologie mentale mais plutôt d’un contexte personnel et/ou social ressenti comme insupportable. Il n’empêche que les recours aux soins médicaux étaient nombreux, ce qui a conduit les auteurs à estimer que « l’angoisse des pauvres se traduit par un recours accru au généraliste ou à l’hôpital, quand celle des riches implique une surconsommation d’antidépresseurs et autres tranquillisants ou d’analystes et autres thérapeutes » (ibid., p. 16). Globalement, les formes d’expressions du mal être des personnes étaient variées et renforçaient souvent leur désinsertion et la dégradation de leur environnement le plus proche.
En identifiant la souffrance psychique des personnes en situation de précarité et d’exclusion, ce rapport a fait date. Dans la même mouvance s’est créé, en 1997, l’ORSPERE, un observatoire dont l’objectif était de travailler sur les liens entre exclusion et souffrance psychique pour faire émerger de nouvelles connaissances et de nouvelles pratiques dans une perspective médico-psycho-sociale. Le groupe parle alors des effets cliniques d’une souffrance psychique d’origine sociale (dont la source et la cause ne seraient donc pas à rechercher au niveau médical). Cette souffrance traduit une « douleur d’existence » (Furtos, 2007, p. 24) qui suit « l’humiliation, le mépris social, ou pire l’indifférence » (ibid.). Il est question de souffrance psychique parce qu’elle est subordonnée au travail psychique, lequel pourra plus ou moins l’intégrer ou se retrouver figé, débordé à l’instar de ce que l’on observe dans les cliniques du traumatisme. Il est aussi question de souffrance psychosociale tant par son origine que par l’espace dans lequel elle se manifeste, tous deux sociaux. A mesure, deux cliniques que nous allons à présent décrire ont progressivement été distinguées : (1) la clinique de la précarité et (2) la clinique psychosociale.
Clinique de la précarité et clinique psychosociale
La clinique de la précarité cible, de manière générale, les personnes qui, en situation de précarité, ont affaire avec les effets d’une souffrance psychique d’origine sociale. Elles n’ont pas forcément perdu tous leurs objets sociaux mais craignent douloureusement ces pertes. Car la précarité, ce n’est pas uniquement d’avoir tout perdu, c’est aussi se sentir menacé de perdre ce dont on dispose encore (Furtos, 2007) et, avec, toute forme de confiance.
Concernant la clinique psychosociale, Castel (1994, 1995) avait déjà défini son champ entre une « zone de vulnérabilité » (Castel, 1994, p. 13) où le travail est précaire et le soutien relationnel fragile et une « zone de désaffiliation » (ibid.) dans laquelle le sujet est isolé socialement et n’a plus d’emploi16. Cette dernière zone représentait, pour lui, la fin du parcours de marginalisation sans pour autant qu’il fasse de ces zones des entités irréversibles. Furtos (2000) quant à lui, situe précisément la clinique psychosociale dans les zones où le sujet a objectivement perdu ses objets sociaux. Cela concerne la zone de « l’assistance réussie » » (ibid., p. 8) où le sujet a trouvé des objets sociaux substitutifs et la zone de désaffiliation/exclusion décrite par Castel (1994).
De ces évolutions ont donc émergé des connaissances plus précises de cette souffrance psychosociale. Une représentation claire nous en est donnée dans le schéma sociologique de Castel qui indique les trajets possibles que les sujets peuvent emprunter en situation de précarité. En 2000, Furtos retravaille ceci en termes de processus psychiques, à partir des processus de désillusion, de deuil, d’anticipation, donc par rapport à la temporalité.
A travers ce schéma, nous distinguons quatre formes d’effets psychiques en provenance du contexte social, selon que le sujet se trouve en :
zone de vulnérabilité (le travail est présent mais le lien social est faible, fragilisé), zone d’assistance (le travail est absent mais le lien social est maintenu à travers le réseau d’assistance) ou (3) zone de désaffiliation/exclusion (le travail et le lien social font défaut).
Ces trois zones sont mises en perspective d’une autre : la zone d’intégration. Dans celle-ci, le lien social et le travail sont présents. Les personnes qui s’y trouvent savent qu’elles pourront un jour se confronter à la perte de leurs objets sociaux mais s’imaginent pouvoir s’en sortir. Autrement dit, elles envisagent « un avenir possible » (Furtos, 2000, p. 6). Si elles souffrent, cela ne les empêche pas pour autant de vivre et d’attendre de l’avenir.
A l’inverse, dans le premier cas (zone de vulnérabilité), le sujet se trouve en situation de précarité exacerbée et de vulnérabilité psychique. Les deuils sont problématiques ainsi que la désillusion. La perte est anticipée de façon catastrophique, car le sujet a concrètement peur de perdre et de s’effondrer (Furtos fait ici référence à la peur de l’effondrement Winnicottienne en rapport avec la défaillance de l’environnement primaire). La souffrance qu’il connaît l’empêche de vivre, le stress est important et il y a mélancolisation (sentiment fort de culpabilité sans objet précis). Il a perdu confiance en l’autre et en un avenir autre que catastrophique. Son état de stress peut rappeler la dépression.
Dans le second cas (zone d’assistance), des objets sociaux substitutifs proposés par l’assistance compensent la précarité. Le sujet a perdu certains de ses objets sociaux et craint toujours d’en perdre d’autres. C’est, pour Furtos, le commencement de « la clinique psychosociale » (ibid., p. 7). Le sujet éprouve de la honte, du découragement, est inhibé, etc. mais ces symptômes sont réversibles car le contrat narcissique n’est pas rompu (il est préservé par le réseau d’assistance) et le sujet peut éventuellement être en bonne santé17 tout en étant dans un « processus croissant de vulnérabilité » (ibid.). Selon son histoire personnelle et selon l’environnement dans lequel il vit actuellement, le sujet peut éprouver une souffrance tolérable qui lui permet d’anticiper l’avenir autrement que de manière catastrophique. En effet, le désir reste présent qu’il s’agisse d’envisager des projets pour s’en sortir ou pour vivre bien dans la situation dans laquelle il se trouve.
Dans le troisième cas (zone de désaffiliation/exclusion), le sujet s’exclut de lui-même car sa souffrance est trop intolérable pour pouvoir en souffrir. Il a perdu tout ou presque tout. L’on peut observer un processus de désubjectivation (projection, déni, clivage) et des troubles du comportement. Le narcissisme est négatif et assujetti à la pulsion de mort car lui-même est perdu ou presque étant donné que le sujet ne se ressent plus comme un humain reconnu comme tel, ni inscrit dans la chaîne générationnelle. Dans cette zone, le sujet a souvent de graves affections somatiques et la réversibilité de tous ces effets cliniques devient problématique. Furtos nomme ceux qui la composent « la clinique « de la casse » » (ibid., p. 5). C’est à son terme que l’on pourra observer, d’après l’auteur, le syndrome d’auto-exclusion, dont nous allons décrire les formes dans ce qu’elles ont de plus abouti, ceci n’excluant pas qu’il comporte divers états intermédiaires (Furtos, 2007).
Le syndrome d’auto-exclusion
En 2007, Furtos revient sur la symptomatologie du syndrome d’auto-exclusion pour en souligner les spécificités et borner le processus psychique qui conduit l’individu d’une exclusion subie à une auto-exclusion agie. Ce processus aurait pour but ultime d’enrayer la souffrance psychique du sujet en lui permettant de ne plus penser et de ne plus ressentir. Furtos l’origine dans un découragement à la fois observable et verbalisable par le sujet. Dans un premier temps réversible, ce découragement se transforme progressivement en un désespoir impossible à verbaliser. Il s’agit, chez le sujet, d’une disparition de sa capacité d’agir à la fois sur le présent et sur l’avenir autrement qu’en s’auto-excluant. Autrement dit, il passe d’un positionnement passif (être exclu) à un positionnement actif (s’exclure). L’individu se situe désormais dans une logique de survie, insoumise au principe de réalité et au principe de plaisir, la vie ne représentant plus la même importance pour lui, quand elle en a encore. Le sujet renonce à beaucoup de choses sauf à l’ « idéal normatif » (ibid., p. 27) qu’il ne peut plus réaliser. N’étant plus en capacité de ressentir la décept ion, il ne peut plus souhaiter et ne peut donc plus agir en ce sens. Ainsi et de façon très personnelle, il s’extrait de lui-même tout en restant présent sur la scène sociale. Le désespoir qui l’habite nécessite une désubjectivation progressive reconnaissable à travers les mécanismes employés par le psychisme qui sont : le déni de la réalité qui affecte son corps et sa psyché et le clivage du moi pour se déconnecter à la fois de la pensée et du sensoriel : « le moi ne veut plus rien savoir de lui-même » (ibid., p. 28). Le clivage est, d’après l’auteur, de nature traumatique en ce que le sujet est confronté à une horreur irreprésentable : celle de ne pas être reconnu, par les autres, comme étant digne d’exister parmi les humains. Ainsi, le sujet se déshabite, ce qui constitue l’un des signes les plus directs de la désubjectivation qui seront souvent accompagnés par « des troubles de l’habiter et de l’habitat » (ibid.). Cette déshabitation de soi se traduit par le corps, les affects et la pensée. Le sujet ressent moins ou plus du tout son corps (ce qui implique les douleurs somatiques, organiques et en finalité, les douleurs psychiques (les affects et les émotions). Autrement dit, il s’agit d’un déni de la souffrance. L’autre traduction est un émoussement affectif ou une hypomanie (excitabilité permanente). Ces deux signes de la déshabitation de soi sont généralement réversibles lorsque le sujet commence à s’installer dans le syndrome. Ensuite, il y a une inhibition intellectuelle, l’intellect étant court-circuité par le clivage ; une rupture des liens (souvent inhérente à la perte de confiance généralisée) ; des comportements paradoxaux (ou défenses paradoxales, lesquelles signent un narcissisme en danger) ; une incurie ; de l’errance ; une disparition de la honte positive, celle qui est propice à la vie en société.
L’auto-exclusion, dont l’objectif est d’enrayer la souffrance du sujet qui s’enraye lui-même est autrement décrite par Roussillon (2005, p. 223) à travers ce qu’il nomme les situations extrêmes de la subjectivité », dans ses rapports à l’au-delà du principe de plaisir et à « la loi du plus faible » (2008b, p. 134), ce que nous allons présenter.
De la « souffrance psychique » (Lazarus et Strohl, 1995 ; Furtos, 2007) à la douleur aiguë » (Roussillon, 2005, p. 224) : « les situations extrêmes et la clinique de la survivance psychique » (ibid.)
Selon Emmanuelli et Tartière (2015) ce n’est pas que les grands exclus ne ressentent pas la douleur mais plutôt qu’ils se « résignent à la subir » (ibid., p. 92). D’après eux, dire que ces personnes ont un seuil élevé de perception de la douleur n’est pas vrai. Il serait plus correct de dire qu’ils la perçoivent sans la comprendre ni pouvoir la décoder. En effet, d’après Roussillon (2005) ou Furtos (2005), la souffrance est un affect qui a un sens et, de fait, appartient à la condition humaine. A l’inverse, en situation extrême, lorsque la détresse et l’impuissance prennent des formes « dégénérées » (Roussillon, 2005, p. 223), les sujets sont confrontés à un affect de « douleur aiguë », (ibid., p. 224), parfois corporelle mais surtout psychique qui ne fait pas sens. C’est une « douleur déshumanisante » (ibid.). A celle-ci s’ajoute donc l’effroi, autrement dit, un affect de terreur désorganisant car « sans nom » (Bion, 1967, p. 132). Dans ces situations, la douleur et la terreur se vivent subjectivement comme des « expériences « sans fin », sans limite » (Roussillon, 2005, p. 224), à tel point que le sujet perd la notion du temps et va devoir tenter de survivre à ces affects. Pour l’auteur, l’irreprésentabilité de la douleur est l’un des fondements des situations extrêmes et produit l’impact traumatique. Dépourvue de sens et de « logique » (ibid.), ne pouvant être pensée et intégrée, la douleur désorganise le sujet et produit en lui des affects « de douleur ou de terreur purs » » (ibid.). Il n’y a pas de possibilité d’écart entre la chose et sa représentation : c’est l’effet de la pulsion de mort. Autrement dit, tout en étant menacé de désorganisation, le sujet ne peut ni transformer ou symboliser la situation de déplaisir, ni fuir ou évacuer la situation traumatique. En effet, « la fuite motrice, (…) effective, l’évacuation hors du cham perceptif » (ibid.) n’est pas possible en situation extrême: « on ne s’évade pas des camps ; on ne peut quitter les bras d’une mère toxique ; on n’échappe pas aux tortures » (ibid.). Il n’y a pas de recours possible (le sujet ne peut même pas concevoir d’objet sur lequel s’appuyer) et la révolte est vaine. L’impasse se passe au niveau subjectif et le sujet voit ses repères habituels « du monde de la conflictualité » (ibid.) se désorganiser. Il se retrouve en situation paradoxale où, plus il essaye d’échapper et de fuir, plus l’étau se resserre. C’est ce vécu d’impasse qui, pour l’auteur, donne au sujet l’impression d’une situation insensée. Le sujet ne peut plus choisir, il est régit par des « logiques de contraintes » (ibid., p. 225) et de compulsions de répétition. Le sujet confronté à l’inhumanité perd non seulement sa dignité d’être humain mais il se confronte aussi au sentiment d’être abandonné et extrêmement seul, ce qui le propulse, concrètement, hors de l’humanité. La honte n’est ici pas un terme propice pour décrire ce qu’éprouve le sujet menacé d’annihilation, cela va bien au-delà. Celle-ci perd sa valeur de signal d’alarme pour un sujet qui, tellement confus, ne ressent que la nécessité de disparaître et de mourir.
Souvent, rappelle l’auteur, le sujet meurt des situations extrêmes. Il peut mourir de maladies somatiques ou survivre en mourant psychiquement. Sinon, il s’engage « dans une « agonie psychique » une « lutte » (agon) contre la mort psychique » (ibid., p. 226). S’il ne peut gagner, il peut survivre en mettant en place des « stratégies » (ibid.). Alors il ne vit pas mais il ne meurt pas non plus et s’engage dans des « défenses paradoxales » (ibid.) en se retirant de lui-même et de ses expériences subjectives.
Nous allons dès à présent décrire les formes que peuvent prendre ces logiques de survie.
Impasse du principe de réalité et logique de survie : des normes hors-normes
La norme du fonctionnement psychique est habituellement représentée par le principe de réalité gouvernant la psyché. Dans ce principe, le sujet renonce au plaisir immédiat et, donc, au désir du tout « tout, tout de suite, tout seul, tous ensemble, tout en un » dit Roussillon (2008b, p. 134). Dans ce principe, le choix et le renoncement importent et le sujet l’accepte, supporte la conflictualité inhérente à la nécessité de devoir faire des choix et de renoncer. Dans cette logique qui est une logique de l’espoir, le sujet attend et espère de son renoncement des bénéfices plus grands que ce que lui aurait apporté ce à quoi il a renoncé « qui n’est, au fond, qu’illusion infantile » (ibid.). De fait, renoncer au plaisir se fait au non d’un plaisir espéré plus satisfaisant, plus fiable. En entrant dans le principe de réalité, le sujet ne quitte donc pas la logique du principe de plaisir, il en quitte simplement les formes infantiles. Pour Roussillon, suivre la logique du principe de réalité c’est donc suivre une logique « qui rend fort » (ibid., p. 135), une logique qui permet au sujet de reprendre à son compte, subjectivement l’impossibilité du « « tout » » (ibid.).
Lorsque le sujet souffre d’une façon trop importante, lorsque sa douleur, sa vulnérabilité et sa situation de précarité sociale ne font plus sens, il est confronté au défaut d’intégration du principe de réalité qui s’accompagne bien souvent d’une non-habitation des logiques de l’espoir. Si le sujet renonce, ce n’est pas parce qu’il pense que cela lui fera accéder à quelque chose de meilleur, à un plaisir plus fiable. Pour lui, renoncer c’est perdre pour de bon, sans compensation possible, sans même l’espoir d’une consolation substitutive. C’est l’ « impasse » (ibid.), il n’y a pas d’issue au sein d’une économie de plaisir ou du principe de réalité. La perte de la conflictualité psychique le « fait basculer dans le monde du paradoxe, dans le monde de la double, triple ou multiple contrainte, qui épuise toute possibilité de se sentir satisfait ou satisfaisant » (Roussillon, 2005, p. 225). Il s’installe à mesure dans un positionnement d’absolu désespoir. Dans ce contexte, des logiques psychiques et des normes hors normes vont s’instaurer pour survivre à cette impasse subjective existentielle. La psychopathologie, pour Roussillon (2008b), ne se situe pas dans l’emploi de ces solutions hors normes mais peut se révéler dans le rapport que le sujet entretient avec le fait de devoir mettre en œuvre ces logiques, ce que nous devons comprendre. Souvent en effet, les solutions que le sujet met en œuvre pour survivre ne sont pas adaptées à la logique du renoncement mais, pourtant, elles apparaissent comme étant logiques dans la situation d’impasse dans laquelle il se trouve. « A situations limites ou extrêmes de la subjectivité, mesure extrêmes » (ibid., p. 135).
Si, dans l’économie du principe de réalité le sujet attend de sa confrontation au conflit/à la difficulté/au déplaisir des gains issus des compromis ou des négociations, le sujet en situation d’impasse ne peut affronter ni la difficulté ni la conflictualité au risque qu’elle n’augmente, se resserre sur lui et l’immobilise dans sa situation d’impasse. Pour sortir de ce piège sans issue, il n’a d’autres solutions que l’évitement, la fuite, le retrait ou le décrochage. C’est la logique du « perdant » (ibid., p. 136) car il s’imagine perdant, à tous les coups.
Mais, sans pouvoir fuir ou se distancier de la situation douloureuse et de l’impasse, le sujet peut rester « pris au piège » (ibid.). Dans ces configurations, plusieurs stratégies de survie peuvent apparaître. Le sujet peut « retourner le piège de l’intérieur » et en faire un style de vie » qu’il s’inflige à lui-même pour « échapper à l’emprise de l’autre » (ibid.). La souffrance se transforme en plaisir et le sujet s’inflige à lui-même « ce à quoi il ne peut se soustraire » (ibid., p. 137). Pour l’auteur il s’agit de défenses paradoxales dans lesquelles le sujet s’exclut activement pour éviter de subir l’exclusion dans la passivité, il se coupe activement du lien pour éviter de le perdre passivement. C’est de l’auto-exclusion. Autrement dit, il y a « nécessité de se couper d’une expérience subjective centrale, (…) de soi-même » (Roussillon, 2005, p. 226) et le paradoxe se situe dans le fait de se couper de soi pour survivre, pour « ne pas succomber à ce que l’on sentirait de soi » (ibid.). Le sujet peut aussi « « fuir » au-dedans » (Roussillon, 2008b, p. 137) en se retirant d’une partie de soi prise au piège de l’impasse subjective. Là, « « ne tenir à rien », céder ses appartenances, abolir le lien qui retient aux choses, retirer ses investissements des parties de soi par lesquelles le piège fonctionne » (ibid.) s‘avère être un moyen de survie : « sacrifier la partie pour sauver le tout » (ibid.). C’est ce que Roussillon nomme « le clivage au moi » (ibid.). Enfin, le sujet peut brouiller ses propres limites en se rendant « incernable, inlocalisable » (ibid.). Il se rend hors d’atteinte, « pratique une politique (…) du « soi blanc », blanchi par retrait, par destruction, dans une (…) « politique de la terre brûlée » intrapsychique » (Roussillon, 2005, p. 226). Ainsi, si dans l’économie du principe de réalité, la limite est constitutive de l’identité, dans la logique de survie elle devient limite du piège « elle est facteur d’impasse, d’étouffement » (Roussillon, 2008b, p. 137).
La nécessité d’une approche transversale : l’intérêt d’une approche en santé mentale
C’est face aux difficultés liées à la pratique mais aussi à la théorisation de ces populations que le champ des cliniques de la précarité et des cliniques psychosociales s’est originé et n’a cessé de faire couler de l’encre depuis le milieu des années 90. Ces connaissances nouvelles ont conduit à une recommandation principale : soutenir une approche transversale du sujet, qu’elle soit théorique ou pratique. Il s’agit de décloisonner le sanitaire et le social (Jacques, 2004) ; de favoriser les rencontres entre le champ de la psychiatrie et du social (Lazarus et Strohl, 1995 ; Furtos, 2005 ; 2007) ; d’encourager les psychiatres et les psychologues à se proposer comme soutien, comme tiers auprès des intervenants sociaux (Furtos, 2000) ; d’aller-vers les personnes qui souffrent trop pour demander (Furtos, 2000 ; Martin, 2011 ; Mathieu, 2011) et d’élargir le paradigme de santé mentale pour distinguer santé mentale et troubles mentaux (Furtos, 2005 ; 2007). Ainsi, pour Douville (2016), les cliniciens ne doivent pas s’acharner à tenter de savoir si la personne est folle ou non ou si elle a des troubles cognitifs. Pour l’auteur, ce n’est pas l’heure de se poser ces questions. Ils doivent plutôt reconstruire ce qui fonde, anthropologiquement, chaque vie en allant au plus près des personnes et en tentant de comprendre comment celles-ci traitent leur corps, leur abri, pour reconstituer quelque chose par la présence, la parole, le respect et par le soin.
Concevoir plus largement le paradigme de santé mentale permet de ne pas se centrer uniquement sur la maladie mais d’y intégrer les effets cliniques de la souffrance psychique d’origine sociale. Cela permet de se pencher sur une souffrance dont l’une des caractéristiques paradoxales peut être d’être invisible (Furtos, 2005 ; 2007). Dans tous les cas, cela permet de se pencher sur une souffrance qui touche toutes les personnes en situation de grande précarité (Laumonier, 2001). Il s’agit donc de penser la santé mentale en intégrant à la réflexion et à la pratique les dimensions économiques, anthropologiques, historiques, politiques et sociales, c’est-à-dire les dimensions du contexte avec lequel l’individu a à faire. En outre, il s’agit de ne pas de se restreindre à la définition émise en 1946 par l’OMS pour qui la santé mentale désignait un complet bien-être. En effet, par exemple, pouvoir souffrir sans s’exclure de sa propre souffrance est déjà un signe de relative bonne santé (Furtos, 2005 ; 2007) sans pour autant être un état de bien être. Ainsi, « une santé mentale suffisamment bonne est définie par la capacité de vivre et de souffrir dans un environnement donné et transformable sans destructivité mais non pas sans révolte » (Furtos, 2004, cité par Furtos, 2007, p. 33). Pour l’auteur, cela consiste à souligner à la fois la capacité du sujet à vivre avec les autres tout en restant en lien avec lui-même mais aussi ses capacités à « investir et créer dans cet environnement, y compris des productions atypiques et non normatives » (ibid.). Dans cette perspective l’environnement, même s’il est délétère, doit pouvoir être appréhendé par le sujet comme une donnée transformable sur laquelle il peut agir et à propos de laquelle il peut espérer. Cela implique de pouvoir, selon les cas, considérer sa capacité à dire « non » comme un signe de relative bonne santé mentale.
C’est sur la base de notre nouvelle modernité que ce paradigme a été repensé (Furtos, 2007). Dépasser ainsi l’approche dichotomique, faisant soit de la maladie mentale la responsable de l’exclusion, soit du contexte social le responsable des troubles psychiques, permet de considérer le sujet en tant que sujet dans sa situation et avec la souffrance psychique qui est la sienne. En effet, il s’agit désormais de prendre en compte les effets psychiques du contexte social dans lequel se situe le sujet et les défenses que ce dernier va utiliser afin de parvenir à vivre ou, même, à survivre dans sa situation d’exclusion. Il s’agit donc de repérer comment le psychisme peut faire pour parvenir, ou non, à retrouver un certain équilibre malgré les situations difficiles qu’il peut être amené à traverser. Si Furtos (2007) a précisé que les productions du sujet pouvaient être « atypiques et non normatives » (ibid., p. 33), cela veut dire, d’après nous et dans cette considération élargie de la santé mentale, que ce qui aurait pu être perçu auparavant comme un signe pathologique (comportements, troubles psychiques, mécanismes de défense) pourrait, dès lors, être perçu comme normal et adapté eu égard au contexte de vie du sujet. Par exemple : souffrir d’insomnie dans la rue n’est pas forcément lié à un syndrome dépressif mais plutôt à l’impossibilité de dormir sereinement. De même que ne présenter aucun trouble dans la rue peut désormais être perçu comme un signe de mauvaise santé mentale étant donné qu’il s’agit d’un environnement délétère dans lequel le sujet ne peut pas évoluer de façon totalement harmonieuse. En ce sens, Laumonier (2001) questionne : « est-il « anormal » de souffrir et d’être déprimé quand on est sans travail, sans logis, et que l’on a perdu les relations qui donnaient sens à la vie ? » (ibid., p. 40). Pour Furtos (2005) la souffrance psychique ne se situe pas nécessairement du côté de la pathologie et son absence ne détermine pas obligatoirement une bonne santé mentale : « souffrir n’est pas une maladie mais une situation d’existence à laquelle nul n’échappe ; on sait, à l’inverse, que l’absence de souffrance ressentie peut constituer une infirmité, en coupant l’être humain de sa capacité à être dérangé par le réel, et d’abord par autrui, ce qui empêche autant la subjectivité que l’épreuve de réalité » (ibid., p. 10).
Cette redéfinition du paradigme de santé mentale fait partie du cadre dans lequel nous inscrivons notre recherche. En effet, cette approche nous permet de questionner le sens des comportements adoptés par les sujets de notre recherche autrement que sous le prisme du normal et du pathologique, difficile à employer vis-à-vis de personnes évoluant dans un contexte anormal. Notre questionnement se centrera sur les relations que les sujets entretiennent avec leurs chiens, le sens que prennent ces relations, ce qui les sous-tend, ce qu’elles impliquent ainsi que les différentes modalités de transactions que nous pourrons repérer entre eux. Définir ce cadre a été primordial en ce qu’il nous a permis de dépasser la vision commune et, nous semble-t-il, dominante concernant le fait qu’avoir un chien lorsque l’on vit dans la rue n’est pas adapté, comme nous le détaillerons plus loin. Disons simplement dès lors que si cela n’apparaît pas adapté c’est parce qu’outre la peur que ce phénomène (ou simplement le sujet exclu) suscite, beaucoup pensent que l’animal empêche la possibilité de réinsertion du sujet et considèrent que ce dernier « devrait déjà s’occuper de lui avant de s’occuper d’un chien ». De la même manière, ce cadre permet de dépasser le clivage enraciné entre le « bon » (Damon, 2003a, p. 26) et le « mauvais » (ibid.) pauvre qui, d’après l’auteur, s’exprimerait aujourd’hui différemment, par l’intermédiaire de nouveaux termes, plus adaptés aux missions du champ social, tels que les « insérables » et les « non insérables » (ibid., p. 29). Ceci nous amène à introduire ici un questionnement proposé par Chobeaux en 2011 : Accompagner, est-ce reconduire dans les normes, ou aider à tracer son chemin ? » (ibid., p. 121). En effet, « un retour critique sur la trilogie habiter-travailler-faire famille au filtre des normes inconscientes ou sous-jacentes qui la structurent est nécessaire » (ibid.).
Repérer les défenses que les personnes mettent en place pour faire face à l’environnement dans lequel elles se trouvent ne peut se faire sans questionner leur éventuelle adaptation ou suradaptation à ce contexte, ce que nous allons faire dès à présent.
L’adaptation ou la suradaptation du sujet à son contexte de vie
Comme Douville (2012), nous considérons l’exclusion comme un processus qui suppose « un individu qui n’est pas ou n’est plus intégré dans un réseau de solidarité familiale, amicale, de quartier » (ibid., p. 9). Les personnes en situation de précarité peuvent être intégrées dans des réseaux solidaires faisant que nous ne pouvons pas les concevoir comme exclues. Celles-ci ne sont pas complètement absentes du lien social. Quant aux personnes exclues, il serait réducteur de les concevoir comme figées dans une sorte de non lieu. D’après l’auteur, elles ont par exemple des codes servant à gérer leurs espaces et leurs territoires, elles utilisent des modes singuliers d’habitation du corps, des mots et de l’espace, elles ne sont pas « sans rien » (ibid., p. 10). Aussi, depuis quelques années, un pan de la recherche s’intéresse aux ressources que le sujet peut mobiliser dans sa situation d’exclusion, ceci dans la perspective élargie du paradigme de santé mentale. En effet, dans sa situation d’exclusion, le sujet va être contraint de mettre en place diverses stratégies de défense pour faire face, évoluer, exister ou survivre dans son environnement (Chevalier et al., 2017). C’est ce que nous avons finalement appréhendé, en partie, en abordant les effets cliniques de la souffrance psychique d’origine sociale avec, à l’extrême, le syndrome d’auto-exclusion (Furtos, 2007) et les stratégies de survie (Roussillon, 2005 : 2008b).
Dans cette perspective, Chobeaux (1996) défend la conception d’un potentiel de socialisation à la marge de la société. La rue n’est pas, d’après lui, un lieu vide, mais un espace où des liens sociaux parviennent à se nouer, aussi précaires soient-ils. Elle est également conçue comme un lieu où les processus d’identification sont à l’œuvre et où des questions de filiation et d’appartenance se jouent (Chevalier et al., 2017) mais cela ne fait pas consensus21 (Emmanuelli et Tartière, 2014). Dans la rue, des individus peuvent avoir des pratiques communes (jonglage, manche), posséder des codes, des symboles, des styles vestimentaires similaires pouvant les rassembler et fédérer une sorte de communauté précaire malgré la méfiance ambiante. Ainsi, comme nous l’avons développé ailleurs (Chevaler et al., 2017), ils adoptent des comportements qui témoignent des stratégies de défense à l’œuvre dans leur situation d’exclusion. C’est-à-dire que certains se rassemblent entre eux tout en se différenciant des autres (les « teuffeurs » contre les « clochards », par exemple) pour faire groupe et être, à minima, narcissiquement soutenus. Des communautés apparaissent même si l’on perçoit leur fragilité (« c’est la jungle, même tes potes c’est pas tes potes »). En somme, d’après Douville (2012), les « processus de désocialisation et de désaffiliation » appellent « d’autres logiques de réaffiliation et de resocialisation » (ibid., p. 10).
Le chien : une interface permettant de créer un contact avec l’autre, avec soi-même et de communiquer quelque chose de soi à l’autre
Dans le discours des professionnels, nous avons repéré trois thématiques principales en lien à cette fonction d’ « interface » (Gimenez, 2002, p. 81). Il s’agit du chien comme permettant : De créer un contact avec l’autre : « lorsqu’on fait les maraudes (…), souvent c’est les chiens les premiers à te dire bonjour. (…) C’est juste il vient et il repart mais, n’empêche que… ». Il permet d’« accéder à la personne. Mais ça marche pas tout de suite ». Par exemple, pour A., « si tu livres ton chien, c’est que tu fais confiance ! » Ici, que le sujet démontre ou non réellement sa confiance par le fait de livrer son chien n’est pas ce qui importe, ce qui importe c’est qu’A. pense que le sujet lui parle par ce geste. Le chien joue aussi un rôle au sein du groupe, même lorsqu’il est, au départ, utilisé individuellement : il fait office d’ « attraction visuelle », les usagers « sont attentifs à ce qui se passe par rapport aux chiens » et tous participent « à essayer de socialiser » un chien agressif. Ici, il apparaît comme point de rassemblement. (Le lecteur intéressé trouvera en annexe 2 une vignette clinique illustrant de manière intéressante cette fonction).
Au CHRS, l’une des éducatrices explique avoir pu, dans une autre structure, entrer en contact avec une personne souffrant de schizophrénie après avoir su se saisir de la présence de ses chiens. S’intéresser à eux et à leurs difficultés à permis au maître d’aborder ses propres difficultés et, à partir de là, de « faire un vrai travail ». De son côté, l’un des éducateurs associe durant l’entretien sur le souvenir d’aquariums présents à une époque dans la structure et raconte : « le soir, on pouvait être sept-huit devant et les gars les regardaient, ça ouvrait d’autres champs de discussions, y’a un côté vachement sympa à tout ça et ça on le retrouve avec les chiens ». Un autre explique avoir été invité la veille par un résident qui souhaitait lui montrer le chat qu’il avait recueilli. Il explique que « c’était rigolo parce qu’il était à quatre pattes, accroupis devant le lit à lui faire des « gouzou gouzou » » et cela lui a permis de voir une nouvelle facette de cet homme habituellement dans la confrontation, « là avec l’animal il était tout attendri ». D’après lui, « l’animal amène quelque chose (…) en tout cas hier soir j’ai inauguré quelque chose de différent avec ce monsieur dans la relation ». L’un des éducateurs dira aussi que « les personnes qui sont sensibles aux animaux se connaissent et se passent des relais. Il y a une communication qui se crée autour des animaux (…) ils en parlent entre eux et il y a une interconnaissance autour de ce sujet là où, les personnes se retrouvent ».
De créer un contact avec soi : Durant l’entretien, les professionnels du CAARUD et du CHRS ont tous associé sur leurs propres histoires avec des chiens ou avec des usagers avec des chiens. Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ ĀĀ ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ De communiquer quelque chose de soi à l’autre : Il est « une manière de se représenter, (…) d’exister aux yeux des autres », parfois le seul « lien particulier » qu’ont les usagers. Il est « une autre manière d’avoir un lien avec [les professionnels] ». Il leur permet de parler « de manière sous-jacente » et aux professionnels d’ « entre[r] dans l’intime des gens » sans être « dans l’agression, le côté intrusif ». Selon eux, « l’état du chien reflète aussi l’état du maître » et ne pas les accepter les ferait « passe[r] à côté des choses ». Il permet d’assigner une place au maître, il est « un personnage » au travers lequel on pense à lui. Cependant, ils expliquent qu’il ne s’agit pas simplement de l’usager mais aussi d’eux-mêmes: ce que tu renvoies sur le chien, c’est aussi ce que tu renvoies sur les autres ». (La vignette clinique placée en annexe 2, illustre également cette fonction.)
Le chien : un « lieu » contenant où déposer ce qui pourrait entraver la rencontre
Dans le discours des professionnels, nous avons repéré trois thématiques principales en lien à cette fonction de lieu de « mise en dépôt » (Gimenez, 2002, p. 81). Il s’agit du chien comme permettant :
De déposer en lui sa « casquette » de professionnel, son besoin de trouver sa place, pour faciliter la rencontre : « Passer par le chien ça enlève un peu cette casquette là, et ça rend les choses un peu plus faciles » car « si tu y vas comme ça, de but en blanc, la personne peut avoir un peu de rejet » et « parler du chien ça évite de… (…) voilà, parler de soi ce n’est pas facile. » Parler de lui aide à « amener d’autres questions qui auraient pu paraître intrusives en intégrant directement la personne » et « ça contribue aussi à la confiance qu’ils peuvent avoir en nous, puisqu’on est capables de se mettre à quatre pattes et de faire les neuneus avec un chien. On est des gens normaux quoi. »49
De projeter à l’intérieur de lui ses angoisses qui rendent la rencontre difficile : accueillir les chiens et leur offrir « un vrai accueil » est important « vis-à-vis du maître (…) et même des autres ». Ce n’est pas « on les regarde pas ! » « Du coup tu fais une caresse au chien, tu dis « bonjour » (…) et puis parler au chien permet de t’identifier toi, voilà, il sait que t’es là (…) ils t’identifient et ça les sécurisent (…) ils ne sont pas stressés les chiens (…) parce qu’ils sont avec des inconnus », « le chien, lui, y’a pas photo, il te reconnaît ». Il permet à l’équipe une approche moins frontale avec l’usager50 et, pour reprendre leurs mots, de trouver une place face à lui, d’être « identifi[és] » en tant que personne. L’importance qu’ils évoquent du regard accordé au chien reflète, d’un point de vue latent, l’importance du regard porté sur eux-mêmes et de celui qu’eux-mêmes portent sur l’autre, ce que semble venir contenir l’animal. De fait, « sécurise[r] » le chien leur permet, selon nous, de se sécuriser eux-mêmes par identification projective.
De déposer en lui un impensable qu’il vient contenir : durant une semaine, les professionnels du CAARUD ont interdit l’entrée aux chiens « pour rappeler le cadre ». Ils ont ressenti à ce moment « un gros vide », comme s’ils évoquaient quelque chose d’un impensable (car, comment penser le vide ?) que le chien contenait habituellement (certainement les angoisses que nous venons de souligner). A. dira que s’ils avaient interdit plus longtemps l’accès aux chiens, ils auraient « perdu des choses par rapport aux usagers, ça n’aurait pas été…». Cette impossibilité d’énonciation montre que le chien vient contenir quelque chose dans l’association. Il leur permet de rappeler le cadre, il « amène de la réalité ». Le vide énoncé représente l’absence de cadre qui les confronte aux effets directs de la relation face auxquels il leur est difficile de trouver une place. Ce ressenti montre aussi à quel point ces professionnels ont investi l’animal dans leurs fonctions car s’il n’est pas là, il manque.
Le rapport de stage ou le pfe est un document d’analyse, de synthèse et d’évaluation de votre apprentissage, c’est pour cela chatpfe.com propose le téléchargement des modèles complet de projet de fin d’étude, rapport de stage, mémoire, pfe, thèse, pour connaître la méthodologie à avoir et savoir comment construire les parties d’un projet de fin d’étude.
|
Table des matières
Introduction
Première partie : EXCLUSION ET RELATION À L’ANIMAL
Chapitre 1 : « Sujet en situation de précarité », « sujet exclu », de qui parle-t-on ?
1.1 Rappel historique
1.1.1 Jusqu’au milieu du XXème siècle : le « vagabond », une cible mal définie pour la répression étatique et la psychiatrie. Le déterminisme est individuel plutôt que social
1.1.2 A partir des années 80 : des nouveaux pauvres aux exclus. Le problème devient progressivement social et l’objectif est à la réinsertion
1.2 Transformations sociales, cliniques et évolution des connaissances scientifiques : exclusion, précarité psychique et santé mentale
1.2.1 L’exclusion
1.2.1.1 Catégoriser par le manque
1.2.1.2 Une multitude de caractéristiques sociodémographiques : le rapport de l’INSEE (2014)
1.2.1.3 De la catégorie au processus
1.2.2 De la précarité sociale à la précarité psychique
1.2.2.1 La précarité selon Wresinski (1987) : perte des objets sociaux, situation de dépendance et sentiment d’insécurité présent et face à l’avenir
1.2.2.2 La précarité psychique selon Furtos : situation de dépendance, défaillance du contexte soci et triple perte de confiance
1.2.2.3 Les objets sociaux
1.2.2.4 Marginalisation de la société et précarité : l’absence des supports d’étayages nécessaires au sujet dépendant
1.2.2.5 Une atteinte narcissique, identitaire et subjective
1.2.3 Les effets cliniques de la souffrance psychique d’origine sociale : d’une souffrance structurante à une souffrance impossible à souffrir
1.2.3.1 La souffrance psychique d’origine sociale : le rapport Lazarus-Strohl (1995) et la création d l’ORSPERE en 1997
1.2.3.1.1 Souffrance des intervenants et contre-transfert
1.2.3.1.2 La souffrance des personnes précarisées
1.2.3.2 Clinique de la précarité et clinique psychosociale
1.2.3.3 Le syndrome d’auto-exclusion
1.2.3.4 De la « souffrance psychique » (Lazarus et Strohl, 1995 ; Furtos, 2007) à la « douleur aiguë (Roussillon, 2005, p. 224) : « les situations extrêmes et la clinique de la survivance psychique » (ibid.)
1.2.3.5 Impasse du principe de réalité et logique de survie : des normes hors-normes
1.2.3.6 Les défenses paradoxales
1.2.3.7 Quelques mots (maux) sur l’intime
1.2.3.8 Les « retours du sujet disparu » (Furtos, 2007)
1.2.4 Psychiatrisation de l’exclusion ou sociologisation de la maladie mentale ? Vers une conception effets cliniques de la souffrance psychique d’origine sociale en termes de santé mentale.
1.2.4.1 L’exclu : un malade mental ou une victime passive de la société ?
1.2.4.2 La non-demande et la question du soin
1.2.4.3 De la difficulté d’établir des diagnostics différentiels
1.2.4.4 La nécessité d’une approche transversale : l’intérêt d’une approche en santé mentale
1.2.5 L’adaptation ou la suradaptation du sujet à son contexte de vie
1.2.6 Les besoins du Moi : esquisse d’une théorisation indispensable pour penser les « cliniques de la souffrance narcissique-identitaire » (Roussillon, 2008a, p. 52)
1.2.6.1 A besoins inassouvis, nul désir
1.2.6.2 Les besoins du moi proprement dits
1.2.6.3 Les « cliniques de la souffrance narcissique-identitaire » (Roussillon, 2008a, p. 52)
1.2.6.3.1 De la détresse au vécu agonistique : l’absence d’objet adéquat/ De la détresse à la potentialité d’être étayé : un recours possible à l’autre
1.2.6.3.2 Souffrance narcissique-identitaire et dynamique interne de besoin d’étayage
1.2.6.3.2.1 Pour introduire
1.2.6.3.2.2 « Appui ou étayage » (Ferrant, 2007, p. 471)
1.2.6.4 Des substituts d’étayage dans la rue ? Un point sur les objets sociaux substitutifs : aliénati ou potentialité transitionnelle ?
1.2.7 En guise de conclusion : esquisse des personnes qui composent notre corpus de recherche
Chapitre 2 : Une clinique de l’ombre : le sujet SDF et son chien
2.1 Apparition du sujet SDF avec chien sur les scènes sociales et juridiques
2.2 Cliniques psychosociales et relation au chien : constat d’un manque de données face un phénomène bien visible
2.2.1 En guise d’introduction : un objet de recherche laissé pour compte dans le champ de la psychologie, un phénomène anecdotique pour la littérature scientifique
2.2.2 Ses rares abords : fonctions psychiques et processus psychiques à l’œuvre
2.2.3 Exploration sociologique et perspectives intrapsychiques au regard du contexte social
2.2.3.1 Les travaux du sociologue Christophe Blanchard
2.2.3.1.1 Le chien : fonction identitaire, fonction de protection, fonction de lien
2.2.3.1.2 Le chien : frein à l’insertion et support pour la stigmatisation
2.2.3.2 En guise de conclusion : garder son chien pour assurer sa survie dans un contexte de prise charge sociale violente et lacunaire
2.3 Le terrain : entre sensibilité clinique, savoirs profanes et préjugés. Représentations intervenants du champ social et du tout-venant
2.3.1 Représentations du sujet SDF accompagné de son chien: bref aperçu du point de vue du toutvenant, des bénévoles du champ social et de la presse
2.3.2 Le chien perçu comme un « outil » de travail par les professionnels des structures dans lesquell nous avons récolté nos données
2.3.2.1 Un retour indispensable à la théorie : concevoir le chien comme un objet de
relation (Gimenez, 2002)?
2.3.2.1.1 Pour introduire le concept d’objet de relation : la problématique de la rencontre entre
professionnels et propriétaires de chiens à la rue
2.3.2.1.2 Le concept d’objet de relation
2.3.2.1.3 Le chien : une interface permettant de créer un contact avec l’autre, avec soi-même et
communiquer quelque chose de soi à l’autre
2.3.2.1.4 Le chien : un « lieu » contenant où déposer ce qui pourrait entraver la rencontre
2.3.2.1.5 Le chien : un support pour la transformation
2.3.2.1.6 Synthèse
2.3.3 L’animal facteur d’exclusion : contraintes sanitaires et financières ? Incompréhension ? Peur ? Déni social du phénomène ?
2.3.3.1 « Des histoires d’hygiène », de dépenses, de « mauvaise volonté » et de violence… La relation SDF-chien : une équation à deux inconnues
2.3.3.2 L’entretien proposé aux professionnels : un temps d’élaboration nous ayant permis de leve certaines résistances et de cerner des mouvements contre-transférentiels
2.4 Pour conclure
Chapitre 3: La relation Homme-Animal dans la littérature scientifique 1
3.1 La relation à l’animal du point de vue de la santé
3.1.1 Introduction : des recherches qui ont évolué sur trois périodes
3.1.2 Les bienfaits de l’animal sur l’homme en général, du point de vue de la santé, dans la littérature scientifique
3.1.2.1 Des effets directs
3.1.2.1.1 Les effets physiologiques
3.1.2.1.2 Les effets psychologiques
3.1.2.2 Des effets indirects : les effets sociaux. Le chien : un facteur adaptatif, un médiateur de lie social ?
3.1.3 Résumé des recherches concernant la relation à l’animal du point de vue de la santé
3.1.4 Les limites de la recherche
3.1.5 Perspectives actuelles : apports théoriques et conceptuels
3.1.6 En résumé : vers une tentative de compréhension des processus psychiques à l’œuvre dans la relation Homme-Animal
3.2 Regard psychanalytique sur l’anthropologie de la relation Homme-Animal
3.2.1 Détour par l’art préhistorique, la religion, les mythes et les contes pour appréhender cette relation sous l’angle de la symbolisation, de l’aire transitionnelle et des mécanismes identificatoires, projectifs et introjectifs
3.2.2 Une relation évolutive, fonction de l’évolution des sociétés et inversement
3.2.3 En résumé
3.3 Pour conclure : le paradoxe de la littérature
Deuxième Partie : CADRE DE RECHERCHE 1
Chapitre 4 : Cadre théorique, problématique et hypothèses 1
4.1 Résumé de nos questionnements théoriques
4.2 Problématisation de l’objet de recherche
4.2.1 Première partie. La constitution de l’objet chien et son influence sur l’activité psychique du suje une conception de la relation à l’animal en termes d’interrelation
4.2.1.1 Explications
4.2.1.2 Cadre théorique : la relation à l’animal dans ses rapports à la pulsionnalité, au narcissisme à la relation d’objet
4.2.1.2.1 Vie pulsionnelle, narcissisme, objet et relation d’objet dans la métapsychologie freudienne.
4.2.1.2.1.1 Considérations générales à propos de la pulsion et de l’objet de la pulsion
4.2.1.2.1.2 De l’introduction du narcissisme au choix d’objet
4.2.1.2.2 Le rôle de l’objet dans la structuration du self chez Winnicott. Emergence du sentimen sécurité et de continuité, intégration du moi et édification des premières relations d’objet.
4.2.1.2.2.1 Le rôle des soins maternels et du miroir de la mère
4.2.1.2.2.2 L’espace potentiel
4.2.1.2.3 Synthèse à propos des besoins du moi (Roussillon, 2008a) : rôle fondamental de l’obje de l’environnement
4.2.1.2.4 Le processus d’identification projective dans la pensée de Bion
4.2.1.3 Résumé de la problématique et des hypothèses
4.2.2 Deuxième partie. De la relation à l’animal dans l’environnement : entre processus de médiation double exclusion
4.2.2.1 Explications
4.2.2.2 Cadre théorique : médium malléable, objet de relation et pulsion de mort
4.2.2.2.1 Du médium malléable à l’objet de relation
4.2.2.2.2 Relation à l’animal et double exclusion : l’œuvre de Thanatos ?
4.2.2.3 Résumé de la problématique et des hypothèses
Chapitre 5 : Méthodologie de recherche
5.1 Terrain de recherche
5.1.1 L’institution comme cadre… de confidentialité
5.1.2 L’institution comme lieu… de la parole humaine (Douville, 2010)
5.1.3 L’institution comme espace… pour créer des liens transversaux
5.1.4 L’institution comme lieu…commun et partageable pour parer les angoisses du chercheur
5.1.5 Un CAARUD comme… premier lieu de recueil
5.1.6 L’expérience de la rue
5.1.6.1 Le Samu Social : rencontres nocturnes et espoir de continuité
5.1.6.2 L’errance du chercheur
5.1.6.3 De la méthode comme outil privilégié du chercheur au risque de confondre rigueur et rigidité
5.1.7 Retour aux CAARUD et découverte d’un CHRS accueillant les maîtres et leur(s) chien(s)
5.2 Population de l’étude et prise de contact
5.2.1 Présentations succinctes
5.2.2 Quelques remarques
5.2.2.1 Un travail d’endurance
5.2.2.2 Des rencontres qui font trace
5.3 Considérations déontologiques
5.4 Procédure de recueil du matériel clinique : l’entretien de recherche semi-directif
5.5 Modalités d’analyse des données
5.5.1 L’analyse clinique des cas
5.5.2 L’analyse de contenu
Troisième partie : RÉSULTATS DE RECHERCHE : PRÉSENTATION, ANALYSE E
DISCUSSION
Chapitre 6 : Analyses cliniques des cas
6.1 Murielle
6.2 Edouard
6.3 Fred
6.4 Samuel
6.5 Claire
6.6 Jeanne
6.7 Laurent
6.8 Louis
6.9 Paul
Chapitre 7 : Analyses de contenu
7.1 La constitution de l’objet chien et son influence sur l’activité psychique du sujet : u conception de la relation à l’animal en termes d’interrelation
7.1.1 L’animal comme miroir contenant et réfléchissant les états internes du sujet, la relation à l’ani comme espace de communication : un support efficace à l’étayage du besoin de sécurité interne
7.1.1.1 Vignettes cliniques
7.1.1.1.1 Murielle et sa chienne, Subu
7.1.1.1.2 Edouard et ses chiens, Cassé et Mademoiselle
7.1.1.1.3 Fred et sa meute
7.1.1.1.4 Samuel et son chien
7.1.1.1.5 Claire et Bala
7.1.1.1.6 Jeanne et Mataï
7.1.1.1.7 Laurent et son « pépère »
7.1.1.1.8 Louis et Texas
7.1.1.1.9 Paul et Cristal
7.1.1.2 Commentaires
7.1.2 L’animal comme objet suffisamment bon, support d’étayage aux besoins du moi/ la relation à l’animal comme voie d’accès à l’aire transitionnelle
7.1.2.1 Vignettes cliniques
7.1.2.1.1 Murielle et sa chienne, Subu
7.1.2.1.2 Edouard et ses chiens, Cassé et Mademoiselle
7.1.2.1.3 Fred et sa meute
7.1.2.1.4 Samuel et son chien
7.1.2.1.5 Claire et Bala
7.1.2.1.6 Jeanne et Mataï
7.1.2.1.7 Laurent et son « pépère »
7.1.2.1.8 Louis et Texas
7.1.2.1.9 Paul et Cristal
7.1.2.2 Commentaires
7.1.3 D’une intimité partagée à l’édification de l’intime: l’œuvre du processus d’identification proje normale et de l’identification introjective
7.1.3.1 Vignettes cliniques
7.1.3.1.1 Murielle et sa chienne, Subu
7.1.3.1.2 Edouard et ses chiens, Cassé et Mademoiselle
7.1.3.1.3 Fred et sa meute
7.1.3.1.4 Samuel et son chien
7.1.3.1.5 Claire et Bala
7.1.3.1.6 Jeanne et Mataï
7.1.3.1.7 Laurent et son « pépère »
7.1.3.1.8 Louis et Texas
7.1.3.1.9 Paul et Cristal
7.1.3.2 Commentaires
7.1.3.3 Retour sur la vignette clinique d’Edouard
7.1.3.4 Retour aux commentaires
7.2 De la relation à l’animal dans l’environnement : entre processus de médiation et double exclusion
7.2.1 Relation à l’animal et processus de médiation : l’animal objet de relation
7.2.1.1 Vignettes cliniques
7.2.1.1.1 Murielle et sa chienne, Subu
7.2.1.1.2 Edouard et ses chiens, Cassé et Mademoiselle
7.2.1.1.3 Fred et sa meute
7.2.1.1.4 Samuel et son chien
7.2.1.1.5 Claire et Bala
7.2.1.1.6 Jeanne et Mataï
7.2.1.1.7 Laurent et son « pépère »
7.2.1.1.8 Louis et Texas
7.2.1.1.9 Paul et Cristal
7.2.1.2 Commentaires
7.2.2 Vivre avec un chien dans la rue : entre idéalisation, résistances, suradaptation paradoxale (Douville, 2011a) et étayage du sujet. L’environnement comme mère insuffisamment bonne, l’animal comme compagnon de relation paradoxal ?
7.2.2.1 Vignettes cliniques
7.2.2.1.1 Murielle et sa chienne, Subu
7.2.2.1.2 Edouard et ses chiens, Cassé et Mademoiselle
7.2.2.1.3 Fred et sa meute
7.2.2.1.4 Samuel et son chien
7.2.2.1.5 Claire et Bala
7.2.2.1.6 Jeanne et Mataï
7.2.2.1.7 Laurent et son « pépère »
7.2.2.1.8 Louis et Texas
7.2.2.1.9 Paul et Cristal
7.2.2.2 Commentaires
Chapitre 8 : Discussion : penser la relation à l’animal dans un contexte de précarité exacerbée
8.1 Introduction
8.1.1 Rappel des objectifs et du plan de recherche
8.1.2 Synthèse des résultats et validation de nos hypothèses
8.2 Positionnement éthique et démarche de recherche : l’approche en santé mentale explorer les effets de la souffrance psychique « identitaire » (Furtos, 2008b, p. 14) d’orig sociale et se frayer un chemin vers le sujet
8.3 L’espace de la relation à l’animal vue comme une invitation à la régression
8.4 Revenir dans et par la fusion/ dans et par la régression
8.5 Échec partiel de la fonction du tiers séparateur sociétal, non-sens et logiques paradoxales en provenance de la société
8.5.1 Un point sur la notion de paradoxe : d’une relation valorisée à une relation exclue
8.5.2 Retour à notre propos
8.6 L’objet de relation : créateur d’aire transitionnelle et soutien à la « préoccupatio paternelle » (Bouche-Florin et al., 2017) sociétale
8.6.1 Une ouverture vers le lien à l’autre
8.6.2 Une ouverture vers plus de bienveillance sociale
8.7 Accepter la relation de dépendance à l’animal : un moyen pour négocier sa souff psychique, son identité et un meilleur pronostic en santé mentale
8.8 La relation au chien : une expérience subjective et identitaire spécifique, potentiellement traumatolytique
8.9 Propositions conceptuelles
8.9.1 Définition du compagnon de relation paradoxal
8.9.2 Transition
8.9.3 Définition de l’objet social de la rue
Conclusion : Quelles perspectives ?
1. Limites de la recherche
2. Étendre nos recherches à la relation à l’animal dans la psychose
3. Comment intervenir auprès du sujet exclu et de son chien ?
3.1 Manque de moyens et de supports pour penser
3.2 Développer les pratiques d’aller-vers et le travail en réseau
3.3 L’idée d’une organisation collective co-étayée et co-étayante
3.4 Apports des pratiques psychanalytiques groupales
3.5 Développer les pratiques de la patience
3.6 Apprendre à identifier les ressources du sujet et à s’appuyer sur elles
3.7 L’implication d’un tiers pensant « témoin » (Roussillon, 2005, p. 235) dans la rel entre le maître et son (ses) chien(s)
3.8 Favoriser le développement d’une enveloppe contenante collective
3.9 Difficultés actuelles et perspectives
Références
Télécharger le rapport complet