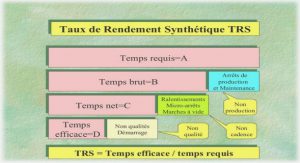Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Revue de la littérature
Etre sage-femme
Avant tout, il est nécessaire de faire le point sur le métier de sage-femme. Nous allons donc définir le métier de sage-femme, expliquer les études qui mènent à cette profession, puis nous relaterons ses compétences et ses modes d’exercice qui lui sont ouverts. Nous démontrerons le fait qu’il s’agisse d’un métier en constante évolution.
Définition de la sage-femme
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, la sage-femme est définie comme « Une personne qui a suivi un programme de formation reconnu dans son pays, a réussi avec succès les études afférentes et a acquis les qualifications nécessaires pour être reconnue ou licenciée en tant que sage-femme. Elle doit être en mesure de donner la supervision, les soins et les conseils à la femme enceinte, en travail et en période post-partum, d’aider lors d’accouchement sous sa responsabilité et prodiguer des soins aux nouveau-nés.
Ses soins incluent des mesures préventives, le dépistage des conditions anormales chez la mère et l’enfant, le recours à l’assistance médicale en cas de besoin et l’exécution de certaines mesures d’urgence en l’absence d’un médecin. Elle joue un rôle important en éducation sanitaire, non seulement pour les patientes, mais pour la famille et la préparation au rôle de parents et doit s’étendre dans certaines sphères de la gynécologie, de la planification familiale et des soins à donner à l’enfant. La sage-femme peut pratiquer en milieu hospitalier, en clinique, à domicile ou en tout autre endroit où sa présence est requise. » Pour pouvoir exercer son métier, la sage-femme doit être inscrite au tableau de l’Ordre des sages-femmes. Celui-ci a été instauré par l’ordonnance du 24 septembre 1945 du Général de Gaulle, concomitamment avec l’Ordre des médecins et l’Ordre des chirurgiens-dentistes. Le premier code de déontologie sera ensuite crée le 30 septembre 1949.
Devenir sage-femme en France
Les évolutions médicales, notamment en l’obstétrique et par conséquent l’élargissement des compétences des sages-femmes, ont permis une augmentation du temps de formation chez celles-ci. Dans les années 1970, le temps de formation était de 3 ans. Il est passé à 4 ans en 1984. Aujourd’hui, 5 années après l’obtention du baccalauréat sont nécessaires afin d’obtenir le Diplôme d’Etat de sage-femme. Depuis 2001, il est indispensable de passer le concours d’entrée à l’école, en validant la première année commune aux études de santé. Le Ministère chargé de la santé et le Ministère de l’enseignement supérieur fixe chaque année le nombre d’admis en école de sage-femme. Il s’agit du « numérus clausus ». À la suite de ce concours, la scolarité continue en alternant cours théoriques et stages cliniques. Les trois premières années accédant à une licence sont généralistes. Les deux dernières années accédant au master sont concentrées sur la grossesse et ses diverses pathologies.
Prochainement, l’accès à l’école de sage-femme changera puisque la ministre de la Santé a annoncé, lundi 17 septembre 2018, la fin du numerus clausus en 2020. Le numerus clausus sera remplacé par un premier cycle commun d’une durée de trois ans, visant à orienter progressivement les étudiants dans les différentes filières de santé en fonction de leur choix et de leurs résultats scolaires. (8) (35)
Compétences de la sage-femme
Une sage-femme exerce une profession médicale à compétences définies. Son champ d’intervention est régi par le Code de Santé Publique. Les compétences de celles-ci sont diverses. Une sage-femme peut réaliser un suivi gynécologique de prévention ainsi que la prescription de contraception chez une femme en bonne santé. Elle peut également réaliser les interruptions volontaires de grossesses de façon médicamenteuse. Elle peut participer aux activités de procréation médicalement assistée. Elle a également un rôle de prévention, notamment pour celle des addictions. Elle réalise la surveillance médicale des grossesses physiologiques, la préparation à la parentalité et à la naissance. Elle réalise les accouchements, puis assure la surveillance de la mère et du nouveau-né dans le post-partum. De ce fait, elle peut donc aussi mener le suivi de l’allaitement. Elle peut également réaliser la consultation post-natale, la vaccination de la mère, du nouveau-né et de l’entourage mais aussi la rééducation périnéale. L’Ordre des sages-femmes a récemment crée un dépliant, expliquant les compétences actuelles des sages-femmes. [Annexe I]
Les sages-femmes ont donc un rôle majeur en matière de prévention et de promotion de la santé. La sage-femme a également la possibilité de passer des diplômes universitaires et interuniversitaires afin d’élargir son champ de compétence, comme par exemple : le diplôme universitaire d’échographie, d’acupuncture, de tabacologie, d’hypnose médicale, d’ostéopathie.
Sage-femme : un métier en mutation
En 1946, le Conseil de l’Ordre est créé pour les sages-femmes et pour les autres professions médicales. Il vise notamment à réglementer l’exercice libéral. Le Conseil de l’Ordre devait être présidé par un médecin. Il a fallu attendre 1995 pour que la présidence du Conseil de l’Ordre ne soit plus assurée par un médecin mais obligatoirement par une sage-femme.
C’est dans les années 2000 que nous redécouvrons le métier de sage-femme. Les sages-femmes exercent désormais de plus en plus hors du milieu hospitalier, en créant des cabinets libéraux. C’est le retour à l’autonomie
Il est à noter que ce mode d’exercice n’existait pratiquement plus dans les années 1980. (9) L’exercice de la sage-femme est en constante mutation de façon qualitative et quantitative. Les activités se diversifient et les responsabilités sont plus affirmées.
Aujourd’hui, selon le rapport d’activité de 2016 du Conseil National de l’Ordre des sages-femmes : 51.3% des sages-femmes font parties de la fonction publique hospitalière, 27.8% exercent en cabinet libéral, 14.9% exercent en secteur privé et 4.8% travaillent dans des services de protection maternelle et infantile. 1.2% ne sont pas recensées parmi ces secteurs d’activités.
Concernant la répartition des actes des sages-femmes en 2014, 79% de ceux-ci étaient cotés en actes de sage-femme (SF) : la rééducation périnéale représentait 46%, la préparation à la naissance et à la parentalité ainsi que les consultations de suivis de grossesse représentaient 43%, le PRADO (programme de retour à domicile) 6% et le suivi gynécologique seulement 1%. (10)
Les compétences des sages-femmes s’élargissent mais elles restent encore peu pratiquées. Ceci est dû au fait que les lois sont encore récentes.
Dans un premier temps, il y a eu la loi de santé publique de 2004. Celle-ci a donné aux sages-femmes la possibilité de :
– Faire la déclaration de grossesse,
– Pratiquer l’examen post-natal,
– Prescrire la contraception orale dans les suites immédiates d’une grossesse ou d’un avortement, certaines vaccinations,
– Prescrire des examens complémentaires dans le cadre d’un suivi de grossesse normale,
– Prescrire des médicaments inscrits sur classes thérapeutiques.
Puis a été mis en place la loi HPST du 21 Juillet 2009 qui vise à moderniser le système de santé. Cela passe par l’élargissement des compétences en matière de suivi gynécologique de prévention et de contraception.
Il est alors nécessaire aux sages-femmes diplômées avant la publication de cette loi, de se mettre à jour face aux nouvelles pratiques qui leur sont offertes. Elles peuvent alors passer un diplôme universitaire de « suivi gynécologique de prévention, sexualité et régulation des naissances ». (11)
Parmi celles qui ont obtenu ce diplôme universitaire et qui se sont installées en cabinet libéral, l’une d’entre elles nous a fait part de son expérience. Elle déclare que le suivi gynécologique est « lent au démarrage ». Elle souhaiterait que les sages-femmes hospitalières informent davantage les patientes qu’il est possible de consulter des sages-femmes libérales pour leur suivi gynécologique. (12)
Nous pouvons donc comprendre que face à ces changements, ajouté au manque de connaissance de la profession, la population peut rencontrer des difficultés à changer son regard envers les sages-femmes.
Toutes ces évolutions donnent des opportunités aux sages-femmes mais aussi des incertitudes pour les femmes.
Une profession avec des difficultés d’embauche
Pour le grand public, le métier de sage-femme est un métier d’avenir, ne présentant aucune difficulté d’embauche. La réalité est tout autre.
Depuis environ 4 ans, il est difficile de trouver un emploi en tant que sage-femme. Le nombre de demandeurs d’emploi en tant que sage-femme augmente chaque année depuis 2010. En 2013, nous en comptions 1000, contre 450 en 2010. En effet, le numerus clausus a augmenté jusqu’en 2005 sans avoir un nombre de départs en retraite égal. Les offres d’emploi en milieu hospitalier existent mais ce sont principalement des contrats à durée déterminée. (13)
De ce fait, l’exercice libéral s’est développé. Ce mode d’exercice comptabilise une augmentation de 109% de 2007 à 2014 : en sept ans, l’exercice a plus que doublé. Cet effectif de sages-femmes libérales augmente de 10% chaque année depuis 2009. (14)
L’âge moyen des sages-femmes libérales en 2010 était de 50 ans. En 2015, il est passé à 40 ans. Il était auparavant rare d’exercer en libéral avant l’âge de 30 ans, mais au vu du contexte, cela est plus fréquent aujourd’hui. En 2010, les sages-femmes ayant moins de 30 ans représentaient 1%, tandis qu’en 2015 elles étaient 31.7 %. En parallèle, le taux de chômage le plus élevé concernait cette tranche d’âge. Ces jeunes diplômées préfèrent alors s’installer plus rapidement. Cependant, nous ne savons pas si ces installations en cabinet libéral, ou ces remplacements de sages-femmes libérales, sont des choix, ou si elles sont dues à un manque de postes en hospitalier. Ces installations impliquent aux sages-femmes de faire des formations complémentaires afin d’offrir un large choix de soins aux patientes. (15)
Cette activité libérale se développant de plus en plus, la profession devrait se faire connaître davantage auprès des patientes. Ceci est indispensable pour l’avenir de notre profession afin d’obtenir une meilleure reconnaissance de l’Etat mais aussi pour veiller à la bonne santé des femmes.
Un manque de reconnaissance
Les sages-femmes françaises ont entamé un mouvement national le 16 octobre 2013. Les associations et syndicats se sont rassemblés afin de soutenir les revendications des sages-femmes. Cette mobilisation historique a prouvé la volonté de changement du système de santé mais a également montré que les sages-femmes ne se sentaient pas reconnues. Cette mobilisation s’est rapidement développée et a donc révélé l’urgence de voir les sages-femmes accéder à un positionnement conforme à leurs compétences, leurs responsabilités et leurs attentes. Les sages-femmes souhaitent faire reconnaître leurs spécificités professionnelles et faire entendre leurs propositions pour la construction d’un parcours de santé spécifique pour les femmes.
Il est nécessaire de placer les sages-femmes au centre du parcours de santé des femmes. L’engagement politique est fort mais nécessaire afin de maintenir une population en bonne santé. (16)(17)(18)
Caroline Raquin, présidente de l’Organisation Nationale Syndicale des Sages-Femmes nous a évoqué les mécontentements des sages-femmes. Celle-ci n’hésite pas à nous dire que les sages-femmes sont « inconnues et invisibles ».
À la suite de ce mouvement national, Madame Schilinger Patricia, sénatrice, a souligné les revendications auprès de Madame la Ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine. Elle lui rappelle que les sages-femmes souffrent d’un manque de reconnaissance de leur métier. Madame la Ministre a donc répondu à cet appel en annonçant un plan d’ensemble le 4 Mars 2014 comprenant 5 mesures :
✓ La création d’un statut médical des sages-femmes en milieu hospitalier,
✓ Des compétences médicales valorisées : en communiquant davantage leurs compétences au grand public,
✓ Des responsabilités nouvelles,
✓ Une formation renforcée dans les écoles,
✓ Une revalorisation des salaires. (19)
Il est prouvé que les sages-femmes souffrent d’un manque de reconnaissance sociale. Une étude a été réalisée par Monsieur Philippe Charrier. Celui-ci voulait déterminer quelles étaient les principales revendications des sages-femmes. Selon les résultats, les sages-femmes seraient en manque de reconnaissance sociale et économique. Il a également demandé quels étaient les enjeux de la profession. A cet item, la réponse la plus fréquente a été « être reconnu ». En seconde position, les sages-femmes ont répondu « avoir de meilleures conditions de travail, un meilleur salaire » (20)
Le livre de Mathieu Azcue, sage-femme, aborde d’autres revendications. Il nous explique que les sages-femmes demandent aux pouvoirs publics d’avoir la possibilité de réaliser des accouchements à domicile et en maison de naissance. En effet, les accouchements à domicile sont autorisés mais soumis à certaines conditions. Il est nécessaire de bénéficier d’une assurance professionnelle couvrant les accouchements à domicile. Or, celle-ci est couteuse et non abordable pour les sages-femmes. De ce fait, les sages-femmes éprouvent donc des difficultés à les pratiquer.
Concernant les maisons de naissance, celles-ci sont encore récentes. Elles ont fait l’objet d’une loi, le 6 décembre 2013 autorisant son expérimentation et précise dans son article 1 qu’ « à titre expérimental et pour une durée de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut autoriser la création de structures dénommées « maisons de naissance ». Les maisons de naissances ouvrent alors en 2015.
Mathieu Azcue nous informe également que les sages-femmes réclament aussi le droit d’organiser elles-mêmes leur formation. (8)
Malgré toutes ces mobilisations et les campagnes réalisées, le manque de reconnaissance se fait toujours ressentir.
Un manque de connaissance
Une réalité dénoncée
Malgré le manque de reconnaissance qui se fait toujours ressentir chez les sages-femmes, nous savons que celles-ci sont devenues des acteurs médicaux incontournables. Or, le grand public n’a pas toujours connaissance des compétences qui leurs sont définies.
La plupart des femmes ont rencontré un jour une sage-femme dans leur vie. Or, toutes ne connaissent pas les compétences de celle-ci. A titre d’exemple, selon un sondage réalisé en 2017 pour le Conseil National de l’Ordre des Sages-Femmes, il a été montré que sur l’échantillon interrogé, soit 1064 femmes, seulement 54% savent qu’une sage-femme peut prescrire une contraception. Dans ce même échantillon, seulement 68 % des femmes envisagent de consulter une sage-femme pour une contraception. Le même questionnaire a été réalisé en 2014 chez 986 femmes. A cette période, 49% des femmes savaient qu’une sage-femme pouvait prescrire une contraception et 59% envisageaient de consulter une sage-femme. Nous pouvons donc noter une amélioration, mais ces chiffres posent tout de même question. (6)
Il y a deux ans, le Ministère de la santé nous a fait part de cette observation. Selon lui, les femmes ne connaissent pas l’étendue des compétences des sages-femmes. Il a fait appel aux syndicats et au Conseil National de l’Ordre des Sages-Femmes. Ensemble, ils ont ainsi créé une campagne d’information nationale sur le rôle et les missions des sages-femmes. Il s’agit d’une vidéo montrant des femmes interviewées dans la rue, à qui cette question a été posée: « Savez-vous quel professionnel de santé peut à la fois assurer votre suivi gynécologique, vous prescrire une contraception, vous accompagner tout au long de votre grossesse, pratiquer l’accouchement et vous suivre vous et votre bébé à la sortie de la maternité ? ». Ces femmes ont répondu « Personne », « Mon médecin traitant », « Le planning familial », « Mon gynécologue » et « Une sage-femme ? ». Cette campagne montre bien, encore une fois, que toute la population ne connait pas l’étendue des compétences d’une sage-femme. Ils ont pour cette même occasion crée une infographie : « 6 bonnes raisons de consulter une sage-femme » (21) [annexe II]
Selon des sondages, une majorité de la population pense qu’une sage-femme est une infirmière spécialisée. Il se pourrait aussi que les sages-femmes souffrent d’une représentation féminine. En effet, seulement 2% des sages-femmes sont des hommes. (8)
Nicolas Dutriaux, sage-femme et membre du Collège National des Sages-Femmes de France, insiste aussi sur le fait qu’une sage-femme peut assurer un suivi gynécologique de l’adolescente à la femme ménopausée, ne présentant aucune pathologie. Ces compétences leur permettraient d’être considérées comme praticiens de premier recours. (22) La réalité est tout autre, peu de femmes s’adressent aux sages-femmes. Ces femmes méconnaissent les compétences des sages-femmes.
A cette problématique s’ajoute le fait que les sages-femmes sont les grandes oubliées des campagnes de communication nationales. (23)
Pour exemple, le 6 Avril 2017, lors de la présentation du plan d’action concernant le dépistage du cancer du sein, le Ministère des Affaires sociales et de la santé n’a pas cité les sages-femmes parmi les professionnels de santé participant à ce dépistage. Les sages-femmes ont donc déclaré dans un article stipulant « en avoir marre d’être oubliées ». (13)
Les élections présidentielles de 2017 ont été l’occasion pour le Conseil National de l’Ordre de mettre en avant la profession de sage-femme. Celui-ci a publié le 6 Décembre 2016 le « livre blanc » intitulé « innover pour la santé publique avec les sages-femmes ». Il contient 12 propositions destinées à promouvoir les compétences des sages-femmes auprès des femmes. Ces 12 propositions sont les suivantes :
→ « Mettre en œuvre les premiers états généraux de la santé génésique des femmes ;
→ Faire de la sage-femme l’acteur médical de premier recours auprès des femmes en bonne santé;
→ Instaurer une consultation dédiée à la santé sexuelle et à la prévention des addictions chez les adolescents ;
→ Faciliter la participation des sages-femmes dans les lycées et collèges à l’éducation de la vie affective et sexuelle ;
→ Généraliser l’ouverture des maisons de naissance ;
→ Faciliter l’ouverture et l’accès aux plateaux techniques pour toutes les femmes ;
→ Créer un dossier médical partagé des nouveau-nés par les sages-femmes ;
→ Garantir l’accès au PRADO pour toutes les femmes ayant accouché ;
→ Soutenir l’émergence de la recherche en maïeutique ;
→ Promouvoir l’exercice libéral au sein de la formation initiale des sages-femmes ;
→ Renforcer la représentation des sages-femmes au sein des instances de gouvernance ;
→ Mettre en place un observatoire européen de la profession de sage-femme. » (24)
Des outils de communications nécessaires
Les Sages-femmes sont dans un changement de culture depuis environ quinze ans, elles réclament une « communication grand public ». La plupart des femmes ne sont pas informées de la possibilité d’être accompagnées uniquement par une sage-femme pour leur grossesse et vont voir en première intention un médecin. Selon l’enquête périnatale de 2016, le gynécologue-obstétricien demeure le professionnel le plus fréquemment consulté pour la surveillance prénatale. Il est cependant à noter que pour un quart des femmes, leur sage-femme a été la responsable principale de leur surveillance dans les six premiers mois de grossesse. De plus, 65 % des femmes ont consulté une sage-femme durant leur suivi prénatal. Les sages-femmes souhaitent que leur statut à l’hôpital prenne en compte la spécificité médicale de leur activité. Monsieur Marcel Rainaud l’a rappelé en attirant l’attention de Madame la Ministre des affaires sociales et de la santé, le 23 Janvier 2014. Celui-ci lui a notamment fait part de son interrogation concernant les consultations de « premier recours » de la part des sages-femmes. Il souligne aussi le fait que les sages-femmes désirent accéder à davantage de reconnaissance, aussi bien concernant leur formation. Les sages-femmes voudraient que leur statut évolue comme praticien médical de premier recours lorsqu’elles sont libérales. Madame la Ministre a répondu à cet appel en annonçant le plan d’ensemble du 4 Mars 2014 comprenant 5 mesures, citées précédemment.
A cela s’ajoute la méconnaissance de la population générale concernant les compétences des sages-femmes, qui entraine un défaut de choix en termes de liberté de choix du praticien. Il est indispensable de développer des outils de communication efficaces afin que les femmes soient informées des rôles et compétences de chacun des praticiens qu’elles seront amenées à consulter. (37)
Cependant, il s’agit d’une profession médicale, il est donc interdit de faire de la publicité de notre métier. Il faut trouver un outil de communication qui puisse convenir. (25)(26)(27)(28)
Comme il est évoqué précédemment, nous savons que Madame la Ministre, Marisol Touraine a créé en 2016, une campagne nationale d’information qui met en lumière le métier de sage-femme. Elle s’est appuyée d’un double dispositif :
Le premier étant une campagne d’affichage : 24000 affiches et 483 000 dépliants présentant les missions des sages-femmes dans toute leur diversité ont été distribués dans les plannings familiaux, les centres de planification et d’éducation familiale (CPEF), les maternités, les centres périnataux de proximité, les centres de protection maternelle et infantile (PMI)…
Pour le second dispositif, il a fallu s’appuyer sur le réseau internet. Le but était d’avoir une grande présence sur celui-ci. Pour cela, il était souhaité que des bannières puissent orner les pages d’accueil des sites des principaux médias généralistes et féminins. Ces bannières renvoyaient vers le « grand dossier » sur le site internet du Ministère des Affaires sociales et de la santé, se composant d’une infographie, d’une vidéo « micro-trottoir », ainsi que des témoignages de sages-femmes et de patientes qui relayaient sur les réseaux sociaux pour compléter ce dispositif. (28) [Annexe III]
De son côté, le Conseil National de l’Ordre a voulu investir Facebook et Twitter en 2011. Ces outils de communication se révèlent aujourd’hui incontournables. Nous comptons aujourd’hui 5000 personnes sur leur page Facebook et plus de 3000 « followers » sur Twitter. Selon le rapport des activités de 2016, « Ces outils peuvent permettre d’informer de façon réactive de nombreuses sages-femmes sur les évolutions professionnelles, les messages de santé publique ou les actualités médicales, institutionnelles et sociétales pouvant présenter un intérêt pour cette communauté médicale. Au-delà des seules sages-femmes, l’Ordre touche également une audience plus large, permettant une diffusion plus importante et plus efficace de l’information, tout en donnant une plus grande visibilité à la profession de sage-femme. » (29)
Notons aussi, qu’il s’agit d’un métier de plus en plus « médiatisé ». Différentes émissions télévisées exposent la profession de sage-femme. Or, celles-ci ne présentent pas nos différents champs de compétences et montrent uniquement les sages-femmes en salle de naissance, ce qui est bien différent de la réalité.
Le point de vue des professionnels
Une enquête auprès des acteurs de périnatalité de Midi-Pyrénées a démontré que ces derniers n’ont pas la même représentation du métier de sage-femme et n’ont donc pas tous les mêmes attentes. Les acteurs de périnatalités interrogés étaient des gynécologues-obstétriciens, anesthésistes-réanimateur et sages-femmes. Il s’agissait d’un test d’association libre ; ce qui consiste à citer 4 ou 5 mots spontanément sur le thème de la profession de sage-femme. Les résultats ont montré que les 10 items les plus fréquents sont : « Accompagnement », « responsabilité médicale », « naissance », « accouchement », « plus beau métier du monde », « nouveau-né, « profession médicale », « grossesse », « écoute » et « disponibilité ». Nous observons que les mots clés cités précédemment par les professionnels de santé font surtout évoquer le thème de l’accouchement. Or, les compétences des sages-femmes ne se limitent pas à cela. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que ces différents acteurs n’interviennent le plus souvent auprès des sages-femmes qu’en salle de naissance. Lors de cette étude, il a également été démontré que les médecins attendaient davantage une attitude technicienne, tandis que les sages-femmes privilégiaient une attitude relationnelle forte. (30)
L’Organisation Mondiale de la Santé a réalisé une étude auprès de 2 470 sages-femmes de 93 pays différents. Parmi les résultats de cette enquête, il existe une volonté de changement. En effet, 89 % des sondées pensent qu’une meilleure reconnaissance de leur métier pourrait changer les choses et 70 % estiment qu’une meilleure information du grand public sur leurs rôles et leurs compétences seraient bénéfiques. (31)
Une responsabilité menacée
Les sages-femmes font partie des professions médicales. Elles ont donc des responsabilités, qui sont liées à l’autonomie dont elles disposent ainsi qu’au champ de compétences qui leur est reconnu par la loi.
Or, comme les ouvrages nous le montrent, la responsabilité des sages-femmes est incomprise. La complexité et l’amélioration des moyens thérapeutiques nécessitent une coopération entre professionnels. Chaque professionnel est complémentaire l’un à l’autre, mais cela peut donner le sentiment que la sage-femme a une responsabilité amoindrie. (32)
Il s’agit d’une profession qui lutte pour l’autonomie. Les sages-femmes françaises sont les seules à être reconnues comme profession médicale à compétences definies ; de quoi semer le doute chez les femmes. (8)
Cette difficulté de communication entre professionnels nous est démontrée lors d’une étude faite par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques en Octobre 2016. Celle-ci s’est intéressée aux attitudes et pratiques professionnels des médecins généralistes dans le cadre du suivi de grossesse. Cette étude nous montre que le gynécologue-obstétricien est le principal interlocuteur du médecin généraliste. En effet, 77% des médecins généralistes ont échangé avec ceux-ci pendant la grossesse. L’étude ne nous précise cependant pas quels étaient les motifs de ces échanges. Les échanges entre médecins généralistes et les sages-femmes sont nettement moins fréquents. Cette fois-ci, seulement 44% ont échangé avec celles-ci.
Il est également renseigné qu’en cas de non réalisation de suivi de grossesse, ou à la fin de leur suivi, les médecins généralistes adressent dans plus de 80% des cas la patiente vers un gynécologue-obstétricien et environ 10% vers une sage-femme.
Pour expliquer ces chiffres, 15 à 20% des médecins généralistes indiquent avoir le sentiment de concurrence avec les sages-femmes et les gynécologues alors que ce sentiment est moins présent envers les gynécologues-obstétriciens. Cela concerne cette fois-ci 7% des généralistes. . (33)
|
Table des matières
INTRODUCTION
REVUE DE LA LITTERATURE
1. ETRE SAGE-FEMME
1.1. DEFINITION DE LA SAGE-FEMME
1.2. DEVENIR SAGE-FEMME EN FRANCE
1.3. COMPETENCES DE LA SAGE-FEMME
1.4. SAGE-FEMME : UN METIER EN MUTATION
1.5. UNE PROFESSION AVEC DES DIFFICULTES D’EMBAUCHE
2. UN MANQUE DE RECONNAISSANCE
3. UN MANQUE DE CONNAISSANCE
3.1. UNE REALITE DENONCEE
3.2. DES OUTILS DE COMMUNICATIONS NECESSAIRES
3.3. LE POINT DE VUE DES PROFESSIONNELS
3.4. UNE RESPONSABILITE MENACEE
RECHERCHE
1. QUESTION DE RECHERCHE
2. HYPOTHESES
3. METHODOLOGIE
RESULTATS
1. CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DES FEMMES
1.1 . L’AGE
1.2. LA PARITE
1.3. LE NIVEAU DE SCOLARITE
1.4. LA SITUATION PROFESSIONNELLE
2. LES CONNAISSANCES SUR LA PROFESSION DE SAGE-FEMME
2.1. GENERALITES
2.2. GYNECOLOGIE
2.3. PER-PARTUM
2.4. POST-PARTUM
3. LE REGARD DES FEMMES
4. LE REGARD DES SAGES-FEMMES
DISCUSSION
1. LES CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES
2. EXPLICATIONS SUR LE MANQUE DE CONNAISSANCE
2.1. LE METIER DE SAGE-FEMME
2.2. LES COMPETENCES GYNECOLOGIQUES
2.2.1. LE SUIVI GYNECOLOGIQUE
2.2.2. LA CONTRACEPTION
2.2.3. L’INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE
2.3. LES COMPETENCES DE LA SAGE-FEMME EN PRE-PARTUM
2.3.1. LA PREVENTION
2.4. LES COMPETENCES DE LA SAGE-FEMME EN PER-PARTUM
2.5. LES COMPETENCES DE LA SAGE-FEMME EN POST-PARTUM
2.6. LE POINT DE VUE DES PROFESSIONNELS
3. LES LIMITES DE NOTRE ETUDE
4. LES FORCES DE NOTRE ETUDE
CONCLUSION
Télécharger le rapport complet