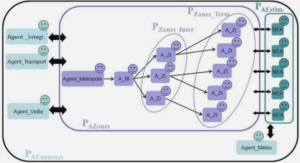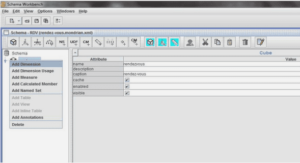Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Formulation des gels hydroalcooliques
Les gels hydroalcooliques sont à différencier des solutions hydroalcooliques. L’organisation mondiale de la santé propose une solution hydro-alcoolique qui est composée d’un principe actif qui est l’alcool, d’eau, d’émollient et de peroxyde d’hydrogène dont l’objectif est de détruire les spores qui pourraient contaminer les récipients.
La différence entre gel et solution sera donc principalement la présence ou non de gélifiant.
Rôle de l’alcool
L’alcool dans le gel a un rôle d’antiseptique. Un antiseptique est un produit qui permet de supprimer ou d’empêcher le développement des bactéries ou des virus. Il est utilisé sur la surface du corps. Ils peuvent être fongicides, (contre les champignons), bactéricides (contre les bactéries), virucides (contre les virus) ou sporicides (contre les spores), en empêchant l’infection par la destruction des microbes.
Les alcools sont les premiers antiseptiques à être utilisés en friction. Les principaux alcools utilisés sont l’éthanol, l’isopropanol et le n-propanol. Les équivalences entre ces différents alcools sont les suivantes : n-propanol 42% = Isopropanol 60% = éthanol 77% (ROTTER, 1984) .
L’activité de l’alcool dépend de sa concentration mais son efficacité diminue considérablement sur les mains humides. Les alcools sont les antiseptiques ayant la plus grande rapidité d’action (ROTTER, 1984).
Leur rémanence est faible, compte tenu de leur pouvoir d’évaporation, mais cet inconvénient est contrebalancé par leur forte activité bactéricide. Il n’y a pas d’induction de résistances démontrée aux alcools.
Les inconvénients des alcools sont liés au fait qu’ils assèchent la peau, ce qui rend nécessaire son association à un émollient pour assurer une bonne tolérance. Aussi, leur efficacité est diminuée, par dilution, sur les mains humides, ce qui explique pourquoi on ne doit les employer que sur des mains sèches. Les alcools (éthylique et isopropylique) sont inactifs sur les germes sous forme de spores et il n’est pas rare de trouver des spores bactériennes, éventuellement de tétanos ou de gangrène, dans les flacons d’alcool chirurgical (HAXHE, 2002).
C’est pourquoi les solutions alcooliques d’antiseptiques doivent être préparées en pharmacie au moyen d’alcool stérile par filtration stérilisante ou par addition de composants agissant sur les germes sporulés (peroxyde d’hydrogène). Le stockage des alcools peut poser des problèmes car ce sont des produits inflammables.
Rôle de l’eau :
L’eau est un constituant essentiel des gels : elle a un rôle de potentialisation de l’action des alcools. L’activité antimicrobienne des alcools est attribuée à leur capacité à dénaturer les protéines et elle sera d’autant plus efficace en présence d’eau. Ainsi, les préparations contenant de 60 à 80 % d’alcool seront les plus efficaces comme dit précédemment et les concentrations plus élevées le seront moins du fait de leur plus faible teneur en eau (Guide recommandé par l’OMS)
Par ailleurs, l’eau a un rôle d’hydratation du carbopol qui est la première étape de sa gélification.
Rôle de l’émollient : La glycérine
Un usage fréquent des gels hydro-alcooliques pour l’hygiène des mains peut causer une sécheresse de la peau à ce niveau à moins qu’un émollient ou produit similaire soit ajouté à la formulation. La présence d’un émollient est indispensable pour garantir un bon état cutané et favoriser ainsi l’observance de la méthode de friction hydro-alcoolique des mains. Ainsi, dans plusieurs études, des solutions hydro-alcooliques ou des gels contenant des émollients ont causé moins d’irritation ou de sècheresse de la peau par rapport aux détergents antimicrobiens testés. Les principaux émollients utilisés sont la glycérine, l’alcool myristique, la triéthanolamine, l’hydroxyurée et la diméthicone (huile de silicone) (Guide recommandé par l’OMS].
Agent Gélifiant
Ils vont permettre la préparation de gels hydro-alcooliques qui sont des produits semi-solides constitués de liquides gélifiés à l’aide d’agents gélifiants appropriés tels que l’amidon, les dérivés de la cellulose, les carbomères ou des silicates de magnésium (Guide recommandé par l’OMS)
Ce sont des macromolécules hydrophiles d’origine naturelle semi-synthétique ou synthétique capables de former des gels emprisonnant une grande quantité de solvant. En faible quantité, ils sont épaississant. De façon générale, ils apportent de la consistance aux produits cosmétiques en améliorant leur stabilité (SAMAKE, 2012).
Agents gélifiants naturels
D’origine végétale
Parmi eux, on peut citer : la Pectine, la gomme de guar et l’amidon ; ils sont obtenus à partir de graine ou pépins de fruits ou de légumes.
D’origine minérale
Ils sont représentés par la silice colloïde appelée aussi gel de silice et silicates.
Agents gélifiants synthétiques
Styrène, acrylates copolymère, acrylate crosspolymer :
Ce sont des agents filmogènes qui produisent un film contenu sur la peau, les cheveux ou les angles. Tous les acrylates sont très filmogènes et très plastifiant.
Carbomères :
Les carbomères sont des polymères synthétiques hydrophiles d’acide acryliques. On les retrouves dans la cosmétique et la pharmacie (SPRINGINSFELD, 2009)
Additifs
Pour l’enrichissement de gel, on peut ajouter des additifs comme des vitamines, colorants, parfums, aleo vera
Efficacité des gels hydro-alcooliques
Sattar , dans une étude in vivo sur douze volontaires, a montré l’activité virucide d’un gel composé d’éthanol, sur trois virus non enveloppés : adenovirus, rhinovirus et rotavirus. La réduction obtenue varie de 2,9 à 4,2 log en 20 secondes de contact ( Bellamy et al en 1993) confirme cette étude en ce qui concerne les rotavirus ( Steimann et al en 1995) qui ont comparé, par contamination artificielle des mains de 7 volontaires, l’efficacité des solutions hydro alcooliques (éthanol, isopropanol, n-propanol ) sur Enterovirus polio. Ce sont les SHA à base d’éthanol qui ont montré la meilleure efficacité avec une différence significative par rapport aux produits à base de propanol. Les tests standardisés par la Food and Drug Administration,( Hobson et al. ,1998) ont montré une efficacité antimicrobienne supérieure in-vivo d’un produit à base d’alcool à 70° par rapport à deux produits moussants antiseptiques, l’un à base de 7,5% de PVPI et l’autre à base de 4% de gluconate de chlorhexidine. Par contre, il n’y a pas de différence significative entre les 3 modes d’application (application du produit alcoolique pendant 3 minutes, soit avec brosse et cure ongle, soit avec une éponge, soit sans support).
En 1999, (Pittet et al. 1999) ont montré que la contamination des mains augmentait avec la durée du soin, d’environ 16 UFC* / minute. La qualité du lavage des mains a une influence sur l’écosystème bactérien en cours de soins.
Les résultats montrent qu’un lavage avec une solution moussante antiseptique ou une friction hydro-alcoolique qui permet de garder un niveau de contamination inférieur à celui obtenu après un lavage des mains avec un savon ordinaire.
Utilisation des gels hydro-alcooliques
Les gels hydro-alcooliques sont très utilisés aujourd’hui, aussi bien dans le domaine public que dans le domaine privé.
En médecine
Leur usage est recommandé par l’OMS dans le cadre du plan de lutte contre les infections nosocomiales.
Leur utilisation est recommandée dans la pratique des soins de santé. Leur utilisation en remplacement ou en complément du lavage
chirurgical se généralise dans les blocs opératoires.
Afin de prévenir la transmission d’herpès, de gastro-entérite, de grippe (TRAVKINE, 2012).
Place des produits hydro-alcooliques dans l’hygiène des mains
L’intérêt du lavage des mains dans la prévention de la transmission des agents infectieux est connu depuis de nombreuses années. Cependant, son application reste trop souvent insuffisante. Différentes raisons entrent alors en jeu : intolérance aux savons, manque de temps, absence de point d’eau. Ce constat incite à promouvoir de nouvelles techniques hygiènes des mains, comme la technique de désinfection des mains avec un produit hydro-alcoolique. Cette technique de friction des mains avec un produit à forte teneur en alcool (solution ou gel hydroalcoolique) permet une hygiène des mains rapide, même en l’absence de point d’eau à proximité du lieu de soin comme au domicile du patient ou en situation d’urgence. Son utilisation a été recommandée par le Comité Technique des Infections Nosocomiales (CTIN) dans un avis rendu le 5 décembre 2001 (OMS. BEH.2001).Son utilisation a fait l’objet d’une campagne d’information lors de la journée nationale d’hygiène des mains par le Ministère de la Santé le 23 mai 2008 (Disponible sur : http://www.sante- jeunessesports gouv.fr/dossiers/sante/mission-mains-propres).
Il est prouvé que la friction hydro-alcoolique est la méthode la plus efficace en terme d’élimination de la flore portée sur les mains. Les principes actifs (alcools) de ces produits hydro-alcooliques ont une excellente activité in vitro, bactéricide y compris sur les Bactéries Multi-Résistantes aux antibiotiques (Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM)), fongicide et virucide sur les virus enveloppés (virus herpès simplex, HIV, virus de la grippe, virus respiratoire syncytial, virus de l’hépatite B et à degré moindre sur les virus nus. La réduction de la contamination des mains quel que soit le produit testé, est toujours supérieure à celle d’un lavage des mains même effectué avec un savon antiseptique à temps de contact égal. Les produits choisis doivent répondre à des normes bien définies.
Carbomères
Les carbomères sont des macromolécules hydrophiles de haut poids moléculaire entre 700 000 et 4 000 000 g/mol (Martini, 1999) et ayant une grande polydispersité de cette masse. Le carbomère est un polymère acrylique réticulé dont les groupements carboxyliques sont responsables de la plupart de ses propriétés. Sous forme de résine déshydratée, les molécules de carbopol sont enroulées en pelotes, ce qui leur donne un fort pouvoir épaississant. Leurs groupements carboxyliques peuvent s’associer et réaliser des ponts d’hydrogène entre les différentes parties de la chaine principale du polymère en solution. Ces groupements carboxyliques deviennent fortement ionisés dans la gamme de pH=4 à pH=6 en présence d’un agent neutralisant et aboutissent à la formation d’un gel grâce aux répulsions électrostatiques entre les chaînes de polymères chargées (French, 1995).
Application pharmaceutique des gels de carbomères
Les polymères de carbopol sont utilisés dans l’industrie des soins personnels depuis quarante ans. Ils ont été utilisés dans la production de gels, crèmes, lotions et produits solaires. Les gels de carbopol ont été appliqués en tant que véhicules médicamenteux dans plusieurs voies d’administration. Les avantages de l’utilisation de gels de carbopol comme véhicules sont :
Bonnes propriétés rhéologiques entraînant une longue déclaration sur le site d’administration Bonne alternative aux formulations de pommades à base d’huile Hydrogels anioniques avec un bon pouvoir tampon qui contribue au maintien du pH souhaité (Liu et al, 2008)
Haute viscosité déjà à de faibles concentrations, Large intervalle de concentration et comportement d’écoulement caractéristique Compatibilité avec de nombreux principes actifs Propriétés bio adhésives
Bonne stabilité thermique
Excellentes caractéristiques organoleptiques
Bonne acceptabilité des patients (Islam et al, 2004).
Islam et al, (2004) ont étudié le comportement rhéologique des gels topiques de carbopol dans une gamme de pH entre 5,0 et 8,0. Le propylène glycol et le glycérol ont été utilisés comme co-solvants. Les gels montraient le comportement des systèmes élastiques. L’élasticité de ces réseaux peut s’expliquer par la triéthylamine comme agent gonflant permettant un tassement serré et la liaison serrée entre les longues chaînes et les chaînes latérales. Les gels de carbopol présentent un comportement pseudoplastique à vitesse élevée. Les segments de chaîne polymère se déforment et s’ajustent dans le sens de l’écoulement. Les caractéristiques pesudoplastiques et non newtoniennes des gels peuvent être expliquées par l’interaction solvant-solvant et solvant-polymère et une viscosité plus élevée du glycérol en tant que co-solvant. La viscosité des gels de Carbopol augmente avec le pH ainsi que par l’ajout de glycérol (Islam et al, 2004).
Gélification des carbomères en fonction du pH
Il est également possible d’obtenir un gel en tirant profit d’un changement de solubilité en fonction du pH (Kumar, 1994). Les solutions aqueuses de Carbopol présentent une transition sol-gel (solution-gel) lorsque le pH est amené au-dessus de son pKa, soit environ 5.5. Au pH physiologique (7-7.1), le carbomère est sous forme gélifiée. La neutralisation s’effectue à l’aide d’une base inorganique hydrosoluble (NaOH, KOH, NH4OH….) ou d’amines hydrosolubles comme le triéthanolamine (TEA), aminométhylpropanol (AMP-95) ou le tetrahydroxypropyléthylènediamine (Neutrol TE). Le gel obtenu est aqueux, stable, transparent, incolore et non collant au toucher (Barry, 1979). Dans notre cas d’étude, nous avons préparé des gels à base de Carbomére (neutralisé par le triéthanolamine (TEA)) pour la préparation d’une forme semi solide.
Caractérisation des gels de carboméres
Caractérisations rhéologiques
Les carbomères sont caractérisés par l’étude de leurs propriétés rhéologiques telles que la viscosité et le degré de thixotropie. Pour évaluer la rhéologie d’un matériau, il est possible de lui appliquer une contrainte ou une déformation et de mesurer sa réponse mécanique. La rhéologie est utilisée pour évaluer la force du réseau formé (gel fort ou faible). Elle permet aussi d’établir le lien entre la structure de la molécule gélifiante et les propriétés mécaniques du gel (Ruiz, 2007).
Un groupe de chercheurs (Islam et al, 2004) a étudié le comportement rhéologique des gels de carbopol et les a classés parmi les fluides ayant un comportement non newtonien et pseudoplastique.
Fluide newtonien
Un fluide est dit newtonien (Nielloud, 2000) lorsque la contrainte appliquée (σ) est une fonction linéaire de la vitesse de déformation (taux de cisaillement : S) ( Figure 5). Le facteur de proportionnalité est appelé viscosité (ɳ), il est constant et indépendant de la vitesse de déformation.
Fluide non newtonien au comportement indépendant du temps
Au contraire, un fluide est dit non-newtonien (Nielloud, 2000) lorsque sa contrainte de cisaillement n’est pas une fonction linéaire de la vitesse de déformation (σ=k.Si). Autrement dit sa viscosité (appelé viscosité apparente) dépend elle aussi de la vitesse de cisaillement.
Caractérisation du réseau des gels de carbomères
Pour obtenir une connaissance détaillée sur l’arrangement moléculaire et la structure des agrégats (morphologie, orientation, cristallinité) qui constituent le gel, diverses techniques peuvent être utilisées. Tout d’abord, les techniques d’imagerie directes, soit la microscopie optique ou la microscopie électronique à balayage MEB fréquemment employée pour la détermination de la température de transition gel-solution et solution-gel pour des gels thermosensibles (Heymann, 1935).
Elle est aussi utilisée pour la détermination de la nature cristalline ou amorphe des particules de médicament incorporées dans un gel de carbomère (Karthikeyan et al, 2012).
Généralités sur la mangue
La mangue est originaire d’Inde. Elle fut introduite en Afrique et au Brésil au XVI ème siècle (Soumah, 1988). C’est un fruit répandu dans les régions tropicales et subtropicales. Elle est cueillie sur des manguiers, arbres mesurant entre 10 et 20m de haut (Martine, 1993), possédant un système racinaire essentiellement pivotant et caractérisé par la présence d’un nombre réduit de grosses racines peu ramifiées (Moutonnet, 1977).
Le manguier est un arbre fruitier de climat tropical caractérisé par une alternance très nette de saison sèche et humide. Les jeunes arbres sont très sensibles au gel. La zone de confort se situe entre 4 et 40 °C avec un optimum entre 23 et 27 °C. Les hautes altitudes sont défavorables à la bonne croissance du manguier notamment en retardant sa floraison (Bafodé, 1988). Le manguier pousse dans des sols très variés. Il préfère cependant des sols profonds, assez légers ou de structure moyenne, capables d’assurer une pénétration suffisante des racines, une bonne aération et un bon drainage
Botanique
Le manguier (figure 6) est un grand arbre qui peut atteindre 10 à 25 mètres de hauteur, avec un houppier de 20 mètres de diamètre. Son écorce est lisse, de couleur gris-brune foncée noire.
A l’intérieur du fruit de manguier ( mangue), il y a un noyau qui représente 9 à 27 % du poids total du fruit et qui en occupe donc une grande partie. Le noyau, plutôt gros et aplati adhère à la chair.
Il est recouvert de fibres plus ou moins développées dans la chair selon les variétés. Sa forme peut être ronde, ovale ou réniforme.
Le noyau contient une graine unique de grande taille appelée amande (figure7) de 4 à 7 cm de long sur 3 à 4 cm de large et 1 cm d’épaisseur.
Cette amande (figure 7) contient du lipide antioxydant, d’amidon et de farine.
Ceci nous amène ainsi à sa valorisation et à l’étude de ses caractéristiques.
Classification botanique de la plante
Du point de vue botanique, les mangues peuvent être classées comme suit (De Laroussilhe, 1980).
Constituants chimiques de l’amande de mangue
Les amandes constituent 62,2 % des noyaux. L’amande de la mangue contient de glucides (consommables en cas de famine), de protéine (10%), de lipide (6,1 %) et des tanins qui le rendent indigeste.
Le lipide d’amande de mangue de couleur jaune qui a l’aspect semi-solide contient :
Des phytosterols tels le stigmastérol, le campestérol et le β- sitostérol;
des acides gras tels l’acide palmitique (16,8%), l’acide stéarique (5,3 %), l’acide oléique (56 ,8 %) et l’acide linoléique (21,1%) (Léa Herilala , 2011-2014 ). C’est pourquoi le lipide de mangue a les propriétés de rendre les lèvres humides et douces car les acides gras bloquent de manière efficace l’humidité sur les lèvres et les imperméabilisent en raison de leur queue hydrophobe et de leur tête hydrophil(https://www.amelioretasante.com, 2019)
Le lipide de mangue figure dans les beurres végétaux car il est riche en acide gras saturé. Les beurres végétaux sont fréquemment incorporés à la base des produits cosmétiques bio auxquels ils confèrent une texture fondante et apportent de nombreuses propriétés bénéfiques pour la peau.
|
Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE
I. Gels hydroalcooliques
I.1. Définition
I.2. Formulation des gels hydroalcooliques
I.2.1. Rôle de l’alcool
I.2.2 Rôle de l’eau :
I.2.3. Rôle de l’émollient : La glycérine
I.2.4. Agent Gélifiant
I.3.Additifs
I.4. Efficacité des gels hydro-alcooliques
I.5. Utilisation des gels hydro-alcooliques
I.5.1. En médecine
I.5.2. En santé public
I.6. Technique de friction des mains avec un gel hydroalcoolique
I.7. Avantage des gels hydro-alcooliques
I.8. Inconvénients des gels hydro-alcooliques
I.9. Place des produits hydro-alcooliques dans l’hygiène des mains
II. Carbomères
II.1. Description chimique
II.2. Différents types de carbomères
II.4. Gélification des carbomères en fonction du pH
II.5. Caractérisation des gels de carboméres
II.5.1 Caractérisations rhéologiques
II.5.2 Caractérisation du réseau des gels de carbomères
III. Généralités sur la mangue
III.1 Botanique
III.2. Classification botanique de la plante
III.3. Constituants chimiques de l’amande de mangue
III.4.Etude d’amande de mangue
DEUXIEME PARTIE
I. Objectifs
I.1. Objectif général
I.2. Objectifs spécifiques
II. Méthodologie
II.1. Matériel
II.1.1.Appareillage et verrerie
II.1.2 Réactifs
II.2. Matière première
II.3. Méthodes
II.3.1. Formulation du gel
II.3.2.Caractérisation du gel
II.3.3. Préparation des extraits
II.3.5.Formulation du gel avec extrait
II.3.6. Test d’activité du gel
III. Résultats
III.1.Détermination de la quantité de carbomére
III.2. Détermination de la CMI
III.3.Détermination de l’activité antibactérienne du gel par bioautographie
IV. Discussions
CONCLUSION
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Télécharger le rapport complet