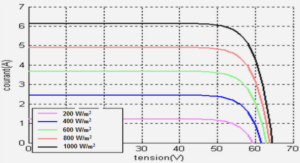Calcul des débits et des charges polluantes
Caractéristiques physiques
La turbidité
La turbidité des effluents résiduaires et des eaux polluées est en général très élevée. Elle s’exprime en gouttes de silice ou de mastic. La turbidité est donc définie par absorptiomètre. La mesure est effectuée au moyen d’un spectrophotomètre à 720 nm car à cette longueur d’onde l’influence de la couleur est négligeable. Pour éviter l’interférence due à la présence de grosses particules décantables, il convient de les éliminer au préalable par décantation. [2]
La couleur
La coloration des eaux urbaines résiduaires détermine qualitativement leur âge. Elle varie généralement du belge clair au noir. Si l’eau est récente, elle présente habituellement une coloration belge claire ; elle s’obscurcit avec le temps et devient de couleur belge grise ou noire, en raison de l’implantation de conditions d’anaérobiose, par décomposition bactérienne de la matière organique. ..).
L’odeur
Elle est principalement due à la présence de certaines substances produites par la décomposition anaérobie de la matière organique : sulfure d’hydrogène, indole, scatoles, mercaptans et autres substances volatiles. Si les eaux résiduaires sont récentes, elles ne présentent pas d’odeurs désagréables ni intenses. Avec le temps, l’odeur augmente en raison du dégagement de gaz tels que le sulfure d’hydrogène ou des composés ammoniacaux provoqués par la décomposition anaérobie.
La température
La température est un facteur écologique important du milieu. Elle joue un rôle important dans la solubilité des sels et surtout des gaz (en particulier O2) dans l’eau ainsi que la détermination du pH et la vitesse des réactions chimiques. La température agit aussi comme un facteur physiologique sur le métabolisme de croissance des microorganismes vivants dans l’eau. La température est mesurée par thermo-sonde (ou par thermomètre). [4]
Matières en suspension (MES)
Les matières en suspension (MES) constituent l’ensemble des particules minérales et ou organiques présentes dans une eau naturelle ou polluée. Elles peuvent être composées de particules de sable, de terre et de sédiment arrachés par l’érosion, de divers débris apportés par les eaux usées ou les eaux pluviales très riches en MES, d’êtres vivants planctoniques (notamment les algues). Elles correspondent à la concentration en éléments non dissous d’un échantillon. La détermination des matières en suspension dans l’eau s’effectue par filtration ou par centrifugation. La méthode par centrifugation est surtout réservée aux eaux contenant trop de matières colloïdales pour être filtrées dans de bonnes conditions, en particulier si le temps de filtration est supérieur à une heure. [5] Les MES sont exprimées par la relation suivante : MES = 30% MMS + 70% MVS. x Les Matières Volatiles en Suspension (MVS) : Les MVS représentent la partie organique des MES et sont obtenues par la calcination à 525 C° pendant 2 heures. x Les Matières Minérales en Suspension (MMS) : Les MMS représentent la différence entre les MES et les MVS et correspondent à la présence de sels minéraux de silice.
Les matières décantables et non décantables :
On distingue les matières qui décantent en un temps donné, et les matières qui ne décantentpas et qui restent donc dans l’eau en se dirigeant vers l’épuration biologique. [6]
Caractéristiques biologiques
Divers micro-organismes pathogènes provenant essentiellement des matières fécales peuvent être rencontrés dans les eaux usées brutes. Ils sont à l’origine de la pollution quaternaire des eaux. Parmi eux, nous pouvons citer les bactéries, les virus, les champignons, les protozoaires et les helminthes.
Les bactéries
Les bactéries sont des organismes unicellulaires simples et sans noyau. Leur taille est comprise entre 0,1 et 10 µm. La quantité moyenne de bactéries dans les fèces est d’environ1012 bactéries/g
Les eaux usées urbaines contiennent environ 106à 107bactéries/100 ml dont 105proteus et entérobactéries, 103à 104streptocoques et 102à 103 clostridiums. Parmi les plus communément rencontrées, on trouve les salmonella dont on connaît plusieurs centaines de stéréotypes différents, dont ceux responsables de la typhoïde, des paratyphoïdes des et des troubles intestinaux. Des germes témoins de contamination fécale sont communément utilisés pour contrôler la qualité relative d’une eau ce sont les coliformes thermo tolérants.[7, 8, 9]
Les virus
Les virus sont des parasites intracellulaires obligés qui ne peuvent se multiplier que dans une cellule hôte. On estime leur concentration dans les eaux usées urbaines comprise entre 103 et 104particules par litre.
Champignons
Généralement, les espèces isolées à partir des eaux usées sont très variables et certaines seulement sont pathogènes telles que : Candida albicans, Aspergillus fumigatus, Cryptococcusneoformans, Epidermophytonsp, Trychophytonspetc.
Protozoaires
Les espèces de protozoaires intestinaux humains qui sont considérés comme pathogènes et fréquemment rencontrés dans les eaux usées sont : Entamoebahistolytica, Balantidium coli, Giardia intestinalis, Crystosporidiumparvum.
Helminthes
La contamination parasitaire des eaux usées résulte du rejet des œufs d’helminthes avec les matières fécales de l’homme ou des animaux. Les œufs d’helminthes pathogènes pour l’homme etmis en évidence dans les eaux usées appartiennent à différents groupes taxonomiques dont : x les nématodes : Ascarissp, Toxocarasp, Trichurissp, Ankylostoma, duodenale…. ; x les cestodes : Taeniasaginata, Taeniasolium, Hymenolepissp…. ; x les trématodes : Fasciolasp, Schistosomasp.
Traitement des eaux usées
La dépollution des eaux usées nécessite une succession d’étapes faisant appel à des Traitements physiques, physico-chimiques et biologiques. En dehors des plus gros déchets Dans les eaux usées, l’épuration doit permettre, au minimum, d’éliminer la majeure partie de La pollution carbonée. Selon le degré d’élimination de la pollution et les procédés mis en œuvre, quatre niveaux de Traitement sont définis.[2,10, 11]
Prétraitement
Tout traitement de dépollution doit comporter ce qu’il est convenu d’appeler un « Prétraitement » qui consiste en un certain nombre d’opérations mécaniques ou physiques destinées à extraire le maximum d’éléments dont la nature et la dimension constitueraient une gêne ultérieurement. Ces opérations sont : le dégrillage, le dessablage et le déshuilage. x Dégrillage L’eau brute passe à travers des grilles composées de barreaux placés verticalement ou inclinés de 60 à 80° sur l’horizontale. L’espacement des barreaux varie de 6 à 100 mm. La vitesse moyenne de passage entre les barreaux est comprise entre 0,6 et 1 m/s Le nettoyage de La grille est généralement mécanique. Il est réalisé par un râteau solidaire d’un chariot qui se déplace de bas en haut le long d’une crémaillère ou entraîné par deux câbles Le fonctionnement du dispositif de nettoyage peut être commandé par une temporisation ou/et à partir d’un indicateur de perte de charge différentiel. Les matériaux de dégrillage constituent un produit gênant qui est composté ou évacué par camions. x Dessableur Le dessableur est un ouvrage dans lequel les particules denses, dont la vitesse est inférieure à 0,3 m/s, vont pouvoir se déposer. Il s’agit principalement des sables. Il est en effet souhaitable de les récupérer en amont de la station plutôt que de les laisser s’accumuler en certains points (bassin d’aération, …) où ils engendrent des désordres divers. Par ailleurs, ils limitent la durée de vie des pièces métalliques des corps de pompe ou d’autres appareillages (effet abrasif, …). x les dessableurs couloirs (à écoulement rectiligne), dont la vitesse d’écoulement est variable ou constante. x les dessableurs circulaires, à alimentation tangentielle ou à brassage mécanique ou à insufflation d’air (pour éviter le dépôt de matières organiques, en heures creuses, avec faible débit) ; x les dessableurs rectangulaires à insufflation d’air. On insuffle de l’air qui provoque une rotation de liquide et crée ainsi une vitesse constante de balayage du fond, perpendiculaire à la vitesse du transit, laquelle, beaucoup plus faible, peut alors être variable sans inconvénient. Le sable est extrait soit mécaniquement par raclage vers un poste de réception, puis repris par pompage, soit directement par pompe suceuse montée sur pont roulant. Le sable séparé contient malgré tous des matières organiques et plusieurs dispositifs sont appliqués pour améliorer sa qualité : lavage par hydro cyclone, extraction des fosses de stockage par des moyens mécaniques qui font, en même temps, office de laveur de sable (vis d’Archimède en auge inclinée, classi¿cation à mouvement alternatif…). Le volume de sable extrait par habitant et par an est de l’ordre de 5 à 12 dm3. x Déshuilage-dégraissage Le dégraisseur a pour objet la rétention des graisses par flottation naturelle ou accélérée par injection de fines bulles (photo 4). Les teneurs en graisses sont appréciées analytiquement par la mesure des MEH (Matières Extractibles à l’Hexane). Ces matières grasses sont susceptibles de nuire à la phase biologique du traitement (mousses, …).
Le traitement primaire (décantation primaire)
Le traitement primaire consiste en une simple décantation. Elle permet d’alléger les traitements biologiques et physico-chimiques ultérieurs, en éliminant une partie des solides en suspension. L’efficacité du traitement dépend du temps de séjour et de la vitesse ascensionnelle (qui s’oppose à la décantation). [8] La décantation primaire permet d’éliminer, pour une vitesse ascensionnelle de 1.2m/h, 40 à 60% de MES, soit 40% de MO, 10 à 30 % de virus, 50 à 90% des helminthes et moins de 50% des kystes de protozoaires et entraine également avec elle une partie des micropolluante.
Coagulation – floculation
Les procédés de coagulation et de floculation facilitent l’élimination des MES et colloïdales. a)Coagulation Le but de la coagulation est de rompre ces forces électrostatiques et de déstabiliser les colloïdes afin de favoriser leur agglomération, et ça en neutralisant les charges de ces substances. Pour ce faire, on injecte dans l’eau des réactifs chimiques chargés positivement nommés « coagulants ». L’injection d’un coagulant doit se faire à un endroit où l’agitation est très forte afin qu’il se disperse rapidement dans l’eau brute. La neutralisation des charges conduit à la formation des « flocs » capables de décanter. Pour les substances organiques dissoutes, elle provoque la formation d’un sel nommé humât d’aluminium ou de fer, selon le coagulant employé.
|
Table des matières
Introduction générale
1 Chapitre: Présentation des filières de traitement des eaux usées
1.1 Origine des eaux usées
1.1.1 Eaux usées domestiques
1.1.2 Eaux usées industrielles
1.1.3 Eaux de ruissellement
1.2 Les paramètres des pollutions
1.2.1 Caractéristiques chimiques
1.2.1.1 Demande biochimique en oxygène (DBO5)
1.2.1.2 Demande chimique en oxygène (DCO)
1.2.2 Caractéristiques minérales
1.2.2.1 PH (Potentiel hydrogène)
1.2.2.2 Nutriments (Azote et phosphore)
1.2.3 Caractéristiques physiques
1.2.3.1 turbidité
1.2.3.2couleur
1.2.3.3odeur
1.2.3.4température
1.2.3.5Matières en suspension (MES)
1.2.3.6Matières décantables et non décantables
1.2.4 Caractéristiques biologiques
1.2.4.1 bactéries
1.2.4.2virus
1.2.4.3Champignons
1.2.4.4Protozoaires
1.2.4.5Helminthes
1.3 Traitement des eaux usées
1.3.1 Prétraitement
1.3.2 traitement primaire (décantation primaire)
1.3.2.1 Coagulation – floculation
1.3.3 traitement secondaire (traitement biologique)
1.3.3.1 procédés extensifs
1.3.3.2 procédés intensifs
a. Lit bactérien
b. Disques biologiques
c. Boues activées
1.3.4 Traitement tertiaire des eaux usées
1.3.4.1 Désinfection des effluents
1.3.4.2Traitement de l’azote
1.3.4.3 Elimination du phosphore
1.3.5 Traitements des boues
1.3.5.1 Principales de traitement
1.3.5.2 Epaississement
1.3.5.3 Déshydratation
1.3.5.4 Séchage
2 Chapitre : Description Générale du schéma directeur d’assainissement de la ville de Tlemcen
2.1 Présentation générale de la région
2.1.1 Situation géographique
2.1.2 Situation hydrographique
2.1.3 Situation démographique
2.1.4 Situation climatique
2.2 Alimentation en eau potable de la ville de Tlemcen
2.3 Assainissement des eaux usées dans la ville de Tlemcen
2.3.1 Type de réseau ou système
2.3.2 Présentation de bassin versant de la ville de Tlemcen
2.3.3 Description générale du système d’assainissement de la ville Tlemcen
2.3.4 Réseaux d’assainissements de la ville qui raccordée vers la station épuration
2.4 Description de la station de d’épuration de Tlemcen
2.4.1 Situation géographique
2.4.2 Etat actuel des ouvrages de la station
2.4.2.1 Données techniques et caractéristiques fondamentales
2.4.2.2 Données de base
2.4.3 Description des ouvrages
2.4.3.1 Les ouvrages d’entrée
2.4.3.2 Les prétraitements
2.4.3.4 Traitement des boues
2.4.4 Identification, origines et causes des problème
2.4.4.1 Problème d’entretien
2.4.4.2 Saturation de la step
2.5 Interventions et travaux
3 Chapitre : Etude d’extension de la station d’épuration d’Ain el houtz
3.1 Révision de la dimension dans l’état Actuelle(2013)
3.1.1 Estimation de la population
3.1.2 Calcul des débits et des charges polluantes
3.1.2.1 Calcul des débits
3.1.2.2 Calcul des charges polluantes
3.2 Dimensionnements les ouvrage de station à l’état Actuelle 2013
3.2.1 Calcul des ouvrages de prétraitements
3.2.1.1 Calcul du dégrilleur
3.2.1.2 Calcul du dessableur dégraisseur
3.2.2 Traitement biologique
3.2.2.1 Bassin d’aeration
3.2.2.2 Clarificateur
3.3 Extension de la station d’épuration à l’horizon 2033
3.3.1 Calcul des débits et des charges polluantes
3.3.1.1 Calcul des débits
3.3.1.2 Calcul des charges polluantes
3.4 Calcul les ouvrage de station
3.4.1 Calcul des ouvrages de prétraitements
3.4.2 Traitement biologique
3.4.2.1 Bassin d’aeration
3.4.2.2 Aération
3.4.2.3 Clarificateur
3.4.2.4 Bassin de désinfection
3.4.2.5 Traitement des boues
4 Chapitre : Proposition d’aménagement d’un bassin d’orage
4.1 Définition du bassin d’orage
4.2 Rôle des bassins d’orage
4.3 Les types du bassin d’orage
4.3.1 Les bassins creux ou sans digue
4.3.2 Les bassins avec digue
4.3.3 Les bassins secs
4.3.4 Les bassins d’absorption
4.4 Implantation du bassin d’orage
4.5 Fonctionnement des bassins d’orage
4.6 Les méthodes des calculs les bassins d’orage
4.6.1 Méthode de volume d’un bassin
4.6.2 La méthode de la pluie critique
4.6.3 Le dimensionnement d’un bassin d’orage à AIN EL HOUTZ
4.6.3.1 Débit usées
4.6.3.2 Débit en temps sec
4.6.3.3 Débit de pluie critique
4.6.3.4 Le débit critique
4.6.3.5 Débit aval admissible
4.6.3.6 Le Débit pluvial en aval
4.6.3.7 L’intensité critique de pluie en aval
4.6.3.8 Le temps de concentration
4.6.3.10 La durée de stockage débit critique
Conclusion générale
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet