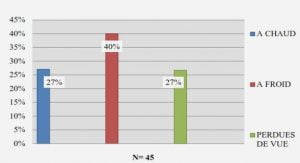BIOLOGIE DES ESPECES
CHAPITRE II ETUDE BIOCLIMATIQUE
INTRODUCTION
La végétation de la région méditerranéenne comme toutes les végétations du globe terrestre résulte, de l‘interaction d‘une multitude de facteurs écologiques, toute fois elle doit sa spécificité à l‘un en particulier le climat (Aubert, 1988) .
Ainsi à l‘ouest algérien et plus précisément sur les monts de Tlemcen, la végétation est à l‘image du climat. La saison estivale est de 6 mois environ, sèche et chaude, alors que le semestre hivernal (octobre – avril) est pluvieux et froid. En effet, « la pluie avec la température constituent la charnière du climat, elles influent directement sur la végétation » (Barry-Lenger et al, 1979), c‘est pour cela que le cortège floristique doit sa diversité à l‘effet des précipitations conjugué à celui des températures.
Par ailleurs , nombreux sont les travaux réalisés sur la bioclimatologie et la climatologie , sur l‘Algérie et monts de Tlemcen citons à titre d‘exemple Seltzer (1946), Bagnouls et Gaussen (1953) , Long (1954), Bortoli et al (1969), Chaumont et Paquin (1971), Stewart (1974), Le Houérou et al (1977), Alcaraz (1982), Djebaïli (1984), Benabadji (1991,1995), Bouazza (1991,1995), Aïnad-Tabet (1996), Benabadji et Bouazza (2000) et Hasnaoui (2008).
Aussi, tenterons-nous de caractériser notre zone d‘étude sur le plan climatique, à partir de données météorologiques fournies par les stations suivantes Hafir, Tlemcen et Saf-Saf.
Cette étude bioclimatique nous sera d‘une grande utilité, puisqu‘elle déterminera par la suite, dans quelle ambiance climatique se développe la végétation des monts de Tlemcen, et notamment celle se rapportant aux « pelouses thérophytiques ».
Le tableau (1) récapitule les renseignements des stations retenus.
ANALYSE DE CERTAINS PARAMETRES CLIMATIQUES
Les précipitations
Les monts de Tlemcen sont caractérisés par une irrégularité spatio-temporelle et de la pluviosité. L‘origine orographique de ce régime pluviométrique semble être confirmée par Alcaraz (1969), mais peut-être dû aussi à des facteurs tels que les vents, l‘altitude et les versants à exposition nord ou sud.Par ailleurs, la tranche pluviométrique que reçoivent les monts de Tlemcen, est nettement atténuée par rapport à celle de l‘Est et du centre, et selon Dahmani (1984), ceci à cause de l‘existence d‘obstacles topographiques, telle la Sierra Nevada Espagnole, et l‘Atlas marocain qui ne font que défavoriser cette région.En réalité, cette tranche pluviométrique varie entre 500 et 800 mm/ an au niveau des monts de Tlemcen, atteignant parfois même les 1000 mm/an dans les zones d‘altitudes (Djebel tenouchfi, 1843 m d‘altitude), comme elle peut être basse de 300 à 400 mm / an dans le sud (environ Sebdou).
Les précipitations moyennes mensuelles et annuelles (tableaux (2) et (3))
Une toute première remarque s‘impose, est que pour l‘ensemble des stations climatiques préconisées, les précipitations sont égales ou dépassent le seuil des 400 mm / an, et cela à toutes périodes confondues.
Les maximas sont enregistrés au niveau du massif le plus élevé Hafir. En effet, cette station dépasse les 700 mm / an (pour l‘ancienne période), alors que pour la nouvelle période on note à peine 483,98 mm / an, Par contre Tlemcen et Saf-Saf restent les stations qui présentent les valeurs pluviométriques les plus basses, n‘atteignant même pas les 700 mm / an
Quant a la répartition mensuelle des pluies, celle-ci semble traduire une grande variabilité, ainsi qu‘une irrégularité bien soulignée.
En effet, la quantité des pluies, varie selon les localités d‘une part, et selon la saison d‘autre part. On remarque bien d‘ailleurs la différence de pluviosité qui existe entre les mois de juin, juillet, aout, septembre où on note le moins de précipitations, et les mois restants pour qui les pluies sont significatives.
Mais toujours est-il que le maximum pluviométrique reste hivernal oscillant entre les mois de novembre, décembre, janvier, février et mars, c‘est le cas de toutes les stations.
En résumé, cette variabilité bien accusée, dans la répartition des pluies, ne peut être expliquée que par une hétérogénéité topographique agissant par conséquence sur la composition et la distribution de la végétation (Mahboubi, 1995).
Régimes saisonniers des précipitations (Tableau 4), (Fig 3)
Pour l‘ancienne période, il semblerait que le régime pluviométrique saisonnier, soit du type HPAE englobant l‘ensemble des stations (Hafir, Tlemcen, Saf-Saf) (voir Fig3), pour un maximum de précipitations allant de 218 à 245 mm en hiver.
Pour les nouvelles périodes par contre, même si le type de régime saisonnier reste inchangé (HPAE), on constate une nette diminution de la quantité des pluies qui est très visible au niveau de la figure 3.
Tableau 2 Précipitations moyennes mensuelles et annuelles en (mm) (Ancienne période 1913 – 1938)
Tableau 3 Précipitations moyennes mensuelles et annuelles en (mm) (Nouvelles périodes Hafir (1975 – 1996) , Tlemcen et Saf-Saf (1990 – 2007) .
O Ancienne période * Nouvelles périodes
Ces constatations, nous permettent de confirmer que les monts de Tlemcen, se caractérisent par une saison où les pluies sont maximales (Hiver), et par une saison sèche qui est l‘été. Le printemps reste aussi une saison très arrosée (c‘est le cas de la plupart de nos stations), cela favorise d‘ailleurs la reprise et la floraison de la végétation, et le repeuplement des pelouses en espèces annuelles.
Les températures
La température représente un facteur limitant de toute première importance. Elle joue le rôle capital dans la vie des végétaux, car elle contrôle l‘ensemble des phénomènes métaboliques, et conditionne de ce fait leur répartition et leur développement.
Nous prendrons en considération, dans le paragraphe qui suit, les moyennes mensuelles, les minima et les maxima.
Températures moyennes mensuelles (Tableaux (5) et (6) )
La lecture du tableau (5), montre clairement que les températures moyennes mensuelles les plus fortes, se situaient au mois d‘août, et cela pour l‘ensemble des stations prises en compte. Remarquons, tout de même que Saf-Saf est la région où on enregistre la plus haute température, atteignant une moyenne mensuelle de 26° C pour le mois d‘août, ceci étant retenu durant l‘ancienne période.
Pour les nouvelles périodes, la station de Saf-Saf reste toujours en tête avec une moyenne mensuelle de 26,3°C pour le mois d‘août ; Seul petit changement à relever, est que les mois les plus chauds varient entre juillet pour (Hafir) et aout (Tlemcen et Saf-Saf), (Tableau 6).
Tableau 6 Températures moyennes mensuelles en (°C) (Nouvelles périodes)
En somme, ces températures moyennes, oscillent suivant les mois et les saisons.
Moyennes des minimums du mois le plus froid (m°C) (Tableaux (7) et (8))
La température moyenne minimale du mois le plus froid durant (1913 – 1938), (Tableau 7), variait entre les valeurs de 1,8 °C pour Hafir et 5,8 °C pour Saf-Saf. Pour les nouvelles périodes par contre, on enregistre une légère hausse de la température moyenne minimale, celle-ci s‘étale de 3,2 °C (Hafir) à 6,44 °C (Saf-Saf) (Tableau 8).
Tableau 7 Moyenne des « MINIMA » (m°C) du mois le plus froid (Ancienne période 1913 – 1938)
Le gradient altitudinal thermique se caractérise selon Seltzer (1946), par une augmentation du minima avec l‘altitude, il généralise cette décroissance pour toutes les stations météorologiques du pays, et cela pour une valeur de 0,4 °C tous les 100 mètres.
Moyennes des maximums du mois le plus chaud (M °C) (tableaux (9) et (10))
L‘examen des tableaux (9) et (10), montre bien, que pour l‘ensemble des stations, la température moyenne maximale (M) est supérieure à 30°C toutes périodes confondues. En effet, elle d‘échelonnait de 30,25°C (Tlemcen) à 33,1 °C (Hafir) pour l‘ancienne période, alors pour les nouvelles périodes celle-ci s‘étale de 31,02 °C (Tlemcen) à 33,7 °C (Saf-Saf).
Les réflexions émises à partir des valeurs de températures des différents tableaux, nous amènent à définir la saison chaude de la saison froide, qui correspond généralement aux 04 mois suivants Juin, Juillet, Août, et parfois même Septembre, qui sont d‘habitude les plus secs.
Tableau 9 Moyennes des « MAXIMA » (M °C) du mois le plus chaud (Ancienne période (1913 – 1938))
SYNTHESE BIOCLIMATIQUE
Amplitudes thermiques moyennes (écarts thermiques) (Tableau 11)
L‘indice de continentalité est définit par rapport à l‘amplitude thermique moyenne (M – m), cet indice permet à son tour de préciser l‘influence qui peut être soit maritime, soit continentale sur une région bien déterminée.
Debrach (1953), a pu proposer en effet, une classification thermique de climats, à partir des limites que peut avoir (M – m)
• M – m < 15 °C Climat insulaire
• 15 °C < M – m < 25 °C Climat littoral
• 25 °C < M – m < 35 °C Climat semi-continental
• M – m > 35 °C Climat continental
Par conséquent, nous constatons de l‘analyse du tableau (11) que les écarts thermiques calculés des différentes stations ne sont pas très élevés, et présentent de faibles fluctuations, puisqu‘ils restent compris entre les 25 °C (Tlemcen) et les 31,3 °C (Hafir).
Aussi, en faisant appel à la classification thermique des climats déjà cités, notre zone d‘étude correspond à un climat « semi-continental » avec (25 °C < M – m < 35 °C)
Tableau 11 Amplitudes thermiques moyennes
Indice de sécheresse estivale (tableau 12)
Etant donnée l‘intensité et l‘importance de la saison sèche, reflétant ainsi un climat méditerranéen typique Emberger (1942), propose un indice de xéricité « l‘indice de sécheresse estivale », pour justement évaluer cette intensité
Is = P / M
Où P Etant la pluviosité estivale (mm)
M moyenne des maxima thermique de la période estivale
Tableau 12 indices de sécheresse des stations de référence (nouvelles périodes)
|
Table des matières
INTRODUCTION GENERALE
PREMIERE PARTIE CADRE D’ETUDE
CHAPITRE I PRESENTATION DE LA ZONE D‘ETUDE
I. 1 SITUATION GEOGRAPHIQUE (Fig.1)
I.2. APERÇU GEOLOGIQUE
I.3. APERÇU HYDROGEOLOGIQUE
I.4. APERÇU GEOMORPHOLOGIQUE
I.4.1. Reliefs
I.4.2. Dynamique des versants
I.4.3. La plaine
I.5. APERÇU SOMMAIRE DE PEDOLOGIE
I.6. DESCRIPTION DES STATIONS D‘ETUDE (Fig. 2)
CHAPITRE II ETUDE BIOCLIMATIQUE
II.1. INTRODUCTION
II.2. ANALYSE DE CERTAINS PARAMETRES CLIMATIQUES
II – 2 – 1 Les précipitations
II.2.1.1. Les précipitations moyennes mensuelles et annuelles (tableaux (2) et (3))
II.2.1.2. Régimes saisonniers des précipitations (Tableau 4), (Fig 3)
II.2.2. Les températures
II.2.2.1. Températures moyennes mensuelles (Tableaux (5) et (6) )
II.2.2.2. Moyennes des minimums du mois le plus froid (m°C) (Tableaux (7) et (8))
II.2.2.3. Moyennes des maximums du mois le plus chaud (M °C) (tableaux (9) et (10))
II.3. SYNTHESE BIOCLIMATIQUE
II.3.1. Amplitudes thermiques moyennes (écarts thermiques) (Tableau 11)
II.3.2. Indice de sécheresse estivale (tableau 12)
II.3.3. Diagrammes ombrothermiques (Bagnouls et Gaussen, 1953) – (Fig4)
II.3.4. Quotient pluviothérmique et climagramme d‘Emberger
II.4. CONCLUSION
CHAPITRE III APPROCHE PEDOLOGIQUE
III.1. INTRODUCTION
III.2. ANALYSES PEDOLOGIQUES
III.2.1. Analyses physico-chimiques du sol
III.2.1.1. La texture
III.2.1.2. L‘humidité au champ
III. 2.1.3. La couleur
III.2.1.4. Le pH
III.2.1.5. La conductivité électrique (CE) et la salinité
III.2.1.5.1. La conductivité électrique
III.2.1.5.2. La salinité
III.2.1.6. Le calcaire total
III.2.1.7. La teneur en matière organique
III.3. RESULTATS
III.4. INTERPRETATION DES RESULTATS
III.4.1. La couleur
III.4.2. La texture
III.4.3. L‘humidité
III.4.4. Le ph
III.4.5. La conductivité électrique (CE) et la salinité
III.4.6. Le calcaire total (CaCo3)
III.4.7. La teneur en matière organique
III.5. CONCLUSION
DEUXIEME PARTIE AUTO-ECOLOGIE DES ESPECES Brachypodium distachyum et Hordeum murinum
CHAPITRE I BIOLOGIE DES ESPECES
I.1. INTRODUCTION
I-2- SYSTEMATIQUE
I.3. BRACHYPODIUM DISTACHYUM (Fig. 6)
I.3.1.Tige ou «chaume »
I.3.2. Feuilles
I.3.3. Racines
I.3.4. Inflorescence
I.3.5. Fruit
I.4. HORDEUM MURINUM (Fig. 7)
I.4.1. Tige (chaume)
I.4.2. Feuilles
I.4.3. Racines
I.4.4. Inflorescence
I.4.5. Fruit
I.5. IMPORTANCE DES POACEES
I.6. CONCLUSION
CHAPITRE II ETUDE BIOMETRIQUE DU Brachypodium distachyum
II.1. INTRODUCTION
II.2. METHODOLOGIE
II.3. INTERPRETATION DES RESULTATS
II.4. CONCLUSION
CHAPITRE III PROFILS EDAPHOLOGIQUES
III.1. INTRODUCTION
III.2. METHODE
III.3. INTERPRETATION DES PROFILS ECOLOGIQUES
III.3.1. Brachypodium distachyum (Fig. 14)
III.3.2. Hordeum murinum (Fig. 15)
III.3.3. Chrysanthemum grandiflorum (Fig. 16)
III.4. CONCLUSION
TROISIEME PARTIE ETUDE FLORISTIQUE
CHAPITRE I APERÇU BIBLIOGRAPHIQUE SUR LA CLASSE DES THERO-BRACHYPODIETEA
I.1. INTRODUCTION
I.2. DESCRIPTION ET SYSTEMATIQUE DE LA CLASSE DES THERO-BRACHYPODIETEA (Braun – Blanquet, 1947)
I.2.1.Ordre des Thero-Brachypodietalia (Braun – Blanquet, 1931), (Molinier, 1934)
I.2.2. Ordre des Lygeo – Stipetalia (Braun – Blanquet et O. de Bolos, 1954)
I.3. LES THERO – BRACHYPODIETEA EN TUNISIE
I.4. LES THERO – BRACHYPODIETEA EN ALGERIE
CHAPITRE II ANALYSE DE LA VEGETATION
II.1. METHODE DES RELEVES FLORISTIQUES
II.2. AIRE MINIMALE
CHAPITRE III APPROCHE PHYTOSOCIOLOGIQUE ET PHYTOECOLOGIQUE
III.1. APPROCHE PHYTOSOCIOLOGIQUE
III.1.1. INTRODUCTION
III.1.2. Les Thero – Brachypodietea en Algérie
III.1.3. Les Thero-Brachypodietea sur les monts de Tlemcen (région d‘étude)
III.1.3.1. L‘ordre des Thero-Brachypodietalia
III.1.3.2. L‘ordre des Lygeo – Stipetalia
III.2. APPROCHE PHYTO – ECOLOGIQUE
III.2.1. Faciès à herbacées xériques (tableau 24)
III.2.2. Faciès à herbacées moins xériques (tableau25)
III.3. CONCLUSION
CHAPITRE IV APPROCHE BIOLOGIQUE, MORPHOLOGIQUE ET BIOGEOGRAPHIQUE
IV.1. INTRODUCTION
IV.2. CARACTERISATION BIOLOGIQUE
IV.2.1. Spectre biologique
IV.2.2. Répartition des familles de la zone d‘étude
IV.3. CARACTERISATION MORPHOLOGIQUE
IV.4. CARACTERISATION BIOGEOGRAPHIQUE (tableau 30 et fig. 20)
IV.5. CONCLUSION
CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES
CONCLUSION GENERALE
PERSPECTIVES (Relations Agronomie et biodiversité)
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet