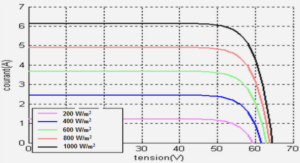Introduction
L’Alimentation en Eau Potable (A.E.P) est l’ensemble des équipements, des services et des actions qui permettent, en partant d’une eau brute, de produire une eau conforme aux normes de potabilité en vigueur, distribuée ensuite aux consommateurs. On considère quatre étapes distinctes dans cette alimentation :
prélèvements – captages (eau de surface ou eau souterraine).
traitement pour la potabilité de l’eau.
adduction (transport et stockage).
distribution au consommateur.
Les recherches menées actuellement dans le domaine des réseaux d’eau potable concernent essentiellement le control de vieillissement réseaux, la réalisation, le diagnostic et la construction de programme de contrôle que ça soit pour le stockage et le transport qu’il aide à diminuer les dégâts des interruptions répétées dans l’eau et aussi en raison de bénéfices entre l’entreprise et le consommateur. Ces différents problèmes constituent, de nos jours, une préoccupation majeure pour les gestionnaires des réseaux d’A.E.P.
Historique de l’eau potable
Dans cet historique nous allons intéresser sur le Transport et la conduire de l’eau puis le stockage est la distribution de l’eau. Au cours des siècles, pour avoir l’eau à leur disposition, les hommes fabriquent des moyens de puisage et des récipients pour le transport et le stockage. Ils mettent au point des techniques pour conduire l’eau sur les lieux de son utilisation et l’evacuer après usage. La rareté ou l’abondance de l’eau, les facilites ou les difficultés pour en disposer marquent les façons de vivre. L’histoire de l’eau et celle des hommes sont étroitement liées. Les premières implantations humaines ont eu lieu à proximité des points d’eau, à travers l’histoire, la conquête de l’eau par l’homme a été longue. Certaines périodes de l’histoire. Ne connais pas ou peu des changements concernant les rapports des hommes et de l’eau.
D’autres au contraire connurent de profonds bouleversements. Nous allons essayer de retracer rapidement l’évolution des usages de l’eau au fil du temps, nous allons intéresser d’abord à l’approvisionnement et l’évacuation des eaux, puis a son utilisation comme énergie et moyen de transport et pour finir, nous aborderons sur l’eau.Le transport de l’eau se fait à bout de bras, à l’aide de seaux, des cruches ou des récipients à anses. Le transport s’effectue aussi sur la tête dans des poteries ventrues. Quand la distance est importante, ils ont utilisé un joug ou un cercle comme les porteurs d’eau professionnels.Dans les régions a terrains perméables, les périodes de sécheresse pendant lesquelles les mares, les citernes et souvent les puits sont à sec, obligent à des transports plus longs, souvent avec attelage, charrette et tonneaux. Le transport de 1’eau est souvent confi aux femmes et aux enfants.
Du Moyen Age jusqu’au XXe siècle, les porteurs d’eau sont le principal moyen de distribution dans les villes et dans les campagnes, la corvée du seau d’eau va perdurer jusqu’au début de notre siècle. Les porteurs d’eau sont vingt mille à Paris en 1850 et les derniers cessent leur activité vers 1900. Au long des siècles, les hommes aménagent des points d’eau sur leurs lieux de vie; ils creusent des puits, construisent des citernes, installent des fontaines. Mais pour que des fontaines existent, il faut des adductions d’eau que seules les sociétés organisées et riches peuvent réaliser et entretenir. Si les villes sont dans l’Empire romain, bien pourvues de fontaines alimentées par les aqueducs, les villes françaises n’ont par la suite, et ce jusqu’au XXe siècle qu’un nombre de fontaines nettement insuffisantDès que la quantité d’eau utilisée par la communauté est beaucoup plus importante que celle nécessaire à l’alimentation humaine, amener l’eau par les conduites diverses devient indispensable, pour les rites, les bains, le spectacle des fontaines, Farrosage, l’abreuvement des animaux…
Conduire l’eau dans une rigole ou un canal, à partir d’ime source, d’une retenue sur un cours d’eau, est une technique que les hommes utilisent depuis très longtemps, certainement depuis le deuxième millénaire avant notre ère. La réalisation parait simple, elle exige pourtant du savoir-faire. L’eau doit s’écouler régulièrement tout en restant à l’altitude la plus élevée possible.
Les ressources hydriques
Selon les circonstances, envisager de recourir aux d’approvisionnement en eau suivantes :
Eaux de surface.
Eaux souterraines.
Eaux de pluie.
Eaux de mer et eaux saumâtres.
Eaux non-conventionnelles .
Alors les trois principales sources d’approvisionnement en eau sont :
-Eaux de surface : Les eaux de surface comprennent les eaux des cours, d’eau (lac,étangs, bassins, rivières, fleuves). Elles sont sujettes à contamination. En effet, ce sont des eaux ou viennent boire les animaux. Leurs abords constituent souvent sur les feuilles des arbres s’accumulent et s’y décomposent généralement.
-Eaux souterraines : Ce sont les eaux des nappes. Elles peuvent être classées en deux catégories :
les nappes phréatiques ou les nappes de puits : elles reposent non loin du sol (quelques dizaines de mètres), et sont peu protégées, donc soumises à la contamination biologique.
les nappes profondes : elles sont situées à quelques centaines de mètres de profondeur et reposent sur des couches de terre avant de constituer la nappe .
-Eaux non-conventionnelles : Sources d’approvisionnement complémentaire qui peuvent être substantielles dans les régions touchées par une pénurie extrême des ressources en eau renouvelables. Ils comprennent : la production d’eau douce par le dessalement de l’eau salée ou saumâtre (surtout à des fins domestique), la réutilisation des eaux usées urbaines ou industrielles (avec ou sans traitement), principalement dans l’agriculture mais de plus en plusdans l’industrie et les secteurs domestiques, l’eau de drainage agricole, le transfert entre bassins, la récolte de l’eau de pluie, l’ensemencement des nuages, la réutilisation des eaux grises, etc.
Définition du réseau de distribution :
Est l’ensemble des intermédiaires de la distribution « grossistes ou détaillants » permettant la commercialisation d’un bien, et parfois même sa promotion. Il s’apprécie en fonction de deux paramètres : le nombre d’intermédiaires qui le composent, et la couverture géographique. Donc les réseaux de distribution différents suivant la nature du produit, la zone géographique de commercialisation ou encore la cible visée [6]. Alors ils existent deux types de réseaux de distribution l’une et le réseau de distribution continue. Par exemple « les réseaux de la distribution d’eau et du gaz, etc.…. ». Et l’autre réseau et le réseau de distribution discontinue. Par exemple « la distribution à l’aide d’un camion ou bien un véhicule, etc… ».
La logistique industrielle
LE LOGISTICS INSTITUTE définit la logistique(1996), comme une collection des fonctions relatives aux flux des marchandises, d’information et de paiement entre lesfournisseurs et les clients depuis l’acquisition des matières premières jusqu’au recyclage ou la mise au rebut des produit finis.
LE COUNCIL OF LOGISTICS Management définit la logistique (1985),comme le processus de planification, de mise en œuvre et de contrôle des flux et des stocks de matière première, en cours produit finis et des flux d’information associé, de leur point d’origine jusqu’à leur point de consommation, dans le but de satisfaire les attentes du client de manière efficiente et au moindre coût.
L’APICS définie, la logistique comme l’art et la science de l’approvisionnement, de la production et de la distribution des composants et produits fabriqués à la bonne place et en bonne quantité.
L’AFNOR définit, la logistique comme la planification, l’exécution et la maitrise des mouvements et des mises en place des personnes ou des biens, et des activités de soutien liées à ces mises en place, au sein d’un même système organisé pour atteindre des objectifs spécifiques.
On distingue classiquement :
La LOGISTIQUE Interne : organisation et gestion des flux au sein de l’entreprise
La LOGISTIQUE Externe, elle-même décomposable en :
-logistique d’approvisionnement : organisation et gestion des flux des fournisseurs.
-logistique de distribution : organisation et gestion des flux de l’entreprise jusqu’aux clients .
Donc, La LOGISTIQUE= MATERIALS MANAGMENT+DISTRIBUTION.
Définition d’une chaine logistique
La chaîne logistique englobe l’ensemble des opérations réalisées pour la fabrication d’un produit ou d’un service allant de l’extraction de la matière première à la livraison au client final en passant par les étapes de transformation, le stockage, et la distribution. De nos jours de plus en plus on regarde la chaîne logistique comme une toile regroupant plusieurs des activités citées, cela est dû à la complexité des organisations actuelles et à leurs dimensions internationales ajoutées aux flux des matières. La chaîne logistique inclut les flux d’information et les flux financiers.
Chaque étape de transformation ou de distribution peut impliquer de nouveaux acteurs, soit de nouveaux fournisseurs ou de nouveaux clients intermédiaires, avec également des nouveaux flux d’informations. Il semble qu’il existe un certain consensus entre les auteurs sur la définition de « la Chaîne Logistique » : Selon « La Londe et Masters » une chaîne logistique, est un ensemble d’entreprises qui se transmettent des matières. En règle générale, plusieurs acteurs indépendants participent à la fabrication d’un produit et à son acheminement jusqu’à l’utilisateur final, producteur de matières premières et de composants, assembleurs, grossistes,distributeurs et transporteurs sont tous membre de la chaîne logistique.Aussi, une chaîne logistique peut être définie, comme un « Réseau d’installation Qui Assure Les Fonctions d’approvisionnement En Matières Premières, De Ces Matières Premières En Composants Puis En Produits Finis Et De Distribution Du Produits Finis Vers Les Clients » [Lee]. Selon [Supply Chain Council, 1997] : « La chaîne logistique globale (ou Supply Chain) est un terme anglo-saxon qui englobe tous les acteurs impliqués dans la production et la livraison d’un produit fini ou d’un service depuis le fournisseur du fournisseur jusqu’au client du client, elle est constituée de fournisseurs, de fabricants de distributeurs et de clients ». [Poirier et Reiter, 2001] : Définissent ainsi la chaîne logistique, d’une façon plus générale. Étant comme : « une chaîne logistique est le système grâce auquel les entreprises amènent leurs produits et leurs services jusqu’à leurs clients » .
L’AFNOR définit une chaîne logistique, comme une suite d’événements pouvant inclure des transformations, des mouvements ou des mises en place et apportant une valeur ajoutée. Une chaîne logistique est composée d’une unité de production, d’une unité de stockages et de réseaux de transport ou distribution et de communication entre ces différents nœuds, et les processus de mise à disposition des produits de la conception au client final. En d’autre terme la chaîne logistique désigne l’ensemble des maillons de la logistique d’approvisionnement : achats, gestion des stocks, manutention, stockage, etc.
|
Table des matières
Introduction générale
Chapitre 1 : Généralités sur la distribution de l’eau potable
1.1 Introduction
1.2 Historique de l’eau potable
1.3 Les ressources hydriques
1.4 La distribution de l’eau potable
1.4.1 Définition du mot distribution (1)
1.4.2 Définition du mot distribution (2)
1.4.3 Définition du circuit de distribution
1.4.4 Définition du réseau de distribution
1.4.5 Définition du réseau de distribution de l’eau potable
1.5 Moyens de transport de l’eau potable
1.6 Configuration des systèmes de distribution de l’eau potable
1.7 Anatomie d’un système de distribution de l’eau potable
1.8 Élément constitutifs d’un réseau de distribution de l’eau potable
1.8.1 Les matériaux des canalisations
1.8.2 Les joints
1.8.3 Les vannes
1.8.4 Les ventouses
1.8.5 Les décharges
1.8.6 Les poteaux d’incendie
1.8.7 La pression dans le réseau
1.8.8 Problèmes rencontrés dans un réseau de distribution d’eau potable
1.8.8 Problèmes de gestion des réseaux d’AEP en Algérie
1.9 Conclusion
Chapitre 2: Intégration de la chaine logistique dans le réseau de distribution de l’eau potable
2.1 Introduction
2.2 La logistique industrielle
2.2.1 Définition
2.3 L’importance de la logistique
2.4 Etat de l’art sur les chaines logistiques
2.5 Définition d’une chaine logistique
2.6 La décision dans la chaine logistique
2.6.1 Les décisions stratégiques
2.6.2 Les décisions tactiques
2.6.3 Les décisions opérationnelles
2.7 La gestion de la chaine logistique
2.8 Les outils d’aide à la décision multicritère
2.9 La méthode VRP (Vehicule Routing Problem)
2.10 Définition de programme LINGO
2.10.1 Description de modèle sur LINGO
2.10.2 Discussion sur les objectifs
2.10.3 Discussion sur les résultats
2.11 Conclusion
Chapitre 3: Automatisatoins du château d’eau et les systèmes des controles
3.1 Introduction
3.2 L’automate programmable industriel « API »
3.2.1 Historique de l’automate
3.2.2 Définition de l’automatisme
3.2.3 Définition de l’automate programmable industriel « API »
3.2.4 Les buts (ou objectifs) de l’automatisation
3.2.5 Les avantages et les inconvénients d’un API
3.3 Structure d’un système automatisé
3.3.1 La partie opérative « O.P »
3.3.2 La partie commande « P.C »
3.4 Description des composants d’un API
3.5 Les types d’un automate programmable industriel « API »
3.6 La simulation du Grafcet sur le logiciel Step7
3.6.1 Cahier des charges
3.6.2 Les solutions technologiques
3.6.3 Analyse temporelle du système
3.7 Les systèmes des contrôles
3.7.1 Notion sur les systèmes des contrôles
3.7.2 Contrôle manuel
3.7.3 Système de contrôle distribué (DCS)
3.8 Définition de système de contrôle distribué (DCS)
3.9 Les principaux objectifs de ce système
3.10 Les avantages de DCS
3.11 Conclusion
Chapitre 4: Réalisation de la maquette
4.1 Introduction
4.2 Description de la réalisation pratique
4.3 Présentation de l’Arduino
4.3.1 Qu’est-ce que c’est ?
4.3.2 Description de l’Arduino UNO
4.3.3 Caractéristique de l’Arduino UNO
4.4 Capteur de température et d’humidité DHT11
4.4.1 Le montage du capteur de DHT11
4.5 Capteur de niveau
4.5.1 Spécification
4.5.2 Montage du capteur de niveau « flotteur »
4.6 Plaque d’essai
4.7 Le ventilateur 12V
4.8 Pompe 12V
4.8.1 Caractéristique de pompe 12 V
4.9 Présentation de la maquette
4.10 Présentation de logiciel utilisé
4.10.1 logiciel Arduino
4.10.2 Principe de fonctionnement de logiciel
4.11 Equipement nécessaire à l’ambiance climatique du château d’eau
4.11.1 Equipements de control
4.11.2 Température
4.11.3 Matériel de chauffage
4.11.4 Ventilation
4.12 Produire de l’énergie à partir de sources renouvelables
4.13 Maquette finale
4.14 Conclusion
Conclusion générale
Référence bibliographique
Annexes
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet