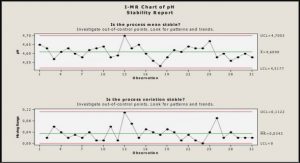Matières d’œuvre
Une matière d’œuvre peut se présenter sous plusieurs formes. Par exemple :
• un PRODUIT, c’est-à-dire de la matière, à l’état solide, liquide ou gazeux, et sous une forme plus ou moins transformée :
− des objets techniques : lingot, roulement, moteur, véhicule…
− des produits chimiques : pétrole, éthylène, matière plastique…
− des produits textiles : fibre, tissu, vêtement…
− des produits électroniques : transistor, puce, microprocesseur, automate programmable…
− etc.
− qu’il faut : concevoir, produire, stocker, transporter, emballer, utiliser…
• de l’ENERGIE
− sous forme : électrique, thermique, hydraulique…
− qu’il faut : produire, stocker, transporter, convertir, utiliser…
• de l’INFORMATION
− sous forme écrite, physique, audiovisuelle…
− qu’il faut : produire. stocker, transmettre, communiquer, décoder, utiliser…
• des ETRES HUMAINS
− pris individuellement ou collectivement
− qu’il faut : former, informer, soigner, transporter, Servir…
Les actionneurs électriques
– Moteur à courant alternative : Il existe deux sortes de moteur à courant alternatif: En premier nous avons les moteurs synchrones qui sont utilisés pour les TGV aussi appelé alternateur quand il est utilisé comme générateur. En deuxième on trouve le moteur asynchrone Qui ne possède aucune connexion entre le rotor et le stator (cas rotor cage d’écureuil). Ce moteur est essentiellement alimenter par des systèmes de courant triphasés.
– Les moteurs pas à pas : Ce sont des machines électrique Synchrone, ou le rotor est en aimant permanant, Et le stator constitue par des bobines commandées par un courant continu géré par un système électronique
– Une machine électrique à courant continu est constituée : D’un stator à base d’un flux de champ magnétique crée soit par des enroulements bobinée soit par un aiment permanent D’un rotor bobiné relié à un collecteur rotatif inversant la polarité de chaque enroulement rotorique.
LES CAPTEURS
Un Capteur est un dispositif transformant l’état d’une grandeur physique observée en une grandeur utilisable. Un détecteur est un dispositif technique (instrument, substance, matière) qui change d’état en présence de l’élément ou de la situation pour lequel il a été spécifiquement conçu. Quelque principe physique exploité par les capteurs : Angle, Courant, Champ magnétique, Débit, Déplacement, Distance, Force, Inertiels, Lumière, Niveau, Position, Pression, Son, Température, forme.
a – Les capteurs tout ou rien : Sur la majorité des systèmes automatisés, le traitement des données est effectué sur des variables de type logiques (informations sur 2 états). Ces variables représentent généralement :
• La présence ou l’absence de l’objet à détecter
• Le passage de l’objet
• Le positionnement de l’objet
• Éventuellement le comptage de l’objet
En fonction des applications on distingue deux Types de technologies :
• Les capteurs à détection avec contacte pour lequel l’objet à détecter entre dir en contact avec un élément du capteur
• Les capteurs à détection sans contact, pour lesquels l’objet est le capteur
Les interrupteurs de positions sont des appareils actionnés par contact direct avec l’objet à détecter. Ils transforment ce contact physique en une fermeture ou ouverture d’un contact électrique.
• Le dispositif d’attaque
• Le corps équipé de contact
• La tête de commande (tête
– Le Détecteur inductif
Les détecteurs inductifs sont des appareils capables de détecter des objets métalliques à distance. Une sortie statique informe de la détection
Les capteurs à détection avec contacte pour lequel l’objet à détecter entre dir avec un élément du capteur
Les capteurs à détection sans contact, pour lesquels l’objet est détecté
Les interrupteurs de positions sont des appareils actionnés par contact direct avec l’objet à transforment ce contact physique en une fermeture ou ouverture d’un contact
Le dispositif d’attaque (à poussoir, à levier, à tige…)
Le corps équipé de contact (NO ou NF) (tête à mouvement rectiligne, angulaire ou multidir
Les détecteurs inductifs sont des appareils capables de détecter des objets métalliques à distance. Une sortie statique informe de la détection
Les capteurs à détection avec contacte pour lequel l’objet à détecter entre directement détecté à distance par
Les interrupteurs de positions sont des appareils actionnés par contact direct avec l’objet à transforment ce contact physique en une fermeture ou ouverture d’un contact multidirectionnel)
Les détecteurs inductifs sont des appareils capables de détecter des objets métalliques à
– Le détecteur capacitif : Les détecteurs capacitifs sont des appareils capables de détecter des objets métal isolants à distance (solide, liquide ou détection. Un détecteur capacitif se compose essentiellement d’un oscillateur dont les condensateurs constituent la face sensible. Celle L’autre armature étant constit sortie, correspondant à un contact NO ou NF, est délivré.
– Les détecteurs photoélectriques : Ce sont des appareils capables de détecter des objets à très grandes distances centimètres à plusieurs dizaines de avec ou sans réflecteur, ou de deux boîtiers; l’un émetteur, l’autre récepteur. Principe de fonctionnement Un détecteur de type barrage est composé d’un émetteur de lumière associé à un récepteur photosensible. Dans le cas du système barrage, les deux composants sont indépendants et placés l’un en face de l’autre. Les détecteurs capacitifs sont des appareils capables de détecter des objets métal solide, liquide ou pulvérulent). Une sortie statique informe de la Un détecteur capacitif se compose essentiellement d’un oscillateur dont les condensateurs constituent la face sensible. Celle-ci est formée par l’une des armatures du condensateur. L’autre armature étant constituée par l’objet à détecter. Après mise en forme, un signal de sortie, correspondant à un contact NO ou NF, est délivré.
b – LES CAPTEURS ANALOGIQUES : Le fonctionnement des thermomètres à résistan phénomène physique, à savoir la variation de la résistance électrique d’un conducteur avec la température. Mais comme ces variations sont différentes suivant qu’il s’agit d’un métal ou d’un agglomérat d’oxydes métalliques, deux cas ont été distingués sous les appellations de thermomètre à résistance d’une part et de thermistance d’autre part.
Contraintes du monde industriel
Influences externes :
− poussières,
− Température
− humidité,
− vibrations,
− parasites électromagnétiques, …
Personnel :
− mise en œuvre du matériel aisée (pas de langage de programmation complexe)
− dépannage possible par des techniciens de formation électromagnétique)
− possibilité de modifier le système en cours de fonctionnement
Matériel :
− – évolutif
− – modulaire
− – implantation aisée
Les systèmes automatisés de production
L’objectif de l’automatisation des systèmes est de produire, en ayant recours le moins possible à l’homme, des produits de qualité et ce pour un coût le plus faible possible.Un système automatisé est un ensemble d’éléments en interaction, et organisés dans un but précis : agir sur une matière d’œuvre afin de lui donner une valeur ajoutée. Le système automatisé est soumis à des contraintes : énergétiques, de configuration, de réglage et d’exploitation qui interviennent dans tous les modes de marche et d’arrêt du système.
SECURITE
Les systèmes automatisés sont, par nature, source de nombreux dangers (tensions utilisées, déplacements mécaniques, jets de matière sous pression …). Placé au cœur du système automatisé, l’automate se doit d’être un élément fiable car :
– un dysfonctionnement de celui-ci pourrait avoir de graves répercussions sur la sécurité des personnes,
– les coûts de réparation de l’outil de production sont généralement très élevés,
– un arrêt de la production peut avoir de lourdes conséquences sur le plan financier.
Aussi, l’automate fait l’objet de nombreuses dispositions pour assurer la sécurité :
• Contraintes extérieures : l’automate est conçu pour supporter les différentes contraintes du monde industriel et a fait l’objet de nombreux tests normalisés (tenue aux vibrations, CEM …)
• Coupures d’alimentation : l’automate est conçu pour supporter les coupures d’alimentation et permet, par programme, d’assurer un fonctionnement correct lors de la réalimentation (reprises à froid ou à chaud)
• Mode RUN/STOP : Seul un technicien peut mettre en marche ou arrêter un automate et la remise en marche se fait par une procédure d’initialisation (programmée)
• Contrôles cycliques :
− Procédures d’autocontrôle des mémoires, de l’horloge, de la batterie, des tensions d’alimentation et des entrées / sorties
− Vérification du temps de scrutation à chaque cycle appelée Watchdog (chien de garde), et enclenchement d’une procédure d’alarme en cas de dépassement de celui-ci (réglé par l’utilisateur)
• Visualisation : Les automates offrent un écran de visualisation où l’on peut voir l’évolution des entrées / sorties
La défaillance d’un automate programmable pouvant avoir de graves répercussions en matière de sécurité, les normes interdisent la gestion des arrêts d’urgence par l’automate ; celle-ci doit être réalisée en technologie câblée. On peut également ajouter des modules de sécurité à l’automate (sécurité des machines). Il existe enfin des automates dits de sécurité (APIdS) qui intègrent des fonctions de surveillance et de redondance accrues et garantissent la sécurité des matériels.
LE LANGAGE A CONTACT OU LADDER
Le Langage graphique très populaire auprès des automaticiens pour programmer les automates programmables industriels (PLC) :
• Permet d’écrire un programme de contrôle sous la forme d’un circuit électrique comportant des interrupteurs.
• À la différence d’un programme s’exécutant sur un microprocesseur, les programmes LLD s’exécutent en mode de balayages répétés.
Le langage à contact est adapté à la programmation de traitements logiques, il utilise le schéma développé .Une bobine d’enclenchement S « set » et bobine de déclenchement R « reset » correspondent à un relais bistable. En plus des blocs fonctions logiques d’automatisme, il existe les blocs de temporisation, de comptage …
|
Table des matières
INTRODUCTION
CHAPITRE I LES SYSTEMES AUTOMATISES
I Introduction aux systèmes automatisés
I.1 Fonction globale d’un système
I.1.1 Matières d’œuvre
I.1.2 Valeur ajoutée
I.1.3 Contexte et valeur ajoutée
I.2 Système de production
II Automatisation
II.1 PARTIE COMMANDE
II.1.1 Objectifs de l’automatisation
II.1.2 Conduite et surveillance d’un système automatisé
III Structure d’un système automatisé
III.1 Partie Opérative
III.1.1 Les actionneurs
a – Les actionneurs électriques
– Moteur à courant alternative
– Les moteurs pas à pas
– Une machine électrique à courant continu est constituée
b – Les actionneurs pneumatiques
– Les vérins pneumatiques
– Type des vérins
c – Autre actionneurs
III.1.2 LES PREACTIONNEURS
a – Les contacteurs et les relais
III.1.3 LES CAPTEURS
a – Les capteurs tout ou rien
– Le Détecteur inductif
– Le détecteur capacitif
– Les détecteurs photoélectriques
– Les détecteurs de niveau
– Le détecteur de pression
b – LES CAPTEURS ANALOGIQUES
III.1.4 LES TRANSMETTEURS
CHAPITRE II AUTOMATE PROGRAMMABLE INDUSTRIEL
IV HISTORIQUE
IV.1 Contraintes du monde industriel
IV.2 Définition
V Place de l’API dans le système automatisé de production (S.A.P.)
V.1 Les systèmes automatisés de production
V.2 Structure d’un système automatisé
V.2.1 Partie opérative
V.2.2 Partie commande
V.2.3 Poste de contrôle
V.3 Domaines d’emploi des automates
V.4 Nature des informations traitées par l’automate
VI Architecture des automates
VI.1 Aspect extérieur
VI.2 Structure interne
VI.3 Fonctions réalisées
VII Câblage des entrées / sorties d’un automate
VII.1 Câblage des entrées / sorties d’un automate
VII.2 Alimentation des entrées de l’automate
VII.3 Alimentation des sorties de l’automate
VIII Traitement du programme automate
IX Sécurité
X Les automates et la communication
X.1 Les bus de terrain
X.2 Les réseaux de terrain
XI Critères de choix d’un automate
CHAPITRE III LANGAGE DE PROGRAMMATION D’UN AUTOMATE PROGRAMMABLE
XII Langages de programmation
XII.1 Liste d’instructions (IL : Instruction list)
XII.2 Langage littéral structuré (ST : Structured Text)
XII.3 Langage à contacts (LD : Ladder diagram)
XII.4 Blocs Fonctionnels (FBD : Function Bloc Diagram)
XIII Programmation à l’aide du GRAFCET (SFC : Sequential Function Chart)
XIV GRAFCET (GRAphe Fonctionnel de Commande Etapes–Transitions)
XIV.1 But du GRAFCET
XV Le langage à contact ou Ladder
XVI Grafcet et langage LADDER
XVI.1 Traduction d’un fonctionnement explicité sous forme d’un Grafcet en son équivalent LADDER
XVII Organisation d’un programme d’automate programmable
CHAPITRE IV SIMULATION EN UTILISANT LE LOGICIEL FACTORY I/O
XVIII I. INTRODUCTION
XIX II ETUDE DE L’INSTALLATION
XIX.1 II.1 Les éléments nécessaires pour élaborer le système
XIX.2 L’organigramme
XIX.3 GRAFCET
CONCLUSION
ANNEXES
Télécharger le rapport complet