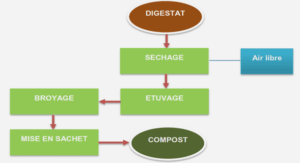Anthroponymie
D’aussi loin dont j’ai pu remonter l’arbre généalogique de la famille DELASTRE, ces derniers ont habité le village de Serrières-de-Briord (Ain) durant au moins trois générations. Mais comme de nombreuses autres familles, il est très probable que le nom DELASTRE ne soit pas originaire de leur région de domicile. C’est pourquoi j’ai décidé de me pencher un plus sur les origines de ce nom.
Le nom DELASTRE est un dérivé du nom DELATTRE, tout comme les noms DELAISTRE, DELHATRE, DELATE, DELAITRE… Ces noms de famille ont donc les mêmes racines. Les origines de ce patronyme sont multiples. Il peut être toponymique, autrement dit un nom qui s’inspire d’un lieu géographique. En effet, « un très grand nombre de noms de famille en DE- ou DU- proviennent soit d’un nom de province, soit d’un nom de terroir, de bourg ou de village »1. Ainsi, le nom DELATTRE peut être originaire de Lattre dans le Pas-de-Calais (62). Ce nom fait d’ailleurs parti des 10 noms les plus portés du Pas-de-Calais de 1891 à 1915 et de 1966 à 19902. Il fait également partis des 30 noms les plus portés dans le Nord-Pas-de-Calais depuis 18913. On a constaté que 1 à 10% des migrants du Nord-Pas-de-Calais avait choisi de s’établir dans la région Rhône-Alpes entre 1891 et 19904. Il semblerait que la famille DELASTRE qui, sur plusieurs générations, est demeurée dans cette région, ne porte donc pas le patronyme le plus répandu en Rhône-Alpes.
Mais le nom DELATTRE est plus souvent associé à un surnom évoquant une maison située près d’un lieu sacré. On peut tirer ce nom de l’ancien français astre, aistre qui désigne « une maison donnant sur le parvis d’une église ou d’un cimetière y attenant »5 ou un « terrain près d’une église ou d’un monastère jouissant du droit d’asile »6. Quelques particularités intérieures de la maison, comme une maison dont l’âtre était carrelé, et non en terre battue, ont pu donner lieu à ces surnoms devenus noms de famille. En effet, ce nom pourrait venir de l’ancien français astre, âtre qui désigne une « partie dallée de la cheminée sur laquelle on fait le feu »7. Les noms DELASTRE, DELESTREE, DELESTREZ, peuvent également venir « de l’estrée », surnom de l’homme qui habitait près d’une route pavée (de l’ancien français estrée, route ; tout comme strasse en allemand ; street en anglais ; strada en italien, etc.). Les surnoms DELATRE, DELATTE, DELATTRE désignaient sans doute en langue d’oïl8 l’homme préposé à la garde de l’entrée et, par extension, du cimetière d’une église (astre, aitre).
Pour finir le nom DELASTRE pourrait s’apparenter à astre, venant du grec par le latin astrum, qui désigne « un corps céleste resplendissant et dont l’influence est censée agir sur le destin des hommes ».
Un peu d’Histoire
Bref historique de la Croix-Rousse
La Croix-Rousse est une colline de la ville de Lyon dominant le Nord de la Presqu’Île entre le Rhône et la Saône. Elle est composée de deux ensembles : les pentes, lyonnaise depuis toujours, et un plateau, à l’extérieur des fortifications lyonnaises du XVIe siècle, formant une paroisse, puis avec la révolution, une commune indépendante rattachée à Lyon en 1852. À l’origine, le plateau de la Croix-Rousse était essentiellement agricole, avec de grandes propriétés appartenant au clergé et à la noblesse. À la révolution, ces terres furent morcelées et rachetées par de riches particuliers. Le rattachement de la Croix-Rousse à la ville de Lyon a permis la mise en place d’un réseau d’adduction d’eau, le pavage des rues, la mise en place de conduites de gaz et la construction d’un hôpital. En 1891, un funiculaire dénommé par les habitants la « ficelle », installé place Croix Paquet, permettait de relier le plateau à la Presqu’Île, les tisseurs de soie aux négociants. Près d’un siècle plus tard, un métro à crémaillère le remplaça sur le même itinéraire de suspension… il existe toujours.
Le gros caillou, symbole croix-roussien par excellence, a été déposé en tant qu’élément morainique11 lors de la fonte des glaciers. La colline de la Croix-Rousse est percée de nombreuses galeries, les fameuses arêtes de poisson, dont les origines sont discutées et que l’on peut parcourir avec autorisation.
Jusqu’en 1865, les pentes, aujourd’hui 1er arrondissement de Lyon, étaient séparées du plateau par un rempart. En 1852, la commune de la Croix-Rousse est rattachée à Lyon et en 1865, Napoléon III ordonne la destruction de ces remparts pour faciliter l’intégration de ce nouveau quartier dans la ville et l’aménagement d’un grand boulevard qu’on appela « boulevard de la Croix-Rousse » et qui sert, aujourd’hui, de limite entre les deux Croix-Rousse. Il ne reste de ce rempart que les extrémités et une avant porte: le fort Saint Jean qui domine la Saône et côté Rhône, le bastion Saint Laurent et quelques bâtiments militaires.
Pour la ville de Lyon, la Croix-Rousse, plateau et pente, est associée à la soie, aux canuts. C’est au 19ème siècle qu’elle prend l’identité de colline laborieuse et dangereuse aux yeux de la bourgeoisie au pouvoir, à qui le peuple dans la rue fait peur. En effet, elle est entrée dans l’histoire nationale avec la révolte des canuts de 1831 (infra : III. 2. La Croix-Rousse, ville de la soie), révolte considérée improprement par de nombreux penseurs politiques et historiens, comme une des premières révoltes ouvrières, voir prolétaires, de l’ère industrielle. Si pour la bourgeoisie, la Croix-Rousse est la colline des barbares (selon l’expression due à la plume du journaliste conservateur Saint-Marc Girardin le 8 décembre 1831) pour tous les républicains du 19ème siècle et plus tard pour la gauche française, elle est la colline qui incarne la lutte du peuple contre les inégalités sociales et qui réclame vouloir « vivre en travaillant ou mourir en combattant » (infra : III. 2. La Croix-Rousse, ville de la soie).
La Croix-Rousse, ville de la soie
La soie a fait la réputation de la ville de Lyon. Intimement liée à son histoire, la soierie lyonnaise a joué un rôle considérable dans le développement de la ville comme dans celui de la région Rhône-Alpes. Les tissus fabriqués dans le quartier de la Croix-Rousse, mais aussi à Saint-Jean ou à Saint Paul, habillaient les plus puissants et décoraient de nombreux palais.
La soie a vu le jour 20 siècles avant Jésus-Christ en Chine, qui garda jalousement le secret de sa fabrication pendant 2 siècles. Il s’agissait d’une matière précieuse, au 1er siècle de notre ère, un kilogramme de soie valait son équivalent en or. C’est grâce à une technique d’espionnage industriel que l’empereur byzantin Justinien vola aux Chinois le secret de fabrication de la soie. Finalement, l’élevage des vers à soie se développa en France à partir du 15ème siècle. À cette époque, Lyon était déjà un carrefour international, commercial et intellectuel. A partir de 1450, grâce à ses quatre foires annuelles, qui attiraient de nombreux drapiers et merciers, la ville de Lyon détint le monopole national du commerce de la soie, ce qui la rendit encore plus incontournable. En 1466, afin de limiter les importations de soierie qui coûtaient trop cher au royaume, le roi Louis XI décida de créer une manufacture royale. Il fit venir d’Italie matériel, maîtres et ouvriers expérimentés, à qui il offrit des avantages fiscaux importants. Mais les consuls préférèrent favoriser le commerce en demeurant des marchands et en vendant à la noblesse des soieries importées. Le roi renonça donc à cette entreprise. Ce fut ainsi la ville de Tours qui accueillit la première manufacture française de soierie.
C’est sous le règne de François Ier que la soierie lyonnaise connu son véritable essor. En effet, en 1528, Etienne Turquet, entrepreneur lombard installé à Lyon, obtint des privilèges royaux pour la fabrication de tissus de soie, d’or et d’argent, ainsi que la suppression des charges pour les ouvriers étrangers qui venaient s’établir à Lyon. D’autres suivirent rapidement son exemple en installant des ateliers de tissage dans la ville. En 1540, Lyon obtint le monopole de l’importation en France de soie grège (ou fil de soie).
En 1554, on pouvait compter au moins 12 000 personnes vivant du tissage au sein de la « Manufacture Lyonnaise ». Il s’agissait de petits ateliers indépendants, aux mains d’artisans, implantés dans la Presqu’île lyonnaise et dans les quartiers situés en bord de Saône. Ils travaillaient essentiellement pour l’église, l’armée et la royauté.
Très vite, les artisans tisseurs s’organisèrent et, dès 1596, définirent des règles strictes sur les modalités d’entrée et de sortie dans la profession. Ainsi, la commercialisation des pièces de soie fut réservée aux maîtres, et le compagnonnage et l’apprentissage furent mis en place. Ce dernier s’étendait sur cinq années et était encadré par un contrat d’apprentissage signé devant notaire. On devenait apprenti, en principe, dès l’âge de 13 ans, sans salaire. La famille de l’apprenti devait régler des frais d’apprentissage au maître qui, de son côté, ne pouvait accueillir plus de deux apprentis. Célibataire, l’apprenti était logé, nourri, chauffé et éclairé par son maître. Son apprentissage était sanctionné par un examen qui, une fois réussi, lui permettait de s’inscrire au registre des compagnons pour une durée de cinq ans. À partir de 1686, le compagnon devait réaliser un chef d’oeuvre pour devenir maître à son tour.
Vers la seconde moitié du 17ème siècle, la France dut faire face à une forte concurrence due à l’importation de toiles peintes importées par la Compagnie des Indes. En réaction, Colbert, alors surintendant des bâtiments et manufactures de Louis XIV, établit, en 1667, le règlement de la Grande Fabrique Lyonnaise, qui regroupait alors l’ensemble des corporations travaillant le tissu. L’objectif était d’atteindre une qualité irréprochable afin lutter contre la concurrence.
En 1621, la Fabrique Lyonnaise comptait près de 1 700 maîtres ouvriers. En 1660, ils étaient plus de 3 000, à faire travailler 10 000 métiers. L’activité fut de nouveau multipliée par 3 entre 1665 et 1690. De somptueuses étoffes étaient réalisées à Lyon pour les princes de la cour ou l’aménagement des différentes demeures royales. Pourtant, en 1685, avec la révocation de l’Edit de Nantes, de très nombreux soyeux12 protestants s’exilèrent, se réfugiant en Suisse et à Londres notamment. Le nombre de métiers tomba alors à moins de 2 000.
C’est au début du 19ème siècle, avec l’avènement du métier Jacquard, que les tisseurs se déplacèrent vers le quartier de la Croix-Rousse, alors commune indépendante. En effet, la soierie avait besoin d’espace. L’arrivée des métiers à tisser Jacquard, de grande taille, modifia profondément le travail des tisseurs, mais également leur mode de vie. Ils ne pouvaient plus vivre dans leurs ateliers du centre-ville, de Saint-Jean ou de Saint Paul. En revanche, les couvents de la Croix-Rousse, aux très hauts plafonds, pouvaient héberger sans problème les mécaniques des métiers qui atteignaient près de 4 mètres de hauteur. Certains lyonnais quittèrent donc la ville pour le faubourg de la Croix-Rousse. Des tisseurs venus de toute la région s’installèrent dans ce quartier, attirés par les avantages fiscaux en vigueur comme la réduction de l’impôt foncier et de la contribution mobilière, ou l’absence de droits d’octroi. Il fallut construire de nouveaux immeubles susceptibles d’accueillir leurs imposantes machines. De solides escaliers de pierre desservaient les étages, les fenêtres étaient deux fois plus hautes que larges. À l’intérieur, le sol était pavé de carreaux de terre cuite non vernis, et au plafond les poutres étaient apparentes et permettaient de caler les métiers. La Croix-Rousse, quartier en hauteur, donc à l’abri des inondations, proposait, entre autres, des loyers moins élevés que la Presqu’Île. Les canuts furent considérés comme les maîtres de ce quartier pendant près d’un siècle.
Le maître tisseur possédait son atelier et son matériel. Sa femme travaillait avec lui et il avait généralement sous ses ordres un ou deux compagnons qu’il logeait. Il formait également un ou deux apprentis. Les journées de travail étaient très longues, elles atteignaient parfois 16h sur 6 jours consécutifs. Il n’y avait pas de dissociation entre la vie familiale et professionnelle, l’atelier servant aussi de logement. Deux tiers de la surface du logement étaient consacrés à l’atelier et un tiers à la vie familiale. En bas se trouvait l’atelier, la chambre des maîtres, la cuisine et la souillarde ; en haut, en soupente, le lieu de couchage du compagnon. Un gros poêle à charbon chauffait l’ensemble. Dans chaque immeuble, plusieurs ateliers étaient installés, entraînant des relations de voisinage qui renforçaient le sentiment d’appartenir à une même communauté. Ainsi, tout le monde se connaissait. Il existait une sorte de solidarité entre les canuts, mêlée à une certaine méfiance. Chaque atelier gardait jalousement ses secrets de fabrication mais parallèlement, les canuts n’hésitaient pas à se prêter un dessin, à s’associer en coopérative pour réduire les frais ou à s’unir lorsqu’il s’agissait de faire respecter les prix.
Prunelle s’enfuit. Cette révolte fit grand bruit à Paris, et le 3 décembre, le duc d’Orléans, fils du roi Louis-Philippe, et le Maréchal Soult se rendirent à Lyon. Le tarif fut annulé, le préfet destitué, et 90 ouvriers furent arrêtés (et finalement acquittés). Une importante garnison fut installée dans la ville, la révolte des ouvriers se solda par un échec.
En 1834, eut lieu une seconde insurrection des canuts. Le nouveau préfet, Adrien de Gasparin, déclara le tarif illégal mais prit néanmoins des mesures sociales favorables : un cours fixe qui régit les prix entre tisseurs et fabricants, et une caisse de prêt pour les maîtres tisseurs mariés. La conjoncture économique était à nouveau bonne, l’industrie de la soie se portait bien. Malgré tout, le patronat estimait que les salaires des ouvriers étaient encore trop élevés et entreprit de les baisser. En février 1834, les canuts lancèrent une grève générale : plusieurs dirigeants d’associations mutuelles ouvrières furent arrêtés. L’évènement effraya les autorités qui firent voter à Paris une loi contre les associations le 9 avril 1834. La révolte éclata alors chez les canuts. Dans les quartiers de la Croix-Rousse, de la rive droite de la Saône et du centre sud de la Presqu’île, des milliers d’ouvriers de la soie se soulevèrent. L’armée, dirigée par le ministre de l’intérieur, Adolphe Thiers, fit mine d’abandonner la ville aux insurgés mais passa à l’offensive du 11 au 15 avril : la répression fut qualifiée de « sanglante semaine » et fit plus de 600 victimes. 10 000 insurgés furent faits prisonniers afin d’être jugés à Paris et condamnés à la déportation ou à de lourdes peines de prison.
En 1848 et 1849, la société des « Voraces », des canuts républicains armés de la Croix-Rousse, mêlèrent à nouveau les tisseurs à une insurrection. Le 24 février 1848, Louis-Philippe abdiqua, mettant fin à la monarchie de Juillet. La seconde République fut proclamée. S’ensuit à Lyon une période de chômage parmi les canuts : les ouvriers non lyonnais, majoritairement savoyards, furent invités à rentrer dans leur pays d’origine… en échange d’un « secours de route et d’un passeport gratuit ». La société des Voraces se rallia aux Savoyards de Lyon et, rapidement, forma le projet d’envahir la Savoie et d’y implanter la république. Le 29 mai, dans une ambiance révolutionnaire, 1500 personnes – 200 voraces et 1 tiers des Savoyards de Lyon – préparèrent le départ place Bellecour, acclamés par une foule importante. La troupe faiblement armée prit Chambéry le 3 avril : elle occupa le château, la mairie et proclama une république qui ne dura qu’une journée. Les Voraces et les Savoyards de Lyon furent mis en échec. Le 15 juin 1849, à l’occasion de la rumeur d’un soulèvement des républicains à Paris, les Voraces tentèrent une nouvelle insurrection. Circonscrite à la Croix-Rousse, elle fut violemment réprimée par l’armée. C’est là qu’entre en jeu le témoignage de cette révolte de Pierre Joseph DELASTRE, l’ancêtre dont j’ai choisi de faire l’arbre généalogique (infra IV. 3. Pierre Joseph DELASTRE et Marguerite AUDIBERT).
Ascendance et descendance de Pierre Joseph DELASTRE
Notre voyage dans le temps débute dans le petit village de Serrières-de-Briord situé dans le département de l’Ain, entre les confins méridionaux du massif du Jura et le Rhône, à égale distance de Lyon et de Bourg-en-Bresse (60 km). Le cadre naturel entre la montagne (roches de la Craz et le Fort), la rivière (Pernaz) et le fleuve (Rhône) a favorisé le développement de ce village et lui a donné son nom (« ser » = serrure).
Petite commune d’une superficie de 8,03 km², Serrières-de-Briord comptait, à la fin du 18ème siècle, environ 500 habitants. Dès l’époque romaine, la vie économique du village s’est basée sur l’exploitation des carrières de pierre calcaire, la viticulture, le transport fluvial de pierres et de vin et les adductions d’eau.
Au 19ème siècle et au cours de la première moitié du 20ème, il existait plusieurs entreprises très actives qui ont aujourd’hui disparu :
➢ Extraction du minerai de fer de 1858-1888 (création du chemin de la Craz),
➢ Exploitation de plusieurs usines de tissage de la soie par des fabricants d’étoffe de soie de Lyon qui trouvaient dans la région de l’Ain la main d’oeuvre nécessaire,
➢ Fabrication de casses d’imprimerie, alimentée par l’énergie du canal de la Pernaz,
➢ Carrière de Gras sur la route de Bénonces,
➢ Scieries.
Tout au long de mes recherches, notamment dans la lecture des différents registres d’état civil, je remarque que le nom et la signature de Pierre DELASTRE reviennent fréquemment. En effet, durant ses jeunes années, Pierre DELASTRE fut désigné parrain de nombreux enfants. Je me suis alors interrogée sur l’importance de cet homme dans le village. Désigné comme étant « Sieur Bourgeois de Serrières » dans l’acte de naissance de ses enfants, j’en ai conclu qu’ayant débuté comme simple marchand, son entreprise a dû prospérer au fil des années, faisant de lui un homme riche et respecté.
A l’époque de l’ancien régime, la société était divisée en trois groupes : le Clergé, les Nobles et le Tiers-Etat. Le Tiers-Etat était un groupe assez hétérogène dans lequel il était possible de constater plusieurs inégalités de richesses et différentes activités pratiquées par ses membres et allant des travaux manuels aux activités financières et intellectuelles. On pouvait différencier ceux que l’on appelait les « bourgeois », des catégories populaires comme les paysans. Il existait plusieurs types de bourgeois :
➢ La bourgeoisie administrative : prestigieuse car travaillant avec les nobles à l’administration de la ville ou de la royauté (magistrats, juges, huissiers, avocats…),
➢ La bourgeoisie de finance : moins prestigieuse car n’étant pas directement au service du roi et peu appréciée de la population car elle était chargée du prélèvement des impôts,
➢ La bourgeoisie marchande : n’était pas au service du roi, il s’agissait d’entrepreneurs privés qui faisaient commerce. Certains membres qui pratiquaient le commerce international étaient parfois plus riches que la bourgeoisie administrative ou de finance,
➢ La bourgeoisie propriétaire : vivait des rentes de ses propriétés en spéculant ou louant ses terres.
Pierre DELASTRE ayant tout d’abord été simple marchand, on peut supposer qu’il faisait partie de la catégorie de la bourgeoisie marchande. On constate également, grâce à une archive familiale présentée ci-après, que Pierre DELASTRE était assez riche pour prêter de l’argent. Il s’agit en effet d’un acte de prêt passé devant notaire, daté du 13 février 1774, par le Sieur Pierre Delastre à Monsieur Marin Rey Pilod, de la somme de 25 livres et 10 sols.
Dans le recensement de population de Lyon de 183668, on retrouve Pierre Joseph DELASTRE âgé de 34 ans dans le recensement (en réalité âgé de 36 ans), ouvrier tisseur de soie, ainsi que sa femme Marguerite AUDIBERT, âgée de 28 ans, exerçant le même métier, et leurs deux enfants : Auguste (nommé dans son acte de naissance Etienne Auguste) âgé de 7 ans et Tony (nommé Antoine dans son acte de naissance, il s’agit vraisemblablement de son surnom) âgé de 4 ans et demi. La famille accueillait également chez eux une employée tisseuse en soie du nom de Marie VALEN.
Les appartements de la Croix-Rousse étaient structurés de façon à y installer un métier à tisser Jacquard, un outil très imposant qui nécessitait d’être placé dans un vaste espace avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres afin d’avoir un maximum de luminosité. Les canuts, comme Pierre Joseph et Marguerite pouvaient ainsi travailler directement à leur domicile.
Les canuts, mal exploités, commencèrent à se révolter en 1831 et en 1832. Après une apparente période d’accalmie, les révoltes reprirent en 1848 et 1849. C’est là que les écrits de Pierre Joseph DELASTRE, dans son petit cahier de notes vert69, qui nous a été transmis de génération en génération, révèle toute son importance. On y apprend quelques détails non négligeables sur le déroulement de la révolte, mais aussi sur les traits de caractères de l’auteur de ce récit et sur sa vie. En juin 1849, âgé de 50 ans, il était affligé d’une grande surdité. C’est plusieurs années après les faits qu’il prendra la décision de poser ses souvenirs à l’écrit. Dans ses notes, il nous décrit avec détail son vécu et son ressenti durant cette journée de révolte et son arrestation. Il semblait d’un caractère paisible et ne paraissait pas être un meneur dans cette révolte.
Son récit débute au matin du 18 juin 1849 (sa mémoire a dû lui jouer des tours car la révolte a eu lieu le 15 juin 1849, mais soyons indulgents, à l’époque il n’y avait pas internet pour se souvenir des dates historiques). Les Voraces croix-roussiens déclenchaient une violente insurrection contre le pouvoir de la 2ème République dont, à Paris, les amis de l’Ordre venaient de prendre le contrôle. L’Histoire affirme que le Général Magnan aurait rétabli l’ordre à Lyon 24h après le début de la révolte. Le récit de Pierre Joseph DELASTRE nous permet de nuancer cette affirmation. Il affirme n’avoir pris aucune part à cette révolte et d’avoir été injustement arrêté avec ses deux fils, âgés respectivement de 20 et 17 ans.
Pierre Joseph DELASTRE résidait avec sa famille juste en face de la grande place de la Croix-Rousse. Ce jour-là, levé dès 3 ou 4 heures du matin, il remarqua que les portes de plusieurs cafés et cabarets, dans lesquels se réunissaient certaines sociétés d’ouvriers, étaient déjà ouvertes. Des hommes de tout âge y entraient et en sortaient continuellement. D’autres groupes de personnes discutaient sur la place et semblaient préoccupées.
Vers 6 heures du matin, Pierre Joseph parti assister à la première messe de la journée. A son retour, il aperçut de jeunes ouvriers sortir des maisons, armés, s’efforçant de cacher leur arme sous leur blouse. Pierre Joseph précise qu’ils semblaient être de jeunes chefs d’atelier de la Croix-Rousse. Une forte barricade avait été construite au bout de la rue Calas. De nombreuses personnes se réunissaient sur la place de la Croix-Rousse, une émeute grondait. Pierre Joseph se pressa de rentrer chez lui.
Il est 9 heures du matin, les insurgés, pour la majorité sans arme et mal vêtus, formèrent deux fils et traversèrent la place en rasant les maisons. Dans leur rang on retrouvait de jeunes gens portant l’uniforme de l’école vétérinaire, ainsi que quelques uniformes d’infanterie de ligne, mais ces derniers paraissaient ivres. Arrivés sur la place de la mairie, des coups de feu furent tirés par une petite caserne se trouvant au-dessus du mur d’enceinte de Lyon. Les insurgés prirent la fuite et construisirent des barricades en différents endroits de la ville. Les boutiques et les habitants s’empressèrent de fermer leurs portes et de se mettre à l’abri. Quelques minutes plus tard, une vive fusillade se fit entendre, puis enfin le bruit terrible du canon qui fit se briser toutes les vitres du voisinage. Craignant d’être touché par une balle ou un boulet de canon, Pierre Joseph, sa femme et ses deux fils se réfugièrent sous l’escalier de la maison, puis dans l’appartement d’un voisin qui ne donnait pas sur la rue. C’est dans l’appartement de ce voisin, où une douzaine de personnes s’était réfugiée, qu’un capitaine entra accompagné d’une petite troupe de soldats. Il les accusa d’avoir tiré sur les militaires qui se trouvaient sur la place par les croisées de la maison de Pierre Joseph. Les soldats les firent sortir de l’appartement alors que le bruit des fusils se faisait encore entendre. Ils furent placés dans une allée le temps que la révolte cesse. Pierre Joseph nous expose alors ses craintes pour son métier à tisser et ses avoirs, très exposés aux coups de canons et de fusils. Autour de lui, les soldats étaient épuisés, certaines jeunes filles sanglotaient, des hommes arrêtés arrivaient dans un état pitoyable, leurs chemises déchirées. A l’extérieur, il pouvait apercevoir au sol un cheval, qui paraissait mort mais qui tressaillait à chaque coup de canon.
C’est seulement vers les 5 ou 6 heures de l’après-midi que les prisonniers furent réunis dans la rue et que l’ont permis aux femmes et aux enfants de se retirer. Les hommes furent menés à la caserne des Bernardines. Pierre Joseph put constater sur le trajet les y menant les dégâts causés par la révolte. Les façades des maisons étaient criblées de balles, plusieurs avaient été percées ou labourées par des boulets de canon. On pouvait voir les rideaux déchirés qui flottaient au dehors, au travers des croisées dont les vitres avaient été brisées. Les débris de verre se mêlaient au sang de ceux qui avaient été blessés durant la bataille. Les prisonniers furent emprisonnés, sans jugement, et déplacés dans plusieurs prisons différentes au cours des 5 jours qui suivirent. Les conditions de détention étaient épouvantables, dans le noir, sans même un peu de paille pour pouvoir s’allonger, à peine un peu d’eau pour épancher sa soif. Les prisonniers eurent la possibilité de correspondre avec leurs proches par le soupirail de leur cellule. Après 3 jours de séparation, Marguerite AUDIBERT fut enfin prévenu du lieu où était emprisonné son mari ainsi que ses deux fils. Elle fit passer à son époux une pièce de cinq francs afin qu’il puisse subvenir à ses besoins le temps de sa détention. Elle put également lui faire parvenir du linge propre. Les détenus eurent la visite d’un groupe de soeurs qui leurs apportèrent de la soupe, ainsi que la visite d’ecclésiastiques qui leur donnèrent des livres et leur procurèrent des paroles de paix. Certains ecclésiastiques leur offrirent même une pièce de 5 francs ou de 20 francs. La délivrance de Pierre Joseph et ses deux fils se fit le cinquième jour de leur détention grâce aux démarches incessantes de plusieurs personnes complaisantes et de sa femme. Enfin chez eux, les trois hommes ont pu découvrir les dégâts de cette « courte guerre » dans leur logis. Dans leur atelier, une balle, tirée de la rue, avait pénétré par ricochet dans la mécanique jacquart d’un métier et y avait fait des dégâts pour 12 ou 15 francs. D’autres balles avaient déchiré des linges dans leur garde-robe et des portes. La façade était criblée par les balles, un boulet avait traversé une poutre de l’appartement au 3ème étage et y avait mis le feu. Un vol avait été commis chez un locataire du 1er étage.
Tout au long de son récit on constate que le caractère pieux et paisible de Pierre Joseph DELASTRE lui ont permis de garder son sang-froid durant cette épreuve qui a touché tous les Croix-Roussiens.
Pierre Joseph DELASTRE et Marguerite AUDIBERT apprirent à leurs enfants le métier de tisseur. Etienne Auguste, l’aîné, en fit son métier. Il se maria avant l’âge de 24 ans (âge auquel il a eu son 1er enfant) avec Françoise CHAURION. Antoine, quant à lui, devint commis et demeura chez ses parents jusqu’au décès de son père le 3 juin 185870 à son domicile, 4 et 5 grande place à Lyon 4ème (Rhône) au deuxième étage. Pierre Joseph DELASTRE mourut 1 an avant son propre père, à l’âge de 59 ans, et exerçait toujours le métier de tisseur.
Marguerite AUDIBERT continua le métier de tisseuse de nombreuses années après le décès de son mari. On la retrouve notamment dans le recensement de population de 187271 à Lyon, domiciliée grande place de la Croix-Rousse, en compagnie de 3 jeunes tisseurs : Julie JACQUET (27 ans), François DANGUIN (24 ans) et Marie DEFONDON (21 ans).
Vers la fin de sa vie, elle partit habiter chez son fils cadet Antoine, sa belle-fille et ses petits-enfants, 17 place de la Croix Rousse à Lyon 4ème, où elle décédera le 20 décembre 188572. Elle avait 78 ans.
Mais la cohabitation entre Louis et son beau-père fut difficile. En effet, Paul HENRY avait une très forte personnalité et un caractère bouillant. Marguerite souffrit beaucoup de cette situation. D’autant plus qu’elle perdit son fils Paul, alors qu’il était âgé de 12 ans106 (vers 1922). Les soucis et la perte de son enfant furent probablement la cause de son ulcère à l’estomac dont elle fut opérée vers l’âge de 40 ans. Elle eut également un cancer du sein, et dû subir une ablation des deux seins. Ces épreuves lui firent perdre sa belle voix, et ses cheveux blanchirent très vite. Il paraît qu’elle était déjà blanche à l’âge de 30 ans, mais sur la photo ci-dessus, la plus jeune de ses filles, Madeleine, doit avoir environ 3 ans. Marguerite HENRY doit donc être âgé de 31 ans environ. Il est donc probable qu’elle ait vu ses cheveux blanchirent complètement vers l’âge de 40 ans. Sa petite-fille, Marie-Claude BRULÉ épouse RICADAT, se souvient que sa grand-mère n’était plus que l’ombre d’elle-même, et qu’elle l’a toujours connue souffrante.
106 Il est décédé alors qu’ils habitaient à Marcigny, les archives d’état civil ne sont numérisées que jusqu’en 1902 donc je devrai me contenter du témoignage de ma grand-mère (Paul Emile DELASTRE était son oncle).
La famille DELASTRE habitera plusieurs années rue de la Paillebotte à Marcigny (Saône-et-Loire) dans la maison de Paul HENRY (maison qui appartient aujourd’hui encore aux descendants de la famille HENRY). En effet, on retrouve Louis Susanne DELASTRE et Marguerite HENRY avec leurs enfants et Paul HENRY, ainsi qu’une domestique, rue de la Paillebotte à Marcigny (Saône-et-Loire) dans les recensements de population de 1926107,1931108 et 1936109. Marie-Claude BRULÉ épouse RICADAT, dont la « Paillebotte » était la maison de vacances, nous la décrit avec détail. Il s’agissait d’une belle et vaste maison ancienne située à côté de la poterie HENRY. Devant « La Paillebotte » se trouvait une grande cour avec deux gros tilleuls, sur laquelle donnaient des dépendances : écuries, grange… Derrière, il y avait un immense jardin avec une vaste pelouse et un sapin, une allée de noisetiers et de lilas, un potager, un verger, des fleurs… et des lapins. C’était un vrai paradis pour petits et grands.
Marie Thérèse DELASTRE épouse BRULÉ
Fille aînée de Louis Susanne DELASTRE, alors professeur de piano, et de Marguerite HENRY, Marie Thérèse DELASTRE est née le 16 mars 1906112 chez ses parents au 83 boulevard de la Croix-Rousse à Lyon. Après avoir vécu une partie de son enfance à Lyon avec son frère et ses soeurs, elle partit vivre avec sa famille à Marcigny (Saône-et-Loire), ville natale de sa mère, avant l’âge de 10 ans. Elle fut mise en pension à Cuisery (Saône-et-Loire) à 15 ans environ pour ses études113. En effet, on constate sur le recensement de population de Marcigny de 1921114 que Marie Thérèse DELASTRE n’y figure pas avec le reste de sa famille. On la retrouve cependant de nouveau sur le recensement de population de 1926115, mais cette fois-ci on ne retrouve pas sa petite soeur Madeleine qui, comme Marie Thérèse avant elle, a été mise en pension vers l’âge de 14 ans.
Marie Thérèse DELASTRE mesurait 1m65, les cheveux châtains et le teint clair. Sa fille Marie-Claude BRULÉ épouse RICADAT la décrit comme étant une femme élégante et distinguée, avec un air à la fois doux et mélancolique. Très timide et réservée, Marie Thérèse parlait peu mais elle demeurait tout de même intimidante aux yeux de ses enfants. Ses études en pension lui permirent de passer le brevet supérieur. Son père, ancien professeur de piano, lui a appris à en jouer. Elle savait également coudre et peindre des aquarelles.
Alors que Marie Thérèse était âgée d’une vingtaine d’années, Charles SIGNARGOUT, une connaissance de la famille DELASTRE, s’était mis en tête de marier son neveu et filleul, Charles BRULÉ, avec l’une des trois filles DELASTRE. On proposa alors à Marie Thérèse de correspondre avec ce jeune inconnu afin qu’ils fassent plus ample connaissance.
Charles Pierre BRULÉ était le fils de Louis Alexandre BRULÉ, cocher, et Marie PARIZET, domestique. Il est né le 14 octobre 1895116 à l’Hôpital Beaujon, 208 rue du faubourg Saint Honoré à Paris 8ème. Charles BRULÉ était un homme de petite taille (1m59 à l’âge de 19 ans, taille inscrite sur son registre matricule) les cheveux châtains, les yeux marrons. Très bon élève, il passa son baccalauréat de Latin-Grec-Philosophie à Paris en 1913 et fut reçu avec mention. Son registre matricule119 fait d’ailleurs mention d’un degré d’éducation de niveau 5 (le plus haut degré d’éducation). Après l’obtention de son baccalauréat, il travailla quelques temps en tant qu’employé de banque à Bourges. Mais la guerre éclata en août 1914. Marie-Claude BRULÉ épouse RICADAT raconte que son père, Charles BRULÉ, aurait devancé l’appel (mais cela n’est pas inscrit dans son registre matricule comme cela devrait l’être dans ce cas). Alors qu’on lui faisait miroiter un départ en Turquie, la réalité fut toute autre, on l’envoya dans les tranchées en France où il fut fait prisonnier à Verdun en 1916 après avoir été enfoui sous terre par une explosion d’obus sans être blessé. Le Caporal BRULÉ (nommé le 5 mai 1915120) fut déclaré disparu le 8 mars 1916 et ne fut déclaré prisonnier que 6 mois plus tard le 6 septembre 1916 dans le camp de Stralkovo (à l’époque territoire Allemand mais aujourd’hui situé en Pologne)121. Il fut envoyé dans une ferme Polonaise. Les gens étaient sympathiques et le traitaient bien. Il s’y cassa le bras, et mal soigné, garda un bras abîmé. Il fut rapatrié en France le 26 décembre 1918.
Sans nouvelles de ses proches, c’est en rentrant chez lui qu’il apprit la mort de sa mère de la grippe espagnole et le mariage de sa soeur. Pour tous ces jeunes soldats qui rentraient de guerre après 4 ans de service, l’Etat organisa des cours accélérés pour ceux qui le désiraient, et dont bénéficia Charles BRULÉ. Il put donc entrer à l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales et pu ainsi obtenir son diplôme en 1 an. Après plusieurs stages, dont l’un à Longwy, il trouva du travail à DAVUM EXPORTATION qui lui proposa de partir aux Indes et de devenir « marchand de fer »123. C’est ainsi qu’il prit le bateau en février 1924, à l’âge de 28 ans, il y restera 3 ans. C’est à cette époque qu’il débutera ses échanges épistolaires avec la jeune Marie Thérèse DELASTRE. Il garda d’ailleurs pieusement ces lettres dans un coffret fermé à clef jusqu’à sa mort124. A son retour des Indes, Charles BRULÉ et Marie Thérèse DELASTRE purent enfin se rencontrer et ne furent sans doute pas déçus l’un de l’autre puisqu’ils se marièrent le 12 août 1930125 à Marcigny (Saône-et-Loire).
Après leur mariage, le jeune couple s’installa à Paris 19 ème, 54 avenue Simon Bolivar. On les retrouve tous les deux dans le recensement de population de 1931 avec une jeune domestique polonaise. Marie Thérèse était alors enceinte de son premier enfant.
Elle donna naissance le 16 juin 1931127 à une petite fille qu’ils appelèrent Marie-Claude. Marie Thérèse accoucha dans une maternité du 12ème arrondissement de Paris. Première petite fille de chaque famille, Marie-Claude fut gâtée et choyée.
Enceinte de son deuxième enfant et demeurant sûrement seule à Paris alors que son époux devait être en déplacement à l’étranger, Marie Thérèse DELASTRE partit s’installer chez ses parents à Marcigny en prévision de son accouchement. Elle donna naissance à Jean-Paul Louis le 10 août 1932128. Malheureusement, l’enfant ne vécut que 10 mois et décéda le 20 juin 1933129. Marie Thérèse fut effondrée par la perte de son fils. Elle commença à avoir des tendances dépressives, résultat sans doute dû en amont à une enfance attristée par la perte de son jeune frère, et par la santé déficiente de sa mère.
Le 2 mai 1935130, Marie Thérèse donna naissance à sa deuxième fille à Paris 19ème qui reçut les prénoms de Geneviève Marie Pauline.
|
Table des matières
Prologue
Préambule
Introduction
I. Méthodologie
II. Anthroponymie
III. Un peu d’Histoire
1. Bref historique de la Croix-Rousse
2. La Croix-Rousse, ville de la soie
IV. Ascendance et descendance de Pierre Joseph DELASTRE
1. Pierre DELASTRE
2. Etienne Auguste DELASTRE
3. Le couple de référence : Pierre Joseph DELASTRE et Marguerite AUDIBERT
4. Antoine DELASTRE
5. Louis Susanne DELASTRE
6. Marie Thérèse DELASTRE épouse BRULÉ
V. Epilogue : Marie-Claude BRULÉ épouse RICADAT
VI. Remerciements
VII. Sources
VIII. Annexes
1. Pierre DELASTRE
2. Etienne Auguste DELASTRE
3. Pierre Joseph DELASTRE
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet