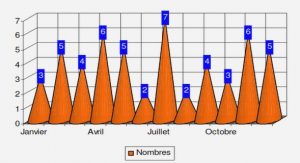Origines et définition théorique du concept
C’est vers la fin des années ’50 que prend forme la théorie du développement endogène, par John Friedmann et Walter Stöhr. C’est une approche volontariste, axée sur un territoire restreint, qui conçoit le développement comme une démarche partant du bas, privilégiant les ressources endogènes. Elle fait appel aux traditions industrielles locales et insiste particulièrement sur la prise en compte des valeurs culturelles et sur le recours à des modalités coopératives. Le développement local possède une référence politique et économique qui prend son essor avec les politiques de décentralisation. Cette expression » développement local » utilisée depuis quelques décennies en Europe( France, Italie, etc.), est d’un usage récent en Afrique Noire et à Madagascar, usage largement impulsé du Nord, qui tend à supplanter celle de » gestion de terroirs » sans qu’il s’agisse en tout point de la même réalité. Le couplage des deux termes » développement » et » local » appelle l’articulation de deux caractéristiques essentielles : la durée qui doit marquer toute démarche de développement, et l’espace, c’est-à-dire le territoire local concerné par cette démarche. Il existe une multitude de définition accordée au développement local, suivant le domaine de préoccupation de son auteur, entre autres : » une intervention structurée, organisée, à visée globale et continue dans un processus de changement des sociétés locales en proie à des déstructurations et des restructurations « 2. « C’est une démarche volontaire d’acteurs se réunissant sur un territoire à taille humaine pour envisager l’avenir de leur territoire. Cela en perspective avec d’autres niveaux d’administration et d’autres échelons politiques de la nation. C’est une vision du local dans le global, qui voit le territoire comme un système en relation avec d’autres systèmes et d’autres acteurs. Les acteurs œuvrant à l’amélioration des conditions de vie de leur territoire, ce qui passe, notamment, par le développement et l’emploi. » « Le développement local est la contribution qu’un petit territoire apporte au mouvement général du développement, en termes de plus-value économique, sociale, culturelle, spatiale. C’est un produit de nature globale instrumenté par le projet de territoire d’une équipe, articulé autour d’initiatives économiques et écologiques. »
Le rôle des acteurs dans le projet collectif
Devant cette multitude d’expériences, il ne faudrait toutefois pas penser que la volonté populaire à l’origine d’un projet collectif global est un ensemble cohérent, spontané, s’exprimant et agissant en tant que tel. Dans une grande majorité des cas, il y a une personne ou une équipe qui, ayant l’intuition de porter des aspirations de cette volonté collective, va jouer, au moins à l’origine, un rôle d’initiateur, de médiateur de la mise en œuvre progressive du projet. Et puis les multiples facettes, parfois contradictoires, de la volonté populaire vont également s’exprimer et se confronter à travers la diversité des responsabilités et des groupes structurés au sein de cette population : des élus, des collectivités territoriales, les associations, les organisations à caractère professionnel (notamment les organisations paysannes), etc. Les intervenants extérieurs (administrations, bailleurs de fonds, consultant…) ont également un rôle essentiel, au moins dans les premières étapes de la démarche de développement.
Le réseau dans le développement local
Au sein d’un territoire, l’approche en réseau se caractérise par le renforcement mutuel des stratégies d’acteurs sous la forme de partenariats locaux. Trois types de partenariats locaux peuvent exister:
– un partenariat créé à l’initiative des personnes, individuellement. Participation le plus souvent militante, généralement ancrée dans une identité très forte, tissant peu à peu les bases d’une citoyenneté rénovée.
– un partenariat créé à l’initiative d’entreprises ou plus généralement d’organismes professionnels qui revendiquent une place privilégiée dans les décisions économiques
– un partenariat créé à l’initiative des pouvoirs publics – locaux ou non – qui suppléent à une initiative privée rare ou défaillante.
Les processus d’approche en réseau – mise en place d’une pédagogie de la négociation, laboratoire d’intégration multisectorielle, création de savoir-faire, passerelles vers la R&D, essaimage vers d’autres territoires – deviennent des champs d’investigation propres au développement local et constituent ce que l’on peut désormais appeler la pédagogie du développement.
Approche de décentralisation annoncée dans le DSRP de Madagascar
Le Gouvernement Malgache considère que les objectifs de développement économique, social, politique, rapide et durable pourront être plus facilement atteints dans le cadre d’une responsabilisation accrue de la population et de meilleures modes de gestion d’une administration de proximité. C’est ainsi que la mise en oeuvre de la décentralisation effective est un moyen d’ancrage et d’appropriation du développement par la population de base ; elle sera accompagnée d’une bonne déconcentration, respectueuse de la valeur de la société traditionnelle « fokonolona ». La déconcentration /décentralisation des services permettront le développement de services de qualité et de proximité. La gestion budgétaire sera rationalisée pour assurer une meilleure répartition des moyens, entre frais de fonctionnement et frais de personnel et une dotation effective aux services déconcentrés en tant que structures opérationnelles. Les nouveaux organes des provinces autonomes et ou régions doivent être pleinement responsables pour les actions de proximité qui font l’objet d’une forte demande de la part des plus pauvres. Ces organes seront à mesure même de collaborer avec des agences d’exécution du secteur public ou non, afin d’éviter la multiplication inutile d’échelons administratifs. Ils devront recevoir l’appui nécessaire pour répondre correctement aux demandes des plus pauvres, ce qui contribuera à asseoir la crédibilité des nouvelles institutions politiques locales. Les transferts de compétence qui en découleront seront particulièrement importantes dans le domaine de l’éducation, la santé, le développement rural et les infrastructures, pour consolider et institutionnaliser les dispositions déjà en cours. Ainsi, dans l’objectif principal consistant à « rapprocher le Gouvernement des citoyens par le biais de la décentralisation » et la déconcentration, cinq axes contribueront à sa mise en oeuvre, à savoir :
Créer un contexte favorable au développement économique et social des communes
Renforcer les capacités institutionnelles des collectivités
Améliorer l’autonomie financière des communes
Rendre les communes plus responsables pour la gestion des services de santé et d’éducation
Renforcer les capacités d’intervention (appui et contrôle) du niveau central
En effet, la décentralisation constitue aujourd’hui un principe essentiel de la définition de stratégies de développement basées sur la » bonne gouvernance » et de la mise en place des politiques d’aide et de coopération. Elle s’inscrit donc dans une perspective d’économie publique locale. La décentralisation est aussi censée contribuer à la réduction de la pauvreté, en améliorant la capacité des plus défavorisés à effectuer des choix, car elle renvoie à la capacité des populations et des institutions qu’elles se donnent de prendre en charge leur propre affaires dans le cadre de la » gouvernance participative « .
LE DEVELOPPEMENT LOCAL PAR LA PROMOTION DU SYSTEME PRODUCTIF LOCAL
La théorie des systèmes productifs locaux s’est d’abord construite à partir du modèle du district industriel. Celui-ci a été développé dans les années 70 et 80 à partir de la théorisation d’un certain nombre d’expériences concrètes, notamment dans la » troisième Italie « . Ceci explique sa définition assez restrictive de « concentration géographique de petites entreprises opérant dans le même secteur ou dans des secteurs proches »9. Les » systèmes productifs locaux » retiennent aujourd’hui d’abord comme caractéristique fondamentale l’existence de clusters, c’est à dire de grappes d’entreprises spécialisées dans les mêmes activités. Le critère essentiel est avant tout :
i) la concentration géographique et sectorielle des entreprises,
ii) les relations inter-firmes et entre les firmes et les institutions et structures d’interface pouvant prendre des formes diverses et plus ou moins intenses débouchant sur des effets d’entraînement.
La dynamique du système de production local est liée à leur compétitivité non seulement sur les marchés nationaux mais également internationaux. Les facteurs de compétitivité en jeu sont d’abord liés à des caractéristiques de leur organisation productive, de leur spécialisation, de la variété de leur production et de leur flexibilité :
Ils devraient regrouper un grand nombre de PME, ayant la même spécialisation, ou des spécialisations voisines, étroitement liées dans les relations input output.
Ces PME devront produire une variété de produits en petites séries, et s’adapteraient à une demande diversifiée et changeante, au contraire de la production de masse des grandes entreprises.
Elles devraient entretenir des relations de coopération-concurrence : tout en se faisant concurrence sur les mêmes marchés, elles pouvaient, notamment en cas de pointe de production, se prêter des capacités de production et de la main d’œuvre, et pratiquer une sous-traitance généralisée et souvent réciproque. Ces comportements seront à l’origine de la grande flexibilité productive de ces systèmes de PME, et permettraient d’élever le degré de variété de la production ainsi que la rapidité des changements de produit et de processus.
Leur efficience productive serait aussi le produit de l’existence d’acteurs et de ressources collectifs, ce qui permet d’établir un premier lien avec la thématique de la décentralisation. Ainsi on peut noter la présence d’un ensemble d’institutions locales, liées entre elles, assurant la promotion de l’activité spécifique du district : collectivités locales, institutions d’enseignement technique et professionnel, associations de producteurs, organismes consulaires, etc. Autrement dit devront engager dans la promotion du district les trois niveaux des autorités publiques locales, du secteur privé et de certaines organisations proches de la société civile. Cette atmosphère de collaboration favorisant la diffusion de l’information technologique dans ces dynamiques, entraînant le partage de valeurs, d’habitude, d’une identité et d’une base sociale commune, par les entrepreneurs de la zone, se traduisant par des normes de comportement spécifiques. La proximité des valeurs et des comportements a un impact spécifique sur les activités de création de ressources c’est à dire d’innovation : la diffusion de la connaissance et l’émergence des innovations notamment sont favorisées par les relations étroites entre les acteurs, qui constituent une véritable capacité d’action collective dans ce domaine. Des externalités positives naissent des caractéristiques des flux de communication internes au district, par exemple quant ils portent sur les inputs spécialisés, objets essentiels des transactions et des informations qui irriguent les secteurs concernés et les entreprises. La présence dans le district de » structures d’interface » entre recherche et industrie, souvent sous l’effet d’initiatives politiques locales, est donc déterminante, ce qui constitue un élément d’une gouvernance locale de ces territoires. Nous ferons surtout référence aux approches intégrées de développement local. Des exemples de réalisation dans le secteur social seront étudiés. Toutefois, les dynamiques de systèmes productifs locaux seront aussi passés en revue afin de contribuer à la définition des stratégies générales d’une politique régionale de soutien aux réseaux d’entreprises dans la Région Sud Ouest.
|
Table des matières
INTRODUCTION
PARTIE I : CONCEPT ET APPROCHE THEORIQUES DU DEVELOPPEMENT LOCAL
1.1- Le développement local
1.1.1- Origines et définition théorique du concept
1.1.2- La notion de développement
1.1.3- La notion de local
1.1.4- Le territoire d’action du développement local
1.1.4.1. Du macro au micro
1.1.5- Le rôle de la Région dans le développement local
1.1.6- Nécessité d’un projet collectif local
1.1.6.1. Le rôle des acteurs dans le projet collectif
1.1.6.2. L’appropriation du projet collectif
1.1.7- Rôle des ressources humaines dans les initiatives locales
1.1.8- La dynamique locale
1.1.9- Le réseau dans le développement local
1.1.10- Synthèse sur les concepts du développement local
1.2- Cadre de Développement local
1.3- La décentralisation
1.3.1- Approche de décentralisation annoncée dans le DSRP de Madagascar
1.3.2- Articulation décentralisation et niveau local
1.4- Le développement local via l’amélioration de la capacité humaine
1.5- Le développement local par la promotion du système productif local
1.6- Contexte du Développement local dans le Sud Ouest
1.7- Approche intégrée du developpement local
PARTIE II : DESCRIPTION DE LA ZONE D’ETUDES ET DIAGNOSTIC
2.1. introduction
2.2. Choix de la zone d’étude
2.3. La méthodologie adoptée
2.4. Caractéristiques de la Région étudiée
2.4.1. Présentation de la région
2.4.2. Typologie sous-régionale
2.4.2.1. Zone des plateaux calcaires
2.4.2.2. Zone des plaines littorales
2.4.2.3. Zone des basses vallées
2.4.3. Milieu physique du Sud Ouest
2.4.3.1. Relief et paysage
2.4.3.2. Géologie
2.4.3.3. Climat
2.4.3.4. Hydrologie
2.4.3.5. Sols et végétation
2.4.3.5.1. Sols
2.4.3.5.2. Végétations
2.4.3.6. Conclusion
2.4.4. Milieux Humain et social du Sud Ouest
2.4.4.1. Effectif de la population
2.4.4.3. Caractéristiques des ménages
2.4.4.5. Conclusion sur le milieu humain
2.4.4.6. Les services sociaux dans la région Sud Ouest
2.4.4.6.1. La santé
2.4.4.6.1.1. Couverture sanitaire
2.4.4.6.2. L’éducation
2.4.4.6.2.1. Taux de scolarisation primaire
2.4.4.6.2.2. Enseignements spécialisés
2.4.4.6.2.3. Enseignement supérieur
2.4.4.6.3. Situation de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement
2.4.4.6.4. Infrastructures socio-culturelles
2.4.4.6.5. La Sécurité publique dans la région sud ouest
2.4.4.6.6. Conclusion
2.4.5. Activités économiques dans le Sud Ouest
2.4.5.1. Secteur agricole
2.4.5.1.1. Agriculture
2.4.5.1.1.1. Caractéristiques globales
2.4.5.1.1.1.1. Superficie cultivée
2.4.5.1.1.1.2. Types de culture
2.4.5.1.1.1.3. Exploitations agricoles
4.4.1.1.1.4. Superficies cultivées
2.4.5.1.1.2. La production
2.4.5.1.1.2.1. Les cultures vivrières
2.4.5.1.1.2.2. Cultures de rente
2.4.5.1.1.2.3. Cultures industrielles
2.4.5.1.2. Elevage
2.4.5.1.3. Pêche et ressources halieutiques
2.4.5.1.4. Conclusion
2.4.5.2. Secteur Industrie et artisanat
2.4.5.2.1. Conclusion
2.4.5.3. Secteur Minier
2.4.5.4. Secteur du Tourisme
2.4.6. Environnement
2.4.6.1. L’environnement terrestre
2.4.6.2. L’environnement marin et côtier
PARTIE III : ANALYSE ET FAISABILITE DE L’APPROCHE INTEGREE DU DEVELOPPEMENT LOCAL DANS LA RSE
3.1. Approche intégrée du développement local dans la RSE
3.1.1. Les conditions d’une approche intégrée de développement local
3.1.2. Analyse des conditions communes des deux secteurs dans la RSE
3.1.2.1. Analyse de la réalité locale en matière de décentralisation
3.1.2.2. Analyse de la réalité locale sur le lien décentralisationdéconcentration
3.1.2.3. Analyse de la réalité locale sur le transfert de fonds et sur la responsabilisation locale
3.1.2.4. Analyse de la réalité locale sur la gouvernance et la lutte contre la corruption
3.1.3. Analyse de l’approche intégrée du développement local dans le secteur social
3.1.3.1. L’approche de soutien communautaire
3.1.3.1.1. Analyse des volets de l’appui direct des communes du FID
3.1.3.1.1.1. Programmation Annuel d’Investissement (PAI)
3.1.3.1.1.2. Gestion financière
3.1.3.1.1.3. Passation des marchés
3.1.3.1.1.4. Qualité de prestation de service
3.1.3.1.1.5. Gouvernance locale
3.1.3.1.1.6. Conclusion
3.1.4. Analyse de l’approche intégrée du développement local dans le secteur économique
3.1.4.1. Les principaux problèmes des activités économiques de la région
3.1.4.1.1. Le secteur agricole
3.1.4.1.2. Le secteur industrie et artisanat
3.1.4.1.3. Le secteur minier
3.1.4.1.4. Le secteur du tourisme
3.1.4.2. Analyse et conclusion de la réalité locale en matière de promotion du système de production localisée
3.1.4.3- Recommandations pour la promotion du système de production localisée
3.1.4.4. Lancement du processus de développement local au niveau régional
3.1.4.5. Le développement local via la promotion du système productif local
3.1.4.5.1. Système Productif Local (SPL)
3.1.4.5.2. Le cluster : Origine et définition
3.1.4.5.3. Caractères d’un cluster
3.1.4.5.4. Conditions pour qu’un cluster soit un instrument de développement local
3.1.4.6. Quelle politique régionale de soutien aux clusters ?
3.1.4.6.1. Appui direct des entreprises
3.1.4.6.2. Structure d’appui en faveur des entreprises
3.1.4.6.3. Soutien à la promotion des clusters
3.1.4.6.4. Intégration des approches du développement local
3.1.4.6.4.1. Analyse croisée de la liaison des approches sectorielles avec celles de soutien direct
3.1.4.6.4.2. Analyse croisée de la liaison des approches sectorielles avec les approches de gouvernement local
3.1.4.6.4.3. Analyse croisée de la liaison des approches de soutien direct avec celles de gouvernement local
3.1.4.6.4.4. Conclusion
CONCLUSION GENERALE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Télécharger le rapport complet