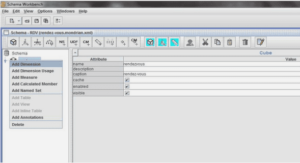APPROCHE DE DÉPLOIEMENT D’UN RESEAU SANS FIL
Contexte de l’étude
J’ai effectué ma maîtrise à trois endroits différents, à l’Université, dans un laboratoire de recherche et pour finir là où j’ai passé la majorité de mon temps en entreprise.Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue ou UQAT est située dans la ville de Val d’or. Cette dernière est une ville industrielle minière au nord-ouest du Québec. Elle a été créée lors du développement des mines d’or. En effet cette ville possède une des plus grandes richesses souterraines du Québec, avec son sol contenant plusieurs types de minéraux très recherchés, tels que le zinc, l’or, le cuivre, mais aussi du plomb et de l’argent. De nos jours, grâce à un marché boursier du minerai haut, l’industrie minière est en pleine expansion. Mais malgré des systèmes mécaniques de plus en plus évolués, il reste primordial pour la sécurité des personnes, mais aussi des équipements d’avoir un système de communication opérationnelle et au meilleur de ses capacités. Or la mise en place des mêmes réseaux que ceux mis en surface n’est pas envisageable. En effet, les modifications dues au confinement et aux obstacles propres au milieu minier demandent donc d’adapter les technologies existantes.
Ce travail a été mené au sein du laboratoire de recherche Télébec en communication souterraine (LRTCS), et dans le cadre d’un programme de bourse en milieu pratique (BMP) fiancé par l’FQRNT. La problématique traitée dans ce travail provient de défis rencontrés lors de déploiement de réseau de communication radio au sein des galeries souterraines d’une mine de zinc située à Matagami et appartenant au groupe industriel Xstrata zinc. La mine Xstrata zinc est une branche de la multinationale Xstrata basée en Espagne. Au fil des années, la mine de Matagami a vu se concrétiser de nombreux proj ets (voir Figure 1). La ville de Matagami se situe à la limite de la région d’Abitibi et de la région de la Baie James. C’est une ville relais qui subsiste principalement grâce à la mine de zinc d’Xstrata, l’entreprise d’ accueil des travaux de ce mémoire.
L’entreprise comporte trois différents sites situés: au Lac Matagami qui comporte le bureau administratif et le concentrateur; Le site Persévérance qui est fermé actuellement, mais il était ouvert durant l’élaboration de nos travaux de maîtrise et possède jusqu’à présent un système de communication fonctionnel sous terre et en surface; et le site du nouveau projet Bracemac Mcleod en cours d’exploitation. L’espace qu’occupe l’entreprise à Matagami S’étend sur plusieurs dizaines de Km2 . Le besoin en communication est très diversifié, en effet il y a plus de 250 personnes qui travaillent sur les différents sites. Ce besoin comprenant aussi bien les échanges d’information pour la gestion de pièces pour et entre les mécaniciens que du trafic issu de divers logiciels et applications utilisés par les personnels des services administratifs ou encore les géologues. D’une manière générale, les mines peuvent se classer en plusieurs types dépendant de la manière dans elles sont exploitées. Une mine à ciel ouvert ou appelé communément par son terme anglophone « Open pit » est mise en place lorsque le minerai se trouve relativement proche de la surface.
Contrairement, aux mines souterraines où il faut creuser des longs tunnels ou galeries pour atteindre le minerai. Il existe principalement deux modes d’exploitation pour les mines souterraines: celle dite mécanisée où on utilise des véhicules motorisés tels des camions, tracteur, etc. pour miner, l’autre non motorisé, exploité directement par une personne réserver exclusivement pour les exploitations de filon d’or avec des galeries très étroites ou aucun véhicule ne peut circuler. Dans une exploitation minière, on peut retrouver un mélange de ces modes d’exploitation combinant à la fois entre une exploitation à ciel ouvert et des galeries souterraines, c’ est le cas de la mine de Matagami. Ces différences de mode d’ exploitation impliquent des déploiements distincts des moyens de communication de manière à répondre aux besoins de communication.
Le système de communication de la mine Matagami est composé d’une partie centrale, qui comporte les principaux serveurs de la compagnie, est située sur le site Lac Matagami (ou MLM), un système de communication sans fil de type WiFi relie les différents lieux distants (Persévérance et Bracemac/Mcleod). Toutes les informations échangées en surface sont transportées à l’aide de différentes technologies de communication. On dénombre principalement l’usage d’un réseau de fibres optique, d’un réseau Ethernet et d’un réseau en micro-ondes radio. Xstrata possède une infrastructure complexe qui repose sur plusieurs types de technologie de communication. Pour des raisons de sécurité, les différentes informations telles que les adresses des équipements, les noms de matériels et autres ont été supprimés. Sur la Figure 2 on retrouve des groupes d’ordinateurs n’appartenant pas toujours au même réseau, des commutateurs, des serveurs, … Toutes ses technologies sont gérées par le service informatique de l’entreprise.
Propagation d’un signal RF
La propagation d’un signal radio dépend de plusieurs données, et peut varier d’un simple trajet direct (LOS) à la présence de chemins indirects (NLOS) dû aux différents obstacles situés dans la zone de communication (hommes, équipements, types de roches, etc.). Comparativement aux systèmes filaires qui sont prévisibles et stationnaires, les signaux radio sont aléatoires et ne permettent pas une analyse simple, notamment dans des environnements aussi complexes que les mines souterraines. Dans un environnement confiné, même avec une ligne de vue directe entre l’émetteur et le récepteur, le fait d’être dans une galerie avec des parois souvent irrégulières, eV ou avec des méthodes de soutènement métallique, cela provoque des trajets multiples de la propagation du signal.
Ce qui peut engendrer à la réception des interférences plus ou moins importantes ou s’il est géré de manière adaptée, il peut devenir un atout pour couvrir des zones qui ne sont plus en visibilité directe. Les principaux phénomènes perturbateurs de la propagation des ondes électromagnétiques sont la réfraction, la réflexion, la diffraction, la diffusion. La réfraction; ce produit lorsque les ondes radio sont capables de passer au travers d’un obstacle, que ce soit une paroi ou un objet. Si cela se produit alors il y a un affaiblissement de la puissance et une déviation du signal vers une autre direction. La réflexion; ce produit lors de la rencontre d’un obstacle qui est incapable d’absorber le signal. Cela est observable quand l’obstacle est de dimension supérieure à la longueur d’onde du signal. La diffraction; est produite lors de la rencontre d’une pointe ou d’une arrête. Cela provoque un changement de direction de l’onde. La diffusion ; produit lorsque le signal touche des obstacles ayant des dimensions de l’ordre de la longueur d’onde similaire ou inférieure au signal.
Les tags
La fonction de base des tags RFID est de contenir des informations (espace de stockage), puis les transmettre. Sous sa forme de base, un marqueur n’est rien de plus qu’une antenne liée à une puce électronique. Mais certaines sont plus élaborées et contiennent également une batterie, c’est ce qui différencie les tags actifs des tags passifs. Un tag actif est un marqueur disposant d’une source d’énergie telle une batterie, pour la transmission de données. Disposer d’une source d’énergie supplémentaire permet de créer un dispositif RFID plus complexe, cela autorise au système une plus grande liberté avec un temps de transmission plus long, ainsi qu’une portée pouvant atteindre une centaine de pieds (plus de 30 mètres). Cette source d’ énergie supplémentaire est également un atout pour améliorer la capacité de stockage, autrement dit la mémoire de la puce, grâce à cette énergie elle peut aller jusqu’à 128 kbit [https://www.chatpfe.com/].
Ce genre de dispositif a un coût plus élevé à la production, mais les avantages d’un tel système sont considérables. Les marqueurs dits passifs sont quant à eux des dispositifs ne disposant pas de batterie. Leur portée est donc considérablement réduite moins de deux pieds (1 mètre). La mémoire est elle aussi diminuée avec seulement quelques kbit. Ces derniers peuvent envoyer leurs informations, grâce au signal reçu de l’appareil de lecture (qui doit être plus puissant qu’avec les tags actifs). Certaines étiquettes passives sont néanmoins équipées de batteries, mais ces dernières ne peuvent être utilisées que pour une raison donnée à des appareils électroniques annexes (autres que pour la transmission radio) de la puissance. Ce genre de procédé est aussi nommé marqueur assisté par batterie. On vient de voir qu’il y a deux types d’ étiquettes, mais il y a aussi une autre différence notable entre le type de mémoire associé à un tag. Le premier type est RO pour Read Only, où lecture seule, c’est-à-dire qu’une fois le marqueur programmé par le fabricant il n’est plus possible de modifier le contenu de la mémoire.
Ces types de balises sont habituellement programmés avec un nombre très limité de données statiques. Le second type de mémoire est la plus intéressante elle s’appelle RW pour Read Write, plus communément appelé« smart tag », grâce à ce type de mémoire l’utilisateur dispose de plus de liberté de mouvement, car il peut stocker une grande quantité de données et il dispose d’une mémoire adressable qui peut facilement être modifiée [15]. Pour cette raison, la balise peut agir comme un « agent de voyage » pour données de toutes sortes, cela permet d’ avoir un système dit décentralisé, c’est -à-dire qui va moins compter sur le rôle du contrôleur. Les possibilités d’application pour les balises actives sont apparemment sans fin. Grâce à de nombreux progrès techniques et son domaine d’application très varié, les coûts de production sont bas (de l’ordre de moins de 1$ dans certains cas).
Il existe un dérivé de ces deux technologies appelées « écriture unique – nombreuse lecture WüRM (Write Only – Read Many). Il est semblable à RO pour ce qui est d’être programmé avec des informations statiques. En outre, certaines balises peuvent contenir à la fois une mémoire de type RO et RW en même temps. Par exemple, une étiquette RFID fixée à une palette peut être marquée avec un numéro de série, qui va correspondre à l’ identification de la palette (ou de son emplacement), qui devrait demeurer stable pendant toute la durée de vie de la palette. La deuxième mémoire (celle RW) sera quant à elle dédiée au contenu de cette dernière à un moment donné. Pour chaque type de tags, il existe différents appareils de lecture.
|
Table des matières
CHAPITRE I : INTRODUCTION
1 Contexte de l’étude
2 Problématique de recherche
CHAPITRE II : APPROCHE DE DÉPLOIEMENT D’UN RESEAU SANS FIL
1 Architecture d’une mine avec un environnement souterrain
2 Propagation d’un signal RF
3 Approches de déploiement sans fil dans les mines
3.1 Câble rayonnant.
3.2 Antennes distribuées
4 Conclusion
CHAPITRE III : TECHNOLOGIE RFID
1 Introduction
2 Contexte du RFID
2.1 La gestion de la chaîne logistique
2.2 Sécurité et contrôle des accès
3 Les composants d’un système RFID
3.1 Les tags
3.2 Passerelles
3.3 Contrôleur
3.4 Distance et fréquenc es selon la portée
4 Conclusion
CHAPITRE IV : APPROCHE DE CONTRÔLE DYNAMIQUE DE LA COUVERTURE RF
1 Introduction
2 Contrôle dynamique de couverture RF
2.1 Principe adaptatif.
2.2 Méthode de résolution
2.3 Organigrannne de progrannnation
2.4 Gestion de la congestion
3 Implémentation et expérimentation
3.1 Principale commande des amplificateurs
3.2 Système RFID !dentee
3.3 Récupération et traitement des données
3.3.1 SQL report builder
3.3.2 Système PI
3.4 La progrannnation
3.4.1 Le langage c
3.4.2 Le langage SQL
4 Conclusion
CHAPITRE V : ÉVALUATION ET ANALYSE DE PERFORMANCE
1 Introduction
2 Configuration réseau
3 Métrique d’évaluation de performance
3.1 Mesure du MOS
3.2 Mesure du SNR
3.3 Mesure du temps de réponse
4 Évaluation du problème de congestion ponctuel..
5 Évaluation des performances avec le système RFID
6 Conclusion
CHAPITRE VI : CONCLUSION ET PERSPECTIVES
BIBLIOGRAPHIES
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet