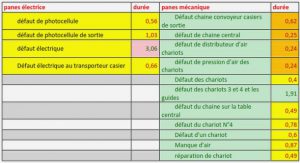Anatomie et pathologies courantes de la hanche
OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGI
Le matériau biomimétique
Comme mentionné dans la section 1.3.5.2, le chirurgien désire pour certains patients une fixation plus distale de la composante fémorale de resurfaçage et en cimente la tige, entraînant une déviation des contraintes dans la tête et le col fémoral. Dans le but de remédier aux problèmes potentiels d’ostéopénie de décharge consécutifs à cette déviation des contraintes, l’utilisation d’un matériau biomimétique dont les propriétés mécaniques sont proches de celles de l’os cortical diaphysaire est proposée (Campbell et al., 2008). Le matériau considéré dans le cadre de ce projet est un composite de fibres de carbone avec une résine de polyamide 12 (CF/Pa12), dont la biocompatibilité a été démontrée en laboratoire (Dimitrievska et al., 2008; Dimitrievska et al., 2009; Hacking et al., 2010). Ce matériau a été utilisé pour fabriquer une tige fémorale d’ATH de forme anatomique (Campbell, Bureau et Yahia, 2008), et des études par éléments finis ont démontré son potentiel de réduction de la déviation des contraintes, notamment dans la zone calcaire (zone située dans le cortex médial, juste sous la ligne de coupe de l’ostéotomie nécessaire à une ATH), dans le cadre de cette application (Bougherara et al., 2007; Bougherara, Bureau et Yahia, 2010; Caouette, Yahia et Bureau, 2011).
Ce matériau composite biomimétique sera utilisé comme matériau de base pour faire le design d’une tige non cimentée : cette tige remplacerait la tige métallique fixée par cimentation d’un implant de resurfaçage actuellement utilisé en clinique (Durom™, de Zimmer). Une composante fémorale avec cette tige biomimétique pourrait permettre la fixation de la tige en diminuant la déviation des contraintes dans la tête et le col fémoral; cette hypothèse sera évaluée numériquement dans le cadre de la présente thèse.
Objectifs
L’évaluation préclinique numérique du design du nouvel implant biomimétique requiert l’évaluation des phénomènes de déviation des contraintes (l’os est sous-contraint en raison de la présence d’un implant métallique) et d’ostéopénie de décharge mécanique (résorption osseuse consécutive à la déviation des contraintes). L’objectif principal de la présente thèse sera donc la mise au point d’outils numériques, notamment pour l’évaluation de l’ostéopénie de décharge mécanique par la modélisation de l’état de contraintes et déformations dans l’os et du remodelage osseux qui s’ensuit. Puisque la tige dans sa version non fixée ne participe pas au transfert de charges vers le fémur, il n’y a aucun avantage à en changer le matériau si elle n’est pas fixée à l’os. La nouvelle tige modélisée sera donc faite de composite biomimétique et recouverte d’hydroxyapatite (HA) de manière à en faciliter l’ostéointégration. L’évaluation de l’ostéointégration de cette tige sera réalisée par la mise au point d’une méthode de modélisation des interfaces à transfert de charge os-implant et osciment capable de simuler ce phénomène. Ces outils (méthode de modélisation de l’ostéopénie de décharge mécanique et méthode de modélisation des interfaces à transfert de charge) seront appliqués au design du nouvel implant biomimétique. Plus spécifiquement, trois objectifs ont été identifiés : 01) Mise au point d’un outil d’évaluation de l’ostéopénie de décharge mécanique par l’intermédiaire de la mise en œuvre d’un modèle de remodelage osseux qui soit adapté à l’os trabéculaire présent dans la tête fémorale et susceptible de subir une résorption osseuse consécutive à la décharge mécanique.
02) Évaluation de l’effet de la méthode de modélisation des interfaces de transfert de charge sur l’état de contraintes et déformations dans l’os de la tête fémorale, afin d’identifier les lacunes à combler des méthodes traditionnelles de modélisation. 03) Mise au point d’une méthode de modélisation des interfaces de transfert de charge osimplant qui permette la modélisation de l’ostéointégration progressive afin d’évaluer la capacité de fixation osseuse de la nouvelle tige en composite de l’implant. La mise au point de ces outils d’évaluation préclinique numérique permettra l’évaluation du design du nouvel implant à tige biomimétique.
Organisation de la thèse
La présente thèse est construite autour de trois articles traitant de la modélisation du remodelage osseux et des interfaces de transfert de charge. Dans un premier temps, les modèles ÉFs ainsi que les analyses préliminaires ayant servi à leur mise au point sont présentés au chapitre 3. La méthode des éléments finis est utilisée pour évaluer l’efficacité du matériau biomimétique à réduire la déviation des contraintes et conséquemment l’ostéopénie de décharge dans la tête et le col fémoral, dans le cas où la tige biomimétique est fixée. Cette évaluation fait l’objet du chapitre 4, qui est constitué de l’article intitulé « Anisotropic Bone Remodeling of a Biomimetic Metal-On-Metal Hip Resurfacing Implant ». L’une des limites de la méthode utilisée dans l’article du chapitre 4 est la modélisation des interfaces de transfert de charge, qui sont constituées de contacts surface à surface de type collés ou frictionnels. L’article du chapitre 5, intitulé « Influence of the Interface Modeling Method on Load Transfer in A Hip Resurfacing Arthroplasty for Different Stem Fixation Scenarios », vise à évaluer l’effet de la méthode de modélisation des interfaces de transfert de charge et des phénomènes connexes comme la présence de contraintes résiduelles attribuables à la polymérisation du ciment osseux sur les déformations dans la tête et le col fémoral, pour différents scénarios de fixation de la tige.
Afin d’évaluer les résultats obtenus pour l’implant biomimétique, il est primordial d’évaluer correctement les risques de descellement aseptique et le potentiel d’ostéointégration des implants modélisés. C’est pour cette raison que la modélisation de l’interface os-implant doit être réellement représentative du phénomène biologique. Un nouvel élément interface a été mis au point : cet élément permet de modéliser les phénomènes d’endommagement progressif et d’ostéointégration des interfaces os-ciment et os-implant. Ce nouvel élément fait l’objet des chapitres 6 et 7 : le chapitre 6 en détaille la mise au point et les propriétés, et le chapitre 7 est constitué de l’article intitulé « A New Interface Element with Progressive Damage and Osseointegration for Modeling of Interfaces in Hip Resurfacing », qui traite de l’évaluation numérique du potentiel d’ostéointégration de la tige biomimétique d’un implant de resurfaçage de la hanche à l’aide du nouvel élément interface.
|
Table des matières
INTRODUCTION
CHAPITRE 1 REVUE DE LA LITTÉRATURE
1.1 Anatomie et pathologies courantes de la hanche
1.1.1 Coxarthrose
1.1.2 Arthroplasties de la hanche
1.2 Implants de 1ière génération
1.2.1 Résultats cliniques
1.3 Implants contemporains
1.3.1 Réintroduction du resurfaçage
1.3.2 Taux de survie atteints par le resurfaçage moderne
1.3.3 Arthroplastie de resurfaçage vs arthroplastie totale conventionnelle
1.3.4 Complications et causes de défaillances
1.3.5 Techniques de fixation
1.3.6 Améliorations proposées aux implants actuels
1.4 Techniques de modélisation
1.4.1 Os fémoral
1.4.2 Ostéointégration des implants et interfaces
1.4.4 Conditions frontières
1.5 Conclusion
CHAPITRE 2 OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE
2.1 Le matériau biomimétique
2.2 Objectifs
2.3 Organisation de la thèse
CHAPITRE 3 MODÈLES GÉOMÉTRIQUES ET ANALYSES PRÉLIMINAIRES
3.1 Modélisation géométrique
3.1.1 Fémur spécifique au patient
3.1.2 Implantation
3.2 Construction des modèles par éléments finis
3.2.1 Étude de convergence des maillages
3.2.2 Propriétés des matériaux utilisées
3.2.3 Modélisation des interfaces
3.2.4 Conditions frontières
3.3 Validation des modèles par éléments finis
3.3.1 Études utilisables pour la comparaison
3.3.2 Discussion et conclusion
3.4 Modèle de remodelage osseux
3.4.1 Modélisation de l’anisotropie
3.4.2 Stimulus de remodelage
3.4.3 Autres paramètres du modèle
3.5 Conclusion
CHAPITRE 4 ANISOTROPIC BONE REMODELING OF A BIOMIMETIC METAL-ON-METAL HIP RESURFACING IMPLANT
4.1 Résumé
4.2 Abstract
4.3 Introduction
4.4 Materials & Methods
4.4.1 The finite element model (FEM)
4.4.2 The anisotropic bone remodeling model
4.5 Results
4.6 Discussion
4.7 Conclusion
4.8 Acknowledgements
CHAPITRE 5 INFLUENCE OF THE INTERFACE MODELING METHOD ON LOAD TRANSFER IN A HIP RESURFACING ARTHROPLASTY FOR DIFFERENT STEM FIXATION SCENARIOS
5.1 Résumé
5.2 Abstract
5.3 Introduction
5.4 Materials and Methods
5.4.1 The FE models
5.4.2 Interface modeling methods
5.4.3 Bone cement curing modeling method
5.4.4 Results presentation
5.5 Results
5.5.1 Bone strains within the femoral head
5.5.2 Predicted bone density changes in the femoral head
5.5.3 Stresses within the femoral component
5.5.4 Implant stability
5.6 Discussion
5.7 Conclusion
CHAPITRE 6 MISE AU POINT DE L’ÉLÉMENT INTERFACE OSTÉOINTÉGRABLE ET DÉGRADABLE
6.1 Relations constitutives du modèle de décohésion à directions couplées
6.1.1 Données expérimentales utilisées pour paramétrer les courbes constitutives
6.1.2 Modèle de décohésion de Moréo
6.1.3 Procédure de couplage des directions
6.1.4 Surface de traction du nouveau modèle
6.2 Application des courbes constitutives dans un modèle ÉFs
6.2.1 Formulation de l’élément interface
6.2.2 Vérification du fonctionnement de l’élément interface
6.2.3 Application de l’élément interface dans un modèle ÉF
6.3 Conclusion
CHAPITRE 7 A NEW INTERFACE ELEMENT WITH PROGRESSIVE DAMAGE AND OSSEOINTEGRATION FOR MODELIN OF INTERFACES IN HIP RESURFACING
7.1 Résumé
7.2 Abstract
7.3 Introduction
7.3.1 Bone-implant and bone-cement interface characteristics
7.3.2 Alternative methods for interface modeling
7.3.3 Objectives
7.4 Materials and methods
7.4.1 Interface model
7.4.2 Finite element model
7.5 Results
7.5.1 Effect of interdigitation depth of the bone-cement interface
7.5.2 Bone strains
7.5.3 Micromotions and osseointegration at stem-bone interface
7.5.4 Stresses in the implant
7.6 Discussion
7.6.1 Primary stability of hip resurfacing vs total hip arthroplasty
7.6.2 Effect of interdigitation depth
7.6.3 Micromotions and osseointegration at stem-bone interface
7.6.4 Compressive behavior of the bone-cement interface
7.6.5 Limitations
7.7 Conclusion
7.8 Acknowledgements
CHAPITRE 8 DISCUSSION GÉNÉRALE
8.1 L’implant Durom™
8.1.1 Design de l’implant
8.2 Méthodes traditionnelles de modélisation des interfaces
8.3 Nouvel élément pour la modélisation des interfaces
8.4 Limites du modèle ÉF
8.4.1 Le matériau composite biomimétique
8.4.2 L’élément interface
8.5 Travaux futurs
CONCLUSION
LISTE DE RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet