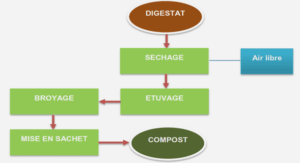Analyse du corps
L’étude de l’anorexie mentale du point de vue anthropologique doit impérativement passer par une analyse du corps et de l’alimentation, notions à travers lesquelles les différentes théories en sciences sociales appréhendent ce trouble. Ainsi, nous nous intéresserons tout d’abord à l’histoire du corps en Occident, pour comprendre l’évolution, à travers les âges, dans les représentations des corps sexués et genrés. Par la suite, nous questionnerons le rapport à l’alimentation de ces mêmes sociétés occidentales, plus particulièrement sous l’angle de la restriction alimentaire, ce qui nous permettra d’envisager la question de la déviance par rapport aux normes relatives à la consommation de nourriture. Ces deux premiers thèmes nous amènerons à prendre en compte une thématique se rapportant à la fois à l’esthétique corporelle et à l’anorexie mentale : le sport, et plus généralement l’activité physique. Enfin, un dernier point semble nécessairement devoir être abordé dans notre étude sur l’anorexie mentale. Le corps, une fois travaillé à partir de ces normes et pratiques corporelles et alimentaires, se trouve depuis le milieu du XXe siècle dans une posture nouvelle : il est montré, affiché, revendiqué. Nous terminerons ainsi notre étude sur le corps par une réflexion sur le corps exhibé, qui est une problématique centrale dans le cas de l’anorexie mentale dans l’espace public et médiatique, et qui, bien que cela soit moins évident, rentre pourtant aussi en jeu dans les conceptions psychiatriques de ce trouble.
Histoire du corps et de l’esthétique
L’esthétique et les canons de beauté occidentaux se sont modifiés au fil des siècles, suivant les évolutions plus larges de la société. Le corps lui-même s’est ainsi façonné en fonction de ces normes esthétiques régissant la bonne tenue sociale. A chaque époque, les individus ont agi sur ce corps pour le modeler de manière à en faire un corps socialement acceptable. L’histoire du corps féminin a d’abord été une histoire masculine : la beauté féminine est celle qui correspond à l’image de la femme idéalisée par les hommes et la place dans la société lui qui est accordée. Au XVIe siècle, « cette première beauté moderne ne se définit qu’au féminin, combinant inévitablement faiblesse et perfection, aiguisant encore sa spécificité » (Vigarello, 2004 : 27). La beauté doit être pudique, car la société est puritaine. Cette bienséance religieuse veut que la beauté soit avant tout dans les bonnes mœurs. L’association du beau au bien n’est pas nouvelle, et n’est que la résurgence des critères du Moyen Âge, momentanément éclipsés au XIIIe siècle, au profit d’une méfiance passagère assimilant beauté et tentation trompeuse (Amadieu, 2005) ; « le péché et la peur, la peur du corps, la peur du corps de la femme surtout, reviennent comme une litanie sous forme de mises en garde ou de condamnation » (Gélis, 2006: 18). La beauté est muette, statique. La visibilité de cette beauté passe avant tout par le visage, ce qui s’explique notamment par le fait que les vêtements féminins alors décents cachent le corps quasi-entièrement. Les yeux sont d’une importance capitale. Ce « sexe » de la beauté est envisagé en fonction des théories humorales. Les hommes sont du côté du chaud et du sec ; les femmes sont froides et humides, plus fragiles, plus enclines à la faiblesse (Vigarello, 2004).
Au XVIIe siècle, la beauté devient expressive : « Une dynamique particulière enrichit les critères de la beauté dans le monde classique : l’accroissement des repères de l’étiquette et du maintien, la civilité nouvelle insensiblement imposée par la sociabilité urbaine et les normes de cours. […] Une seconde dynamique promeut encore ce versant expressif, celle transformant les représentations du corps. […] La beauté physique gagne en profondeur et en intériorité. Elle gagne aussi, au bout du compte, en légitimité nouvelle : celle de l’artifice et de l’embellissement, même si demeure la certitude d’un seul modèle possible de perfection » (Vigarello, 2004 : 57). Ce nouveau dynamisme dans la beauté est notamment lié au développement du mode de vie urbain ; mais cette dynamique est paradoxale, puisque sont recherchés à la fois un corps expressif et un corps maintenu, redressé. Il est encore ici question d’une beauté presque exclusivement féminine. Le regard est décentré par rapport au siècle précédent : il se déplace du visage vers le corps. Il porte désormais sur la taille, et sur l’allure générale. Ceci explique la vogue nouvelle du corset en tant qu’instrument de maintien. Le corset est en fabriqué en 1647 par Fabrice d’Aquapendente. Au départ réservé au soin médicaux, il devient néanmoins, sous une forme simplifiée, «l’instrument quotidien de la tenue : celui de l’élégance et du maintien » (ibid. : 79). Le corset impose l’esthétique dans la prévention et la pédagogie : les enfants de familles aisées en portent un dès leur plus jeune âge, dans le but de façonner au plus tôt leur corps, de le maintenir droit autant que de le redresser. Le corset féminin répond à cette même logique : le buste doit être droit, le corps cambré. Le corset pour enfant disparaît aux alentours de 1770. En revanche, le corset féminin subsiste tout en se transformant : il devient moins rigide, et sans baleines. « La rigidité régresse. La beauté voudrait des parties plus mobiles comme des mouvements plus légers » (ibid. : 108). Cette mobilité reste néanmoins toute relative. Le corset subsiste en tant qu’accessoire féminin incontournable, structurant la silhouette et contraignant le corps à une posture droite, n’ayant qu’une marge de liberté réduite. Ce même corset accroît la distinction sociale des corps. La beauté se « naturalise ». Le caractère devient l’un des éléments de cette beauté, distinguant ainsi la beauté « animée » et la beauté « inanimée », selon que la femme soit plutôt extravertie ou introvertie (bien qu’ici, la notion d’extravagance soit toute relative). La beauté n’est plus régie par la raison : elle passe du côté des passions, de l’affect. L’attention accordée, au siècle dernier, aux yeux devient un intérêt pour le regard : l’idée nouvelle d’une beauté « profonde » s’installe (ibid.). Au XVIIIe siècle, « La beauté […] n’est plus commandée par l’intelligence mais par le sensible ; le critère n’est plus celui de l’absolu, mais celui du relatif » (ibid. : 93). Un rapport entre le beau et la fonction s’instaure dans les normes esthétiques corporelles. Les chairs s’affermissent. L’excès de « délicatesse » est perçu comme nuisant tant à la beauté qu’à la santé (Venel, 1776 : 115) : certaines considérations hygiénistes entrent alors en jeu dans la conception de la beauté. Ce fait est certainement à mettre en relation avec la philosophie des Lumières ellemême, qui revient sur la distinction entre l’âme et le corps. Établie dès l’Antiquité, cette séparation de l’esprit et de la matière a, très tôt, été reprise par l’Église dans le sens d’une opposition entre corps impur et âme pure, afin de stigmatiser le corps en tant que chose peccamineuse. Les humanistes reforment cet ensemble, et mettent en accord corps et âme. Ces philosophes se réapproprient l’adage de Juvénal mens sana in corpore sano, qu’ils appliquent à leur philosophie, traduit sous la formule un esprit sain dans un corps sain. Le couple « beauté-santé » actuel pourrait donc dater du siècle des Lumières. Le corset féminin n’a plus vocation au redressement. Il est pourtant conservé, sous une forme encore modifiée et simplifiée, pour servir au maintien des « chairs superflues » ; il n’est alors pas encore totalement question de transformer le corps lui-même pour le rendre conforme aux normes esthétiques, puisque l’instrument sert à cacher les défauts de ce corps. La beauté s’individualise.
Les artifices deviennent acceptables. La coiffure devient une prolongation de la beauté, un arrangement nécessaire (ibid.). La tenue féminine se transforme au XIXe siècle : les robes changent, deviennent plus moulantes, plus droites. Les représentations de l’esthétique féminine n’ont pourtant pas totalement changé : l’aspect cambré du corps suggéré par les robes bouffantes reste dans les esprits, ce qui oblige alors le corps lui-même à se tenir cambré. Le corset est toujours porté, aidant le corps à simuler cette posture. Le primat de la cambrure l’emporte d’ailleurs sur celui de la minceur. La beauté se fait « romantique ». La pâleur en devient un critère, signifiant la profondeur de l’âme. Ce siècle est aussi celui de l’éloge de l’artifice : la beauté « volontaire » est valorisée, conçue comme une beauté sociale. La féminité doit être ostentatoire et improductive (Vigarello, 2004). Cette nouvelle beauté serait à l’origine du critère essentiel de la minceur dans les canons esthétiques actuels. « Si ce modèle corporel s’atténue en France à partir des années 1850, il ne disparaît cependant ni totalement, ne définitivement. À l’échelle du XIXe siècle, le corps romantique a donc sans doute constitué un tournant, et non une parenthèse […]. Cette apologie de la restriction alimentaire et du corps qui l’accompagne n’est toutefois pas seulement une mode romantique. Elle manifeste l’inscription du contrôle alimentaire et de la minceur dans une topologie sociale qui engage à la fois la classe et le genre » (Darmon, 2008 : 30-31) .
La « conquête anatomique » débute en cette fin de siècle : le regard se pose définitivement sur le corps. « L’affleurement de ces hanches, dès la fin du XIXe siècle, ne transforme pas seulement les modèles, il transforme les pratiques : celles de l’amincissement en particulier » (ibid. : 173). Il s’agit désormais d’ « amincir le «bas » » (Vigarello, 2004 : 174). Les pèse-personnes ne sont pas encore démocratisés, mais il est possible et encouragé pour les femmes de prendre les mesures de leurs mensurations, à l’aide notamment d’un mètre-ruban. Parallèlement, les grands magasins se développent. « À cette diversification des soins et du regard sur soi, demeurée très instinctive, rare même, s’ajoute un accroissement des objets de la beauté socialement plus étendu à la fin du XIXe siècle […]. Un large « marché de la beauté » s’est constitué. Ce qui étend toujours davantage le thème de l’artifice, banalisant avec la fin du siècle l’image d’une beauté construite, toujours moins définissable hors de la mode et des conventions » (ibid. : 180). Les grands magasins, le Bon Marché en particulier, diffuse la culture bourgeoise parmi les travailleurs du secteur tertiaire, les amenant à devenir la classe moyenne. Ils démocratisent également un nouvel outil d’inspection du corps, le rendant accessible au plus grand nombre : le miroir. Les femmes se regardent désormais de plain-pied, dans leur intimité quotidienne. Le nu se normalise. Dans le même temps, le corps commence à se dévoiler en été.
Au XXe siècle, le corps se veut mince, tonique, résolument actuel : « Toute aussi importante, une mutation commencée avec les années 1920 a conduit aux silhouettes flèches d’aujourd’hui, en magnifiant un corps liane aux jambes interminables, une effigie souple, musclée, mêlant bien-être et ventre plat. Ce qui confirme l’inévitable présence de la norme collective, son impact majeur, alors que les formules individualisantes n’en sont elles-mêmes qu’un des aspects » (Vigarello, 2004 : 189). Le corps se montre, s’arbore, se met en scène dans la vie quotidienne, sous la forme d’un corps esthétisé au plus haut point, travaillé sans en avoir l’air. Présenté ensoleillé, actif, demi-nu, ce nouveau corps mêle vigueur et minceur. Le corset disparaît définitivement, remplacé par le soutien-gorge, préconisé par le couturier Poiret dès 1906, et qui opte pour un maintien plus naturel ; la gaine disparaît par la suite, réduisant la lingerie à sa plus simple expression (Sohn, 2006 ; Ory, 2006). Les mensurations évoluent, et les chiffres envahissent les magazines féminins à partir des années 1930. Ces derniers fixent les normes de rapport entre poids et volume correspondants à la taille de chacun. « Les indices s’aiguisent, les rapports se resserrent, plus sévères qu’auparavant : le niveau de poids n’est plus seulement équivalent à celui des centimètres dépassant le mètre, 60 kg pour 1,60 m, il lui est inférieur, 55 kg ou 57 kg pour 1,60 m, comme le suggère La Coiffure et ses modes en 1930 » (Vigarello, 2004 : 201). Le thème du poids domine, même si la balance reste un instrument encore rare, car encombrant et coûteux. L’appareil évolue en revanche après 1935 : il devient plus mobile, plus léger ; plus accessible. Les conseils et injonctions de beauté donnés par la presse féminine se renouvellent avec cette invention : « Qui souvent se pèse se connaît bien » (ibid. : 202). Cette insistance sur les chiffres, cette attention portée au moindre écart, pourrait avoir favorisé la vogue des concours de beauté. Dans ces mêmes années apparaît également un élément nouveau dans cette gestion intensive du corps féminin : la cellulite. « Palpation, pincement, massages divers révèlent brusquement ce qui aurait pu depuis toujours être perçu. La cellulite naît d’un effet de regard : une manière de porter les yeux et la main, une culture de l’examen aussi, confrontant plus qu’auparavant dénudement et enlaidissement » (Vigarello, 2004 : 222). Le magazine Vogue d’août 1939 en fait l’ « ennemi public numéro 1 ». Entre 1950 et 1960, le corps est devenu un objet de consommation. La beauté se veut généralisée, portée par « la rhétorique lisse et versatile du marché » (id.). « Le corps de l’homme du XXe siècle – qui sera pendant longtemps, en première ligne, un corps de femme– sera soumis aux aléas d’un triple régime cosmétique, diététique et plastique, considéré ici dans un ordre croissant de nouveauté par rapport aux pratiques anciennes » (Ory, 2006 : 136).
Au XXIe siècle, « la silhouette l’emporte, imposant définitivement le « bas », sa référence active, mobile, sur un visage longtemps jugé dominant » (Vigarello, 2004 : 229). Les pratiques se diffusent et s’étendent à une plus grande tranche d’âge : les pré-adultes, accédant quasiment aujourd’hui au statut d’adultes, partagent maquillage, recours chirurgical, artificialisation et esthétisation de soi. La beauté n’est plus exclusivement féminine ; la femme n’est plus seule à connaître les injonctions des normes esthétiques. « Le principe d’égalité a tout changé. La beauté physique échappe à la seule dépendance, comme elle échappe au seul « éternel féminin », traversant des références auparavant exclusives l’une de l’autre : la passivité, l’activité, l’assujettissement, l’autonomie. Un basculement a eu lieu dont il est difficile de mesurer toute l’étendue : la beauté, ne définissant plus un genre, peut être cultivée et même revendiquée par les deux. Elle s’est émancipée du spectre de la «force » ou de la « faiblesse », de celui de la valorisation ou de la dévalorisation, devenant « beauté illimitée » » (ibid. : 233). Néanmoins, la beauté n’est pas pour autant unisexe : « La féminisation du muscle, la masculinisation de la minceur ne sauraient, bien évidemment, réduire les deux modèles à l’identique » (id.). Bien que de grands traits de l’esthétique corporelle et de soin du corps soient partagés par les deux sexes, certaines modes ne s’appliquent pas également. C’est ainsi le cas du modèle de la minceur extrême, exclusivement féminin, qui trouve son apogée dans les années 1960, porté par la vogue de la poupée Barbie et les mannequins façon Twiggy (Ory, 2006). La beauté est, depuis les années 1980, sous tendue par « une obsession des enveloppes corporelles : le désir d’obtenir une tension maximale de la peau ; l’amour du lisse, du poli, du frais, du svelte, du jeune ; l’anxiété face à ce qui de l’apparence paraît relâché, plissé, poché, fripé, ridé, alourdi, ramolli ou détendu ; une dénégation active des marques du vieillissement sur l’organisme » (Courtine, 1993 : 229). Il faut contextualiser cette évolution des critères esthétiques. La beauté change « bien au-delà des seuls effets de mode : elle épouse les grandes dynamiques sociales, les ruptures culturelles, les conflits de genre ou de génération» (Vigarello, 2004 :255).
|
Table des matières
I. Introduction
II. Analyse du corps : esthétique et alimentation
1. Histoire du corps et de l’esthétique
2. Les normes alimentaires et rapport à l’aliment
a) La diététique
b) Les régimes
c) Les troubles du comportement alimentaire
3. La diffusion des normes occidentales
4. Le corps musclé
a) Histoire du sport
b) Le muscle
c) L’anorexie mentale dans le sport
5. Le corps exhibé
a) Le culte du corps
b) La photographie
c) Le corps anormal
d) Exhiber le corps maigre
III. La construction de la catégorie médicale de l’anorexie
1. Jeûnes religieux et anorexie mentale
a) Les jeûneuses mystiques sont-elles-anorexiques ?
b) La nosographie comme fait de culture
2. Épidémiologie de l’anorexie mentale
a) Revue des données dans la littérature psychiatrique
b) Le problème de la fat phobia
c) Existe-t-il une épidémie d’anorexie mentale ?
3. La médecine comme idéologie
a) Quantitatif et qualitatif
b) La psychiatrie est-t-elle universelle ?
4. Des premières observations aux taxinomies psychiatriques
a) Premières observations
b) Entre physique et mental : la recherche des causes de l’anorexie
c) L’anorexie mentale comme pathologie psychiatrique. Définitions et traitements
IV. Politique et anorexie
1. L’anorexie comme objet politique : l’approche féministe de l’anorexie mentale
a) Les critiques féministes de la psychiatrie
b) L’anthropologie critique féministe de la santé
2. L’intersectionnalité dans l’anorexie mentale
a) Un trouble de l’adolescence
b) Un trouble féminin
c) Un trouble de classe
d) Un trouble de jeunes filles blanches
3. L’anorexie comme objet des politiques
a) Les politiques de santé publique en matière de nutrition
b) L’anorexie dans le mannequinat
c) L’anorexie sur internet
V. Conclusion