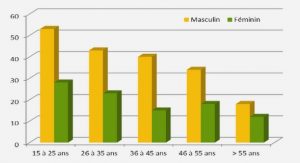Exploitation agricole
L’exploitation agricole est une entité économique dans laquelle l’agriculteur pratique un système de production en vue d’augmenter son profit. (Ministère de la Coopération (République Française), 1980) C’est aussi une unité de production ayant pour ressources la surface agricole, le nombre d’actifs, la superficie des différentes cultures, l’effectifs des troupeaux, le nombre et puissance des matériels, la capacité des bâtiments, la quantité des intrants. Elle est gérée par un ou plusieurs niveaux de décisions. La gestion s’effectue spatialement et temporellement en fonction des capacités intrinsèques de l’unité et des aléas et situations extrinsèques des milieux écologique, économique et social. La dépendance avec ces situations caractérise l’exploitation comme un système ouvert où il faut connaître les conditions d’accès et les rapports de prix pour les achats d’intrants et d’équipement, la vente de produits agricoles, la location de terre, la location de main d’œuvre, les emprunts de capital (CIRADGRET, 2000). D’autres points de vue stipule que c’est une unité technico- économique de production agricole comprenant tous les animaux qui s’y trouvent, toutes les terres utilisées entièrement ou en partie pour la production agricole et qui, soumise à une direction unique, est exploitée par une personne seule ou accompagnée d’autres personnes, indépendamment du titre de possession, du statut juridique, de la taille et de l’emplacement (MAEP, 2006). Mais encore, c’est une juxtaposition d’un nombre variable d’unités élémentaires de production formant une exploitation qui deviendra l’unité de production du secteur agricole (ENSA, 1972).
Analyse-diagnostic des situations agraires
L’analyse- diagnostic des situations agraires est l’identification et la hiérarchisation des éléments de toutes natures, que ce soit agro- écologique, technique, socio- économique ou autre, qui conditionne le plus l’exploitation des systèmes de production agricole et elle permet de comprendre comment ils influencent concrètement sur les transformations de l’agriculture. Elle présente les phénomènes normaux et étudie les différences entre les faits observés par zonage et typologie tout en mettant les mécanismes de ces dernières (DUFUMIER, 1996).
Stratégies des exploitations des zones de production
En englobant les pratiques des différentes spéculations, trois (03) grands groupes de répartitions sont marqués et ils sont liés à ces trois fleurs coupées. D’une part, au- dessus, deux (02) groupes de filières sont marquées. Le premier englobe les spéculations tels que : porc, volaille, arachides, fruits et quelques fleurs coupées. Ce groupe adopte une stratégie qui sera, dorénavant, appelée stratégie glaïeuls, du nom de cette grande fleur pratiquée dans ce type de système de production. Le deuxième groupe présente les spéculations manioc, maïs, pois chiche et les fleurs telles que : roses, hypocrites et gypsophiles. La présence de matériels et d’actifs y est aussi marquée. Ce groupe adopte alors une stratégie qui sera nommée : stratégie rose, du nom de cette grande fleur qui est pratiquée dans ce système. D’autre part, en-dessous, la stratégie englobe les spéculations tomates et les petites fleurs telles que godetia, marguerite, statice, pied d’alouette et gueule de loup. Pour ce groupe, la stratégie sera appelée : stratégie petites fleurs, du fait que les grandes fleurs ne sont pas pratiquées dans ce système et que seules les petites fleurs le sont. L’analyse en composante principale, affichée en annexe II, liée aux observations sur les spéculations fleurs coupées uniquement montre des différences significatives en termes de stratégies adoptées par les paysans. Les filières riz, fraises, patate, haricots, fruits et légumes feuilles sont regroupées au centre. Il en est de même de la possession de bœufs. Ici, trois (03) stratégies dominantes ont été marquées, au niveau des systèmes de production des paysans. La première est liée à la production de glaïeuls, accompagnée de ceux des camomilles et des astromélia. Dans cette stratégie, l’élevage de volailles et de porcs sont aussi prépondérants. Les ménages présentent souvent des effectifs élevés. La deuxième est liée par la culture de rosiers. Celle-ci est accompagnée par les cultures des hypocrites et parfois des gypsophiles. Les ménages adoptant cette stratégie investissent beaucoup plus souvent dans les matériels agricoles et ont un sens poussé de la culture vivrière de manioc. La troisième est dominée par la culture de petites fleurs. Les ménages de ce groupe cultivent aussi, le plus souvent, des légumes. Les points communs sont leurs activités dans la culture de riz et l’élevage bovin qui, le plus souvent, est utilisé en traction animal. Mais l’élevage de vaches laitières commencent à prendre place et cela avec l’adoption des cultures fourragères sur les bas-fonds. Les systèmes de production diffèrent suivant les types de fleurs principales. Il y a les systèmes dont la principale culture de fleur est constituée des roses. Il y a ceux dont la culture de fleur est constituée principalement par les glaïeuls et enfin ceux principalement liés aux petites fleurs.
Structure de la filière
Pour mieux décrire les différents maillons de la filière, le circuit commercial des fleurs coupées a été établi. Les principaux maillons sont au nombre de 4. D’amont en aval, s’établissent, d’abord, les producteurs qui sont éparpillés dans la Région analamanga et, plus particulièrement, au niveau de la ceinture florale formée par les bassins de production. La plupart de ces producteurs sont des agriculteurs. Pour éviter les frais ou supporter la charge due à celle-ci, et parfois, par occupation de main d’œuvre, ils arrivent souvent qu’ils vendent les fleurs localement à d’autres producteurs ou aux collecteurs. Ces derniers occupent le deuxième maillon. Ils peuvent venir acheter les fleurs au niveau des zones de production. D’autres attendent la venue des producteurs, au niveau du marché d’Anosy mais rarement au niveau des points de ralliement. Ces collecteurs vendent principalement les produits à Anosy. Mais d’autres ravitaillent différents autres points de vente journaliers ou hebdomadaires. D’autres, encore, sont ambulants. Les marges commerciales adoptées par les collecteurs gravitent les 30%, après de long marchandages. Ensuite, il y a les fleuristes. Ils ont de grande capacité à acquérir les produits et ont différents points de vente qui sont éparpillés à proximité des divers centres d’activité de la ville, principalement : Anosy, Ampandrana, Ivato, Analakely, Antaninarenina et les autres. Parfois, ils possèdent leurs propre terrain de cultures floricoles, parfois non. Ils investissent beaucoup plus que les collecteurs dans les structures immobilières et dans d’autres équipements relatifs au commerce de fleurs. De ce fait, ils augmentent leurs coûts commerciaux. Par suite, ces fleuristes prennent beaucoup plus de marge commerciale et sont beaucoup plus exigeants quant à la quantité et surtout à la qualité des produits. L’entretien à permis d’affirmer que la marge dépasse largement les 30% des prix d’acquisition.
Le marché de fleurs coupées au niveau de la ville d’Analamanga
Le marché est aussi très localisé et limité, avec 85% à 90% du volume produit alimentant le marché d’Anosy. C’est une réclamation répétitive rencontrée souvent auprès des producteurs. En effet, le temps de vente (prise de place pour l’installation de produits) permis aux paysans est uniquement avant 08h du matin, après quoi, d’autres coûts supplémentaires doivent être payés. Or, c’est le premier marché réputé pour la vente de fleurs coupées. Malgré ce fait, d’autres points de vente sont actuellement en essor, tel le cas de Mandroseza, d’Ambanidia, d’Ampandrana, d’Ambohipo et les autres marchés hebdomadaires. Il est aussi intéressant de noter que les fleurs périssent beaucoup plus longtemps que les légumes-feuilles. La présence de cours d’eau, près des points de ralliements permet de garder la vigueur des plantes. Le marché, en tant que lieu physique, est donc un pilier de la logique commerciale des producteurs. Les saisonnalités de la production de fleurs coupées, selon les variétés, entraînent des fluctuations de prix, qui rendent avantageuses les prix des produits, en contre saison. Par contre, pour les fleurs dont la production peut se produire durant toute l’année, comme les petites fleurs, la vente permet une continuité de la trésorerie. A part Antananarivo, la ville de Toamasina est aussi une des marchés privilégiés des producteurs floricoles, surtout pendant les mois de Novembre, pour commémorer la fête de toussaint. C’est pendant ce mois que le pic de vente y est établi, avec 60 colis par jour par personne contre 5 pendant les jours normaux. Le volume de vente par semaine au niveau du marché d’Anosy est estimé à environ 25 116 286 Ar, d’après les calculs. Les roses en constituent les 64%, soit 16 000 000Ar. Ensuite, les petites fleurs y contribuent à 31%, soit 7 754 286 Ar. Et, enfin, les glaïeuls complètent les 5% restants, soit 1 362 000 Ar. Par contre, d’autres recherches affirment que la culture peut rapporter jusqu’à 200 000 Ar par mois pour les glaïeuls ordinaires, à raison de 5 000 Ar la douzaine. La production par famille est de 50 à 70 douzaines par semaine. Il y a des producteurs qui mettent en vente ses bouquets au marché de Mandroseza, tous les week-ends, et qui peuvent empocher 100 000 Ar par semaine (ANONYME, 2010). La différence est entre les prix unitaire de 1200 Ar minimum contre 5000 Ar, avant les évènements de 2009. En analyse économique, une filière peut être considérée, selon l’approche méso-économique, par le repérage, le long des diverses opérations, les acteurs, leurs logiques de comportement, leurs modes de coordination, et repérer ainsi les nœuds stratégiques de valorisation, de dégagement de marges (FRAVAL, 2010).
|
Table des matières
INTRODUCTION
1. CONCEPT ET ETAT DE L’ART
1.1. Concepts technico- économiques
1.1.1. Horticulture
1.1.2. Marché
1.1.3. Filière
1.2. Concepts liés à la ruralité
1.2.1. Terroir
1.2.2. Système agraire
1.2.3. Exploitation agricole
1.2.4. Système de production
1.2.5. Système de culture
1.2.6. Mode de faire valoir
1.3. Analyse-diagnostic des situations agraires
1.4. Stratégie paysanne
2. MATERIELS ET METHODES
2.1. Matériels
2.1.1. Justification de l’étude
2.1.2. Outils utilisés
2.2. Méthodes
2.2.1. Démarches communes aux hypothèses
2.2.2. Démarches spécifiques à chaque hypothèse
3. RESULTATS
3.1. Etude des stratégies paysannes liées à la production de fleurs coupées
3.1.1. Stratégies des exploitations des zones de production
3.1.2. Stratégies au niveau spatial
3.1.3. Stratégies spécifiques aux principales spéculations floricoles
3.2. Etude globale de l’offre de fleurs coupées dans la Région Analamanaga
3.2.1. Dispositions géographiques
3.2.2. Etude de la disparité des offres
3.2.3. Structure de la filière
3.3. Etude de la dynamique des systèmes de production des producteurs de fleurs coupées
3.3.1. Etude de la dynamique des stratégies par zones
3.3.2. Situations des fleurs coupées au sein des différentes zones de production
4. DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS
4.1. Discussions
4.1.1. Les stratégies actuelles des différents systèmes de production
4.1.2. L’organisation de l’offre floricole des bassins de production
4.1.3. Les dynamiques des systèmes de production des zones floricoles d’Analamanga
4.2. Recommandations
4.2.1. Recommandations organisationnelles
4.2.2. Recommandations techniques
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
Webiographie
ANNEXES
Annexe I : Collecte de donnees
Questionnaire
Déclaration des variables
Annexe II : Analyse en composantes principales
Annexe III : Régression
Généralités
Télécharger le rapport complet