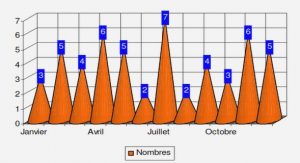Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Approche subjective (pauvreté ressentie)
L’idée principale de l’approche subjective est que la pauvreté ne se base pas sur le minimum vital ni sur l’état des conditions d’existence (de vie) mais sur la perception d’individus interrogés quant à leur situation et à leur difficulté financière, quelles qu’en soient les causes (les ménages sont supposés à connaître de façon précise leur situation), d’où les trois sous-approches :
Perception générale de leur niveau de vie : elle consiste à interroger directement les ménages quant à leur appréciation de leurs conditions et niveaux de vie ;
Non satisfaction des besoins vitaux : elle repose sur le concept classique de satisfaction des besoins vitaux pour définir la pauvreté mais à laisser aux ménages eux-mêmes d’évaluer le niveau de leur pauvreté ;
Difficulté financière : elle consiste à interroger les ménages quant à leur perception de leur aisance financière.
Lignes et mesure de la pauvreté
La ligne de la pauvreté est la ligne de démarcation qui sépare les pauvres des non pauvres. A chaque approche correspond une mesure de la pauvreté.
Ligne de la pauvreté monétaire
Par définition, le seuil ou la ligne de pauvreté dans le cadre de l’approche monétaire est le coût monétaire dans un temps et lieu donné d’un niveau de référence de bien-être individuel. Ainsi, un individu est qualifié de pauvre si les ressources matérielles à sa disposition sont inférieures à un seuil préalablement défini. Deux méthodes sont utilisées pour déterminer le seuil de pauvreté monétaire.
Seuil absolu
La notion de pauvreté absolue se réfère à la satisfaction des besoins essentiels : nourriture, logement, soins médicaux, habillement, l’énergie. Autre que la méthode fournie par la Banque Mondiale qui retient un seuil unique de un $ par personne et par jour en PPA (parité de pouvoir d’achat) de 1985 (traduit en seuil national par le biais d’une formule de PPA) ou de deux $, la méthode de coûts des besoins essentiels est souvent utilisée. Elle consiste à évaluer en terme monétaire la dépense minimale permettant à un individu de satisfaire ses besoins essentiels. Elle suppose l’évaluation de deux composantes du seuil de pauvreté : seuil de pauvreté alimentaire et seuil de pauvreté non alimentaire. Le seuil de pauvreté alimentaire correspond à un minimum calorique indispensable à la survie quotidienne, traduit en terme monétaire. Le calcul de besoin minimum journalier est basé sur la table d’équivalence calorique de l’OMS en tenant compte de la taille moyenne et de la composition des ménages. Quant aux besoins essentiels non alimentaires, l’évaluation du seuil n’est pas toutefois immédiate. L’équivalent de l’approche nutritionnelle pour les autres besoins tels que le logement, l’éducation, la santé n’existe pas. Une démarche possible est d’évaluer ce seuil à partir du seuil de pauvreté alimentaire et du rapport des dépenses non alimentaires aux dépenses alimentaires. Ainsi, le seuil de pauvreté est alors fixé comme la somme de ces deux seuils précédemment déterminés. Cependant, même à un niveau national, il peut paraître nécessaire de tenir compte de la diversité des situations régionales comme les différences dans les habitudes de consommation, des niveaux de prix et donc des coûts de la vie. En effet, il paraît important d’ajuster le seuil de pauvreté défini au niveau national en fonction des conditions réelles pour chaque région et milieu de résidence. Dans ce cas, un individu dont le niveau de dépense est inférieur à ce seuil est alors qualifié de pauvre.
On peut alors distinguer deux seuils :
seuil d’extrême pauvreté : correspond à la valeur du minimum calorique indispensable à la survie quotidienne, c’est-à-dire à la ligne de pauvreté alimentaire. En effet, un individu est qualifié d’extrêmement pauvre s’il ne dispose pas des revenus ou ressources nécessaires pour satisfaire ses besoins alimentaires essentiels, défini sur la base de besoins caloriques minimaux (2133Kcal/jour) ;
seuil de pauvreté générale ou tout simplement seuil de pauvreté : qui correspond à la somme du seuil de pauvreté alimentaire et seuil de pauvreté non alimentaire.
Seuil relatif
La pauvreté relative se réfère à la distribution des revenus et correspond à un indicateur d’inégalité. En effet, le seuil de pauvreté est fixé en fonction de la distribution des niveaux de vie de l’ensemble de la population. Dans ce cas, on peut caractériser les pauvres au regard de ceux que possèdent les autres. Cette approche définit la pauvreté sur la base des bas revenus par rapport aux revenus de la population dans l’ensemble en fixant le seuil de pauvreté « revenu minimum souhaitable » à un pourcentage du revenu moyen ou médian ou à un certain décile (quintile) de la distribution des revenus. A titre indicatif, en France, le seuil de pauvreté est fixé comme la moitié du revenu médian c’est-à-dire 50% du revenu médian.
L’on note que le seuil de pauvreté relatif est souvent critiqué dans la mesure où il peut être utilisé davantage pour refléter le degré des inégalités de la répartition des revenus plutôt que de la pauvreté. Le seuil s’accroît ou décroît selon que le revenu national s’élève ou se baisse. Autrement dit, la pauvreté est envisagée comme une forme d’inégalité.
Il faut noter aussi que le seuil relatif est destiné pour la mesure de la pauvreté dans les pays développés tandis que dans les pays en développement, où nombre des besoins élémentaires ne sont pas satisfaits, on privilégie la pauvreté absolue.
Mesure de la pauvreté non monétaire
Par l’approche non monétaire, la pauvreté se définit en termes de privation qui cherche à repérer un certain nombre de difficultés, de manque, ou de privation dans différents domaines des conditions d’existence. C’est-à-dire la pauvreté est appréhendée dans sa nature multidimensionnelle. On peut alors recourir à la méthode adoptée par le PNUD pour mesurer la pauvreté multidimensionnelle5. C’est une méthode qui se veut refléter des privations multiples dont souffre chaque individu sur le plan de l’éducation, de la santé et du niveau de vie.
En effet, le nombre d’indicateurs pris en considération est de 10. On attribue à chaque personne un score en fonction du nombre de privations subies par le ménage pour chacun des dix indicateurs des composantes. Le score maximal est de dix, chaque dimension faisant l’objet d’une pondération égale. En d’autres termes, le score maximal pour chaque dimension est de 3/10. Les dimensions de l’éducation et de la santé présentent chacune deux indicateurs, chaque composante a donc une valeur de 5/3 (16.7%). Pour sa part, la dimension du niveau de vie repose sur 6 indicateurs ; par conséquent, chaque composante est égale à 5/9 (5.6%). Les seuils sont définis de la manière suivante :
• Éducation : aucun membre du ménage n’a achevé cinq années de scolarité et au moins un enfant d’âge scolaire (moins de 14ans) ne fréquente pas l’école ;
• Santé : au moins une personne du ménage souffre de malnutrition, et un ou plusieurs enfants sont décédés ;
• Quant aux seuils de niveau de vie, ils sont associés aux facteurs suivants : pas d’électricité, pas d’accès à une eau claire et potable, pas d’accès à des installations d’assainissement adéquates, utilisation de combustibles de cuisson « sales » (déjections animales, bois ou charbon de bois), habitation avec des sols sales, le ménage ne possède ni voiture, ni camionnette, ni véhicule motorisé similaire, mais possède tout au plus l’un des biens suivants : bicyclette, motocyclette, radio, réfrigérateur, téléphone ou téléviseur.
Pour permettre de déterminer les personnes en situation de pauvreté multidimensionnelle, on fait la somme des privations de chaque ménage afin d’obtenir le niveau de privations par ménage, noté c. Le seuil de pauvreté a été fixé à 3 ou 33.3% c’est-à-dire, on considère qu’un ménage (et chaque membre) est multidimensionnellement pauvre si son niveau de privations c est supérieur ou égal à 3 ou 33.3%.
Un ménage dont le niveau de privations se situe entre 20 % et 33,3 % (2 à 3) est vulnérable à la pauvreté multidimensionnelle ou risque de se retrouver dans cette situation. Les ménages dont le niveau de privations est supérieur ou égal à 50 % sont en situation de pauvreté multidimensionnelle sévère.
Mesure de la pauvreté subjective
Le seuil de pauvreté subjective est construit à partir des résultats des enquêtes auprès des ménages portant sur leurs perceptions de leur condition et niveau de vie, difficulté budgétaire qu’ils rencontrent.
Pour la perception générale de son niveau de vie
Pour évaluer eux-mêmes leur condition et niveau de vie, les ménages doivent répondre à deux questions suivantes :
Comment estimez-vous votre niveau de vie actuel : très élevé, élevé, moyennement élevé, moyennement faible, faible, très faible ? ou bien dans quel niveau social classez-vous votre ménage en comparaison avec ce qui règne dans votre environnement social, est-ce parmi les très riches, les relativement riches, les moyens, les relativement pauvres ou les très pauvres ?
Quel est votre sentiment sur vos conditions de vie actuelles : ça va bien, ça va à peu près, c’est juste mais il faut faire attention, vous y arriver difficilement, ne sait pas ?
Le score de pauvreté subjective générale est construit en échelonnant les réponses pour chaque question. On attribue une valeur maximum aux réponses les plus négatives, et un score nul aux deux premières modalités qui traduisent des sentiments de satisfaction.
Non satisfaction de besoins vitaux
Rappelons que cette approche repose sur le concept classique des besoins vitaux pour définir la pauvreté mais le niveau de satisfaction est appréhendé d’un point de vue subjectif, c’est-à-dire elle consiste à laisser aux ménages d’évaluer eux-mêmes leur niveau de satisfaction. Pour déterminer le seuil permettant de classer un ménage comme pauvre, on va emprunter la méthode appliquée par Razafindrakoto Mireille et François Roubaud6(2000). Ainsi, premièrement, il faut déterminer les besoins considérés comme vitaux pour la population étudiée. On se base sur les réponses à une première série des questions demandant aux ménages qu’ils estiment nécessaires parmi certains nombres des items. Puis, on sélectionne les critères suivant le principe de consensus. Ainsi, on a retenu les types de besoins nécessaires par plus de 75% des ménages enquêtés, ce qui a conduit à retenir quelques items parmi les items proposés.
Il est à noter que les principaux besoins jugés essentiels par les ménages recoupent largement ceux qui sont habituellement retenus par les économistes (alimentation, santé, éducation). Concernant chacun de ces besoins, les ménages ont été interrogés sur leur niveau de satisfaction, compte tenu de leur consommation effective. Le score cumulatif de pauvreté subjective de satisfaction des besoins a ainsi été construit sur la base des réponses obtenues pour les items identifiés comme fondamentaux.
De ces différentes approches et différentes mesures, on peut résumer que la pauvreté est un phénomène complexe multidimensionnel. Elle recouvre différentes sortes de privations. Le recours à ces trois approches (monétaire, non monétaire et subjective) permet de bien appréhender la définition d’un état de pauvreté pour une personne ou un ménage ou catégories d’individus voire un pays. Mais ça exige beaucoup de temps, un certain coût relativement élevé. Ainsi, les principales analyses portant sur ce sujet s’arrêtent souvent sur la dimension monétaire, qui est facile à appréhender et à mesurer. En effet, il est difficile de donner une définition stricte de la pauvreté. S’arrêter sur une définition précise est toutefois nécessaire si l’on veut quantifier l’ampleur de la pauvreté, sa sévérité. Réciproquement, toute quantification de la pauvreté doit être relativisée à une définition préalablement établie.
PHASE D’AGREGATION
L’agrégation quantitative des situations individuelles peut recouvrir différentes formes. Elle varie suivant les critères et objectifs retenus. On peut citer deux méthodes possibles, qui peuvent être complémentaires : l’une basée sur le seuil de pauvreté et l’autre, celui adoptée par le PNUD qui veut appréhender la pauvreté dans sa nature multidimensionnelle et fonde son étude sur la notion du développement humain.
Les indicateurs élémentaires
Une fois identifié le seuil de pauvreté permettant ainsi de recenser les populations pauvres, différents indicateurs peuvent être proposés pour agréger les situations individuelles en une mesure synthétique. Comme le bien-être peut être mesuré par la consommation, le revenu, l’utilité individuelle, il est représenté par un nombre Yi sans plus de précisions, mais parfois désigné par commodité par le terme revenu ou consommation. On peut emprunter la méthode de comparaison des indicateurs ( P )
i : un individu ou un ménage pauvre sachant que 1<i<q
q : nombre total des individus ou ménages pauvres, vivant en dessous du seuil z
n : effectif total de la population ou des ménages
Yi : consommation ou revenu de l’individu i.
De cette formule, on obtient les trois indicateurs suivants :
L’incidence de la pauvreté
Pour α=0, on obtient P0= q =H appelé taux de pauvreté, défini comme le pourcentage ou la n proportion des pauvres dans la population totale.. Cet indicateur permet d’appréhender l’étendue de la pauvreté. On a fréquemment retenu le terme d’incidence pour désigner cette mesure ou le terme de headcount pour la Banque Mondiale.
Par exemple, P0=60% : cela signifie que 60% de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté.
Cependant, cette mesure d’incidence ne donne aucune information sur l’intensité de la pauvreté et sur les différences de revenu au sein de la population pauvre. Pour en rendre compte, il est opportun d’apporter les deux indicateurs suivants.
L’intensité de la pauvreté
Pour α =1, P1= H*I avec I= (z-M)/z où M le revenu moyen des pauvres, I ratio du déficit de revenu et P1 l’intensité de la pauvreté qui désigne l’écart de revenu moyen ou de niveau des consommations moyennes des pauvres à combler pour atteindre le seuil de pauvreté.
Cette mesure est parfois appelée déficit de revenu. En effet, le montant total qu’il faudrait consacrer à une réduction totale de la pauvreté est égal à q*z*P1.
La sévérité de la pauvreté
Si α=2, on obtient P2 qui mesure la sévérité ou la profondeur de la pauvreté. Ainsi, elle mesure la concentration des pauvres en dessous du seuil. C’est la somme des carrés des écarts entre le revenu moyen et le seuil de pauvreté.
Il est à signaler que P1 et P2 accordent plus d’importance aux pauvres parmi les pauvres.
Si les niveaux de consommation des certains groupes d’individus pauvres s’approchent du seuil, la valeur de P1 et P2 diminuent alors que la valeur de P0 reste la même jusqu’à ce que ces niveaux dépassent le seuil. Par ailleurs, on peut dire que ces trois mesures élémentaires de la pauvreté sont en fait complémentaires et leur évolution peut parfois recouvrir des situations très différentes. En effet, lorsque la dotation initiale d’un pauvre augmente sans toutefois dépasser le seuil de pauvreté, l’incidence de la pauvreté reste identique mais son intensité diminue. Il en est de même, si la dotation d’un pauvre est en partie redistribuée en faveur d’un plus pauvre, sans que la dotation de ce dernier après redistribution ne franchise pas le seuil, l’inégalité parmi les pauvres décroît mais l’incidence et l’intensité moyenne restent inchangées.
Les indicateurs de PNUD
Avec l’apparition du concept de développement humain au début des années 90, le PNUD a élaboré une autre mesure que celui basée sur le seuil de pauvreté.
L’IDH et indicateur des pénuries des capacités (IPC)
L’IDH (indicateur de développement humain)8
C’est un indice composite qui se fonde sur trois critères majeurs à savoir :
La longévité mesurée par l’espérance de vie à la naissance ;
Niveau d’éducation mesuré par un individu mesuré pour le le taux d’alphabétisation et pour le le taux brut de scolarisation tous niveaux confondus ;
Le niveau de vie évalué à partir du PIB par habitant en tenant compte de la parité du pouvoir d’achat (PPA).
Une fois que les valeurs minimale et maximale sont définies, on calcule pour chacune de ces variables composantes un indice de la manière suivante :
Ces valeurs minimale et maximale sont respectivement de :
– e0 min=25 ans et e0 max=85 ans pour l’espérance de la vie ;
– alpha. min=0% et alpha. max=100% pour l’alphabétisation des adultes ;
– scol. min=0% et scol. max=100% en ce qui concerne le taux brut de scolarisation ;
– PIB min=100$ et PIB max=40.000$ pour les valeurs minimale et maximale du revenu réel par habitant.
Il est à noter que la définition de cet indicateur n’a cessé de s’évoluer pour tenir compte des critiques qui lui ont été adressées. En effet, depuis 2011, l’IDH se base sur une moyenne géométrique :
L’objectif est d’éviter qu’un très mauvais score de l’une des composantes de l’indice puisse être intégralement compensé par un meilleur score sur une autre. A part, le calcul de niveau de vie est aussi modifié. En effet, il est calculé à partir d’un logarithme naturel et le PIB par habitant a été remplacé par le revenu national brut par individu en tenant compte de la PPA.
Notons que l’IDH est un nombre compris entre 0 et 1 : plus on s’éloigne de 1, plus on est pauvre.
– L’indicateur de pénurie de capacités (IPC)9
Toujours dans le but de mesurer la pauvreté des ménages, le PNUD a élaboré un nouvel indicateur, IPC qui est également un indicateur de pauvreté pluridimensionnelle. Sans prétendre à l’exhaustivité, l’IPC tentera de refléter le manque dans trois domaines du développement humain, entre autres :
La carence, le manque de potentialités dans la nutrition, dans le système de santé, l’accès à l’eau potable,…à travers l’indicateur d’insuffisance pondérale des enfants de moins de 5ans ;
Les insuffisances en matière d’éducation de base et d’inégalité entre sexe à travers l’indicateur « analphabétisme des femmes adultes » et ;
Les pénuries en matière d’accès aux soins de santé en général et, gynécologique et obstétrique en particulier, évaluées par le biais de l’indicateur « naissances non
assistées par le personnel médical »
L’IPC s’obtient alors par la moyenne de ces trois indicateurs.
L’IPH : indicateur de pauvreté humaine
Pour permettre caractériser le niveau de pauvreté d’un pays et mesurer l’impact de la pauvreté sur
la population, le PNUD a créé un indicateur de pauvreté humaine (IPH) en 1997. Puisqu’il existe des pays développés et des pays sous-développés ou en voie de développement, le PNUD a distingué deux types d’IPH : IPH-1 et IPH-2.
En effet, l’IPH-1 est destiné pour caractériser le niveau de pauvreté dans les pays en voie de développement. Il se concentre sur trois (3) aspects essentiels de la vie dans l’IDH mais envisage ces aspects sous l’angle des manques dont :
Longévité liée à la survie, mesurée à partir de l’espérance de vie à la naissance ; L’instruction, évaluée à partir de la durée moyenne de scolarisation ;
Des conditions de vue décentes, liées à l’accès aux services publics de base.
Le rapport de stage ou le pfe est un document d’analyse, de synthèse et d’évaluation de votre apprentissage, c’est pour cela chatpfe.com propose le téléchargement des modèles complet de projet de fin d’étude, rapport de stage, mémoire, pfe, thèse, pour connaître la méthodologie à avoir et savoir comment construire les parties d’un projet de fin d’étude.
|
Table des matières
INTRODUCTION
PARTIE I : CONCEPTS THEORIQUES SUR LA PAUVRETE ET LES POLITIQUES PUBLIQUES
CHAP. I : CONCEPTS THEORIQUES SUR LA PAUVRETE
Section 1 – Phase d’indentification
1-1- Approches et définitions
1-1-1- Approche objective
1-1-2-Approche subjective (pauvreté ressentie)
1-2- Lignes et mesure de la pauvreté
1-2-1-Ligne de la pauvreté monétaire
1-2-2- Mesure de la pauvreté non monétaire
1-2-3- Mesure de la pauvreté subjective
Section 2 – Phase d’agrégation
2-1- Les indicateurs élémentaires
2-1-1- L’incidence de la pauvreté
2-1-2- L’intensité de la pauvreté
2-1-3- La sévérité de la pauvreté
2-2- Les indicateurs de PNUD
2-2-1- L’IDH et indicateur des pénuries des capacités (IPC)
2-2-2- L’IPH : indicateur de pauvreté humaine
2-2-3- L’IPM (Indice de Pauvreté Multidimensionnelle)
CHAP. II : CONCEPTS THEORIQUES SUR LES POLITIQUES PUBLIQUES
Section 1- Elaboration des politiques publiques
1-1 – Les étapes d’élaboration des politiques publiques
1-1-1- Représentation du problème et inscription dans l’agenda politique
1-1-2- Identification des objectifs et des moyens de prise en charge
1-1-3- Choix des solutions et procédures
1-2- La rationalisation des décisions publiques
1-2-1- La rationalité des acteurs de la politique publique
1-2-2- Méthodes de rationalisation des politiques publiques
Section 2 – Le DSRP
1-1- Origine de l’initiative DSRP
1-2- Les principes de base des DSRP et les principaux acteurs
1-2-1- Principes
1-2-2- Les nouveaux acteurs
1-3- Elaboration des DSRP
1-3-1- Contenu
1-3-2- Etapes d’élaboration des DSRP
PATIE II : ANALYSE DE LA PAUVRETE A MADAGASCAR ET LE DSRP
CHAP. III : SITUATION DE LA PAUVRETE A MADAGASCAR
Section 1 – Etats des lieux
1-1- Dynamique de la pauvreté
1-1-1- Evolution du taux de pauvreté
1-1-2- Evolution de l’intensité de la pauvreté
1-2 – Situation de la pauvreté depuis 2010
1-2-1- Pauvreté monétaire
1-2-2- Pauvreté d’existence
1-2-3- Pauvreté humaine
Section 2- Les facteurs déterminants de la pauvreté à Madagascar
2-1- Les facteurs déterminants extérieurs
2-1-1- Effets des crises
2-1-2- Insuffisance des investissements, taux de croissance économique très faible
2-2- Les déterminants micro-économiques
2-2-1- Caractéristiques du ménage et région de résidence.
2-2-2- Niveau de revenu très faible
2-2-3- Le niveau d’instruction et secteur d’activité du chef de ménage
CHAP. IV : L’ANALYSE DU DSRP
Section 1- Présentation du DSRP
1-1- Origine
1-1-1- Contexte économique
1-1-2- Contexte social
1-2- Elaboration
1-2-1- Du DSRP-I (Intérimaire) au DSRP complet
1-2-2- Mise à jour
1-3- Bases du DSRP
1-3-1- Les objectifs globaux et les axes stratégiques
1-3-2- Programmes ainsi que les actions à mettre en oeuvre
1-3-3- Stratégies mises à jour
Section 2 – Analyse des impacts et résultats de la mise en oeuvre de la stratégie de la réduction de la pauvreté (DSRP)
2-1- Evolution de l’IDH
2-1-1- Evolution de l’IDH national
2-1-2- Evolution des IDH régionaux
2-2- Impacts économiques
2-2-1- Evolution globale de la croissance
2-2-2- Evolution de la structure de production.
2-3- Evolution des indicateurs de la pauvreté (monétaire)
2-3-1- Evolution de l’incidence de la pauvreté
2-3-2- Evolutions de l’intensité de la pauvreté
CONCLUSION
ANNEXES
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Télécharger le rapport complet