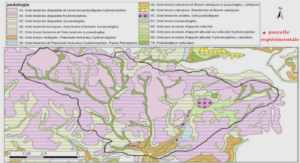Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Comment mesurer la délinquance (définitions des termes, enquêtes et statistiques, limites)
La difficulté dans les domaines des Sciences Sociales est de disposer d’indicateurs valides capables de mesurer des phénomènes abstraits. En criminologie cette problématique est particulièrement saillante puisque les comportements délinquants sont difficilement observables et donc quantifiables de manière directe. Le propre des comportements illicites est de se dérouler le plus loin possible des regards indiscrets afin de réduire au maximum le nombre de témoins potentiels. La statistique criminelle est définie de la manière suivante par Raymond Gassin : « le dénombrement pour un territoire donné et au cours d’une période déterminée de divers faits relatifs à la criminalité : infractions connues, condamnations prononcées, nombre de personnes détenues etc. » (Gassin, 1988, p. 106).
La criminalité apparente et légale en France
En statistiques de la criminalité l’ensemble des infractions commises (criminalité réelle) se distingue de la criminalité apparente qui sont les infractions constatées ou dénoncées. La différence entre les deux est appelé « chiffre noir » de la délinquance.
Les statistiques officielles de la délinquance en France
Selon Aubusson les premières statistiques criminelles sont apparues en France et en Angleterre dès les premières années du 19e siècle. Avant cette date des premières quantifications de la délinquance avaient été réalisées dans les dernières décennies du 18e siècle. Parmi ces tentatives figure le dénombrement des peines prononcées par les juges toscans effectué par l’archiduc Pietro-Lepoldino entre 1762 et 1782. En France, le conseiller d’état Jean Baptiste de Montyon recensa pour la période comprise entre 1775 et 1786 les condamnations rapportées dans les miniatures du parlement de Paris et rédigea les observations sur la moralité en France (Robert, Zauberman, 2011).
En France ce sont les textes législatifs qui définissent les crimes et les délits et les textes réglementaires qui définissent les contraventions conformément aux articles 34 et 37 de la constitution de la Ve République.
Les différentes mesures de la délinquance disponibles en France sont les plaintes déposées chez les forces de l’ordre, les condamnations prononcées par la justice et l’exécution des peines recensée par les statistiques pénitentiaires. Ces trois sources statistiques : policières, judiciaires et pénitentiaires sont qualifiées comme statistiques officielles parce qu’elles sont produites par l’Etat. Elles nous apprennent par exemple que depuis la moitié du 19e siècle le nombre d’homicides volontaires perpétrés en France a fortement décliné, passant de 2 500 cas en 1850 à 932 en 2015 alors que le nombre d’habitants a doublé entre ces deux dates. Néanmoins entre 2010 et 2015 le nombre d’homicides volontaires constaté par la police et la gendarmerie a connu une progression en passant de 675 à 811 faits.
La statistique policière est le résultat d’une interaction constante entre les services de police et les citoyens. Les victimes qui se déplacent jusqu’au commissariat pour déposer une plainte représentent la source la plus importante. Cependant leur signalement ne permet pas toujours l’identification d’un suspect. En revanche, les témoins d’un acte illicite rapportent moins d’affaires, mais leur témoignage permet souvent d’identifier un coupable. Keith Bottmley et Clive Coleman en 1981 se sont interrogés sur l’influence jouée par le plaignant et les éléments mis à disposition des policiers dans l’enregistrement des plaintes.
L’autre source de collectes est liée à l’activité policière stricto-sensu, dont l’action est dirigée en fonction des priorités établies par la classe politique. Ainsi si l’accent est mis sur la lutte contre le trafic de drogue ou bien l’anti-terrorisme, cela a une incidence sur le taux d’évolution des chiffres de la délinquance. Enfin l’activité des services de police n’échappe pas à la question gestionnaire. La statistique peut ainsi être utilisée comme un moyen de contrôler la qualité du travail des forces l’ordre.
Il existe un hiatus dans les statistiques policières entre les faits enregistrés suite à une plainte et les faits qui en raison de l’avancée de l’enquête peuvent être transmis aux autorités judiciaires. Ainsi, le nombre de délits recensés diminue au fur et à mesure que le processus pénal progresse. Les statistiques policières sont pour cette raison plus proches de la criminalité réelle que les chiffres issus des statistiques judiciaires et pénitentiaires. Par exemple en France en 2012, d’après les statistiques centralisées publiées par la Direction centrale de la Police Judiciaire et sans tenir compte des 368 963 infractions routières, 3 521 994 crimes et délits furent enregistrés par les forces de police et de gendarmerie. Les atteintes aux biens représentaient 61,49% des infractions relevées tandis que les crimes et délits contre les personnes comptaient pour 13,75 % des procès-verbaux des forces de l’ordre. Au cours de cette même année 2012, 910 000 infractions furent sanctionnées par 617 221 condamnations inscrites au Casier Judiciaire, dont 3 540 pour des crimes, 422 549 pour des délits et 52 629 pour des contraventions de 5e classe (tableau 1).
Enquêtes de délinquance auto-reportées et enquêtes de victimisation
Cependant, ces statistiques officielles sont l’objet de critiques multiples et variées car elles ne tiennent pas compte de la criminalité cachée. En effet, une part importante de l’activité illicite échappe à tout processus de quantification. Les premières critiques formulées à l’encontre des statistiques officielles stipulèrent également qu’elles ne contribuaient pas réellement à mesurer la criminalité mais plutôt la réaction sociale. Ainsi l’analyse des statistiques officielles aux Etats Unis d’Amérique renforcèrent les théories criminologiques affirmant que la délinquance était le plus souvent l’acte d’hommes jeunes, issus de classes sociales modestes, résidant en ville et souvent membre des communautés latino ou afro américaines ( Merton, 1938, Cohen, 1955).
Dans les années 1960, la théorie de la réaction sociale, appelée aussi « analyse stigmatique » a été développée par les sociologues et psychologues sociaux américains qui s’intéressaient au phénomène de déviance. Parmi les artisans de cette théorie figure Howard Becker qui dans son ouvrage « outsiders » publié pour la première fois en 1963 et réédité en 1985, affirme que les déviants sont avant tout le fruit d’une construction sociale : « le comportement déviant et le comportement que les gens stigmatisent comme tel » (Becker, 1963, p. 33).
Pour tenter d’apporter une solution au chiffre noir de la délinquance, les chercheurs en sciences criminelles ont mis au point deux méthodes : les enquêtes de délinquance reportée d’une part et les sondages de victimisation d’autre part. Ces sondages conçus à partir des années 1950 sont considérés comme deux apports majeurs de la criminologie de la seconde moitié du 20e siècle (Aebi, 2006).
Dans le premier cas le questionnaire est rempli par les délinquants, tandis que dans la deuxième méthode l’enquête s’intéresse à un panel représentatif de la population d’un quartier, d’une ville, d’un état. Les enquêtes de délinquance auto-reportées vont remettre en cause les généralités quant à l’existence d’un profil-type de délinquant, confirmant la thèse de Durkheim pour qui la délinquance étant un phénomène normal. Ce qui signifie que n’importe qui est susceptible de commettre un acte illicite (Aebi, 2006). L’idée à l’origine de la conception des enquêtes de victimologie part du principe que les victimes ne portent pas toujours plainte auprès des services de police, et ce pour différentes raisons : le dépôt n’est pas jugé utile, l’agresseur appartient au cercle relationnel proche, la victime a un sentiment de culpabilité ou de honte.
C’est pour pallier cette problématique que les enquêtes de victimisation ont été imaginées. La première grande enquête a été réalisée aux Etats Unis en 1965 par le National Opinion Research Center pour le compte de la commission Katzenbach, auprès d’un échantillon de plus de 10 000 individus de plus de dix-huit ans représentatifs de la population américaine (Fattam, 1981). A l’étonnement général remarque l’auteur, les résultats de l’enquête présentaient des taux supérieurs aux statistiques enregistrées par la police, par exemple : « le taux de victimisation révélé par l’enquête dépassait celui des délits signalés à la police de 50 % pour les vols avec violence, de 100 % pour les cas d’assaut grave, et d’environ 300 % pour les viols » (Fattam, 1981, p. 424). Il est admis que dans le cadre des viols où la variation des pourcentages est dans l’exemple cité la plus forte, le nombre de plaintes déposées est généralement faible (Coutanceau et al., 2016). Il est possible qu’un sentiment de honte voire la proximité de la victime avec son agresseur, empêche celle-ci de se rendre au commissariat afin d’y déposer une plainte (Brownmiller, 1975 ; Medea, Thompson, 1974).
En raison de leur faculté à apporter une solution tangible aux limites manifestes de la mesure de la délinquance à partir de la seule statistique enregistrée par l’activité de la police et de la gendarmerie les enquêtes de victimisation ont gagné d’autres pays occidentaux dans les années 1970. Pourtant en dépit des écarts que les enquêtes renseignent par rapport aux données officielles ces questionnaires présentent également un certain nombre de limites. Il est prouvé que les statistiques officielles de la délinquance ont tendance à sous-évaluer la criminalité réelle. Cependant, les deux méthodes de sondage représentent un coût financier important qui peut entraver leur passation au plus grand nombre. De plus, parmi les personnes enquêtées il est impossible de recouper les informations obtenues avec les dépôts de plainte enregistrés par la police en raison de l’obligation de protéger les informations privées et du caractère anonyme des enquêtes.
Néanmoins les enquêtes et les statistiques officielles ne mesurent pas exactement la même chose. Les sondages révèlent d’une part que si les enquêtés avouent avoir commis un acte illicite dans leur vie, ceci ne se produit pas de manière récurrente. De plus les délits avoués sont majoritairement véniels tandis que les actes délictueux les plus graves restent le fait d’une minorité. Les premiers sondages de délinquance auto-reportés recensaient donc essentiellement des comportements problématiques tandis que les statistiques officielles compilent les actes délinquants qui violent le code pénal. Les statistiques officielles ne mesurent donc que la criminalité apparente. Les problèmes de prévalence concerne la délinquance qui échappe au système de justice pénale, soit parce qu’ils ne sont pas découverts soit parce qu’ils ne sont pas dénoncés.
En France l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) réalisa entre 1996 et 2007 des études de victimation dans son enquête permanente sur les conditions de vie (EPCV) réalisée chaque année auprès d’un échantillon représentatif de la population de plus de quinze ans et composé de 11 000 individus. Depuis 2007, l’Insee procède chaque année à l’enquête victimation – Cadre de vie et sécurité pour connaître la délinquance survenue dans les deux ans précédant la passation du questionnaire. L’enquête réalisée en France métropolitaine auprès d’un panel d’environ 25 500 ménages porte sur les atteintes à la personne et aux biens qu’ils aient fait l’objet ou non d’un dépôt de plainte. Le sondage s’intéresse également au sentiment d’insécurité et à la satisfaction des personnes interrogées quant à leur cadre de vie. Les résultats de ces enquêtes sont ensuite publiés par L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) dans son rapport annuel sur la criminalité en France.
L’époque des premières cartes de statistiques délinquantes
Les premières analyses spatiales du crime ont vu le jour en Europe dans la première moitié du 19e siècle (Collombié, 2009). Les travaux menés par le géographe italien Adriano Balbi et le statisticien et juriste français André-Michel Guerry marquent les débuts de la représentation cartographique de la statistique criminelle (Jones, Jonhstone, 2011). Les premières cartographies de la criminalité ont été réalisées en France par le Belge Adolphe Quetelet (1796-1874) et le Français André-Michel Guerry (1802-1866). Tous deux instaurèrent l’école cartographique et utilisèrent les premières statistiques criminelles établies en France entre 1826 et 1830 pour observer la répartition spatiale du phénomène criminel. La statistique judiciaire qui consiste en l’enregistrement régulier des inculpations et des jugements, si elle présente une finalité politique indéniable suscite très vite un intérêt scientifique évident.
En 1829 André-Michel Guerry avait déjà publié une étude sur la relation entre l’instruction et la criminalité mais son apport essentiel à la statistique criminelle se manifeste avec l’édition en 1833 de l’Essai sur la statistique morale en France dans lequel ils croisent les chiffres de délinquance reportés à l’échelle départementale avec les niveaux d’instruction, l’âge des accusés et leur sexe. Parmi les phénomènes sociaux traités par Adolphe Quetelet, le crime occupe une place importante à côté de ses recherches sur le mariage, le suicide et la mendicité. Quetelet qui cherche à identifier les déterminants qui dans une société conduisent à la criminalité croit en l’existence de l’interaction de plusieurs facteurs de nature variée. A l’instar d’autres statisticiens moraux de son temps, il est persuadé du rôle exercé par des déterminants démographiques et sociaux sur la criminalité : tel que le niveau de vie, le degré d’instruction, l’âge et le sexe.
Par leurs travaux ils mirent en évidence la constance de la criminalité, ainsi que la recrudescence des crimes contre les personnes durant les mois chauds dans les régions du sud du pays et contre les biens durant la saison froide dans les régions septentrionales. Ils qualifièrent leurs résultats de « loi thermique de la criminalité ». Ils eurent recours à la carte thématique choroplèthe inventée en 1828 par le baron français Charles Dupin pour représenter à l’échelle départementale l’évolution de l’intensité du crime contre les personnes et les biens par un dégradé de couleurs (Figure 2).
Le regain d’intérêt pour une approche géographique de la criminalité
L’analyse spatiale peut être définie comme l’étude des relations horizontales qu’entretiennent les espaces géographiques façonnés de manière spécifique par les sociétés en fonction de leur caractéristiques anthropologiques, leur niveau d’avancée technique et leur mode d’organisation politique et sociale (Pumain, Saint-Julien, 2010).
L’analyse spatiale utilise des méthodes mathématiques et statistiques pour déceler et comprendre la nature et le degré de relation qu’entretiennent les lieux (Brunet, Ferras, Théry, 1992).
Cette orientation de la recherche en géographie se distingue de la « géographie culturelle » par la mobilisation de modèles et la présence de lois devant permettre de comprendre la structuration de l’espace. Si l’approche géographique classique est souvent dénoncée en raison d’une incapacité à produire des résultats généralisables en raison d’une spécificité supposée propre à chaque lieu, l’analyse spatiale est parfois critiquée pour sa tendance inverse sensée nier les singularités locales.
L’analyse spatiale fut utilisée afin de lutter contre la propagation des épidémies. A la fin du 19e siècle le docteur Snow cartographia l’adresse des Londoniens décédés du Choléra ainsi que l’emplacement des pompes à eau qui selon son hypothèse étaient les vecteurs de la maladie (Besson, 2005). Il parvint au moyen de cette première analyse spatiale par distribution de points, à cerner le problème au niveau de la pompe de Broad Street contaminée par la défectuosité du réseau d’eau public (Colombié, 2009) (figure 3).
Des espaces urbains confrontés au creusement des inégalités
Les différentes phases d’urbanisation qui ont transformé la société et les paysages à travers le monde depuis la révolution industrielle, trouvent leur origine dans les crises du capitalisme et la nécessaire absorption du surproduit du capital (Harvey, 2015). L’hausmannisation de Paris sous le Second Empire, la suburbanisation des Etats-Unis au lendemain de la seconde guerre mondiale ainsi que l’urbanisation des continents pauvres depuis maintenant quelques décennies, sont cités en exemple par l’auteur afin d’illustrer son propos dans son ouvrage Villes rebelles. Le géographe britannique s’interroge sur les conséquences de la production urbaine capitaliste pour l’ensemble de la société et notamment pour les individus les plus pauvres. L’auteur juge le dynamisme planétaire comme une tentative de résoudre les crises d’un système condamné à produire pour survivre et ce quel que soit les coûts humains, sociaux et écologiques engendrés. Or la construction immobilière et l’aménagement des espaces publics ont tendance à se faire de manière violente au détriment des plus démunis qui n’ayant aucun pouvoir d’infléchir les politiques d’urbanisation, se trouvent relégués toujours plus loin des espaces qui concentrent la richesse, les privilèges et la consommation. C’est ainsi que des agglomérations de plus en plus fragmentées apparaissent en différents points de la planète, avec partout des îlots de prospérité qui dans les pays du Sud économique côtoient un bidonville global en pleine croissance (Davis, 2007).
Les villes françaises sont également concernées par les effets de la conquête bourgeoise des centres historiques et des anciens quartiers populaires. L’augmentation des prix de l’immobilier empêche les couches populaires de résider dans les lieux les plus centraux et les plus prisés des agglomérations. Leur départ contraint vers la périphérie n’est pourtant pas nécessairement mal vécu dans la mesure où l’accession à la propriété leur donne l’illusion de suivre une trajectoire résidentielle ascensionnelle (Guilluy, Noyé, 2004). Le consumérisme et les loisirs concourent à remodeler les villes au profit de ceux qui disposent du capital, aussi David Harvey remarque que « dans ces conditions, il devient bien plus difficile de soutenir les idéaux d’identité, de citoyenneté et d’intégration urbaines, ainsi que la moindre politique urbaine cohérente, déjà menacée par l’insatisfaction croissante que suscite l’éthique néolibérale individualiste. L’idée même que la ville puisse fonctionner comme un corps politique collectif, comme un lieu à l’intérieur et à partir duquel pourraient émaner des mouvements sociaux progressistes, paraît, superficiellement en tout cas, de moins en moins plausible. » (Harvey, 2015, pages 47-48).
De telles assertions peuvent-elles s’appliquer à Marseille lancée elle aussi dans une politique de renouvellement urbain visant à mieux adapter la ville à la nouvelle économie mondiale et à assurer la cohésion entre les différents quartiers et noyaux villageois qui la compose ? Les cités de grands ensembles de logement social, concernées par cette politique, sont pour la plupart localisés dans les premières et secondes périphéries. Leur situation géographique par rapport à l’hyper centre-ville confère à la notion de banlieue à Marseille une place singulière. Trois acceptions sont induites par le terme de banlieue qui se succèdent dans le temps : la première signification est juridique, la seconde géographique, la dernière symbolique (Vieillard-Baron, 2001). L’une des singularités de Marseille par rapport à des villes comme Paris ou Lyon, est liée à la présence des cités sensibles au sein même de ses limites administratives, souvent à proximité des quartiers centraux, situés dans les environs immédiats du Vieux-Port et touchés eux aussi par une surreprésentation des individus pauvres et une volonté de conquête bourgeoise. En raison de l’étalement urbain les quartiers sensibles et les cités de grands ensembles se retrouvent localisées à une distance raisonnable des centres des métropoles.
Dans un contexte de pénurie de réserves foncières et d’augmentation des prix de l’immobilier les quartiers sensibles deviennent des espaces à enjeux pour les promoteurs immobiliers et les élus politiques qui souhaitent favoriser l’installation de nouvelles populations mieux dotées financièrement et mieux intégrées socialement. Les banlieues marseillaises ne participent pas d’une dimension géographique évidente. Elles ne sont pas aisément identifiables par rapport à une localisation extérieure aux contours administratifs de la ville, ce qui est le cas des banlieues parisiennes et lyonnaises localisées dans des communes limitrophes mais distinctes. La notion de banlieue à Marseille est avant tout empreinte d’une dimension symbolique, en tant qu’espace concentrant des ménages pauvres, établis dans des cités reléguées certes spatialement dans les périphéries mais surtout ayant une accessibilité contrariée aux activités économiques et sociales.
Le 20 janvier 2015, le premier ministre de la république française Manuel Valls suscitait la polémique en évoquant « un apartheid territorial, social, ethnique » dans certains quartiers à la périphérie des grandes agglomérations. Dans son ouvrage ghetto urbain paru en 2008 Didier Lapeyronie affirme que l’emploi du terme ghetto pour qualifier certaines banlieues n’est pas usurpé. Les quartiers ainsi désignés ne sont pas nécessairement ceux qui concentrent les immigrés et les pauvres. Les ghettos sont non seulement construits de l’extérieur en tant que « produit[s] de la ségrégation raciale, de la pauvreté, de la relégation sociale » (p. 11) mais aussi constitués de l’intérieur par des habitants qui y développent une contre-culture avec ses normes et ses valeurs pouvant parfois s’opposer à celles en vigueur dans la société dans laquelle ces quartiers s’insèrent. Les cités sont des lieux d’expression d’une « culture jeune » fortement influencée par le mouvement hip-hop né dans le quartier afro-américain new-yorkais du Bronx (Lafargue de Grangeneuve, 2008).
Ce sont des espaces qui sont également l’objet d’une attention particulière dans la lutte contre les inégalités économiques et sociales qui mettent en péril le vivre-ensemble. La loi du 21 février 2014 a défini une nouvelle géographie prioritaire en cartographiant sur la base du carroyage de 200 mètres de l’INSEE, les territoires urbains concentrant plus de 50% des ménages ayant des ressources inférieures à 60% du revenu médian. C’est au cours de l’été 1981 que le problème des banlieues a retenu l’attention des pouvoirs publics à la suite d’émeutes qui semblaient jusqu’alors être l’apanage des villes des Etats Unis d’Amérique (Linhart, 1992). A compter de la décennie 1970 la politique de la ville s’institutionnalisa, contribuant par la même occasion à refonder les politiques sociales en France entre 1985 et 1995 (Tissot, 2007). Pourtant dès 1971, la DATAR (Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale) dans une publication intitulée Images de la France de l’an 2000 prédisait une augmentation de la ségrégation sociale dans les espaces urbains en raison de l’internationalisation croissante du Marché. Avec le risque que les exclus contraints de vivre dans des quartiers paupérisés ne soient amenés à se révolter contre les possédants résidants dans les beaux quartiers et les centres villes. Le profil social des quartiers sensibles témoignent des difficultés d’intégration économique et sociale auxquelles sont confrontées leurs habitants. La politique de la ville encouragea à ses débuts l’animation sociale, puis essaya de favoriser l’intégration par l’emploi avant d’opter pour la démolition de certaines cités de grands ensembles malgré le déficit en logements sociaux (Guilluy, Noyé, 2004).
De la politique du logement social qui émerge en France à la fin du 19ème jusqu’à la politique de la ville, la croissance démographique des villes et leur expansion urbaine auront produits un certain nombre de problème nécessitant des solutions pragmatiques pour y apporter des solutions viables et concrètes. A la pénurie de logements pour les classes populaires, au manque d’équipements urbains et aux inégalités d’accès aux services succédèrent les problèmes posés par la dégradation du cadre de vie.
Il est intéressant d’observer la pérennité des problèmes urbanistiques et sociaux déjà présents au 19e siècle, avec des différences toutefois importantes en termes de salubrité publique, de risque épidémiologique, de résorption de la pauvreté et de dotation en infrastructures et équipements publics, du moins dans les pays occidentaux. La crise du logement reste pourtant une problématique prégnante tandis que la correction des dysfonctionnements produits par les aménagements réalisés au cours de la période dite des Trente Glorieuses influence les politiques de renouvellement urbain, dans un contexte de recomposition économique et sociale et de redéfinition du rôle de l’Etat. La décentralisation et la réorganisation territoriale ont institué une nouvelle structure hiérarchique des pouvoirs marquée par la démocratie participative et l’émergence du local.
Parallèlement la construction européenne et l’internationalisation des échanges commerciaux ont contribué à la mise en concurrence des territoires et des travailleurs. Les règles sociales et fiscales n’étant pas harmonisées au sein des espaces de libre-échange constitués progressivement à partir des années 1950, la dégradation des conditions économiques et sociales imputable à la stagnation des salaires et à la désindustrialisation, la baisse des dotations de l’état qui tend à limiter son action aux fonctions régaliennes, la création de super-collectivités qui accentue l’éloignement, l’anonymat et la bureaucratie, nourrissent une défiance croissante vis-à-vis des dirigeants et accentuent les craintes et les tensions.
Politique de la ville et urbanisme contre la délinquance
Le problème de l’insécurité préoccupe un nombre croissant de maires et d’habitants (Le Goff, 2005). En France, l’insécurité est depuis trois à quatre décennies à l’origine de différentes actions menées conjointement par l’état et les collectivités territoriales pour le réaménagement du cadre urbain, connu en tant que Politique de la ville. Dans les conditions actuelles de remise en question de l’État providence, l’insécurité liée à la dégradation des conditions économiques et sociales se confond avec la peur de l’agression, thème récurrent dans les médias de masse.
La Politique de la ville désigne en France le partenariat contractuel passé entre l’état et les collectivités territoriales pour lutter contre la dégradation de certains quartiers urbains et l’exclusion de leurs habitants. Mise en pratique progressivement depuis plus de trente ans le bilan de la politique de la ville est mitigé (Epstein, 2011). Si les fonds alloués ont permis d’améliorer le cadre de vie et de désenclaver bon nombre de cités, l’évolution urbaine peine à pallier les difficultés économiques et sociales auxquelles sont confrontés les habitants. Privilégier l’amélioration du bâti au détriment de l’insertion des habitants est une critique souvent émise contre la politique de la ville.
Dans les années 1960 la « question sociale urbaine » se limite à la remise en cause de l’urbanisme fonctionnel dont le « grand ensemble » de Sarcelles symbolise les ratés. Avec les chocs provoqués par les crises pétrolières des années 1970 le chômage de masse gagne la France et de nouvelles problématiques apparaissent dans les cités durement touchées par la crise. En 1976 le fond d’aménagement urbain est créé pour soutenir financièrement des opérations urbaines telle que l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH). En 1977 le programme habitat et vie sociale (HVS) a pour objectif de faire revenir les classes moyennes dans une cinquantaine de cités HLM concernées par les opérations de réhabilitation du logement (David, 2001).
L’apparition en France des « violences urbaines » dans les années 1980 contraignent les pouvoirs publics à prendre une série de mesures pour lutter contre les difficultés qui se concentrent dans les quartiers. En 1981, suite à « l’été chaud » des Minguettes survenu dans la banlieue lyonnaise, le gouvernement socialiste nouvellement élu met en place différents programmes dont les plus emblématiques sont les suivants : développement social des quartiers (DSQ) ; zone d’éducation prioritaire (ZEP) ; commission nationale de prévention de la délinquance (CNPD) ; Commission nationale de développement social des quartiers (CNDSQ). Parallèlement des études sont menées par le gouvernement qui deviendront le socle idéologique de la politique de la ville : Ensemble refaire la ville (CNDSQ, 1981) ; Rapport Schwartz (1981) suivie de la création des missions locales pour favoriser l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ; rapport de la commission des maires sur la sécurité présidée par Gilbert Bonnemaison Face à la délinquance : prévention, répression, solidarité (1982). Cependant, en raison d’une mauvaise coordination ces différents programmes n’atteignent pas les objectifs fixés (Blanc, 2007). En 1988 le développement social des quartiers cède le pas au développement social urbain. Le quartier n’est plus considéré comme l’échelle pertinente pour la résorption des inégalités. La politique locale de l’emploi est désormais pensée à l’échelle de l’agglomération. C’est à partir de cette date que la politique de la ville s’institutionnalise via la création de trois instances :
– Conseil national des villes (instance de proposition)
– Comité interministériel des villes (instance de décision)
– Délégation interministérielle à la ville (instance d’animation et d’exécution)
En 1990, Michel Delebarre devient le premier ministre chargé de la ville et treize sous–préfets sont nommés. Enfin en 1991, la loi sur la solidarité financière oblige les communes riches à financer la dotation de solidarité urbaine destinée aux communes pauvres devant gérer un parc hlm important. La loi d’orientation pour la ville, votée la même année vise à favoriser la mixité sociale des communes pour assurer un développement plus équilibré des villes.
Apparu en 1989 de manière expérimentale les contrats de ville change le niveau conceptuel de la politique de la ville. Désormais ce ne sont plus les quartiers qui constituent l’échelle pertinente de réflexion pour la résolution des différents problèmes rencontrés, mais l’agglomération dans son ensemble.
Avec l’adoption en 1999 de la loi Chevènement, de la loi de modernisation de l’action publique et territoriale et d’affirmation des métropoles ou encore de la loi de programmation pour la Ville et la cohésion urbaine en 2014 le rôle des intercommunalités a été renforcé et il est attendu que les Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les nouvelles métropoles s’occupent de l’application de la politique de la ville. La fusion en 2015 de l’Acsé, du secrétariat général du comité interministériel des villes (SG–CIV) et de la délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale (DATAR) au sein du commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) doit assurer la relation entre les espaces urbains, périurbains et ruraux.
Le rapport de l ‘ONZUS paru en 2006 affirme qu’en dépit des programmes les inégalités augmentent « entre les quartiers sensibles et les autres quartiers des agglomérations auxquelles ils appartiennent. » quant aux zones franches urbaines elles sont critiquées pour « ne pas avoir eu un impact mécanique suffisant sur le chômage de leurs habitants pour compenser l’ampleur du handicap de départ affectant leur territoire. » (ASH, 2006, p. 17). En 2007 les contrats de ville étaient remplacés par les Contrats urbains de cohésion sociale (Cucs).
|
Table des matières
Chapitre 1 – De l’homme à l’espace : une histoire de la compréhension du crime.
1. Etat des savoirs sur le fait criminel
1.1 La violence dans les sociétés humaines
1.2 Crimes et criminels avant la naissance des Sciences criminelles
2. La criminologie
2.1 Qu’est-ce que le crime et comment confondre le criminel ?
2.1.1 Le crime
2.1.2 Le criminel : causes intrinsèques et extrinsèques
3. Comment mesurer la délinquance (définitions des termes, enquêtes et statistiques, limites)
3.1 La criminalité apparente et légale en France
3.1.1 Les statistiques officielles de la délinquance en France
3.1.2 Enquêtes de délinquance auto-reportées et enquêtes de victimisation
3.2 Pourquoi et comment cartographier la délinquance ?
3.2.1 L’époque des premières cartes de statistiques délinquantes
3.2.2 Le regain d’intérêt pour une approche géographique de la criminalité
4. Ville et insécurité
4.1 Des espaces urbains confrontés au creusement des inégalités
4.2 Qu’est-ce que la banlieue ?
4.2.1 Banlieues et faubourgs
4.2.2 La peur des faubourgs
4.2.3 De la nécessité de réorganiser et d’assainir les villes
4.2.4 Loger la main d’oeuvre
4.2.5 Du pavillon aux grands ensembles
4.3 Politique de la ville et urbanisme contre la délinquance
5. Le trafic de drogue
5.1 Le trafic de drogue à Marseille
5.1.1 Apparition de la French connection
5.1.2 La guerre contre la « French connexion »
5.1.3 Le trafic de drogue aujourd’hui
Chapitre 2 – Le contexte marseillais : espaces urbains et espaces criminogènes
6. Marseille comme terrain d’étude
6.1 Réalisation de la tâche urbaine
6.2 Les caractéristiques d’urbanisation distinguées par arrondissement
7. Marseille une histoire urbaine chaotique
7.1 Grandeur et décadence des activités économiques marseillaises
7.2 Marseille, une ville trop vaste et trop pauvre, impactée par les inégalités
7.3 Les grandes ambitions du renouvellement urbain
7.4 Le projet Euroméditerranée
8. Marseille « ville violente » : entre emphase médiatique et déni de la réalité
8.1 Création de la base de données
8.2 Cartographie des « règlements de compte entre malfrats »
8.2.1 Première analyse géographique générale
8.2.2 Temporalité des règlements de compte
8.3 Analyse d’une distribution spatiale d’un semis de point
8.3.1 Analyse des règlements de compte référencés à l’aide du logiciel Crimestat
8.3.2 Statistique spatiale de premier ordre
8.3.3 Mesures d’autocorrélation spatiale
8.4 Détermination des zones de concentration du crime (hotspots)
8.4.1 Création des zones de hotspots dans Crimestat
8.4.2 Détermination des zones de hotspots à l’aide de la morphologie mathématique
8.5 Caractéristiques sociodémographiques des zones de hotspot de crime
Chapitre 3 – Analyse configurationnelle du réseau routier, ségrégations spatiales et règlements de compte
9. L’influence des caractéristiques d’aménagement de l’espace urbain sur la localisation des zones de concentration des homicides
9.1 Comparaison entre les densités urbaines des zones de hotspot avec le reste de la ville
9.2 Densité des réseaux routiers, ferroviaires et des lignes de transport en commun
9.3 Nombre d’arrêts des transports en commun
9.4 Lieux de crime distance et accessibilité au réseau
9.4.1 Distance des zones de crime vis-à-vis des autoroutes
9.4.2 Distance euclidienne des points de meurtres par rapport aux accès autoroutiers
10. Accessibilité réseau
10.1 Création d’un jeu de donnée réseau.
10.2 Création d’un graphe et nettoyage d’un filaire de voirie :
10.2.1 Attribution des coordonnées
10.2.2 Vérification des couches de lignes et de noeuds au moyen de l’extension Space syntax toolkit installées dans Qgis
10.2.3 Vérification du degré des noeuds
10.3 Analyse de la ressource la plus proche
10.4 Cartes isochrones
10.4.1 Intervalles métriques
10.4.2 Intervalles temporels
11. Théorie des graphes :
11.1 Théorie des graphes en géographie
11.2 Structure du graphe
11.2.1 Analyse de graphe au moyen du logiciel Gephi
11.2.2 Résultat des mesures calculées dans gephi
12. Réseau et système urbain
12.1 Analyse des réseaux spatiaux
12.2 Analyse des réseaux avec le logiciel Spatial Design Network Analysis
12.2.1 Comparaison des mesures calculées à l’échelle communale et au niveau des zones de hotspot
12.2.2 Analyse des indicateurs à l’échelle des cités de grands ensembles de logements sociaux 12.3 Analyse des réseaux avec la boîte à outil Urban Network Analysis
13. Syntaxe Spatiale
13.1 Réalisation d’une carte axiale
13.2 Analyse de la carte axiale de Marseille
13.2.1 Présentation et visualisation des principales indices pour l’analyse d’une carte axiale
13.2.2 Mesures de choix et d’intégration de la carte axiale
13.2.3 Lisibilité de la configuration spatiale de Marseille
13.3 Analyse des segments
13.3.1 L’analyse angulaire des segments
13.3.2 Principaux indices de l’analyse d’une carte de segments
13.4 Les apports et les limites de la Syntaxe Spatiale
Conclusion
Bibliographie
Télécharger le rapport complet